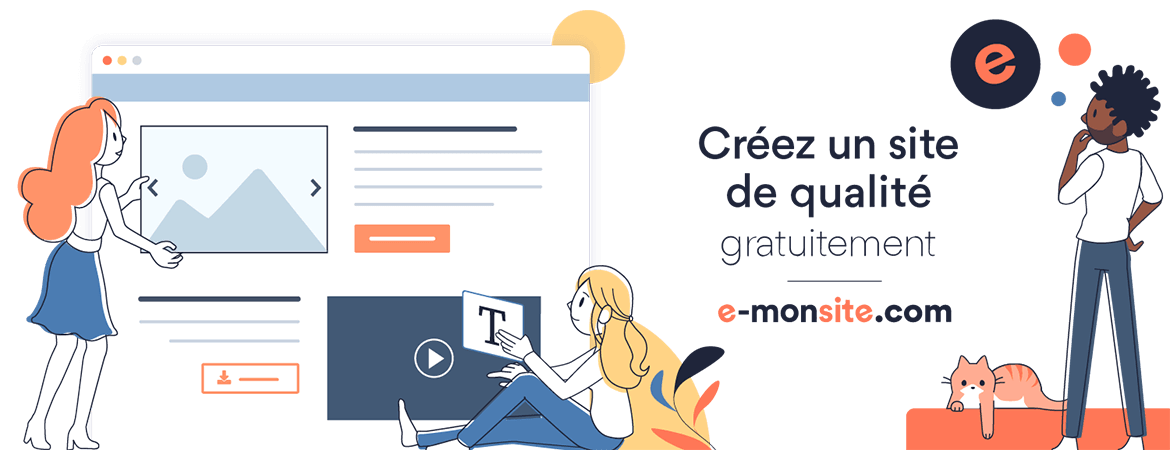- Accueil
- Un jour une oeuvre un destin
- Madame de Bovary
Madame de Bovary
Le procès de Madame Bovary (29 janvier-7 février 1857)
L’année 1857 est restée célèbre dans les annales des procès intentés à la littérature : à quelques mois d’intervalle, Flaubert et Baudelaire comparaissent devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de la Seine, sous le chef d’inculpation d’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs, et en face du même procureur impérial, Ernest Pinard. Madame Bovary est acquitté et Les Fleurs du mal condamné, mais dans les deux jugements se retrouvent identiquement le blâme pour excès de réalisme.
Pendant la rédaction de son roman, Flaubert mesure l’effet social de son œuvre : il est très conscient d’écrire un livre qui scandalisera une partie de son public. Le procès à venir s’ouvre déjà dans le roman lui-même, par les discussions entre Charles et sa mère, qui veut interdire à Emma les « mauvais livres », et menace « d’avertir la police, si le libraire persistait dans son métier d’empoisonneur ».
Avant le procès proprement dit, un différend entre l’auteur et les premiers éditeurs a déjà failli les conduire en justice, Flaubert se trouvant alors dans le rôle du plaignant. Maxime Du Camp et Laurent-Pichat, directeurs de la Revue de Paris, jugeaient en effetindispensable de pratiquer des coupures dans une œuvre qui leur paraissait « embrouillée ». Ils trouvaient trop longs la noce, les Comices, l’opération du pied-bot. Conseillé par son ami Bouilhet, Flaubert avait déjà allégé volontairement son texte et il n’était pas prêt à accepter les nouvelles corrections que Laurent-Pichat voulait lui imposer. Il obtint que tous les passages visés seraient rétablis dans la Revue de Paris. Le manuscrit du copiste porte les multiples traces des interventions de l’auteur et de ses éditeurs-censeurs : d’abord les corrections par Flaubert des erreurs commises par ses copistes, puis les sacrifices volontaires de nombreux passages, enfin les ratures pratiquées par Laurent-Pichat, identifiables par les réactions de Flaubert en marge, qui rétablit son texte en le recopiant (parfois avec des variantes) quand il est devenu peu lisible sous les traits de biffure, ou en intimant à l’imprimeur l’ordre de composer le texte. Malgré la parole donnée à l’auteur, les éditeurs reculent au dernier moment devant la publication de la scène du fiacre, par crainte de la police correctionnelle. Sous la pression de cet argument, Flaubert finit par s’exécuter, en obtenant toutefois que la suppression serait signalée dans la Revuepar une note (livraison du 1er décembre 1856, p. 45). Mais la publication de la dernière partie du roman, dans le numéro du 15 décembre, entraîne de nouvelles coupes : c’est alors que Flaubert envisage d’intenter un procès aux directeurs de la Revue. Il se contente de leur imposer la publication d’une note de protestation (p. 250).
Cette note a pu attirer l’attention du ministère de l’Intérieur, la Revue de Paris étant surveillée en raison de ses positions républicaines ; elle avait déjà fait l’objet de deux blâmes pour des articles politiques, et un troisième entraînerait son interdiction (elle disparaîtra d’ailleurs en 1858). C’est Du Camp qui avertit son ami de l’ouverture d’une instruction judiciaire, à la fin du mois de décembre 1856. Les lettres qui suivent montrent comment Flaubert mobilise les relations politiques de sa famille rouennaise, pendant que son avocat, maître Senard, cherche des protections à la Cour impériale. Flaubert tente également d’obtenir des recommandations auprès d’écrivains et de critiques célèbres, Lamartine et Sainte-Beuve, qui ont apprécié son roman. Il pense faire imprimer une sorte de mémoire, composé du roman annoté et d’une préface comportant des « explications esthético-morales ». Le mémoire fut interdit et la préface jamais écrite, mais on en a retrouvé récemment un brouillon, publié dans La Censure et l’œuvre (voir la bibliographie qui suit).
Le procès eut lieu le 29 janvier 1857 (et non le 31 comme on le trouve parfois, à la suite d’une erreur commise par Flaubert lui-même). Flaubert avait fait sténographier le réquisitoire et la plaidoirie, qui nous sont donc parvenus. Le procureur Ernest Pinard et l’avocat Jules Senard, homme politique influent, partagent les mêmes valeurs morales et la même conception utilitariste de la littérature, qui doit servir à l’édification des lecteurs. Le premier reproche à l’auteur de Madame Bovary la couleur « lascive » de son roman, la « beauté de provocation » qui caractérise son héroïne et le mélange du sacré et du profane. Le second plaide en faveur d’un fils de bonne famille respectée dont le roman prêche par le contre-exemple : le suicide d’Emma montre suffisamment la punition du vice. Bien que Flaubert ait trouvé la plaidoirie de son avocat « splendide », le lecteur d’aujourd’hui est peut-être plus sensible au trouble à la fois moral et esthétique exprimé en son temps par le procureur Pinard, choqué par la « domination » qu’exerce Emma sur les hommes, et sensible à l’effet immoral produit par le procédé de l’impersonnalité : l’auteur n’intervient jamais dans son œuvre pour juger la conduite de ses personnages, et il n’a pas pris la peine d’y introduire une figure positive qui eût été le porte-parole du bon sens.
Le jugement est rendu huit jours après le procès, le 7 février 1857. Flaubert est acquitté, mais blâmé pour son « réalisme vulgaire et souvent choquant ». Le roman peut alors paraître en librairie, sans les coupures imposées par les dernières livraisons de la Revue de Paris. Mais après être passé par la double censure des coupures préventives et de la parole d’un procureur, le texte se défait en fragments produisant des « effets lubriques » que Flaubert ne sait pas toujours comment faire rentrer dans un ensemble homogène. L’auteur est évidemment satisfait par le succès foudroyant de son coup d’essai, mais il aurait préféré ne le devoir qu’à l’art, et non au scandale judiciaire.
Le roman paraît chez Michel Lévy le 16 avril 1857. Dès qu’il est en possession de ses volumes, Flaubert reporte sur un exemplaire les 71 corrections indiquées par Laurent-Pichat sur le manuscrit du copiste ou effectivement faites dans la Revue de Paris. Cet exemplaire témoin, conservé à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, a été reproduit en fac-similé pour le cent cinquantenaire de la publication du roman. Lors de sa réédition chez Charpentier en 1873, Flaubert joindra en appendice les pièces du dossier pénal
Le procès de Madame Bovary
Le 31 janvier 1857 s’ouvrait devant le Tribunal Correctionnel de Paris l’un des plus curieux procès littéraires que la France ait connu. Le procès de Madame Bovary .
Au banc des accusés s’asseyaient trois prévenus : le gérant de la revue de Paris, l’imprimeur, et un jeune auteur encore inconnu, Gustave Flaubert.
Celui-ci n’avait pas encore publié, Madame Bovary était sa première œuvre. Âgé de 35 ans, il était le fils du docteur Achille Flaubert, chirurgien-chef de l’Hôtel-Dieu de Rouen.
Après les décès de son père et de sa sœur, survenus la même année, il vivait seul avec sa mère dans le pavillon de Croisset, près de Rouen ; ce pavillon que Maupassant a si bien décrit :« C’était une jolie maison blanche de style ancien, plantée tout au bord de la Seine, au milieu d’un jardin magnifique qui s’étendait par-derrière et escaladait la grande côte de Canteleu. Des fenêtres de son vaste cabinet de travail, on voyait passer tout près, comme s’ils allaient toucher les murs avec leurs vergues, les grands navires qui montaient vers Rouen ou descendaient vers la mer ».
C’est donc un jeune bourgeois, un fils de famille, élevé dans un milieu médical, un provincial, qui vient s’asseoir sur le banc de la correctionnelle.
Son roman, publié d’abord comme tous les romans de l’époque en feuilleton dans la Revue de Paris, avait provoqué les plaintes indignées de nombreux lecteurs. Il avait fallu supprimer le passage du fiacre où les deux amants, Emma et Léon, enfermés dans le fiacre, stores baissés, sillonnaient toute la journée les faubourgs de Rouen.
Le Second Empire était à l’apogée de son triomphe, les publicistes avaient donné des majorités écrasantes et l’on était encore au temps de l’empire autoritaire. La masse des électeurs qui avait porté Napoléon au pouvoir était rurale et conservatrice. L’Empire s’appuyait sur la religion et sur l’ordre. C’est ce qui explique sans doute ces poursuites, destinées à satisfaire l’opinion et par la même occasion à supprimer un journal d’opposition, car la Revue de Paris était libérale.
Flaubert, en comparaissant devant ce tribunal, ne se doutait pas que ce procès allait lui apporter une monumentale publicité, allait lancer son livre avec fracas et allait lui assurer la célébrité.
Il est curieux, dans un temps où la pornographie sévit un peu partout dans les livres et sur les écrans, d’examiner ce qui pouvait choquer nos ancêtres, il y a un siècle à peine. Cela nous renseigne sur l’évolution des mœurs et doit nous inciter à la prudence dans nos jugements sur les œuvres littéraires ou artistiques.
Les débats ont dû être très longs à en juger par la longueur du réquisitoire et de la plaidoirie.
Au siège du Ministère Public se trouvait l’avocat impérial Pinard.
La défense était assurée par Me Sénard, un grand nom du barreau et de la politique, ancien président de l’Assemblée Nationale, ancien ministre de l’Intérieur, un ami de la famille Flaubert.
Le délit reproché aux trois accusés n’existe plus aujourd’hui, c’était : l’outrage à la morale publique et à la religion.
Le réquisitoire de l’avocat impérial Pinard fut d’après Roger Dumesnil, qui est l’un des meilleurs spécialistes de Flaubert, « un monument de sottise et de mauvaise foi qui semblait né de la collaboration de Tartuffe et de Homais ».
Il critique d’abord le titre.
— « On l’appelle Madame Bovary, mœurs de province ».
— Vous pouvez lui donner un autre titre et l’appeler avec justesse : histoire des adultères d’une femme de province.
— « La couleur générale de l’œuvre, permettez-moi de vous le dire, c’est la couleur lascive ! ».
L’avocat impérial Pinard cite ensuite les principaux passages qui lui paraissent répréhensibles comme portant atteinte à la morale.
Il retient notamment deux passages du livre, qu’il appelle les deux chutes, la chute avec Rodolphe et la chute avec Léon.
Auparavant le procureur avait résumé d’une façon tendancieuse le roman. Ceux qui ont lu Madame Bovary (on l’étudie aujourd’hui sur les bancs du lycée) savent que Mme Bovary qui s’ennuyait dans son village de Yonville-l’Abbaye, à côté d’un mari médiocre qui était officier de santé et dont « la conversation était plate comme un trottoir de rue », eut deux amants, Rodolphe, un gentilhomme campagnard et Léon, un clerc de notaire de Rouen, que poussée par l’usurier Lheureux, elle fit des dettes à l’insu de son mari, et que déçue par ses deux amants et redoutant le scandale, car ses meubles étaient saisis par ses créanciers, elle déroba, dans le capharnaüm du pharmacien Homais de l’arsenic et s’empoisonna.
La première chute a lieu dans la forêt.
— « J’ai tort, j’ai tort, disait-elle, je suis folle de vous entendre.
— « Pourquoi ? Emma, Emma.
— « Ô Rodolphe, fit lentement la jeune femme en se penchant sur son épaule.
— « Le drap de sa robe s’accrochait au velours de l’habit. Elle renversa son cou blanc qui se gonfla d’un soupir, et défaillante, toute en pleurs, et se cachant la figure, elle s’abandonna ».
— Et croyez-vous Messieurs, dit Pinard, qu’elle ait honte après cela ?
Pas du tout, non, le front haut, elle rentra en glorifiant l’adultère.
La preuve, elle répétait, « j’ai un amant, j’ai un amant ».
— Voilà Messieurs qui pour moi est bien plus dangereux, bien plus immoral que la chute elle-même !
La deuxième chute a lieu dans le fiacre avec Léon.
Le procureur tient à signaler que par « un scrupule qui l’honore, le rédacteur de la revue a supprimé la scène de la chute dans le fiacre ».
— Mais si la Revue de Paris baisse les stores du fiacre, elle nous fait pénétrer dans la chambre où se donnent les rendez-vous :
— « Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet de son corset qui sifflait autour de ses hanches, comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements, et pâle sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine avec un long frisson ».
— Voilà s’écrie Pinard « Une peinture admirable sous le rapport du talent mais une peinture exécrable au point de vue de la morale !
— « Chez Flaubert, point de voile, point de gaze. C’est la nature dans toute sa nudité, dans toute sa crûdité ».
Après ce morceau d’éloquence judiciaire cité aujourd’hui dans toutes les éditions littéraires comme l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire, la tâche était rude pour l’avocat Me Sénard.
— « Messieurs, M. Gustave Flaubert est accusé devant vous d’avoir fait un mauvais livre, d’avoir dans ce livre outragé la morale publique et la religion. M. Gustave Flaubert est auprès de moi, il affirme devant vous qu’il a fait un livre honnête.
La pensée de son livre est une pensée morale et religieuse pouvant se traduire par ces mots : l’excitation à la vertu par l’horreur du vice ».
Ainsi dès l’exorde, le thème de la plaidoirie est annoncé, il va plaider la relaxe et va nous démontrer que Flaubert a voulu faire œuvre de moraliste, ou que du moins une moralité se dégage de son œuvre.
Il commence par présenter l’inculpé en signalant que son père, « son Illustre père », le Dr Flaubert a été pour lui un vieil ami.
C’est un jeune homme d’un caractère sérieux, il a fait des études et pas n’importe quelles études, des études de droit, il a beaucoup voyagé jusqu’en Orient, il a beaucoup travaillé et cet ouvrage est le fruit de longues études de longues méditations.
Ceci est vrai puisque l’on sait que Flaubert a mis près de 5 ans pour écrire Madame Bovary, entre 1851 et 1856 et non sans les plus grandes difficultés puisqu’il avait connu ce qu’il appelait « les affres du style ».
Le portrait de l’accusé étant ainsi tracé, va commencer la discussion, paragraphe par paragraphe, des passages reprochés à son client.
D’abord le titre. Ce qui a choqué le procureur impérial Pinard, c’est semble-t-il le sous-titre « Mœurs de Province » ; il propose puisqu’il faut un sous-titre : Histoire de l’éducation donnée en province et se lance dans une tirade sur les dangers de l’éducation des jeunes filles au-dessus de leur condition. Emma était la fille d’un fermier, le père Rouault, et elle a été élevée au couvent des Ursulines avec de petites bourgeoises, ce qui lui a donné des idées de grandeur. Voilà une conception de l’éducation qui est du dix-neuvième siècle, il n’est pas encore question de démocratisation de l’enseignement, mais c’était en effet l’idée développée par Flaubert et l’analyse de l’avocat devait plaire aux juges du Second Empire.
Il fait remarquer ensuite au tribunal que le livre est écrit « avec une grande puissance d’observation dans tous les détails ». Les paysages, les objets, les vêtements, les sentiments, tout est noté, l’auteur ne fait grâce de rien.
Il multiplie « les petits faits vrais » chers à Stendhal, qui donnent du volume et de la présence aux personnages. Toutefois remarque l’avocat, lorsqu’il arrive au moment scabreux, l’auteur le décrit d’un mot : « Elle s’abandonna » ou bien dans le fiacre, les stores sont baissés et l’on voit seulement « une main nue qui passa sous les petits rideaux de toile jaune, et jeta des déchirures de papier qui se dispersèrent au vent ».
— « La toute-puissance descriptive disparaît parce que sa pensée est chaste ».
Me Sénard prend plaisir alors à comparer cette scène du fiacre avec une autre scène décrite par Mérimée dans La double méprise et qui se passe dans une chaise de poste. Cette scène qu’il ne lit pas est paraît-il beaucoup plus audacieuse ! Or, Mérimée fait partie de l’Académie Française, il est reçu à la cour, ses fonctions officielles font de lui une sorte de ministre de la Culture du Second Empire.
L’avocat fait passer son livre au tribunal qui pourra le lire dans le cours du délibéré.
D’autres grands noms dans la littérature sont appelés au secours de Flaubert. Lamartine qui l’a reçu chez lui et lui aurait dit : « il est déjà très regrettable qu’on se soit ainsi mépris sur le caractère de votre œuvre et qu’on ait ordonné de la poursuivre, mais il n’est pas possible pour l’honneur de notre pays, qu’il se trouve un tribunal pour vous condamner ».
Me Sénard s’explique ensuite longuement sur les passages reprochés à son client, notamment sur les deux chutes, et son système de défense est toujours le même, il consiste à replacer ces phrases lues par le procureur impérial Pinard, dans leur contexte, et pour cela il est obligé de lire de longs passages qui expliquent et éclairent les intentions de l’auteur ; et il cite une phrase de Flaubert dans un mémoire que celui-ci avait rédigé pour sa défense et qu’il n’a pas publié : « On m’accuse avec des phrases prises çà et là dans mon livre, je ne puis me défendre qu’avec mon livre tout entier », mais ajoute l’avocat « demander à des juges la lecture d’un roman tout entier, c’est leur demander beaucoup ! »
Il montre que Mme Bovary est cruellement punie de ses fautes, trop cruellement puisqu’elle meurt dans d’épouvantables souffrances : « L’adultère que dépeint Flaubert n’est pas charmant, il n’est chez lui qu’une suite de tourments, de regrets de remords ».
D’ailleurs où Flaubert a-t-il pris son inspiration ? Dans Bossuet qui a décrit « les illusions des sens » dans un livre tout écorné, que l’avocat remet au tribunal car c’est paraît-il le livre de chevet de M. Flaubert, «il le feuillette jour et nuit » Le tribunal va quitter l’audience avec toute une bibliothèque !
Reste le deuxième motif d’inculpation, c’est l’offense à la religion. La dernière partie de la plaidoirie va être consacrée à cela. L’accusation a été sur ce point beaucoup moins virulente et le procureur impérial Pinard a surtout reproché à I’ accusé d’avoir « mêlé des choses profanes à des choses sacrées ». Ainsi quand Emma était enfant « lorsqu’elle allait à confesse, elle inventait des petits péchés, afin de rester là plus longtemps à genoux dans l’ombre, sous le chuchotement du prêtre ».
L’avocat montre qu’il ne faut pas confondre la religion, qu’il respecte et qu’il pratique lui-même comme tout bon catholique, avec la bigoterie et la fausse dévotion caractérisée par « le petit commerce de reliques, de médailles, de petits bons dieux, de petites bonnes vierges ». C’est cela que l’auteur a voulu dire, Messieurs, aucun sentiment troublé dans tout cela !
Le procureur Pinard avait reproché à l’auteur la scène de l’extrême-onction, il paraît que le rite était tourné en dérision et pendant la cérémonie on entendait par la fenêtre la voix d’un mendiant aveugle qui chantait une chanson d’amour. Toujours le mélange du profane et du sacré :
Me Sénard répond que pour écrire cette scène, Flaubert, avec son souci de la vérité, s’est documenté dans un ouvrage que lui avait confié un vénérable ecclésiastique et qui s’intitule « Explication historique, dogmatique, morale, liturgique et canonique du catéchisme », par M. l’Abbé Guillois, curé de Notre-Dame du Pré, au Mans. Ouvrage recommandé par de nombreux archevêques et il remet le livre pieux au tribunal. Il paraît que le vénérable ecclésiastique, lorsqu’il a lu le récit de Flaubert « lui a serré la main avec des larmes ».
Enfin dernier reproche pour l’offense à la religion le personnage de l’abbé Bournisien est un personnage ridicule, c’est un curé matérialiste. Il est vrai qu’il est gros et gras, aime les bons repas et n’est d’aucun secours à la pécheresse, Emma Bovary, lorsqu’elle va se confier à lui — Allez consulter votre mari lui répond-il. Mais réplique Me Sénard, ce n’est pas un ecclésiastique éminent, c’est un simple curé de campagne.
En tout cas, il est beaucoup moins ridicule que le pharmacien Homais, « le voltairien », le sceptique, l’incrédule, l’homme qui est en querelle perpétuelle avec le curé. Il cite des livres dans lesquels « des ecclésiastiques jouent un rôle déplorable », et l’on pourrait en citer bien d’autres, le curé de Tours de Balzac, le Rouge et le Noir de Stendhal, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, et ceux-là n’ont pas été poursuivis.
Que penser de cette plaidoirie ?
À la lecture, elle nous paraît un peu longue, les juges d’aujourd’hui, qui sont pressés ne la supporteraient plus. Il y a des répétitions, le plan n’est pas bien net, les arguments se bousculent en désordre, le style est emphatique, mais c’est le style judiciaire de l’époque.
Les arguments sont un peu hypocrites, car on veut nous faire croire que Flaubert a voulu faire œuvre de moraliste, Flaubert lui-même s’en défendra plus tard.
Mais le but de l’éloquence judiciaire étant de convaincre, Me Sénard a parfaitement réussi puisque finalement Flaubert a été acquitté.
Les attendus sont soigneusement balancés, comme dans les pièces de Courteline, l’auteur y est blâmé sévèrement car « il y a des limites que la littérature même la plus légère ne doit pas dépasser », mais il est rendu hommage à son travail et à son talent.
Le jugement est tout à l’honneur de la magistrature qui n’a pas cédé aux pressions du pouvoir.
Après le procès, Flaubert est découragé, plein d’amertume, il n’essaie pas de profiter de l’énorme publicité faite autour de son livre, il aspire au calme, à la retraite, et se retire à Croisset, dans son pavillon au bord de la Seine où il demeurera jusqu’à sa mort, sortant peu, vivant comme un ermite, travaillant beaucoup et écrivant d’autres chefs-d’œuvre.
Quant à l’avocat impérial Pinard, il avait une revanche à prendre, il la trouva avec Baudelaire contre qui il fit un réquisitoire pour le procès des Fleurs du Mal.
Mais Baudelaire eut moins de chance que Flaubert, il fut condamné.
Les deux procès furent les derniers grands procès littéraires. Ils n’apportèrent aucune gloire au procureur Pinard mais n’empêchèrent pas Flaubert et Baudelaire d’entrer dans l’immortalité.
Vingt-deux ans après, en 1880, Flaubert écrivait à Maupassant une lettre au sujet d’un recueil de poèmes que celui-ci venait de publier, l’un des poèmes, intitulé « Au bord de l’eau », avait provoqué l’indignation du parquet d’Etampes et Maupassant risquait à son tour d’être poursuivi.
Flaubert prend aussitôt sa défense, il n’a pas oublié son propre procès et l’évoque en ces termes : « Tu t’assoiras mon petit sur le banc des voleurs et tu entendras un particulier lire tes vers et les relire en appuyant sur certains mots auxquels il donnera un sens perfide, il en répétera quelques-uns plusieurs fois, tel que le citoyen Pinard ».
Dans cette lettre qui servira de préface au recueil de Maupassant, il donne son opinion sur la question de la « moralité dans l’art ». « Ce qui est beau est moral ; voilà tout selon moi ».
Quant à Baudelaire, injustement condamné, il sera réhabilité par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 mai 1949.
Le conseiller chargé du rapport sur ce procès s’exprime ainsi : « On éprouve un peu en défendant Baudelaire et les Fleurs du Mal, du reproche d’obscénité, l’impression de plaider pour un livre de la bibliothèque rose ».
En un siècle, les mœurs ont bien changé, mais Emma Bovary poursuit son rêve et son ennui, son histoire est de tous les temps.
« Ma pauvre Bovary, disait Flaubert, souffre et pleure dans vingt villages de France à cette heure même ».

Procès de Madame Bovary :
réquisitoire
d'Ernest Pinard
LE MINISTÈRE PUBLIC
CONTRE
M. GUSTAVE FLAUBERT
–––
RÉQUISITOIRE DE M. L’AVOCAT IMPÉRIAL,
M. ERNEST PINARD
Messieurs, en abordant ce débat, le ministère public est en présence d’une difficulté qu’il ne peut pas se dissimuler. Elle n’est pas dans la nature même de la prévention : offenses à la morale publique et à la religion, ce sont là sans doute des expressions un peu vagues, un peu élastiques, qu’il est nécessaire de préciser. Mais enfin quand on parle à des esprits droits et pratiques, il est facile de s’entendre à cet égard, de distinguer si telle page d’un livre porte atteinte à la Religion ou à la Morale. La difficulté n’est pas dans notre prévention, elle est plutôt, elle est davantage dans l’étendue de l’œuvre que vous avez à juger. Il s’agit d’un roman tout entier. Quand on soumet à votre appréciation un article de journal, on voit tout de suite où le délit commence et où il finit ; le ministère public lit l’article et le soumet à votre appréciation. Ici il ne s’agit pas d’un article de journal, mais d’un roman tout entier qui commence le 1er octobre, finit le 15 décembre, et se compose de six livraisons, dans la Revue de Paris, 1856. Que faire dans cette situation ? Quel est le rôle du ministère public ? Lire tout le roman ? C’est impossible. D’un autre côté, ne lire que les textes incriminés, c’est s’exposer à un reproche très-fondé. On pourrait nous dire : si vous n’exposez pas le procès dans toutes ses parties, si vous passez ce qui précède et ce qui suit les passages incriminés, il est évident que vous étouffez le débat en restreignant le terrain de la discussion. Pour éviter ce double inconvénient, il n’y a qu’une marche à suivre, et la voici, c’est de vous raconter d’abord tout le roman sans en lire, sans en incriminer aucun passage, et puis de lire, d’incriminer en citant le texte, et enfin de répondre aux objections qui pourraient s’élever contre le système général de la prévention.
Quel est le titre du roman ? Madame Bovary. C’est un titre qui ne dit rien par lui-même. Il en a un second entre parenthèses : Moeurs de province. C’est encore là un titre qui n’explique pas la pensée de l’auteur, mais qui la fait pressentir. L’auteur n’a pas voulu suivre tel ou tel système philosophique vrai ou faux, il a voulu faire des tableaux de genre, et vous allez voir quels tableaux !!! Sans doute c’est le mari qui commence et qui termine le livre, mais le portrait le plus sérieux de l’œuvre, qui illumine les autres peintures, c’est évidemment celui de madame Bovary.
Ici je raconte, je ne cite pas. On prend le mari au collège, et il faut le dire, l’enfant annonce déjà ce que sera le mari. Il est excessivement lourd et timide, si timide que lorsqu’il arrive au collège et qu’on lui demande son nom, il commence par répondre Charbovari. Il est si lourd qu’il travaille sans avancer. Il n’est jamais le premier, il n’est jamais le dernier non plus de sa classe ; c est le type, sinon de la nullité, au moins de celui du ridicule au collège. Après les études du collège, il vint étudier la médecine à Rouen, dans une chambre au quatrième, donnant sur la Seine, que sa mère lui avait louée chez un teinturier de sa connaissance. C’est là qu’il fait ses études médicales et qu’il arrive petit à petit à conquérir, non pas le grade de docteur en médecine, mais celui d’officier de santé. Il fréquentait les cabarets, il manquait les cours, mais il n’avait au demeurant d’autre passion que celle de jouer aux dominos. Voilà M. Bovary.
Il va se marier. Sa mère lui trouve une femme : la veuve d’un huissier de Dieppe ; elle est vertueuse et laide, elle a quarante-cinq ans et 1.200 livres de rente. Seulement le notaire qui avait le capital de la rente partit un beau matin pour l’Amérique, et madame Bovary jeune fut tellement frappée, tellement impressionnée par ce coup inattendu, qu’elle en mourut. Voilà le premier mariage, voilà la première scène.
M. Bovary, devenu veuf, songe à se remarier. Il interroge ses souvenirs ; il n’a pas besoin d’aller bien loin, il lui vient tout de suite à l’esprit la fille d’un fermier du voisinage qui avait singulièrement excité les soupçons de madame Bovary, mademoiselle Emma Rouault. Le fermier Rouault n’avait qu’une fille, élevée aux Ursulines de Rouen. Elle s’occupait peu de la ferme ; son père désirait la marier. L’officier de santé se présente, il n’est pas difficile sur la dot, et vous comprenez qu’avec de telles dispositions de part et d’autre les choses vont vite. Le mariage est accompli. M. Bovary est aux genoux de sa femme, il est le plus heureux des hommes, le plus aveugle des maris ; sa seule préoccupation est de prévenir les désirs de sa femme.
Ici le rôle de M. Bovary s’efface ; celui de madame Bovary devient l’œuvre sérieuse du livre.
Messieurs, madame Bovary a-t-elle aimé son mari ou cherché à l’aimer ? Non, et dès le commencement il y a ce qu’on peut appeler la scène de l’initiation. À partir de ce moment, un autre horizon s’étale devant elle, une vie nouvelle lui apparaît. Le propriétaire du château de la Veaubeyssard [sic] avait donné une grande fête. On avait invité l’officier de santé, on avait invité sa femme, et là il y eut pour elle comme une initiation à toutes les ardeurs de la volupté ! Elle avait aperçu le duc de Laverdière, qui avait eu des succès à la cour ; elle avait valsé avec un vicomte et éprouvé un trouble inconnu. À partir de ce moment, elle avait vécu d’une vie nouvelle ; son mari, tout ce qui l’entourait, lui était devenu insupportable. Un jour, en cherchant dans un meuble, elle avait rencontré un fil de fer qui lui avait déchiré le doigt ; c’était le fil de son bouquet de mariage. Pour essayer de l’arracher à l’ennui qui la consumait, M. Bovary fit le sacrifice de sa clientèle, et vint s’installer à Yonville. C’est ici que vient la scène de la première chute. Nous sommes à la seconde livraison. Madame Bovary arrive à Yonville, et là, la première personne qu’elle rencontre, sur laquelle elle fixe ses regards, ce n’est pas le notaire de l’endroit, c’est l’unique clerc de ce notaire, Léon Dupuis. C’est un tout jeune homme qui fait son droit et qui va partir pour la capitale. Tout autre que M. Bovary aurait été inquiété des visites du jeune clerc, mais M. Bovary est si naïf qu’il croit à la vertu de sa femme ; Léon, inexpérimenté, éprouvait le même sentiment. Il est parti, l’occasion est perdue, mais les occasions se retrouvent facilement. Il y avait dans le voisinage d’Yonville un M. Rodolphe Boulanger (vous voyez que je raconte). C’était un homme de trente-quatre ans, d’un tempérament brutal ; il avait eu beaucoup de succès auprès des conquêtes faciles ; il avait alors pour maîtresse une actrice ; il aperçut madame Bovary, elle état jeune, charmante ; il résolut d’en faire sa maîtresse. La chose était facile, il lui suffit de trois occasions. La première fois il était venu aux Comices agricoles, la seconde fois il lui avait rendu une visite, la troisième fois il lui avait fait faire une promenade à cheval que le mari avait jugée nécessaire à la santé de sa femme ; et c’est alors, dans une première visite de la forêt, que la chute a lieu. Les rendez-vous se multiplieront au château de Rodolphe, surtout dans le jardin de l’officier de santé. Les amants arrivent jusqu’aux limites extrêmes de la volupté ! Madame Bovary veut se faire enlever par Rodolphe, Rodolphe n’ose pas dire non, mais il lui écrit une lettre où il cherche à lui prouver, par beaucoup de raisons, qu’il ne peut pas l’enlever. Foudroyée à la réception de cette lettre, Madame Bovary a une fièvre cérébrale à la suite de laquelle une fièvre typhoïde se déclare. La fièvre tua l’amour, mais resta la malade. Voilà la deuxième scène.
J’arrive à la troisième. La chute avec Rodolphe avait été suivie d’une réaction religieuse, mais elle avait été courte ; madame Bovary va tomber, de nouveau. Le mari avait jugé le spectacle utile à la convalescence de sa femme, et il l’avait conduite à Rouen. Dans une loge, en face de celle qu’occupaient M. et Madame Bovary, se trouvait Léon Dupuis, ce jeune clerc de notaire qui fait son droit à Paris, et qui en est revenu singulièrement instruit, singulièrement expérimenté. Il va voir madame Bovary ; il lui propose un rendez-vous. Madame Bovary lui indique la cathédrale. Au sortir de la cathédrale, Léon lui propose de monter dans un fiacre. Elle résiste d’abord, mais Léon lui dit que cela se fait ainsi à Paris, et alors plus d’obstacle. La chute a lieu dans le fiacre ! Les rendez-vous se multiplient pour Léon comme pour Rodolphe, chez l’officier de santé et puis dans une chambre qu’on avait louée à Rouen. Enfin elle arriva jusqu’à la fatigue même de ce second amour, et c’est ici que commence la scène de détresse, c’est la dernière du roman.
Madame Bovary avait prodigué, jeté les cadeaux à la tête de Rodolphe et de Léon, elle avait mené une vie de luxe, et pour faire face à tant de dépenses, elle avait souscrit de nombreux billets à ordre. Elle avait obtenu de son mari une procuration générale pour gérer le patrimoine commun ; elle avait rencontré un usurier qui se faisait souscrire des billets, lesquels n’étant pas payés à l’échéance, étaient renouvelés, sous le nom d’un compère. Puis étaient venus le papier timbré, les protêts, les jugements, la saisie, et enfin l’affiche de la vente du mobilier de M. Bovary, qui ignorait tout. Réduite aux plus cruelles extrémités, madame Bovary demande de l’argent à tout le monde et n’en obtient de personne, Léon n’en a pas, et il recule épouvanté à l’idée d’un crime qu’on lui suggère pour s’en procurer. Parcourant tous les degrés de l’humiliation, madame Bovary va chez Rodolphe ; elle ne réussit pas ; Rodolphe n’a pas 3,000 francs. Il ne lui reste plus qu’une issue. De s’excuser auprès de son mari ? Non ; de s’expliquer avec lui ? Mais ce mari aurait la générosité de lui pardonner, et c’est là une humiliation qu’elle ne peut pas accepter : elle s’empoisonne. Viennent alors des scènes douloureuses. Le mari est là, à côté du corps glacé de sa femme. Il fait apporter sa robe de noces, il ordonne qu’on l’en enveloppe et qu’on enferme sa dépouille dans un triple cercueil.
Un jour, il ouvre le secrétaire et il y trouve le portrait de Rodolphe, ses lettres et celles de Léon. Vous croyez que l’amour va tomber alors ? Non, non, il s’excite, au contraire, il s’exalte pour cette femme que d’autres ont possédée, en raison de ces souvenirs de volupté qu’elle lui a laissés ; et dés ce moment il néglige sa clientèle, sa famille, il laisse aller au vent les dernières parcelles de son patrimoine, et un jour on le trouve mort dans la tonnelle de son jardin, tenant dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs.
Voilà le roman ; je l’ai raconté tout entier en n’en supprimant aucune scène. On l’appelle Madame Bovary ; vous pouvez lui donner un autre titre, et l’appeler avec justesse Histoire des adultères d’une femme de province.
Messieurs, la première partie de ma tâche est remplie ; j’ai raconté, je vais citer, et après les citations viendra l’incrimination qui porte sur deux délits ; offense à la morale publique, offense à la morale religieuse. L’offense à la morale publique est dans les tableaux lascifs que je mettrai sous vos yeux, l’offense à la morale religieuse dans des images voluptueuses mêlées aux choses sacrées. J’arrive aux citations. Je serai court, car vous lirez le roman tout entier. Je me bornerai à vous citer quatre scènes, ou plutôt quatre tableaux. La première, ce sera celle des amours et de la chute avec Rodolphe ; la seconde, la transition religieuse entre les deux adultères ; la troisième, ce sera la chute avec Léon, c’est le deuxième adultère, et enfin la quatrième que je veux citer, c’est la mort de madame Bovary.
Avant de soulever ces quatre coins du tableau, permettez-moi de me demander quelle est la couleur, le coup de pinceau de M. Flaubert, car enfin son roman est un tableau, et il faut savoir à quelle école il appartient, quelle est la couleur qu’il emploie, et quel est le portrait de son héroïne.
La couleur générale de l’auteur, permettez-moi de vous le dire, c’est la couleur lascive, avant, pendant et après ces chutes ! Elle est enfant, elle a dix ou douze ans, elle est au couvent des Ursulines. À cet âge où la jeune fille n’est pas formée, où la femme ne peut pas sentir ces émotions premières qui lui révèlent un monde nouveau, elle se confesse.
« Quand elle allait à confesse (cette première citation de la première livraison est à la page 30 du numéro du 1er octobre), quand elle allait à confesse, elle inventait de petits péchés afin de rester là plus longtemps, à genoux dans l’ombre, les mains jointes, le visage à la grille sous le chuchotement du prêtre. Les comparaisons de fiancé, d’époux, d’amant céleste et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l’âme des douceurs inattendues. »
Est-ce qu’il est naturel qu’une petite fille invente de petits péchés, quand on sait que pour un enfant ce sont les plus petits qu’on a le plus de peine à dire ? Et puis à cet âge-là, quand une petite fille n’est pas formée, la montrer inventant de petits péchés dans l’ombre, sous le chuchotement du prêtre, en se rappelant ces comparaisons de fiancé, d’époux, d’amant céleste et de mariage éternel, qui lui faisaient éprouver comme un frisson de volupté, n’est-ce pas faire ce que j’ai appelé une peinture lascive ?
Voulez-vous madame Bovary dans ses moindres actes, à l’état libre, sans l’amant, sans la faute ? Je passe sur ce mot du lendemain, et sur cette mariée qui ne laissait rien découvrir où l’on pût deviner quelque chose, il y a là déjà un tour de phrase plus qu’équivoque, mais voulez-vous savoir comment était le mari ?
Ce mari du lendemain « que l’on eût pris pour la vierge de la veille, » et cette mariée « qui ne laissait rien découvrir où l’on pût deviner quelque chose ». Ce mari (p. 29), qui se lève et part « le coeur plein des félicités de la nuit, l’esprit tranquille, la chair contente, » s’en allant « ruminant son bonheur comme ceux qui mâchent encore après dîner le goût des truffes qu’ils digèrent ».
Je tiens, messieurs, à vous préciser le cachet de l’œuvre littéraire de M. Flaubert, et ses coups de pinceau. Il a quelquefois des traits qui veulent beaucoup dire, et ces traits ne lui coûtent rien.
Et puis, au château de Lavaubyessard [sic], savez-vous ce qui attire les regards de cette jeune femme, ce qui la frappe le plus ? C’est toujours la même chose, c’est le duc de Laverdière, amant, « disait-on, de Marie-Antoinette, entre MM. de Coigny et de Lauzun, » et sur lequel « les yeux d’Emma revenaient d’eux-mêmes, comme sur quelque chose d’extraordinaire et d’auguste ; il avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines ! »
Ce n’est là qu’une parenthèse historique, dira-t-on ? Triste et inutile parenthèse ! L’histoire a pu autoriser des soupçons, mais non le droit de les ériger en certitude. L’histoire a parlé du collier dans tous les romans, l’histoire a parlé de mille choses, mais ce ne sont là que des soupçons, et, je le répète, je ne sache pas qu’elle ait autorisé à transformer ces soupçons en certitude. Et quand Marie-Antoinette est morte avec la dignité d’une souveraine et le calme d’une chrétienne, ce sang versé pourrait effacer des fautes, à plus forte raison des soupçons. Mon Dieu, M. Flaubert a eu besoin d’une image frappante pour peindre son héroïne, et il a pris celle-là pour exprimer tout à la fois et les instincts pervers et l’ambition de madame Bovary !
Madame Bovary doit très bien valser, et la voici valsant : « Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient ; tout tournait autour d’eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet, comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d’Emma par le bas s’ériflait au pantalon ; leurs jambes entraient l’une dans l’autre, il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui ; une torpeur la prenait, elle s’arrêta. Ils repartirent, et, d’un mouvement plus rapide, le vicomte, l’entraînant, disparut avec elle, jusqu’au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber, et un instant, s’appuya la tête sur sa poitrine. Et puis, tournant toujours, mais plus doucement, il la reconduisit à sa place ; elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. »
Je sais bien qu’on valse un peu de cette manière, mais cela n’en ait pas plus moral !
Prenez madame Bovary dans les actes les plus simples, c’est toujours le même coup de pinceau, il est à toutes les pages. Aussi Justin, le domestique du pharmacien voisin, a-t-il des émerveillements subits quand il est initié dans le secret du cabinet de toilette de cette femme. Il poursuit sa voluptueuse admiration jusqu’à la cuisine.
« Le coude sur la longue planche où elle (Félicité, la femme de chambre) repassait, il considérait avidement toutes ces affaires de femme étalées autour de lui, les jupons de basin, les fichus, les collerettes et les pantalons a coulisse, vastes de hanches et qui se rétrécissaient par le bas.
— À quoi cela sert-il ? demandait le jeune garçon, en passant sa main sur la crinoline ou les agrafes.
— Tu n’as donc jamais rien vu ? répondait en riant Félicité. »
Aussi le mari se demande-t-il, en présence de cette femme sentant frais, si l’odeur vient de la peau ou de la chemise.
« Il trouvait tous les soirs des meubles souples et une femme en toilette fine, charmante et sentant frais, à ne savoir même d’où venait cette odeur, ou si ce n’était pas la femme qui parfumait la chemise. »
Assez de citations de détail ! Vous connaissez maintenant la physionomie de madame Bovary au repos, quand elle ne provoque personne, quand elle ne pêche pas, quand elle est encore complètement innocente, quand au retour d’un rendez-vous, elle n’est pas encore à côté d’un mari qu’elle déteste ; vous connaissez maintenant la couleur générale du tableau, la physionomie générale de madame Bovary. L’auteur a mis le plus grand soin, employé tous les prestiges de son style pour peindre cette femme. A-t-il essayé de la montrer du coté de l’intelligence ? Jamais. Du coté du coeur ? Pas davantage. Du coté de l’esprit ? Non. Du coté de la beauté physique ? Pas même. Oh ! je sais bien qu’il y a un portrait de madame Bovary après l’adultère des plus étincelants ; mais le tableau est avant tout lascif, les poses sont voluptueuses, la beauté de madame Bovary est une beauté de provocation.
J’arrive maintenant aux quatre citations importantes ; je n’en ferai que quatre ; je tiens à restreindre mon cadre. J’ai dit que la première serait sur les amours de Rodolphe, la seconde sur la transition religieuse, la troisième sur les amours de Léon, la quatrième, sur la mort.
Voyons la première. Madame Bovary est près de la chute, près de succomber.
« La médiocrité domestique la poussait à des fantaisies luxueuses, les tendresses matrimoniales en des désirs adultères, » … « elle se maudit de n’avoir pas aimé Léon, elle eut soif de ses lèvres. »
Qu’est-ce qui a séduit Rodolphe et l’a préparé ? Le gonflement de l’étoffe de la robe de madame Bovary qui s’est crevée de place en place selon les inflexions du corsage ! Rodolphe a amené son domestique chez Bovary pour le faire saigner. Le domestique va se trouver mal, madame Bovary tient la cuvette.
« Pour la mettre sous la table, dans le mouvement qu’elle fit en s’inclinant, sa robe s’évasa autour d’elle sur les carreaux de la salle ; et comme Emma, baissée, chancelait un peu en écartant les bras, le gonflement de l’étoffe se crevait de place en place selon les inflexions du corsage. » Aussi voici la réflexion de Rodolphe :
« Il revoyait Emma dans la salle, habillée comme il l’avait vue, et il la déshabillait. »
P. 417. C’est le premier jour où ils se parlent. « Ils se regardaient, un désir suprême faisait frissonner leurs lèvres sèches, et mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent. »
Ce sont là les préliminaires de la chute. Il faut lire la chute elle-même.
« Quand le costume fut prêt, Charles écrivit à M. Boulanger que sa femme était à sa disposition et qu’ils comptaient sur sa complaisance.
Le lendemain à midi, Rodolphe arriva devant la porte de Charles avec deux chevaux de maître ; l’un portait des pompons roses aux oreilles et une selle de femme en peau de daim.
Il avait mis de longues bottes molles, se disant que sans doute elle n’en avait jamais vu de pareilles ; en effet, Emma fut charmée de sa tournure, lorsqu’il apparut avec son grand habit de velours marron et sa culotte de tricot blanc …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..
Dès qu’il sentit la terre, le cheval d’Emma prit le galop. Rodolphe galopait à côté d’elle. »
Les voilà dans la forêt.
« Il l’entraîna plus loin autour d’un petit étang où des lentilles d’eau faisaient une verdure sur les ondes…
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..
— J’ai tort, j’ai tort, disait-elle, je suis folle de vous entendre.
— Pourquoi ? Emma ! Emma !
— O Rodolphe ! … fit lentement la jeune femme, en se penchant sur son épaule.
Le drap de sa robe s’accrochait au velours de l’habit. Elle renversa son cou blanc, qui se gonflait d’un soupir ; et défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s’abandonna. »
Lorsqu’elle se fut relevée, lorsqu’après avoir secoué les fatigues de la Volupté, elle rentra au foyer domestique, à ce foyer où elle devait trouver un mari qui l’adorait, après sa première faute, après ce premier adultère, après cette première chute, est-ce le remords, le sentiment du remords qu’elle éprouva, au regard de ce mari trompé qui l’adorait ? Non ! le front haut, elle rentra en glorifiant l’adultère.
« En s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage. Jamais elle n’avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu sur sa personne la transfigurait.
Elle se répétait : J’ai un amant ! un amant ! Se délectant à cette idée comme à celle d’une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc enfin posséder ces plaisirs de l’amour, cette fièvre de bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux, où tout serait passion, extase, délire… »
Ainsi, dès cette première faute, dès cette première chute, elle fait glorification de l’adultère, elle chante le cantique de l’adultère, sa poésie, ses voluptés. Voilà, messieurs, qui pour moi est bien plus dangereux, bien plus immoral que la chute elle-même !
Messieurs, tout est pâle devant cette glorification de l’adultère, même les rendez-vous de nuit, quelques jours après.
« Pour l’avertir, Rodolphe jetait contre les persiennes une poignée de sable. Elle se levait en sursaut ; mais quelquefois il lui fallait attendre, car Charles avait la manie de bavarder au coin du feu, et il n’en finissait pas. Elle se dévorait d’impatience ; si ses yeux l’avaient pu, ils l’eussent fait sauter par les fenêtres. Enfin elle commençait sa toilette de nuit, puis elle prenait un livre et continuait à lire fort tranquillement, comme si la lecture l’eût amusée. Mais Charles, qui était au lit, l’appelait pour se coucher.
— Viens donc, Emma, disait-il, il est temps.
— Oui, j’y vais ! répondait-elle.
Cependant, comme les bougies l’éblouissaient, il se tournait vers le mur et s’endormait. Elle s’échappait en retenant son haleine, souriante, palpitante, déshabillée.
Rodolphe avait un grand manteau ; il l’en enveloppait tout entière, et, passant le bras autour de sa taille, il l’entraînait sans parler jusqu’au fond du jardin.
C’était sous la tonnelle, sur ce même banc de bâtons pourris où autrefois Léon la regardait si amoureusement durant les soirées d’été ! Elle ne pensait guère à lui, maintenant.
Le froid de la nuit les faisait s’étreindre davantage, les soupirs de leurs lèvres leur semblaient plus forts, leurs yeux, qu’ils entrevoyaient à peine, leur paraissaient plus grands, et au milieu du silence il y avait des paroles dites tout bas qui tombaient sur leur âme avec une sonorité cristalline et qui s’y répercutaient en vibrations multipliées. »
Connaissez-vous au monde, messieurs, un langage plus expressif ? Avez-vous jamais vu un tableau plus lascif ? Écoutez encore :
« Jamais madame Bovary ne fut aussi belle qu’à cette époque ; elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l’enthousiasme, du succès, et qui n’est que l’harmonie du tempérament avec les circonstances. Ses convoitises, ses chagrins, l’expérience du plaisir et ses illusions toujours jeunes, comme font aux fleurs le fumier, la pluie, les vents et le soleil, l’avaient par gradations développée, et elle s’épanouissait enfin dans la plénitude de sa nature. Ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ses longs regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu’un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres, qu’ombrageait à la lumière un peu de duvet noir. On eût dit qu’un artiste habile en corruptions avait disposé sur sa nuque la torsade de ses cheveux. Ils s’enroulaient en une masse lourde, négligemment, et selon les hasards de l’adultère qui les dénouait tous les jours. Sa voix maintenant prenait des inflexions plus molles, sa taille aussi ; quelque chose de subtil qui vous pénétrait se dégageait même des draperies de sa robe et de la cambrure de son pied. Charles, comme au premier temps de leur mariage, la trouvait délicieuse et tout irrésistible. »
Jusqu’ici la beauté de cette femme avait consisté dans sa grâce, dans sa tournure, dans ses vêtements ; enfin elle vient de vous être montrée sans voile, et vous pouvez dire si l’adultère ne l’a pas embellie :
« — Emmène-moi ! s’écria-t-elle. Enlève-moi ! … oh ! je t’en supplie !
Et elle se précipita sur sa bouche, comme pour y saisir le consentement inattendu qui s’exhalait dans un baiser. »
Voilà un portrait, messieurs, comme sait les faire M. Flaubert. Comme les yeux de cette femme s’élargissent ! comme quelque chose de ravissant est épandu sur elle, depuis sa chute ! sa beauté a-t-elle jamais été aussi éclatante que le lendemain de sa chute, que dans les jours qui ont suivi sa chute ? Ce que l’auteur vous montre, c’est la poésie de l’adultère, et je vous demande encore une fois si ces pages lascives ne sont pas d’une immoralité profonde !!!
J’arrive à la seconde situation. La seconde situation est une transition religieuse. Madame Bovary avait été très malade, aux portes du tombeau. Elle revient à la vie, sa convalescence est signalée par une petite transition religieuse.
« M. Bournisien (c’était le curé) venait la voir. Il s’enquérait de sa santé, lui apportait des nouvelles et l’exhortait à la religion dans un petit bavardage câlin, qui ne manquait pas d’agrément. La vue seule de sa soutane la réconfortait. »
Enfin elle va faire la communion. Je n’aime pas beaucoup à rencontrer des choses saintes dans un roman, mais au moins, quand on en parle, faudrait-il ne pas les travestir par le langage. Y a-t-il dans cette femme adultère qui va à la communion quelque chose de la foi de la Madeleine repentante ? Non, non, c’est toujours la femme passionnée qui cherche des illusions, et qui les cherche dans les choses les plus saintes, les plus augustes.
« Un jour qu’au plus fort de sa maladie elle s’était crue agonisante, elle avait demandé la communion ; et à mesure que l’on faisait dans sa chambre les préparatifs pour le sacrement, que l’on disposait en autel la commode encombrée de sirops, et que Félicité semait par terre des fleurs de dahlia, Emma sentait quelque chose de fort passant sur elle, qui la débarrassait de ses douleurs, de toute perception, de tout sentiment. Sa chair allégée ne pesait plus, une autre vie commençait ; il lui sembla que son être montant vers Dieu allait s’anéantir dans cet amour, comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur. »
Dans quelle langue prie-t-on Dieu avec les paroles adressées à l’amant dans les épanchements de l’adultère ? Sans doute on parlera de la couleur locale, et on s’excusera en disant qu’une femme vaporeuse, romanesque, ne fait, pas même en religion, les choses comme tout le monde. Il n’y a pas de couleur locale qui excuse ce mélange ! Voluptueuse un jour, religieuse le lendemain, nulle femme, même dans d’autres régions, même sous le ciel d’Espagne ou d’Italie, ne murmure à Dieu les caresses adultères qu’elle donnait à l’amant. Vous apprécierez ce langage, messieurs, et vous n’excuserez pas ces paroles de l’adultère introduites, en quelque sorte, dans le sanctuaire de la Divinité ! Voilà la seconde situation, j’arrive à la troisième, c’est la série des adultères.
Après la transition religieuse, madame Bovary est encore prête à tomber, Elle va au spectacle à Rouen. On jouait Lucie de Lammermoor. Emma fit un retour sur elle-même.
« Ah ! si dans la fraîcheur de sa beauté, avant les souillures du mariage et les désillusions de l’adultère (il y en a qui auraient dit : les désillusions du mariage et les souillures de l’adultère), avant les souillures du mariage et les désillusions de l’adultère, elle avait pu placer sa vie sur quelque grand coeur solide, alors la vertu, la tendresse, les voluptés et le devoir se confondant, jamais elle ne serait descendue d’une félicité si haute. »
En voyant Lagardy sur la scène, elle eut envie de courir dans ses « bras pour se réfugier en sa force, comme dans l’incarnation de l’amour même, et de lui dire, de s’écrier: Enlève-moi, emmène-moi, partons ! à toi, à toi ! toutes mes ardeurs et tous mes rêves ! »
Léon était derrière elle.
« Il se tenait derrière elle, s’appuyant de l’épaule contre la cloison ; et de temps à autre elle se sentait frissonner sous le souffle tiède de ses narines qui lui descendait dans la chevelure. »
On vous a parlé tout à l’heure des souillures du mariage ; on va vous montrer encore l’adultère dans toute sa poésie, dans ses ineffables séductions. J’ai dit qu’on aurait dû au moins modifier les expressions et dire : les désillusions du mariage et les souillures de l’adultère. Bien souvent, quand on s’est marié, au lieu du bonheur sans nuages qu’on s’était promis, on rencontre les sacrifices, les amertumes. Le mot désillusion peut donc être justifié, celui de souillure ne saurait l’être.
Léon et Emma se sont donné rendez-vous à la cathédrale. Ils la visitent, ou ils ne la visitent pas. Ils sortent.
« Un gamin polissonnait sur le parvis.
— Va me chercher un fiacre ! lui crie Léon. L’enfant partit comme une balle …
— Ah ! Léon ! … vraiment … je ne sais … si je dois … ! et elle minaudait. Puis d’un air sérieux : C’est très-inconvenant, savez-vous ?
— En quoi ? répliqua le clerc, cela se fait à Paris.
Et cette parole, comme un irrésistible argument, la détermina. »
Nous savons maintenant, messieurs, que la chute n’a pas lieu dans le fiacre. Par un scrupule qui l’honore, le rédacteur de la Revue a supprimé le passage de la chute dans le fiacre. Mais si la Revue de Paris baisse les stores du fiacre, elle nous laisse pénétrer dans la chambre où se donnent les rendez-vous.
Emma veut partir, car elle avait donné sa parole qu’elle reviendrait le soir même. « D’ailleurs, Charles l’attendait ; et déjà elle se sentait au coeur cette lâche docilité qui est pour bien des femmes comme le châtiment tout à la fois et la rançon de l’adultère … »
« Léon, sur le trottoir, continuait à marcher, elle le suivait jusqu’à l’hôtel ; il montait, il ouvrait la porte ; entrait. Quelle étreinte !
Puis les paroles après les baisers se précipitaient. On se racontait les chagrins de la semaine, les pressentiments, les inquiétudes pour les lettres ; mais à présent tout s’oubliait, et ils se regardaient face à face, avec des rires de volupté et des appellations de tendresse.
Le lit était un grand lit d’acajou en forme de nacelle. Les rideaux de levantine rouge, qui descendaient du plafond, se ceintraient [sic] trop bas vers le chevet évasé, — et rien au monde n’était beau comme sa tête brune et sa peau blanche, se détachant sur cette couleur pourpre, quand, par un geste de pudeur, elle fermait ses deux bras nus, en se cachant la figure dans les mains.
Le tiède appartement, avec son tapis discret, ses ornements folâtres et sa lumière tranquille, semblait tout commode pour les intimités de la passion. »
Voilà ce qui se passe dans cette chambre. Voici encore un passage très important — comme peinture lascive !
« Comme ils aimaient cette bonne chambre pleine de gaieté, malgré sa splendeur un peu fanée ! Ils retrouvaient toujours les meubles à leur place, et parfois des épingles à cheveux qu’elle avait oubliées, l’autre jeudi, sous le socle de la pendule. Ils déjeunaient au coin du feu, sur un petit guéridon incrusté de palissandre. Emma découpait, lui mettait les morceaux dans son assiette en débitant toutes sortes de chatteries, et elle riait d’un rire sonore et libertin, quand la mousse du vin de Champagne débordait du verre léger sur les bagues de ses doigts. Ils étaient si complètement perdus en la possession d’eux-mêmes, qu’ils se croyaient là dans leur maison particulière, et devant y vivre jusqu’à la mort, comme deux éternels jeunes époux. Ils disaient notre chambre, nos tapis, nos fauteuils, même elle disait mes pantoufles, un cadeau de Léon, une fantaisie qu’elle avait eue. C’étaient des pantoufles en satin rose, bordées de cygne. Quand elle s’asseyait sur ses genoux, sa jambe, alors trop courte, pendait en l’air, et la mignarde chaussure, qui n’avait pas de quartier, tenait seulement par les orteils à son pied nu.
Il savourait pour la première fois, et dans l’exercice de l’amour, l’inexprimable délicatesse des élégances féminines. Jamais il n’avait rencontré cette grâce de langage, cette réserve de vêtement, ces poses de colombe assoupie. Il admirait l’exaltation de son âme et les dentelles de sa jupe. D’ailleurs, n’était-ce pas une femme du monde, et une femme mariée ? une vraie maîtresse, enfin ? »
Voilà, messieurs, une description qui ne laissera rien à désirer, j’espère, au point de vue de la prévention ? En voici une autre, ou plutôt voici la continuation de la même scène :
« Elle avait des paroles qui l’enflammaient avec des baisers qui lui emportaient l’âme. Où donc avait-elle appris ces caresses presque immatérielles, à force d’être profondes et dissimulées ? »
Oh ! je comprends bien, messieurs, le dégoût que lui inspirait ce mari qui voulait l’embrasser à son retour, je comprends à merveille que lorsque les rendez-vous de cette espèce avaient lieu, elle sentît avec horreur la nuit « contre sa chair, cet homme étendu qui dormait. »
Ce n’est pas tout, à la page 73, il est un dernier tableau que je ne peux pas omettre ; elle était arrivée jusqu’à la fatigue de la volupté.
« Elle se promettait continuellement pour son prochain voyage une félicité profonde ; puis elle s’avouait ne rien sentir d’extraordinaire. Mais cette déception s’effaçait vite sous un espoir nouveau, et Emma revenait à lui plus enflammée, plus haletante, plus avide. Elle se déshabillait brutalement, arrachant le lacet mince de son corset qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Elle allait sur la pointe de ses pieds nus regarder encore une fois si la porte était fermée, puis elle faisait d’un seul geste tomber ensemble tous ses vêtements ; — et pâle, sans parler, sérieuse, elle s’abattait contre sa poitrine, avec un long frisson. »
Je signale ici deux choses, messieurs, une peinture admirable sous le rapport du talent, mais une peinture exécrable au point de vue de la morale. Oui, M. Flaubert sait embellir ses peintures avec toutes les ressources de l’art, mais sans les ménagements de l’art. Chez lui point de gaze, point de voiles, c’est la nature dans toute sa nudité, dans toute sa crudité !
Encore une citation de la page 78.
« Ils se connaissaient trop pour avoir ces ébahissements de la possession qui en centuplent la joie. Elle était aussi dégoûtée de lui qu’il était fatigué d’elle. Emma retrouvait dans l’adultère toutes les platitudes du mariage. »
Platitudes du mariage, poésie de l’adultère ! Tantôt c’est la souillure du mariage, tantôt ce sont ses platitudes, mais c’est toujours la poésie de l’adultère. Voilà, messieurs, les situations que M. Flaubert aime à peindre, et malheureusement il ne les peint que trop bien.
J’ai raconté trois scènes : la scène avec Rodolphe, et vous y avez vu la chute dans la forêt, la glorification de l’adultère, et cette femme dont la beauté devient plus grande avec cette poésie. J’ai parlé de la transition religieuse, et vous y avez vu la prière emprunter à l’adultère son langage. J’ai parlé de la seconde chute, je vous ai déroulé les scènes qui se passent avec Léon. Je vous ai montré la scène du fiacre — supprimée — mais je vous ai montré le tableau de la chambre et du lit. Maintenant que nous croyons nos convictions faites, arrivons à la dernière scène, à celle du supplice.
Des coupures nombreuses y ont été faites, à ce qu’il parait, par la Revue de Paris. Voici en quels termes M. Flaubert s’en plaint :
« Des considérations que je n’ai pas à apprécier ont contraint la Revue de Paris à faire une suppression dans le numéro du 1er décembre. Ses scrupules s’étant renouvelés à l’occasion du présent numéro, elle a jugé convenable d’enlever encore plusieurs passages. En conséquence, je déclare dénier la responsabilité des lignes qui suivent ; le lecteur est donc prié de n’y voir que des fragments et non pas un ensemble. »
Passons donc sur ces fragments et arrivons à la mort. Elle s’empoisonne. Elle s’empoisonne, pourquoi ? « Ah ! c’est bien peu de chose, la mort, pensa-t-elle, je vais m’endormir et tout sera fini. » Puis, sans un remords, sans un aveu, sans une larme de repentir sur ce suicide qui s’achève et les adultères de la veille, elle va recevoir le sacrement des mourants. Pourquoi le sacrement, puisque, sans sa pensée de tout à l’heure, elle va au néant ? Pourquoi, quand il n’y a pas une larme, pas un soupir de Madeleine sur son crime d’incrédulité, sur son suicide, sur ses adultères ?
Après cette scène, vient celle de l’extrême-onction. Ce sont des paroles saintes et sacrées pour tous. C’est avec ces paroles-là que nous avons endormi nos aïeux, nos pères et nos proches, et c’est avec elles qu’un jour nos enfants nous endormiront. Quand on veut les reproduire, il faut le faire exactement ; il ne faut pas du moins les accompagner d’une image voluptueuse sur la vie passée.
Vous le savez, le prêtre fait les onctions saintes sur le front, sur les oreilles, sur la bouche, sur les pieds, en prononçant ces phrases liturgiques : Quidquid per pedes, per aures, per pectus, etc., toujours suivies des mots misericordia… péché d’un côté, miséricorde de l’autre. Il faut les reproduire exactement, ces paroles saintes et sacrées ; si vous ne 1es reproduisez pas exactement, au moins n’y mettez rien de voluptueux.
« Elle tourna sa figure lentement et parut saisie de joie à voir tout à coup l’étole violette, sans doute retrouvant au milieu d’un apaisement extraordinaire la volupté perdue de ses premiers élancements mystiques, avec des visions de béatitude éternelle qui commençaient.
Le prêtre se releva pour prendre le crucifix ; alors elle allongea le cou comme quelqu’un qui a soif, et collant ses lèvres sur le corps de l’homme-Dieu, elle y déposa de toute sa force expirante le plus grand baiser d’amour qu’elle eût jamais donné. Ensuite il récita le Misereaturet l’Indulgentiam, trempa son pouce droit dans l’huile et commença les onctions : d’abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres ; puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses; puis sur la bouche, qui s’était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d’orgueil et crié dans la luxure ; puis sur les mains, qui se délectaient aux contacts suaves, et enfin sur la plante des pieds, si rapides autrefois quand elle courait à l’assouvissance de ses désirs, et qui maintenant ne marchaient plus. »
Maintenant, il y a les prières des agonisants que le prêtre récite tout bas, où à chaque verset se trouvent les mots : Ame chrétienne, partez pour une région plus haute. " On les murmure au moment où le dernier souffle du mourant s’échappe de ses lèvres. Le prêtre les récite, etc.
« À mesure que le râle devenait plus fort, l’ecclésiastique précipitait ses oraisons ; elles se mêlaient aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines qui tintaient comme un glas lugubre. »
L’auteur a jugé à propos d’alterner ces paroles, de leur faire une sorte de réplique. Il fait intervenir sur le trottoir un aveugle qui entonne une chanson dont les paroles profanes sont une sorte de réponse aux prières des agonisants.
« Tout à coup on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots, avec le frôlement d’un bâton, et une voix s’éleva, une voie rauque qui chantait :
Souvent la chaleur d’un beau jour
Fait rêver fillette à l’amour.
Il souffla bien fort ce jour-là,
Et le jupon court s’envola.
C’est à ce moment que madame Bovary meurt.
Ainsi voilà le tableau : d’un coté, le prêtre qui récite les prières des agonisants ; de l’autre, le joueur d’orgue, qui excite chez la mourante « un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement … Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait plus. »
Et puis ensuite, lorsque le corps est froid, la chose qu’il faut respecter par-dessus tout, c’est le cadavre que l’âme a quitté. Quand le mari est là, à genoux, pleurant sa femme, quand il a étendu sur elle le linceul, tout autre se serait arrêté, et c’est le moment où M. Flaubert donne le dernier coup de pinceau.
« Le drap se creusait depuis ses seins jusqu’à ses genoux, se relevant ensuite à la pointe des orteils. »
Voilà la scène de la mort. Je l’ai abrégée, je l’ai groupée en quelque sorte. C’est à vous de juger, et d’apprécier si c’est là le mélange du sacré au profane, ou si ce ne serait pas plutôt le mélange du sacré au voluptueux.
J’ai raconté le roman, je l’ai incriminé ensuite et, permettez-moi de le dire, le genre que M. Flaubert cultive, celui qu’il réalise sans les ménagements de l’art, mais avec toutes les ressources de l’art, c’est le genre descriptif, la peinture réaliste. Voyez jusqu’à quelle limite il arrive. Dernièrement un numéro de l’Artiste me tombait sous la main ; il ne s’agit pas d’incriminer l’Artiste, mais de savoir quel est le genre de M. Flaubert, et je vous demande la permission de vous citer quelques lignes de l’écrit qui n’engagent en rien l’écrit poursuivi contre M. Flaubert, et j’y voyais à quel degré M. Flaubert excelle dans la peinture ; il aime à peindre les tentations, surtout les tentations auxquelles a succombé madame Bovary. Eh bien, je trouve un modèle du genre dans les quelques lignes qui suivent de l’Artiste du mois de janvier, signées Gustave Flaubert, sur la tentation de saint Antoine. Mon Dieu ! c’est un sujet sur lequel on peut dire beaucoup de choses, mais je ne crois pas qu’il soit possible de donner plus de vivacité à l’image, plus de trait à la peinture. Apollinaire à saint Antoine : — « Est-ce la science ? Est-ce la gloire ? Veux-tu rafraîchir tes yeux sur des jasmins humides ? Veux-tu sentir ton corps s’enfoncer comme dans une onde dans la chair douce des femmes pâmées ? »
Eh bien ! c’est la même couleur, la même énergie de pinceau, la même vivacité d’expressions !
Il faut se résumer. J’ai analysé le livre, j’ai raconté, sans oublier une page. J’ai incriminé ensuite, c’était la seconde partie de ma tâche : j’ai précisé quelques portraits, j’ai montré madame Bovary au repos, vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de ceux qu’elle ne devait pas tenter, et je vous ai fait toucher les couleurs lascives de ce portrait ! Puis, j’ai analysé quelques grandes scènes : la chute avec Rodolphe, la transition religieuse, les amours avec Léon, la scène de la mort, et dans toutes j’ai trouvé le double délit d’offense à la morale publique et à la religion.
Je n’ai besoin que de deux scènes : l’outrage à la morale, est-ce que vous ne le verrez pas dans la chute avec Rodolphe ? Est-ce que vous ne le verrez pas dans cette glorification de l’adultère ? Est-ce que vous ne le verrez pas surtout dans ce qui se passe avec Léon ? Et puis, l’outrage à la morale religieuse, je le trouve dans le trait sur la confession, p. 30 de la 1re livraison, n° du 1er octobre, dans la transition religieuse, p. 854 et 550 du 15 novembre, et enfin dans la dernière scène de la mort.
Vous avez devant vous, messieurs, trois inculpés : M. Flaubert, l’auteur du livre, M. Pichat qui l’a accueilli et M. Pillet qui l’a imprimé. En cette matière, il n’y a pas de délit sans publicité, et tous ceux qui ont concouru à la publicité doivent être également atteints. Mais nous nous hâtons de le dire, le gérant de la Revue et l’imprimeur ne sont qu’en seconde ligne. Le principal prévenu, c’est l’auteur, c’est M. Flaubert, M. Flaubert qui, averti par la note de la rédaction, proteste contre la suppression qui est faite à son œuvre. Après lui, vient au second rang M. Laurent Pichat, auquel vous demanderez compte non de cette suppression qu’il a faite, mais de celles qu’il aurait dû faire, et enfin vient en dernière ligne l’imprimeur qui est une sentinelle avancée contre le scandale. M. Pillet, d’ailleurs, est un homme honorable contre lequel je n’ai rien à dire. Nous ne vous demandons qu’une chose, de lui appliquer la loi. Les imprimeurs doivent lire ; quand ils n’ont pas lu ou fait lire, c’est à leurs risques et périls qu’ils impriment. Les imprimeurs ne sont pas des machines ; ils ont un privilège, ils prêtent serment, ils sont dans une situation spéciale, ils sont responsables. Encore une fois ils sont, si vous me permettez l’expression, comme des sentinelles avancées ; s’ils laissent passer le délit, c’est comme s’ils laissaient passer l’ennemi. Atténuez la peine autant que vous voudrez vis-à-vis de Pillet ; soyez même indulgents vis-à-vis du gérant de la Revue ; — quant à Flaubert, le principal coupable, c’est à lui que vous devez réserver vos sévérités !
Ma tâche remplie, il faut attendre les objections ou les prévenir. On nous dira comme objection générale : mais après tout, le roman est moral au fond, puisque l’adultère est puni ?
À cette objection, deux réponses : je suppose l’œuvre morale, par hypothèse, une conclusion morale ne pourrait pas amnistier les détails lascifs qui peuvent s’y trouver. Et puis je dis : l’œuvre au fond n’est pas morale.
Je dis, messieurs, que des détails lascifs ne peuvent pas être couverts par une conclusion morale, sinon on pourrait raconter toutes les orgies imaginables, décrire toutes les turpitudes d’une femme publique, en la faisant mourir sur un grabat à l’hôpital. Il serait permis d’étudier et de montrer toutes ses poses lascives ! Ce serait aller contre toutes les règles du bon sens. Ce serait placer le poison à la portée de tous et le remède à la portée d’un bien petit nombre, s’il y avait un remède. Qui est-ce qui lit le roman de M. Flaubert ? Sont-ce des hommes qui s’occupent d’économie politique ou sociale ? Non ! Les pages légères de Madame Bovarytombent en des mains plus légères, dans des mains de jeunes filles, quelquefois de femmes mariées. Eh bien ! lorsque l’imagination aura été séduite, lorsque cette séduction sera descendue jusqu’au cœur, lorsque le cœur aura parlé aux sens, est-ce que vous croyez qu’un raisonnement bien froid sera bien fort contre cette séduction des sens et du sentiment ? Et puis, il ne faut pas que l’homme se drape trop dans sa force et sa vertu, l’homme porte les instincts d’en bas et les idées d’en haut, et, chez tous, la vertu n’est que la conséquence d’un effort, bien souvent pénible. Les peintures lascives ont généralement plus d’influence que les froids raisonnements. Voilà ce que je réponds à cette théorie, voilà ma première réponse, mais j’en ai une seconde
Je soutiens que le roman de Madame Bovary, envisagé au point de vue philosophique, n’est point moral. Sans doute madame Bovary meurt empoisonnée ; elle a beaucoup souffert, c’est vrai ; mais elle meurt à son heure et à son jour, mais elle meurt, non parce qu’elle est adultère, mais parce qu’elle l’a voulu ; elle meurt dans tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté ; elle meurt après avoir eu deux amants, laissant un mari qui l’aime, qui l’adore, qui trouvera le portrait de Rodolphe, qui trouvera ses lettres et celles de Léon, qui lira les lettres d’une femme deux fois adultère, et qui, après cela, l’aimera encore davantage au-delà du tombeau. Qui peut condamner cette femme dans le livre ? Personne. Telle est la conclusion. Il n’y a pas dans le livre un personnage qui puisse la condamner. Si vous y trouvez un personnage sage, si vous y trouvez un seul principe en vertu duquel l’adultère soit stigmatisé, j’ai tort. Donc, si dans tout le livre, il n’y a pas un personnage qui puisse lui faire courber la tête, s’il n’y a pas une idée, une ligne en vertu de laquelle l’adultère soit flétri, c’est moi qui ai raison, le livre est immoral !
Serait-ce au nom de l’honneur conjugal que le livre serait condamné ? Mais l’honneur conjugal est représenté par un mari béat, qui, après la mort de sa femme, rencontrant Rodolphe, cherche sur le visage de l’amant les traits de la femme qu’il aime (liv. du 15 décembre, p. 289). Je vous le demande, est ce au nom de l’honneur conjugal que vous pouvez stigmatiser cette femme, quand il n’y a pas dans le livre un seul mot où le mari ne s’incline devant l’adultère.
Serait-ce au nom de l’opinion publique ? Mais l’opinion publique est personnifiée dans un être grotesque, dans le pharmacien Homais, entouré de personnages ridicules que cette femme domine.
Le condamnerez-vous au nom du sentiment religieux ? Mais ce sentiment, vous l’avez personnifié dans le curé Bournisien, prêtre à peu près aussi grotesque que le pharmacien, ne croyant qu’aux souffrances physiques, jamais aux souffrances morales, à peu près matérialiste.
Le condamnerez-vous au nom de la conscience de l’auteur ? Je ne sais pas ce que pense la conscience de l’auteur ; mais, dans son chapitre X, le seul philosophique de l’œuvre, livr. du 15 décembre, je lis la phrase suivante :
« Il y a toujours après la mort de quelqu’un comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. »
Ce n’est pas un cri d’incrédulité, mais c’est du moins un cri de scepticisme. Sans doute il est difficile de le comprendre et d’y croire, mais enfin pourquoi cette stupéfaction qui se manifeste à la mort ? Pourquoi ? Parce que cette survenue est quelque chose qui est un mystère, parce qu’il est difficile de le comprendre et de le juger, mais il faut s’y résigner. Et moi je dis que si la mort est la survenue du néant, que si le mari béat sent croître son amour en apprenant les adultères de sa femme, que si l’opinion est représentée par des êtres grotesques, que si le sentiment religieux est représenté par un prêtre ridicule, une seule personne a raison, règne, domine : c’est Emma Bovary. Messaline a raison contre Juvénal.
Voilà la conclusion philosophique du livre, tirée non par l’auteur, mais par un homme qui réfléchit et approfondit les choses, par un homme qui a cherché dans le livre un personnage qui pût dominer cette femme. Il n’y en a pas. Le seul personnage qui y domine, c’est madame Bovary. Il faut donc chercher ailleurs que dans le livre, il faut chercher dans cette morale chrétienne qui est le fond des civilisations modernes. Pour cette morale, tout s’explique et s’éclaircit.
En son nom l’adultère est stigmatisé, condamné, non pas parce que c’est une imprudence qui expose à des désillusions et à des regrets, mais parce que c’est un crime pour la famille. Vous stigmatisez et vous condamnez le suicide, non pas parce que c’est une folie, le fou n’est pas responsable, non pas parce que c’est une lâcheté, il demande quelquefois un certain courage physique, mais parce qu’il est le mépris du devoir dans la vie qui s’achève, et le cri de l’incrédulité dans la vie qui commence.
Cette morale stigmatise la littérature réaliste, non pas parce qu’elle peint les passions : la haine, la vengeance, l’amour ; le monde ne vit que là-dessus, et l’art doit les peindre ; mais quand elle les peint sans frein, sans mesure. L’art sans règle n’est plus l’art ; c’est comme une femme qui quitterait tout vêtement. Imposer à l’art l’unique règle de la décence publique, ce n’est pas l’asservir, mais l’honorer. On ne grandit qu’avec une règle. Voilà, messieurs, les principes que nous professons, voilà une doctrine que nous défendons avec conscience.