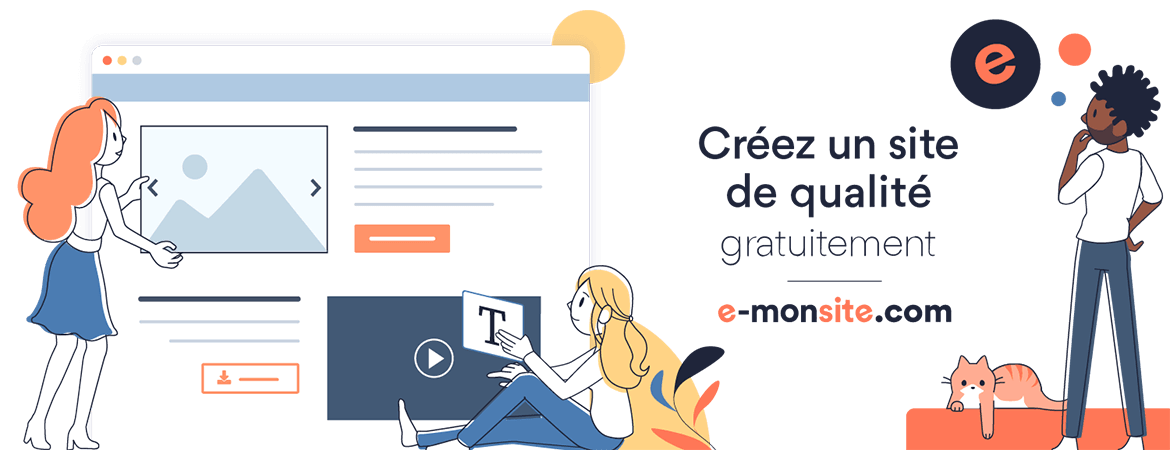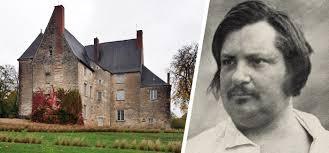-
-
- ___________
Collection : L'écrivain
Auteur / Intervenant : Honoré de Balzac
Date : 5 octobre 1831
Matériaux et techniques : Encre noire sur vélin filigrané
Dimensions : 21,6 x 27,7 cm
Localisation : Réserve
_____________
Madame
[...] je fis, pour développer mes pensées et les jeter dans les âmes jeunes par de frappants tableaux, les scènes de la vie privée. Dans cet ouvrage, tout de morale et de sages conseils, rien n'est détruit, rien n'est attaqué, je respecte les croyances auxquelles je n'ai pas foi. Je suis historien, et jamais la vertu ne fut plus préconisée que dans ces scènes.
Henriette Maillé de La Tour-Landry (1796-1861), épouse séparée du marquis de Castries, entretint une liaison publique avec le prince Victor de Metternich (1803-1829) dont elle eut un fils. Après la mort de son amant, elle tint salon à Paris et reçut des gens de lettres parmi lesquels Balzac, amené par le duc de Fitz-James, oncle d'Henriette. Honoré multiplie les visites, s'éprend rapidement de la marquise et devient alors légitimiste. Après avoir sans succès tenté de séduite Zulma Carraud, il rejoint madame de Castries à Aix-les-Bains mais ses assuidités restent vaines et l'écrivain frustré retourne en France se faire consoler par madame de Berny.
La Duchesse de Langeais met en scène Antoinette de Langeais, aristocrate parisienne qui s'amuse à affoler le général de Montriveau, tout en se refusant à lui. Madame de Castries a évidemment servi de modèle pour Antoinette, et la frustration de Montriveau reproduit sans doute celle de Balzac qui fustige la froideur, l'insensibilité et la coquetterie de la duchesse de Langeais.
Cette vengeance littéraire n'empêche pas la poursuite de relations amicales. Balzac dédie à Henriette L'Illustre Gaudissart en 1843, et elle le reçoit très régulièrement chez elle jusqu'en 1848.
_______________________
Main de Balzac en bronze?
-

- ___________________________
-


___________________
Collection : L'écrivain
Date : 1850
Matériaux et techniques : bronze
Dimensions : 22,8 x 11,5 x 4,5 cm
Localisation : Épreuves corrigées
"Ses mains étaient magnifiques", se souvient la baronne de Pommereul, amie d'une soeur de Balzac.
La maladie dont mourut Balzac ne permit pas la prise d'empreinte de son visage,
comme il était coutume de le faire à la mort des grands hommes.
Le mouleur ne put intervenir que sur la main.
_________________________________________
Portrait de Madame Hanska

- ________________________

_______________________
Collection : L'écrivain
Auteur / Intervenant : Jean Gigoux
Matériaux et techniques : Huile sur toile
Dimensions : 55 x 46 cm
Localisation : Relations familiales et professionnelles
_______________________
Née en 1805 ou 1826, Eveline Rzewuski, future madame Hanska, appartient donc à une noble famille polonaise et parle donc français. Elle épous Vanceslas Hanski vers 1825. Sa découverte de Balzac est d'abord livresque. Elle lui adresse en mars 1832 une première lettre d'Odessa signée "l'étrangère", début d'une ample correspondance qui dure jusqu'en 1848. Genève en 1833, Vienne en 1835 accueillent de brèves rencontres et à la mort de monsieur Hanski, en 1841, Balzac espère épouser son "louploup chéri". Mais celle-ci, alarmée par les dettes perpétuelles et le bruit des aventures sentimentales de son amant, envisage alors de rompre. Réconciliés, ils sillonnent l'Europe et Ève accepte enfin de devenir madame de Balzac le 14 mars 1850. Cinq mois plus tard, l'écrivain revenu en France meurt dans son hôtel parisien. Il reste de cette belle et tragique histoire plus de quatre-cents lettres de Balzac - celles de madame Hanska ont été détruites - qui constituent un pan essentiel de son oeuvre littéraire, à la fois roman d'amour, autobiographie, chronique de la vie littéraire et artistique, et commentaire irremplaçable de La Comédie humaine.
__________________________________
Honoré de Balzac par Dantan
-
-

- ____________________________

______________________________
Collection : L'écrivain
Auteur / Intervenant : Jean-Pierre Dantan
Date : 1835
Matériaux et techniques : Plâtre teinté
Dimensions : 34 cm
Localisation : Portraits de Balzac d'hier à aujourd'hui
___________________________
Dès 1831, Jean-Pierre Dantan se fait connaître grâce à l’exécution d’une caricature sculptée du peintre Cicéri. Il décide alors d’éditer et de commercialiser auprès du public les charges de personnalités célèbres, et Balzac fait l’objet de deux statuettes éditées en 1835. Celle-ci le représente rond, joufflu, la tête à demi rasée, une dentition imparfaite révélée par un grand sourire, avec son chapeau et son immense canne. Contrairement à la plupart des réalisations de Dantan, le socle ne présente pas le nom sous forme de rébus mais porte des attributs de l’écrivain ; la canne, le chapeau, la chevelure et les ciseaux. Dantan semble anticiper la décision de Balzac de couper ses longs cheveux, comme l’explique le texte accompagnant cette caricature dans l’album Musée Dantan, publié en 1838 : « nous prévenons les femmes de trente ans et au-dessus qu’après l’apparition de sa charge, Balzac, pour se rendre méconnaissable, s’est fait couper sa longue chevelure ; mais hélas ! peine inutile, le grand homme ne réfléchissait pas que son ventre trahirait son incognito. » L’autre statuette figure Balzac sous la forme d’une canne, son visage en guise de pommeau.
Comme la plupart des modèles, Balzac est dans un premier temps flatté de ces caricatures qui attestent sa célébrité et en parle en termes amusés « Ils me prennent au sérieux, si bien que Dantan a fait ma charge. La voulez-vous ? Je vous l’enverrai avec le manuscrit de Séraphîta et tous les volumes que j’ai à vous envoyer. » Et il ajoute qu’il mettra « dans l’envoi du 17 avril, mes deux charges en plâtre par Dantan qui a caricaturé tous les grands hommes. Le sujet principal de la charge est cette fameuse canne à ébullition de turquoises, à pomme ciselée, qui a plus de succès en France que toutes mes œuvres. Quant à moi, il m’a chargé sur ma grosseur. J’ai l’air de Louis XVIII. Ces deux charges ont eu un tel succès que je n’ai pas pu encore m’en procurer. »
Un an plus tard cependant, associant la caricature qui déforme la silhouette à la contrefaçon de l’œuvre, Balzac décrie cette « mauvaise charge » de Dantan et « l’horrible lithographie » qu’elle a inspirée.
Il est significatif qu’en 1836 – un an après le retentissant procès qu’il intente pour la protection du droit moral sur son œuvre – Balzac décide de se faire portraiturer par le peintre Louis Boulanger, alors qu’en 1833 il avait refusé au peintre Gérard l’autorisation de faire son portrait, alléguant qu’il n’était « pas un assez beau poisson pour être mis à l’huile ». L’écrivain a pris conscience que son image et celle de son œuvre étaient indissociables, et que les caricatures contribuaient aussi à déformer la perception de ses romans.
________________________________________
Musée littéraire, la Maison de Balzac a développé dès sa création une importante collection d'imprimés conservée à la bibliothèque. Celle-ci donne aujourd'hui accès à plus de 23.000 monographies et périodiques ainsi qu'à de nombreux dossiers documentaires et fonds d'archives. Ces collections, centrées sur l'oeuvre d'Honoré de Balzac et de Théophile Gautier, concernent aussi leur environnement social, littéraire ou artistique.
La bibliothèque s’adresse à toute personne (amateur, chercheur, étudiant, quel que soit son niveau d’études) intéressée par ces collections. Pour y accéder, le lecteur traverse l'ancien appartement de Balzac situé en rez-de-jardin, puis descend deux étages. Installée à l'arrière de l'édifice, la bibliothèque est contigüe à la rue Berton, charmante enclave du XVIIIe siècle.
Le fonds patrimonial rassemble autour de cinq grands pôles un ensemble sans équivalent de documents précieux régulièrement exposés : publications illustrées essentiellement, mais aussi ouvrages portant dédicace, reliures d'époque, éditions uniques ou rares...
Constitué autour des éditions d'Honoré de Balzac, puis de celles de Théophile Gautier, le fonds a été enrichi de nombreuses publications du 19e siècle essentielles à la compréhension des deux écrivains, qui ont multiplié les expériences dans le domaine de l'édition ou du journalisme et se sont montrés particulièrement attentifs au principe de "fraternité des arts" alors en vogue.
Balzac travaille à l'organisation de son œuvre à l'époque où il occupe l'appartement du rez-de-jardin. La Maison de Balzac s'efforce de conserver l'intégralité de ce monument littéraire : les éditions originales en premier lieu, mais aussi toutes celles, y compris contemporaines, à caractère rare ou précieux.
Parmi ces éditions figurent les œuvres de jeunesse (publiées sous pseudonymes), les pièces de théâtre (que Balzac rédige seul ou en collaboration), ainsi que les adaptations théâtrales auxquelles ses romans ont donné lieu. La bibliothèque conserve aussi plusieurs préfaçons ou contrefaçons belges, contre lesquelles Balzac, membre fondateur de la Société des Gens de Lettres, s'est insurgé au nom du respect du droit d'auteur.
Le fonds patrimonial comprend également de nombreuses éditions illustrées, auxquelles l'écrivain porte un intérêt particulier : grâce à sa fréquentation du milieu journalistique, Balzac connaît personnellement plusieurs dessinateurs parmi les plus doués de son temps et leur commande des "vignettes" destinées à illustrer son œuvre, contribuant ainsi à lancer la carrière de plusieurs artistes de renom. La première édition de ses œuvres complètes, l'édition Furne (1842-1848), est ainsi ornée de planches dues aux meilleurs crayons de l'époque. De 1852 à 1856 paraît l'édition Marescq, publication populaire illustrée de plus de 200 gravures sur bois originales ou empruntées aux éditions antérieures. Avec l'édition Conard publiée au début du XXe siècle, Charles Huard renouvelle l'iconographie de façon significative, avant l'avènement des éditions modernes, dont l'illustration est moins littérale.
A partir de 1825, Balzac se lance dans diverses entreprises d’édition, d’imprimerie et de fonderie de caractères. Ces tentatives de pallier l’insuccès de ses premiers textes littéraires se solderont par un échec : en 1828, il a 60.000 francs de dettes et décide d'interrompre son activité d'"homme de lettres de plomb", selon son expression, pour se consacrer à l'écriture. La production de Balzac imprimeur s’élève à plus de 300 pièces, dont certaines sont devenues rarissimes, allant du prospectus pour les "pilules antiglaireuses de longue vie" aux treize volumes des Oeuvres complètes de Shakespeare. La majeure partie de ces documents variés, parfois illustrés, est représentée dans le fonds des "impressions de Balzac" de la bibliothèque.
Cette courte mais intense expérience de Balzac dans les métiers du livre se retrouve aussi bien dans son œuvre (notamment dans Illusions perdues) que dans l'intérêt constant de l'écrivain pour la présentation matérielle des ouvrages, qu'il s'agisse de l'illustration ou de la reliure. Balzac apprécie les beaux livres et, comme nombre d'amateurs alors, fait relier les ouvrages de sa bibliothèque par des artisans experts. Quelques volumes de sa collection personnelle sont conservés à la Maison de Balzac, dont certains sont annotés ou dédicacés de sa main.
L'intérêt de Balzac pour l'objet-livre figure aussi de façon originale dans l'attention portée à la typographie, et particulièrement par le choix qu'il fit, lors de l'édition de la Physiologie du mariage, de brouiller les caractères de deux pages devenues ainsi illisibles.

__________
Collection : Balzac et le livre
Auteur / Intervenant : Honoré de Balzac
Date : 1826
Localisation : Bibliothèque
______________
L'édition pré-originale de la Physiologie du mariage occupe une place singulière dans l'oeuvre de Balzac. Non édité sous cette forme - inachevée -, cet ouvrage unique, issu de la collection personnelle de l’écrivain, est le seul des textes de Balzac imprimé sur ses presses. L'intérêt particulier de l'écrivain pour le papier se vérifie à la fois par la qualité des matériaux utilisés que par la présence de pages de gardes en papier décoré et de tranches marbrées.
Balzac a fait relier son ouvrage avec soin, avec un texte de son père auquel il rend ainsi hommage. La couvrure de ce volume, constituée d’un beau maroquin rouge, est typique des reliures dont Balzac fait recouvrir les ouvrages de sa bibliothèque. Le décor doré, présent jusque sur les chants des deux plats, en accentue le raffinement et témoigne de l’attrait de l'écrivain pour l’ensemble des arts du livre.
La Physiologie du mariage marque aussi une étape importante dans la carrière de l'écrivain. A la charnière des romans de jeunesse et des « Scènes de la vie privée », elle représente le passage, provisoire, d'une écriture romanesque à une écriture analytique, dans le prolongement et le dépassement d'ouvrages alors à la mode : les Arts et les Codes.

______________



__________
Collection : Balzac et le livre
Auteur / Intervenant : Honoré de Balzac
Date : 1828
Localisation : Bibliothèque
__________
L’insuccès de ses premières œuvres (publiées sous pseudonymes) incite le jeune Balzac à tenter de faire carrière dans les métiers du livre. D’abord associé à Urbain Canel en tant qu’éditeur, il rachète une imprimerie puis une fonderie de caractères dans l'espoir de maîtriser toutes les étapes (donc les coûts) de fabrication d’un livre. Malgré l’ardeur au travail (Balzac imprimera plus de trois cents textes de toute nature entre avril 1826 et août 1828), il est criblé de dettes et doit céder ses parts à son associé, le typographe Jean-François Laurent, et à sa maîtresse Mme de Berny, qui lui avait procuré la mise de fonds initiale. Le fils de la "Dilecta", Alexandre de Berny, réussit à faire fructifier l’entreprise qui devient l’une des fonderies les plus réputées de France (elle s'associera notamment, au début du XXe siècle, avec les typographes Peignot), dont l'activité perdurera jusqu’en 1974.
Le Spécimen des divers caractères, vignettes et ornemens typographiques de la fonderie de Laurent et de Berny a paru en juin 1828 après que Balzac a abandonné l’affaire, ce qui explique que son nom ne soit mentionné qu’en tant qu’imprimeur. En fait, Balzac participe à la conception entière du catalogue commencée en décembre 1827, suite au rachat du fonds de la célèbre fonderie de caractères Gillé. A côté des ornements créés par Achille Deveria, Henry Monnier ou Tony Johannot (artistes que Balzac connaît grâce à sa fréquentation du milieu journalistique) figurent ainsi plusieurs motifs typiques du XVIIIe siècle.
Ce catalogue (dont la Maison de Balzac possède l’un des rares exemplaires dont la couverture ait été conservée, ornée d’une vignette dessinée par Henry Monnier) témoigne de la variété du matériel typographique possédé par Balzac. Il permet de connaître non seulement les goûts, mais aussi l'ampleur des connaissances techniques que l'écrivain a acquises en tant qu'"homme de lettres de plomb", comme il se plaît alors à se présenter.
___________________

________________
Collection : Balzac et le livre
Auteur / Intervenant : Honoré de Balzac
Date : 1838
Localisation : Bibliothèque
____________
e roman La Peau de chagrin a été illustré dès sa première parution en volumes, publiés chez Urbain Canel en 1831 avec des frontispices de Tony Johannot. C’est cependant l’édition parue en 1838 chez Delloye et Lecou dans l’éphémère collection « Balzac illustré », imaginée par l’écrivain lui-même, qui constitue le témoignage tangible de l'intérêt et des préférences de Balzac en matière d'illustration.
Les principes de cette illustration sont multiples. Outre la fidélité au texte, à laquelle Balzac attache une grande importance, les images se caractérisent par leur omniprésence. Le roman est illustré de plus de cent "vignettes" gravées sur acier d'après des artistes sélectionnés par Balzac lui-même, parmi lesquels Gavarni, Janet-Lange, Français et Marckl. L'écrivain donnait des indications précises sur les images souhaitées, révélant son goût pour la diversité aussi bien dans les sujets représentés (portraits de groupe ou de personnage isolé, décors, scènes du roman, symboles et figures allégoriques), que dans leur emplacement : bandeau, cul-de-lampe, fleuron, lettrine et illustration de couverture. Seules les rééditions de l'ouvrage, auxquelles Balzac n'a pas participé, comprennent quelques planches hors-texte reprenant certains des portraits insérés entre les paragraphes.
De fait, Balzac n'envisage pas l'image indépendamment du texte, comme en témoigne l'absence de contour des vignettes. L'écrivain la considère au contraire comme consubstantielle à la page typographique, suivant en cela le principe de "fusion des arts" en vogue à l'époque romantique. Placée en exergue au roman, la ligne serpentine (dérivée du moulinet tracé par le héros de Vie et opinions de Tristram Shandy de Laurence Sterne) souligne cette parenté du texte et de l'image. De même, l'inscription figurant sur la peau-talisman est savamment mise en page dans le cours du texte. Balzac, qui fut un temps fondeur de caractères typographiques, est à ce point sensible aux formes visuelles de l'écriture qu'il leur attribue l'origine même de la révision de son texte :
« Le texte de l’édition illustrée est revu avec tant de soin, qu’il faut le regarder comme le seul existant, tant il diffère des éditions précédentes ; cette solennité typographique a réagi sur la phrase, et j’ai découvert bien des fautes et des sottises, en sorte que je désire bien vivement que le nombre des souscripteurs permette de continuer cette publication, qui me donnera l’occasion d’arriver à ce que je puis de mieux pour mon ouvrage comme pureté de langage » (Lettre à Mme Hanska du 20 janvier 1838).
La Maison de Balzac possède deux exemplaires de valeur de cette édition. Le premier a gardé sa couverture illustrée "à la cathédrale" et reprend les motifs de l'architecture gothique, redécouverte à l'époque romantique. Le second est l'exemplaire de Zulma Carraud, fidèle amie de Balzac, relié de maroquin rouge au chiffre de sa propriétaire et dédicacé de la main de l'auteur.
_____________________________________
notice du catalogue de la bibliothèque
voir l'exemplaire numérisé de la BnF
notices iconographiques des illustrations
présentation de l'oeuvre dans l'édition critique en ligne de La Comédie humaine
________________________________