Artisanat

Assiettes en faïence de Quimper
Fortuné PELLICANO
La faïence de Quimper. La faïence est désormais aussi emblématique de Quimper que la cathédrale Saint-Corentin, les ponts de l'Odet ou la crêpe dentelle ! A l'époque gallo-romaine, un village de potier métamorphosait l'argile de l'anse de Toulven en objets d'usage quotidien, du côté de Locmaria. Mais c'est vers la fin du XVIIe siècle que la faïence fait son apparition dans la capitale de la Cornouaille, lorsqu'un certain Jean-Baptiste Bousquet, en 1690, s'installe à Locmaria pour y apporter un savoir-faire appris dans les deux importants centres provençaux de Moustiers et Marseille.
Dès la seconde moitié du siècle suivant se répandent dans l'univers de la faïence quimpéroise les fameux poncifs " bretons " qui feront sa renommée internationale : le petit Breton en costume glazik et bragoù braz et sa compagne portant fièrement la coiffe de Quimper ! Sous la direction artistique du morlaisien Alfred Beau, à une époque où la Bretagne apparaît aux ethnologues comme une contrée aussi exotique que la Pampa argentine, les décors inspirés des gravures d'Oliver Perrin connaissent un succès qui ne se démentira pas. Ainsi, dès 1864, les jeunes établissements Henriot, surfant sur cette vague identitaire, créent des motifs inspirés des travaux du peintre Lalaisse,
qui a publié quelques années auparavant de riches études dédiées aux costumes bretons. Ils embauchent ensuite des artistes d'envergure comme le peintre Mathurin Méheut, le sculpteur Armel Beaufils, les artistes Robert Micheau-Vernez, Jim Sévellec ou encore René-Yves Creston, l'un des membres éminents de l'école des Seiz Breur. La période de l'entre-deux guerres, avec ses désirs récurrents d'associer étroitement la tradition la plus enracinée à la modernité la plus échevelée, est l'une des plus exaltantes et créatrices de la faïence quimpéroise.
C'est celle où Paul Fouillen, ancien chef d'atelier chez HB (Hubaudière-Bousquet), s'installe à son compte, place du Stivell, pour créer des pièces inspirées des enluminures irlandaises et des broderies bretonnes.
L'après-guerre porte un rude coup à l'univers de la faïence quimpéroise, frappé de plein fouet par la concurrence des produits bon marché. Plusieurs entreprises doivent déposer le bilan au cours des Trente Glorieuses, qui semblent inaugurer le purgatoire de l'artisanat.
En 1968, HB rachète Henriot, au bord de la faillite. Le répit sera d'assez courte durée car, en 1983, elle n'évite malheureusement pas le dépôt de bilan. Le repreneur, Paul Janssens, un riche américain d'origine néerlandaise qui commercialise déjà le " Quimper " aux États-Unis depuis des années, entend restaurer une image de qualité de la faïence entièrement peinte à la main par des ouvriers qui tiennent plus de l'artisan et de l'artiste que du simple exécutant. Décidant de vendre ses pièces dans un circuit de magasins spécialisés haut de gamme, il permet à l'entreprise tricentenaire de redresser la barre et de passer d'une cinquantaine de salariés en 1984 à 130 dix ans plus tard. En septembre 2003, l'entreprise est rachetée par le Breton Pierre Chiron, qui la ramène ainsi dans le giron régional.
Mais les temps changent et le marché étasunien se trouve d'autres centres d'intérêt. Dans l'hexagone, les goûts évoluent également, tout comme les porte-monnaie. Les services de table décorés à la main par les peintres des bords de l'Odet ne trouvent plus guère de place dans les corbeilles de mariages... C'est pourquoi aujourd'hui, avec un effectif de 51 personnes, l'entreprise délaisse peu à peu ce qui, hier, fit sa renommée : les arts de la table.
Fini les assiettes glazik à dominante bleu et crème, fini aussi les grandes soupières familiales signées et peintes à la main. Place à une toute nouvelle gamme d'objets : des bijoux en faïence, des coeurs et des petits bateaux, ainsi que des lampes élégamment décorées. Et retour en force du célébrissime bol à oreilles et prénom, qui s'est offert une cure de jouvence en gris très chic ! Si l'on a cru cette belle entreprise du patrimoine breton une nouvelle fois menacée en 2011, c'était sans compter sur son rachat par Jean-Pierre Le Goff, qui a de beaux projets. Tout n'est pas finit pour la faïence !
Les bijoux. La plupart des bijouteries de Bretagne proposent un choix plus ou moins important de bijoux bretons, généralement en argent massif, parfois en or. Les thèmes bretons et celtiques côtoient des inspirations plus abstraites. On ne peut, en vérité, parler de tradition séculaire de la joaillerie en Bretagne. Le phénomène en tant que style est bien plus récent. Sans doute est-il né avec la marque Kelt, qui, en 1935, décida de développer une gamme de bijoux d'inspiration artistique bretonne, avec l'aide d'artistes tels que René-Yves Creston et Pierre Peron, membres du mouvement Seiz Breur.
Musique – Danses
Si la Bretagne est un pays de musique et de danse, le Kreiz Breizh, appellation donnée à son centre et plus précisément à la région de Carhaix, fait tout particulièrement honneur à ce duo. C'est en effet dans le Poher que se situe le berceau de la danse chantée, le kan an diskan (chant et contre-chant, en breton). Et ce n'est pas un hasard si Carhaix est devenu le symbole de cette Bretagne festive, le lieu incontournable d'un festival tout aussi incontournable...
Les bombardes et binious ne sont toutefois pas plus autochtones que la harpe. Les Bretons se sont en effet appropriés ces instruments empruntés à des contrées lointaines : vraisemblablement à la Mésopotamie pour la harpe, au bassin méditerranéen pour le biniou et au Moyen Orient pour la bombarde. Et c'est le couple bombarde-biniou (biniaouer-talabarder, en breton) qui est devenu emblématique de la musique bretonne et même, dans une certaine mesure, de la Bretagne ! Un troisième instrument s'ajoute à ce duo vedette : le tambour.
C'est avec ce dernier que fut formé " l'Orchestre National Breton ", nommé ainsi par Alexandre Bouët dans sa Galerie Bretonne, puis adoubé par Roland Becker. Des instruments " nouveaux " font au fil du temps leur apparition dans toute la Bretagne, comme l'accordéon, surnommé boest an diaoul (la boîte du diable), et la clarinette, dite treujenn gaol (tronc de choux). Malgré l'intrusion intempestive de ces instruments, auxquels on peut rajouter le violon et la veuze, le couple biniaouer-talabarder se maintient jusqu'à la Première Guerre mondiale. De nouveaux concurrents comme le saxophone, avec l'arrivée du jazz, viennent, durant l'entre-deux guerres, lui porter un coup très rude. Nombre de sonneurs traditionnels rangent alors bombardes et binious.
Les bagadoù. Paradoxalement, c'est de la capitale que vient le renouveau. Et plus précisément du milieu des Bretons de Paris. En 1932, Hervé Le Menn, Dorig Le Voyer et Robert Audic créent, dans l'exil, le Kenvreuriezh ar Viniaouerien (la Confrérie des joueurs de biniou), qui pose les premières bases de cette renaissance. Mais c'est la création par Polig Montjarret, Robert Marie et Dorig Le Voyer de la Bodageg ar Sonerien, en mai 1943 à Rennes, qui est le moteur principal de la formidable résurrection qui s'opère dans les décennies suivantes.
Assurément, ce sont les bagadoù qui ont popularisé la musique bretonne à travers le monde ! Au singulier bagad, le mot a pour racine bag qui, en breton, désigne le bateau. Littéralement, bagadoù désignerait donc une batelée de musiciens. La parenté des bagadoù bretons avec les pipe-bands écossais est des plus évidentes. Cependant, la cornemuse écossaise ne s'implante dans notre région qu'à partir du début du XXe siècle, remplaçant progressivement, mais pas totalement, le vieux biniou breton. Le premier bagad est créé en 1949 par les cheminots de Carhaix.
Le succès est immédiat et, après Carhaix, Quimperlé et Rostrenen se dotent à leur tour de bagadoù. Comme les pipe-bands, ils comportent un pupitre de cornemuses écossaises, un pupitre de caisses claires, écossaises, une grosse caisse ainsi qu'un pupitre de bombardes bretonnes. Cette forme instrumentale est depuis considérée comme la forme traditionnelle du bagad, ce qui fait d'ailleurs débat : une forme instrumentale de cinquante ans peut-elle être considérée comme traditionnelle ? La forme originale du bagad a été plus ou moins modifiée selon les bagadoù :
la majorité de ceux-ci possèdent maintenant des toms, une ou plusieurs lombardes ou trombardes, et certains utilisent même djembés et congas, tandis que d'autres n'hésitent pas à employer synthétiseurs et guitares électriques ! Plusieurs ensembles se sont également associés à des formations de jazz voire de rock et à des ensemble de percussions africaines. Ainsi, le compositeur Didier Ropers a même signé une oeuvre concertante pour bagad et orchestre symphonique. Le répertoire s'est lui aussi élargi au point que, dans certains bagadoù, les airs traditionnels bretons ne servent parfois que de support ou sont délaissés au profit de compositions contemporaines.
Le phénomène fest-noz. Littéralement, fest-noz signifie la fête de nuit. Une fête, oui, et quelle fête ! Communautaire en diable, le fest-noz s'est élevé en quelque quarante ans au rang des véritables institutions de Bretagne. Au point qu'il vient supplanter, dans bon nombre de terroirs de Bretagne, les discothèques ! Des danses claniques, associées à chaque terroir : l'an-dro ou l'hanter-dro chez les Vannetais, la gavotte à la montagne, la dañs fisel ou la dañs plin dans le secteur de Bourbriac. Ici, on se tient fermement par le bras ou par la main, pour des chaînes qui n'ont ni début ni fin mais où tout un peuple se retrouve soudé. La danse des Sioux ou des Arapahos ? Il y a de cela, tant la transe semble parfois au bout de la danse... Le fest-noz est ainsi une tradition immémoriale en Bretagne.
Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était une fête occasionnelle, spontanée, privée et plutôt liée au monde rural. C'est vers la fin des années cinquante que Loeiz Ropars et ses amis du cercle celtique Mesaerien Poullaouen inventent le fest-noz " mod nevez ", qui se déroule en salle et où les chanteurs se retrouvent sur scène équipés d'un micro
. Le succès est immédiat ! On peut même dire fulgurant. Adaptée à l'évolution de la société bretonne, la formule se répand comme une traînée de poudre. Expérimenté à Paris en avril 1957, puis à Poullaouen en décembre de la même année, le fest-noz " mod nevez " est exporté dès 1958 dans les Côtes d'Armor, à Saint-Servais, où les frères Morvan, de Saint-Nicodème, entament une carrière prestigieuse. En 1959, les soeurs Goadec montent pour la première fois sur les planches à Châteauneuf-du-Faou, où elles subjuguent danseurs et auditoire. " Partis du Kreiz Kerné (centre Cornouaille), les festoù-noz gagnent toute la Bretagne ", titre Le Télégramme dans son édition du 14 mars 1961.
Le fest-noz devient en effet très vite le partenaire obligé de tout festival qui se respecte. Et si, durant les seventies, le fest-noz a des allures souvent militantes, ce n'est plus le cas de nos jours. Définitivement passé dans les moeurs, il draine désormais des milliers de garçons et de filles qui n'ont d'autre objectif que de s'amuser et de se défouler au son des bombardes et des binious, de la vieille, de l'accordéon, du violon et même de la harpe ! Pour découvrir cette fête traditionnelle bretonne, ne manquez pas Le Printemps de Châteauneuf à Pâques, La Nuit de la Gavotte à Poullaouën en septembre ou encore La fête des bruyères dans le Cap-Sizun, le deuxième week-end d'août depuis 1961 !
Coiffes et costumes
Les costumes permettent d'identifier les Bretons aussi sûrement que la musique et la langue. Ces fameux costumes bretons remontent au XVIe siècle. Quel pays d'Europe peut s'enorgueillir d'une telle diversité de coupes, de couleurs, d'étoffes, d'une telle abondance de décors et de motifs ? Quant aux coiffes, elles semblent immortaliser les Bretonnes comme s'il s'agissait d'images pieuses, fixées pour l'éternité sur des milliers de boîtes de galettes. Au risque de décevoir, la coiffe a pourtant aujourd'hui quasiment disparue. Portée encore largement dans les années 1970, elle se réduit de nos jours à quelques isolats finistériens, comme la presqu'île de Plougastel et le Pays Bigouden, où quelques mam-goz (grands-mères) font de la résistance. Depuis des années, c'est en effet dans les archives que doivent puiser les costumières des cercles celtiques pour récréer des costumes tel que l'on peut les voir au Musée Départemental Breton de Quimper. Le pluriel est de mise car il n'y a guère ici de costume " régional ". Chaque mode vestimentaire obéit à des lois rigoureuses et correspond à un territoire bien délimité, à un " clan ".
Au féminin. A Quimper, la robe est très ajustée avec une collerette droite et une coiffe en forme de pyramide tronquée, la borledenn. A Pont-Aven, le costume, qui est aussi porté dans tout le sud-est de la Cornouaille, de Fouesnant à Quimperlé et de Pont-Aven au Faouët, est absolument somptueux. La robe est longue avec de larges manches de velours brodé, la collerette tuyautée est très ample et la coiffe est dotée d'anses de dentelles d'où jaillissent des rubans de soie claire. Sur l'île de Sein, les femmes sont toutes de noir vêtues : tablier, robe, châle, de même que leur coiffe aux larges rubans qui pendent dans le dos.
Dans le sud des Monts d'Arrée et dans la région de Châteaulin, la coiffe se réduit à un fin lacet en forme de huit, alors que dans la presqu'île de Plougastel, microcosme où l'esprit de clan est resté vivace, les costumes suivent les saisons et les circonstances : robe noire, tablier rayé et fichu à pois blancs pour les jeunes filles mais bleu quadrillé de blanc pour les femmes mariées, voilà pour la semaine ; pour les jours de fêtes, c'est jupe violette, tablier en soie bleu pâle, verte ou gorge de pigeon, corsage vert à manches retroussées et corselet bleu et orange. La coiffe, qui est toute blanche, est composée de trois coiffes superposées, celle du dessous étant richement brodée. Dans le Poher, les femmes portent le corledenn, un bonnet de résille porté sur l'arrière de la tête. Les jours de fête, les jeunes filles arborent fièrement une sorte de hennin pointu.
Dans le Léon, les femmes portent de longues robes aux teintes douces et d'immenses châles de soie. Robes et châles qui sont particulièrement somptueux dans le Pays Pagan, de l'Aber Wrac'h à Goulven. Quant à la coiffe, ou cornette, elle consiste en un grand hennin de dentelle. Et puis il y a aussi le pays bigouden. Le pays bigouden et sa fameuse coiffe en pain de sucre, qui demande pour sa fixation d'utiliser une technique éprouvée ! Le costume bigouden est sans doute l'un des plus étranges : jupe courte et corsage dégageant bien le cou, avec des ornementations brodées en jaune, orange et rouge, en des motifs géométriques, des cercles et des spirales évoquant des gravures que l'on peut retrouver sur d'anciens monuments mégalithiques ou sur des objets d'orfèvrerie celtiques.
Au masculin. Les costumes d'hommes ne font pas office, et loin s'en faut, de parents pauvres en matière de variété. En principe, l'habillement comporte un gilet croisé, le jiletenn, et une veste droite non boutonnée, la chupenn. Si autrefois le bragou braz (pantalon bouffant) en tissu plissé était de mise, il fut, en grande partie, supplanté par le costume noir. Mais dans le pays Glazik, la région de Quimper, le gilet et la veste sont bleus. Sur la presqu'île de Plougastel, la chupenn est bleue pour les hommes mariés et violette pour les jeunes gens.
Les gilets sont généralement brodés, particulièrement en pays bigouden, mais ils peuvent aussi être plutôt austères, comme dans le Léon (pourpoint noir, plastron empesé, turban bleu nuit à carreaux). Et les chapeaux ? Et bien contrairement à ce qu'affirme la chanson paillarde " Les Bretons ", ces derniers, en dehors de quelques terroirs limités, ne portent pas des chapeaux ronds mais des feutres de formes fort diverses car, bien entendu, chaque " clan " a le sien ! Ces chapeaux sont pour la plupart ornés de rubans de velours - les guildes, d'où l'expression " chapeaux à guildes " - qui retombent dans le dos.
Armor-Lux ou le succès du tricot rayé…
C'est dans le décret du 27 mars 1858 que se situe l'acte de naissance de la marinière. C'est à cette date que le tricot rayé bleu et blanc fit son entrée officielle dans la liste des tenues de matelots de la marine, les marins ayant pour coutume de dire que la rayure permettait de mieux repérer l'homme tombé à la mer. L'entreprise Armor-Lux en a fait un incontournable de la mode et lui a consacré, lors de ses 70 ans d'existence en 2008, un livre retraçant son histoire, "
Eloge de la marinière ", aux éditions Palantines. La marinière rayée 100 % coton d'Armor-Lux reste ainsi tendance année après année, dans des coloris allant du pudique bleu marine au jaune, vert ou rose fluo... Un classique indémodable et régulièrement réactualisé !
... et du pull marin
C'est en Bretagne que le chandail marin trouverait ses origines. A la fin des années 50, s'appuyant sur l'engouement de la France pour la Bretagne et la mer, Armor-Lux lança sa ligne marinière avec son pull marin. C'est le grand succès jusqu'à la fin des années 70. Il s'en vend alors plus de 200 000 chaque année, notamment au Japon, aux États-Unis et au Canada. A la même période, ce vêtement sera adopté par les officiers de surface avant de devenir la tenue de travail des marins.
Sports et jeux traditionnels
Le Gouren, qui désigne la lutte bretonne, est certainement le plus connu des sports bretons. Originaire des pays celtiques, le Gouren fut longtemps un exercice très prisé des guerriers bretons. De cette époque, il a d'ailleurs gardé l'esprit chevaleresque qu'on retrouve aujourd'hui dans le serment prêté par les lutteurs avant chaque compétition. Contrairement à la lutte gréco-romaine, la lutte bretonne se pratique toujours debout, le but étant de déséquilibrer l'adversaire. Les lutteurs portent une ample et forte chemise de toile serrée à la ceinture.
Toute déloyauté et tout coup bas sont rigoureusement interdits. La victoire (lamm) peut être obtenue aux points ou par la chute de l'un des deux adversaires. Aujourd'hui, les jeunes dès 6 ans peuvent pratiquer ce sport. Un championnat national se dispute chaque année, tandis qu'une rencontre internationale réunit une dizaine de nations d'Europe et même d'Afrique. A préciser que le Gouren est avant tout un sport de combat non violent et respectueux de l'adversaire.
Côté jeux, il est difficile de tous les nommer tant ils sont nombreux et attachés à des territoires. Lors de vos visites touristiques, vous en retrouverez certains qui se sont étendus à toute la Bretagne, tels que le palet, la boule bretonne ou encore le jeu de quilles.
.
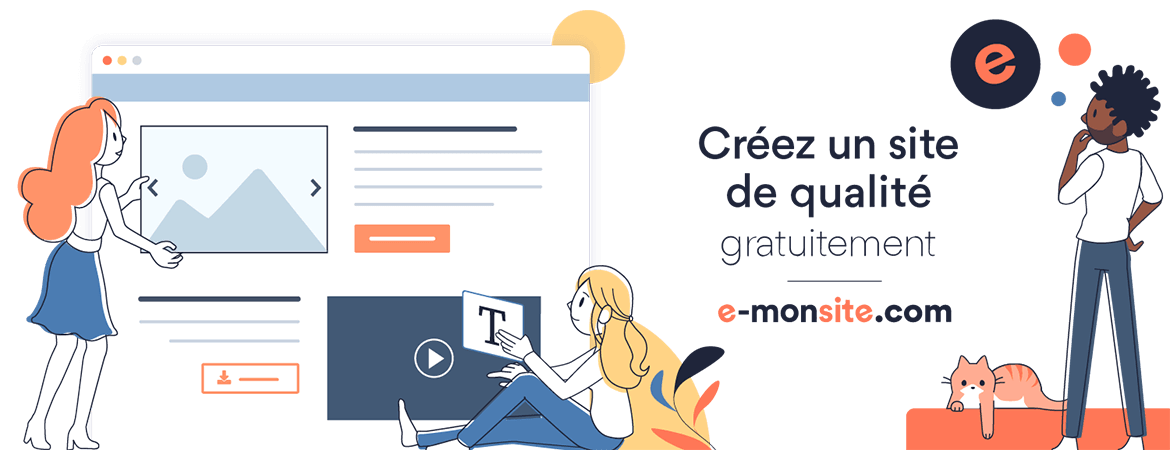
















 _______________________
_______________________













