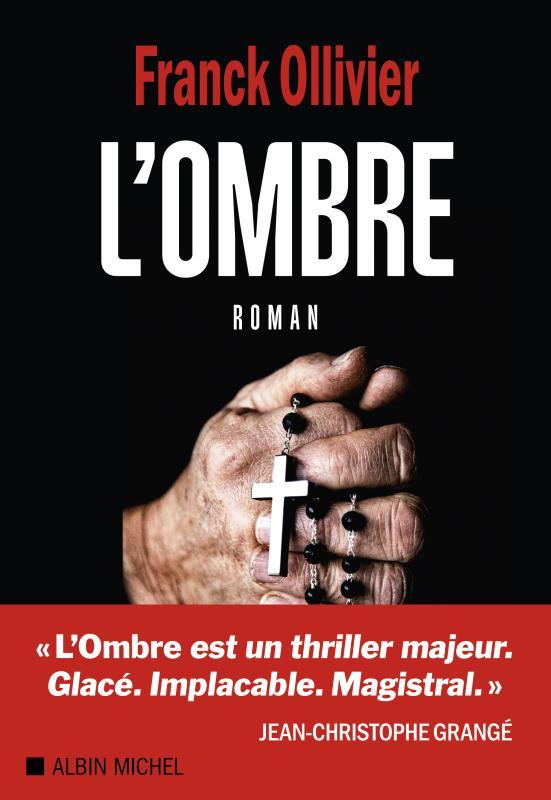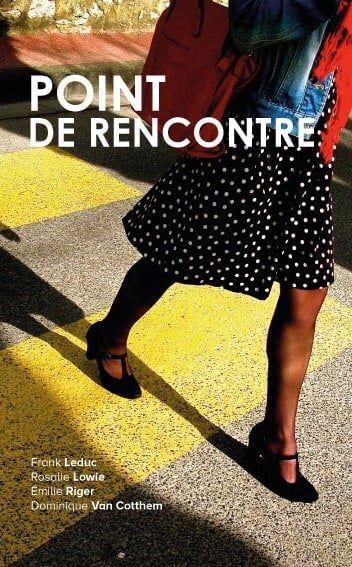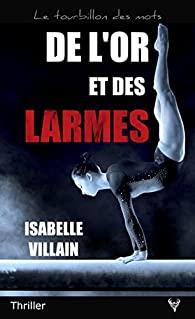Charles Baudelaire les Fleurs du Mal le Procès
______________________
https://www.youtube.com/watch?v=LaAqKNcPlOc
__________________
____________________
Les 137 poèmes des Fleurs du Mal sont regroupés en chapitres eux-mêmes organisés d’une manière stricte : ils évoquent les tentatives du poète pour dépasser sa misérable condition humaine, par l’amour et l’art (ch. 1), l’observation de la société (ch. 2), l’ivresse (ch. 3), le mal (ch. 4), la révolte (ch. 5). Ces tentatives, chaque fois vaines, ne lui laissent d’espoir que dans la mort (ch. 6). Ces poèmes sont d’une forme classique (vers rimés d’une métrique régulière) mais d’un esprit poétique nouveau (les « correspondances ») qui ouvre la voie à ce qu’on appellera par la suite le « symbolisme ».
Les premiers mots :
« BENEDICTION
Lorsque, par un décret des puissances suprêmes,
Le Poète apparaît en ce monde ennuyé,
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié »
____________
La sottise, l’erreur, le péché, la lésine, Occupent nos esprits et travaillent nos corps, Et nous alimentons nos aimables remords, Comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ; Nous nous faisons payer grassement nos aveux, Et nous rentrons gaîment dans le chemin bourbeux, Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches. Sur l’oreiller du mal c’est Satan Trismégiste Qui berce longuement notre esprit enchanté, Et le riche métal de notre volonté Est tout vaporisé par ce savant chimiste
. C’est le Diable qui tient les fils qui nous remuent ! Aux objets répugnants nous trouvons des appas ; Chaque jour vers l’Enfer nous descendons d’un pas, Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu’un débauché pauvre qui baise et mange Le sein martyrisé d’une antique catin, Nous volons au passage un plaisir clandestin Que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant, comme un million d’helminthes, Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons, Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie, N’ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins Le canevas banal de nos piteux destins,
C’est que notre âme, hélas ! n’est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lices, Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, 4 Les Fleurs du Mal – Charles BAUDELAIRE Dans la ménagerie infâme de nos vices, Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde ! Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris, Il ferait volontiers de la terre un débris Et dans un bâillement avalerait le monde ; C’est l’Ennui ! — L’œil chargé d’un pleur involontaire, Il rêve d’échafauds en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, — Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère !
_________________
Le Moniteur universel, 14 juillet 1857.
..... Mais vous n’êtes pas non plus les seules fleurs de la nature. Il y a aussi les fleurs des lieux malsains, celles qu’engendrent les cloaques impurs et délétères. Il y a la Flore des poisons et des végétaux vénéneux, la Flore du mal, et on voit où je veux en venir, au volume de poésies du traducteur d’Edgard Poe, aux Fleurs du mal de Charles Baudelaire.
Supposez une fantaisie sinistre qui manque aux fantaisies du conteur américain, une imagination qui va de pair avec ses imaginations désordonnées ; supposez, dans un palais comme celui du prince Prospero, par exemple, à la suite des sept grandes salles éclairées du côté du corridor par leurs fenêtres flamboyantes, une serre de vitrage disposée pour servir de jardin d’hiver. La serre est un autre palais. Le maître, qui l’a fait construire au gré de son goût bizarre, n’a pas voulu y réunir les plantes précieuses, les fleurs qui réjouissent les sens par l’odorat et l’esprit par les yeux, les feuillages d’une douce et argentine verdure, les belles palmes, les grands éventails, les longues bannières flottantes, et les panaches inclinés de la végétation des Antilles. La nature pacifique a donné depuis longtemps ses plus riches échantillons. Il a voulu savoir ce que pouvait donner la nature meurtrière. Il a voulu développer les plantes funestes et qui portent le signe du mal dans leurs formes inquiétantes. Il a fait rechercher les écorces qui distillent des sucs dangereux, les ombrages qui exhalent le vertige et la fièvre. Il a créé des marécages tapissés de toutes les écumes, de toutes les mousses, de toutes les lies, de toutes les perles verdâtres de la corruption végétale. Il a ménagé des lieux bas et étouffés où des mouches de mille couleurs bourdonnent et imitent abominablement le mouvement de la respiration dans le ventre des bêtes mortes. D’un bout à l’autre de ce terrible jardin, une chaleur morne couve à la fois la pourriture et les parfums pénétrants qui se confondent, en sorte que les parfums révoltent et que les sens étonnés ont peur de se plaire à l’infection. Et cependant, de tous côtés pousse une floraison inouïe, des lianes merveilleuses et d’une force de production que l’on n’avait pas soupçonnée, des formes hideuses et superbes, des couleurs d’un éclat sinistre et auprès desquelles pâlirait toute autre couleur. Le maître du lieu a réalisé un Éden de l’enfer. La Mort s’y promène avec la Volupté sa sœur, toutes deux pareilles et défiant l’œil de distinguer celle qui attire ou celle qui repousse. La race de l’ancien serpent rampe meurtrie dans les allées, et, au milieu, l’arbre de la science pousse un dernier jet qui jaillit par miracle de son tronc foudroyé.
Je cherche à rendre l’impression du livre, je tâche d’être compris plutôt que je n’explique ma pensée. Le feuilleton parle pour tout le monde. Un livre comme Les Fleurs du mal ne s’adresse pas à tous ceux qui lisent le feuilleton. En donnerai-je une idée plus précise ? En rattacherai-je la forme au souvenir de quelque forme littéraire ? Je la rattache et je le rattache lui-même à l’ode que Mirabeau a écrite dans le donjon de Vincennes. Il en a par moments l’audace, l’hallucination sombre, les beautés formidables et toujours la tristesse. C’est la tristesse qui le justifie et l’absout. Le poëte ne se réjouit pas devant le spectacle du mal. Il regarde le vice en face, mais comme un ennemi qu’il connaît bien et qu’il affronte. S’il le craint encore ou s’il a cessé de le craindre, je ne sais, mais il parle avec l’amertume d’un vaincu qui raconte ses défaites. Il ne dissimule rien. Il n’a rien oublié. Dans un temps où la littérature indiscrète a raconté au public les mœurs de la vie de bohème, les aventures de la baronne d’Ange et celles de Marguerite Gautier, il est venu après les amusants conteurs dire à son tour l’idylle à travers champs, l’églogue à côté d’une bête morte, le boudoir de la courtisane assassinée, et personne ne viendra plus après lui. Il a écrit la vérité dernière. Il ne s’est pas menti à lui-même. Il n’a menti à personne. Les fleurs du mal ont un parfum vertigineux. Il les a respirées, il ne calomnie pas ses souvenirs. Il aime son ivresse en se la rappelant, mais son ivresse est triste à faire peur. Il n’accuse pas autrement, il ne se plaint pas autrement, il est triste. Une lumière manque à son livre pour l’éclairer, une sorte de fable pour en déterminer le sens. S’il l’appelait la Divine Comédie, comme l’œuvre de Dante, si ses pécheresses les plus hardies étaient placées dans un des cercles de l’Enfer,le tableau même des Lesbiennes n’aurait pas besoin d’être retouché pour que le châtiment fût assez sévère. Du reste, et c’est par là que je termine, j’ai déjà rapproché de Mirabeau l’auteur des Fleurs du mal, je le rapproche de Dante, et je réponds que le vieux Florentin reconnaîtrait plus d’une fois dans le poëte français sa fougue, sa parole effrayante, ses images implacables et la sonorité de son vers d’airain. Je cherchais à louer Charles Baudelaire, comment le louerais-je mieux ? Je laisse son livre et son talent sous l’austère caution de Dante.
Je n’en dirai pas autant de Denise. On fait une fois Les Fleurs du mal, un chef-d’œuvre de réalité sauvage, un livre du plus grand style et d’une férocité magistrale, on le fait (quand on peut le faire), on ne le recommence plus.
Édouard Thierry
______________
« Tout à vous,
« Jules Barbey d’Aurevilly. »
24 juillet 1857.
I
S’il n’y avait que du talent dans les Fleurs du mal de M. Charles Baudelaire, il y en aurait certainement assez pour fixer l’attention de la Critique et captiver les connaisseurs, mais dans ce livre difficile à caractériser tout d’abord, et sur lequel notre devoir est d’empêcher toute confusion et toute méprise, il y a bien autre chose que du talent pour remuer les esprits et les passionner… M. Charles Baudelaire, le traducteur des œuvres complètes d’Edgar Poe, qui a déjà fait connaître à la France le bizarre conteur, et qui va incessamment lui faire connaître le puissant poëte dont le conteur était doublé, M. Baudelaire qui, de génie, semble le frère puîné de son cher Edgar Poe, avait déjà éparpillé, çà et là, quelques-unes des poésies qu’il réunit et qu’il publie. On sait l’impression qu’elles produisirent alors. À la première apparition, à la première odeur de ces Fleurs du mal, comme il les nomme, de ces fleurs (il faut bien le dire, puisqu’elles sont les Fleurs du mal) horribles de fauve éclat et de senteur, on cria de tous les côtés à l’asphyxie et que le bouquet était empoisonné ! Les moralités délicates disaient qu’il allait tuer comme les tubéreuses tuent les femmes en couche, et il tue en effet de la même manière. C’est un préjugé. À une époque aussi dépravée par les livres que l’est la nôtre, les Fleurs du mal n’en feront pas beaucoup, nous osons l’affirmer. Et elles n’en feront pas, non seulement parce que nous sommes les Mithridates des affreuses drogues que nous avons avalées depuis vingt-cinq ans, mais aussi pour une raison beaucoup plus sûre, tirée de l’accent, — de la profondeur d’accent d’un livre qui, selon nous, doit produire l’effet absolument contraire à celui que l’on affecte de redouter. N’en croyez le titre qu’à moitié ! Ce ne sont pas les Fleurs du mal que le livre de M. Baudelaire. C’est le plus violent extrait qu’on ait jamais fait de ces fleurs maudites. Or la torture que doit produire un tel poison sauve des dangers de son ivresse !
Telle est la moralité, inattendue, volontaire peut-être, mais certaine, qui sortira de ce livre cruel et osé dont l’idée a saisi l’imagination d’un artiste ! Révoltant comme la vérité, qui l’est souvent, hélas ! dans le monde de la Chute, ce livre sera moral à sa manière ; et ne souriez pas ! cette manière n’est rien moins que celle de la toute-puissante Providence elle-même, qui envoie le châtiment après le crime, la maladie après l’excès, le remords, la tristesse, l’ennui, toutes les hontes et toutes les douleurs qui nous dégradent et nous dévorent pour avoir transgressé ses lois. Le poëte des Fleurs du mal a exprimé, les uns après les autres, tous ces faits divinement vengeurs. Sa muse est allée les chercher dans son propre corps entr’ouvert, et elle les a tirés à la lumière d’une main aussi impitoyablement acharnée que celle du Romain qui tirait hors de lui ses entrailles. Certes, l’auteur des Fleurs du mal n’est pas un Caton. Il n’est ni d’Utique ni de Rome. Il n’est ni le Stoïque, ni le Censeur. Mais quand il s’agit de déchirer l’âme humaine à travers la sienne, il est aussi résolu et aussi impassible que celui qui ne déchira que son corps, après une lecture de Platon. La Puissance qui punit la vie est encore plus impassible que lui ! Ses prêtres, il est vrai, prêchent pour elle. Mais elle-même ne s’atteste à nous que par les coups dont elle nous frappe. Voilà ses voix ! comme dit Jeanne d’Arc. Dieu, c’est le talion infini. On a voulu le mal, et le mal engendre. On a trouvé bon le vénéneux nectar, et l’on en a pris à si haute dose, que la nature humaine en craque et qu’un jour elle s’en dissout tout à fait ! On a semé la graine amère, on recueille les fleurs funestes. M. Baudelaire, qui les a cueillies et recueillies, n’a pas dit que ces Fleurs du mal étaient belles, qu’elles sentaient bon, qu’il fallait en orner son front, en emplir ses mains, et que c’était là la sagesse. Au contraire, en les nommant, il les a flétries. Dans un temps où le sophisme raffermit la lâcheté et où chacun est le doctrinaire de ses vices, M. Baudelaire n’a rien dit en faveur de ceux qu’il a moulés si énergiquement dans ses vers. On ne l’accusera pas de les avoir rendus aimables. Ils y sont hideux, nus, tremblants, à moitié dévorés par eux-mêmes, comme on les conçoit dans l’enfer. C’est là en effet l’avancement d’hoirie infernale que tout coupable a de son vivant dans la poitrine. Le poëte, terrible et terrifié, a voulu nous faire respirer l’abomination de cette épouvantable corbeille qu’il porte, pâle canéphore, sur sa tête hérissée d’horreur. C’est là réellement un grand spectacle ! Depuis le coupable cousu dans un sac qui déferlait sous les ponts humides et noirs du moyen âge, en criant qu’il fallait laisser passer une justice, on n’a rien vu de plus tragique que la tristesse de cette poésie coupable, qui porte le faix de ses vices sur son front livide. Laissons-la donc passer aussi ! On peut la prendre pour une justice, — la justice de Dieu !
II
Après avoir dit cela, ce n’est pas nous qui affirmeront que la poésie des Fleurs du mal est de la poésie personnelle. Sans doute, étant ce que nous sommes, nous portons tous (et même les plus forts) quelque lambeau saignant de notre cœur dans nos œuvres, et le poëte des Fleurs du mal est soumis à cette loi comme chacun de nous. Ce que nous tenons seulement à constater, c’est que, contrairement au plus grand nombre des lyriques actuels, si préoccupés de leur égoïsme et de leurs pauvres petites impressions, la poésie de M. Baudelaire est moins l’épanchement d’un sentiment individuel qu’une ferme conception de son esprit. Quoique très lyrique d’expression et d’élan, le poëte des Fleurs du mal est, au fond, un poëte dramatique. Il en a l’avenir. Son livre actuel est un drame anonyme dont il est facteur universel, et voilà pourquoi il ne chicane ni avec l’horreur, ni avec le dégoût, ni avec rien de ce que peut produire de plus hideux la nature humaine corrompue. Shakspeare et Molière n’ont pas chicané non plus avec le détail révoltant de l’expression quand ils ont peint l’un, son Iago, l’autre, son Tartuffe. Toute la question pour eux était celle-ci : « Y a-t-il des hypocrites et des perfides ? » S’il y en avait, il fallait bien qu’ils s’exprimassent comme des hypocrites et des perfides. C’étaient des scélérats qui parlaient ; les poëtes étaient innocents ! Un jour même (l’anecdote est connue), Molière le rappela à la marge de son Tartuffe, en regard d’un vers par trop odieux, et M. Baudelaire a eu la faiblesse… ou la précaution de Molière.
Dans ce livre, où tout est en vers jusqu’à la préface, on trouve une note en prose[1] qui ne peut laisser aucun doute non seulement sur la manière de procéder de l’auteur des Fleurs du mal, mais encore sur la notion qu’il s’est faite de l’Art et de la Poésie ; car M. Baudelaire est un artiste de volonté, de réflexion et de combinaison avant tout. « Fidèle — dit-il, — à son douloureux programme, l’auteur des Fleurs du mal a dû, en parfait comédien, façonner son esprit à tous les sophismes comme à toutes les corruptions. » Ceci est positif. Il n’y a que ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprendront pas. Donc, comme le vieux Gœthe, qui se transforma en marchand de pastilles turc dans son Divan, et nous donna ainsi un livre de poésie, — plus dramatique que lyrique aussi, et qui est peut-être son chef-d’œuvre, — l’auteur des Fleurs du mal s’est fait scélérat, blasphémateur, impie, par la pensée, absolument comme Gœthe s’est fait Turc. Il a joué une comédie, mais c’est la comédie sanglante dont parle Pascal. Ce profond rêveur qui est au fond de tout grand poëte s’est demandé en M. Baudelaire ce que deviendrait la poésie en passant par une tête organisée, par exemple, comme celle de Caligula ou d’Héliogabale, et les Fleurs du mal, — ces monstrueuses, — se sont épanouies pour l’instruction et l’humiliation de nous tous ; car il n’est pas inutile, allez ! de savoir ce qui peut fleurir dans le fumier du cerveau humain, décomposé par nos vices. C’est une bonne leçon. Seulement, par une inconséquence qui nous touche et dont nous connaissons la cause, il se mêle à ces poésies, imparfaites par là au point de vue absolu de leur auteur, des cris d’âme chrétienne,
- Aller↑ Première édition, 1857. — Voici cette note de Charles Baudelaire, placée alors en tête de la partie du livre intitulée Révolte, et qu’il avait supprimée dans la seconde édition :
« Parmi les morceaux suivants, le plus caractérisé a déjà paru dans un des principaux recueils littéraires de Paris, où il n’a été considéré, du moins par les gens d’esprit, que pour ce qu’il est véritablement : le pastiche des raisonnements de l’ignorance et de la fureur. Fidèle à son douloureux programme, l’auteur des Fleurs du mal a dû, en parfait comédien, façonner son esprit à tous les sophismes, comme à toutes les corruptions. Cette déclaration candide n’empêchera pas sans doute les critiques honnêtes de le ranger parmi les théologiens de la populace, et de l’accuser d’avoir regretté pour notre Sauveur Jésus-Christ, pour la Victime éternelle et volontaire, le rôle d’un conquérant, d’un Attila égalitaire et dévastateur. Plus d’un adressera sans doute au ciel les actions de grâces habituelles du Pharisien : Merci, mon Dieu, qui n’ayez pas permis que je fusse semblable à ce poëte infâme ! »
Charles Baudelaire avait eu raison sans doute de biffer cette note, puisqu’elle n’avait pas suffi à convaincre et à désarmer ses juges. Mais n’avons-nous pas le devoir de rétablir ici tout ce qui peut contribuer à mettre en pleine lumière la pensée du poëte ?
(Note des éditeurs.)
______________
Les poésies de Charles Baudelaire étaient depuis longtemps attendues du public, j’entends de ce public qui s’intéresse encore à l’art et pour qui c’est encore quelque chose que l’avénement d’un poëte.
Et, à ce sujet, ne calomnions pas trop la société actuelle. Il est difficile que quelque chose de beau ou de bon se produise sans que cette société, qu’on dit si matérielle et si endormie, n’en reçoive quelque agitation. Je vais plus loin. Je suis étonné de sa bonne volonté à faire des succès et à se laisser duper par le mot d’ordre de ceux qu’elle investit de la fonction de l’éclairer. On lui sert des tragédies vulgaires, sans invention et sans style ; on lui dit : C’est du Corneille ; elle y va, et elle applaudit. Un peintre étale au beau milieu d’un salon une toile ambitieuse, d’un dessin douteux et d’une couleur équivoque, on dit au public ; C’est du Véronèse ; il s’y rue, et il applaudit. Combien de fois n’avons-nous pas vu dans ces dernières années la foule se porter en masse et en hâte dans les théâtres, dans les ateliers, chez les libraires, sur l’avis trompeur d’un farceur ou d’un intéressé ; et là, en présence du chef-d’œuvre, s’écarquiller les oreilles et les yeux, le cou tendu, la poitrine contenue, ne demandant qu’à se laisser violer dans son indifférence ! Est-ce sa faute si l’enthousiasme ne lui vient pas, et si le lendemain ses bras laissent tomber le pavois qu’ils avaient élevé la veille ? A-t-elle manqué à Félicien David, à Daubigny, à Jean-François Millet, à Victor de Laprade ? Ne fait-elle pas fête chaque soir à Weber, qu’on vient de lui rendre ? Tout récemment encore, n’a-t-elle pas fait accueil à Gustave Flaubert ?
Ce qui manque aujourd’hui aux hommes d’un vrai mérite, aux artistes graves et convaincus, ce n’est donc pas le bon vouloir du public ; le public ne demande qu’à faire des succès, parce qu’il veut jouir. Ce qui leur manque, c’est le concours loyal, désintéressé de ceux à qui le public, trop occupé et trop affairé, a dévolu la charge de l’éclairer et de l’avertir, de faire pour lui le dépouillement des réputations, et qui, à force de lui crier au loup pour des ombres, finissent par l’endormir dans son indifférence.
Longtemps avant que les Revues eussent publié des vers de M. Baudelaire, on savait qu’il existait quelque part, dans les entrailles fécondes de cette ville qui contiennent tant de germes pour l’avenir, un poëte original, un esprit bien trempé, trop poëte ou trop artiste selon quelques-uns, mais dont les qualités vivaces et surabondantes devaient faire diversion à l’ennui et à la médiocrité générale. Le public, nous en sommes témoins, s’est entretenu dix ans dans cette attente. Les extraits donnés par les journaux ont soutenu cette réputation naissante.
Nous n’avons pas voulu, pour apprécier le talent de M. Baudelaire, attendre l’impression du public. Sans doute on criera à l’exagération. Mais est-ce dans ces temps de médiocrité prolixe de la poésie officielle, de la poésie des salons et des académies, est-ce bien d’une surabondance de sève que nous avons à nous plaindre ? N’est-il pas vrai qu’il en est aujourd’hui de la poésie comme de la peinture ? Tout le monde peint bien, dit l’un, tout le monde fait bien les vers, répond l’autre. Oui, si par bien peindre et être bon poëte, on peut entendre ne manquer ostensiblement à aucune règle convenue, s’exprimer couramment dans le langage de tout le monde et savoir relier habilement par des procédés connus des phrases apprises et des poncis. Tout le monde peint bien parce que tout le monde a été à l’école, a visité les musées et a la tête meublée de souvenirs. Or la mémoire est une faculté calme qui ne fait pas trembler la main comme l’imagination. Nos artistes mettent sur leur palette du Rubens, du Rembrandt, du Guyp, du Van Ostade, etc., etc. Ils s’entourent de gravures. Comment, avec cela, en y ajoutant un peu de goût et les traditions de l’école, ne réussiraient-ils pas auprès de la foule ? Mais regardez d’un peu près les œuvres de ces habiles peintres, appliquez-leur la méthode de jugement qui résulte de l’étude des maîtres, et vous découvrirez qu’ils n’ont ni unité, ni science, ni sincérité, ni idéal, ni bonne foi, ni art de composition, rien, en un mot, de ce qui constitue, non pas le grand peintre, mais le peintre. Tout le monde écrit bien parce que tout le monde sait lire, et que, depuis trois cents ans que l’on imprime, bon nombre de sentiments et de nuances de sentiments ont été exprimés par de grands écrivains. N’est-ce pas le sublime du genre scolastique et académique que d’emprunter la pompe à Bossuet, la concision à La Bruyère, la profondeur à Pascal, l’ironie à Voltaire, la passion à Rousseau, etc., etc. ? De sorte qu’à force d’exprimer ses propres sentiments avec le langage des maîtres, on arrive à penser à leurs frais et finalement à ne plus penser du tout. Disons-le franchement, depuis Louis XIV la poésie française se meurt de correction[1]. Et lorsque, au commencement de ce siècle, l’auteur des Orientales et de Hernaniest venu régénérer la langue poétique en lui rendant tout ce qu’elle avait perdu en 1660, le pittoresque, la propriété, le grotesque, on l’a traité de barbare et de Topinambou. Que penseront nos neveux lorsqu’ils trouveront dans les journaux du temps, à l’adresse du plus grand inventeur de rhythmes que la France ait eus depuis Ronsard, les épithètes de sauvage et d’Iroquois ? Que penseront-ils surtout dans cette plaisanterie, banale alors, du mot coupé par l’hémistiche, appliquée au versificateur le plus sévère de l’époque ? Comme il n’est pas de brevet pour l’invention poétique, il n’est aujourd’hui fils de bonne maison, pourvu du grade de bachelier ès lettres, et ayant un peu de lecture, qui ne parvienne à coudre convenablement ensemble quelques hémistiches de nos poëtes modernes. C’est le même procédé que ci-dessus, pour la prose : on exprime sa mélancolie aux dépens de Lamartine, son ironie avec de Musset, son indignation avec Barbier, son scepticisme avec Théophile Gautier. Chacun a fait son petit Lac, son petit Pas d’armes du roi Jean, son petit Iambe, sa petite Comédie de la Mort, sa petite Ballade à la lune. On emprunte les pensées avec le langage ; ou plutôt on se sert d’une langue riche pour déguiser le néant de sa pensée et la nullité de son tempérament. À part quatre ou cinq noms que je me dispense de citer, mais que chacun connaît, je demande si, dans les essais poétiques qui se sont manifestés dans ces dernières années, il est possible de voir autre chose que réminiscences et pastiches. N’est-ce pas toujours la mélancolie de Lamartine, la rêverie de Laprade, la mysticité de Sainte-Beuve, l’ironie de de Musset, la sérénité de Théodore de Banville ? Eh bien, je le déclare, en présence d’une moutonnerie si persistante, le poëte qui met la main sur mon cœur, dût-il l’égratigner un peu, irriter mes nerfs et me faire sauter sur mon siège, me semblera toujours préférable à cette poésie, irréprochable sans doute, mais insipide, sans parfum et sans couleur, et qui vous coule entre les mains comme de l’eau.
Je ne ferai donc point le procès à M. Baudelaire pour ses exagérations. Tous les tempéraments excessifs, tous les talents volontaires impliquent certains défauts auxquels les meilleurs conseils ne sauraient remédier. Il faut en pareil cas supprimer le poëte ou garder les défauts. Les défauts de M. Delacroix sautent aux yeux : le premier venu peut apercevoir dans sa peinture des audaces, des négligences, la laideur des visages ; mais il a fallu vingt ans pour faire comprendre sa tonalité savante et l’intensité de ses compositions. Je préfère, à propos de M. Charles Baudelaire, m’occuper de signaler et d’expliquer ce que je vois de beau et de rare dans son talent, plutôt que de perdre mon temps à relever des taches qu’on verra bien sans que je m’en mêle, et que la charité de tels de nos confrères saura merveilleusement faire valoir. J’ai d’ailleurs, pour agir ainsi, une excuse excellente, l’exemple du recueil même qui me prend aujourd’hui pour organe. Lorsque la Revue des Deux Mondes publia, l’an dernier, quelques-unes des poésies de M. Baudelaire, elle les fit précéder d’une note un peu prude, et dans tous les cas fort maladroite. La Revue française s’est conduite plus franchement : elle a choisi, c’était son droit ; mais, son choix fait, elle l’a publié sans commentaire[2].
II
Le livre des Fleurs du mal[3] contient tout au juste cent pièces, parmi lesquelles un assez grand nombre de sonnets, et dont la plus longue excède à peine cent vers. Si je m’arrête tout d’abord à ce résultat, c’est qu’en s’ajoutant à d’autres observations, elle confirme une opinion que j’ai depuis longtemps sur l’avenir de la poésie. Cette opinion, qui n’est point une simple conjecture, mais une induction tirée du développement de l’histoire, est qu’à mesure que le nombre des lecteurs augmente, à mesure que le livre imprimé, en se répandant, convertit les auditeurs impressionnables, passionnables, en lecteurs méditatifs et réfléchis, la poésie doit concentrer son essence et restreindre son développement. Je ne prétends pas, — ce qu’on ne manquerait pas de me faire dire si je ne revenais sur mon assertion, — que la poésie doive devenir un art purement plastique. Mais du moins elle doit resserrer ses moyens plastiques comme son inspiration. La poésie à grandes proportions, la poésie épique, est celle des peuples, non pas barbares, mais peu liseurs, ou qui ne savent pas encore lire et qui sont naturellement plus saisissables par la passion que par laréflexion ; c’est la poésie des époques héroïques ; c’est aussi la poésie des peuples opprimés ou asservis, et c’est pour cela peut-être que la France n’a pas de poëme épique. — Le poëme didactique est un jeu de rhétoricien qui ne peut être poétique qu’épisodiquement. — Quant au poëme démonstratif ou persuasif, à la poésie de propagande, au poëme-sermon, au poëme-pamphlet, ne sont-ils pas devenus ridicules aujourd’hui qu’un article de journal ou une simple brochure renseigne plus vite et plus nettement ? La philosophie ni la science n’ont affaire de la Muse.
Des savants, des docteurs les mystères terribles
D’ornements égayés ne sont point susceptibles.
Répétons-le, car on ne saurait trop le dire, la découverte de l’imprimerie, en mettant aux mains des hommes un moyen direct et expéditif de communiquer leur pensée, a destitué les arts de toute mission de propagande ou d’enseignement. Ce que disaient autrefois les bas-reliefs d’une cathédrale, les fresques d’un édifice, ce que chantaient les rhapsodes et les trouvères, qui n’étaient pas toujours des poëtes, le livre aujourd’hui le dit plus clairement et plus vite. Toutes les fois qu’il s’agira de s’instruire et de comprendre, il sera toujours plus tôt fait de lire un traité que de dégager la moelle instructive des ornements égayés de la Muse. Du jour où le livre fut inventé, les arts émancipés ont eu chacun un domaine séparé que le voisin ne peut envahir qu’à la condition de se suicider. L’allusion politique tue le poëme, dont elle fait un pamphlet ; la prédication tue le drame en en faisant un traité de morale. Quel profit Voltaire, eût-il eu tout le génie poétique qui lui manquait, pouvait-il attendre de sa Henriade alors que les mémoires sur la Ligue étaient déjà dans toutes les mains ? Qui songe à relire, autrement que par curiosité littéraire, les lourds poëmes didactiques de Saint-Lambert, de Lemierre et de Delille, depuis que nous avons une Maison rustique, des dictionnaires, une littérature scientifique ?
Désormais divorcée d’avec l’enseignement historique, philosophique et scientifique, la poésie se trouve ramenée a sa fonction naturelle et directe, qui est de réaliser pour nous la vie complémentaire du rêve, du souvenir, de l’espérance, du désir ; de donner un corps à ce qu’il y a d’insaisissable dans nos pensées et de secret dans le mouvement de nos âmes ; de nous consoler ou de nous châtier par l’expression de l’idéal ou par le spectacle de nos vices. Elle devient, non pas individuelle, suivant la prédiction un peu hasardeuse de l’auteur de Jocelyn, mais personnelle, si nous sous-entendons que l’âme du poëte est nécessairement une âme collective, une corde sensible et toujours tendue que font vibrer les passions et les douleurs de ses semblables.
Cette vérité, que j’essaye de prouver par le raisonnement, est démontrée d’ailleurs par l’exemple et par la transformation progressive de la poésie moderne. Qu’ont fait depuis trente ans Lamartine, Hugo, de Vigny, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, qu’écrire en des œuvres fragmentaires, limitées, l’histoire de l’âme humaine, qu’exprimer dans une forme de plus en plus serrée et de plus en plus parfaite impressions, rêves, aspirations, regrets, depuis la passion la plus vive jusqu’à la rêverie la plus vague ? Les uns et les autres ont tâté le pouls à l’humanité et en ont noté les pulsations dans un rhythme précis, sonore ou coloré. Car c’est la conséquence forcée de cette évolution finale de la poésie, de nécessiter une exécution plus ferme et une plastique plus serrée. Le vers négligé, mou, le versus pedestris du xviiie siècle, qui convient si bien à la muse décrépite de l’abbé Delille et de ses imitateurs, n’est plus de mise dans un poëme court destiné à frapper l’esprit des lecteurs par une succession rapide d’images intenses.
Je félicite M. Baudelaire d’avoir compris ces conditions nouvelles de la poésie, car c’est assurément une preuve de force que de se trouver du premier coup à la hauteur de son temps.
III
La poésie de M. Baudelaire, profondément imagée, vivace et vivante, possède à un haut degré ces qualités d’intensité et de spontanéité que je demande au poëte moderne.
Il a les dons rares, et qui sont des grâces, de l’évocation et de la pénétration. Sa poésie, concise et brillante, s’impose à l’esprit comme une image forte et logique. Soit qu’il évoque le souvenir, soit qu’il fleurisse le rêve, soit qu’il tire des misères et des vices du temps un idéal terrible, impitoyable, toujours la magie est complète, toujours l’image abondante et riche se poursuit rigoureusement dans ses termes.
On dira que parfois le ton est poussé au noir, ou au rouge, et que le poëte semble se complaire à irriter les plaies où il a glissé la sonde. Mais, à notre tour, prenons garde à ne pas tomber dans l’exagération. Je sais bien que les satires de d’Aubigné, non plus que celles de Régnier, non plus que certaines pièces de Saint-Amant ou même de Ronsard, ne pourraient guère paraître dans nos revues actuelles. Et cependant chacun les a dans sa bibliothèque et s’en fait honneur. Les poëtes en ce temps-là n’écrivaient que pour les poëtes ou pour les âmes assez grandes pour comprendre l’Art. Nous avons inventé un mode de publication qui s’adresse à tous indistinctement, à l’homme du monde comme à l’artiste, aux jeunes filles comme aux érudits. Est-ce une raison pour retrancher de la poésie moderne tout un ordre de compositions qui a ses précédents, ses chefs-d’œuvre, j’allais dire ses classiques, et qui d’ailleurs répond si directement à une série de passions et de phénomènes ? Devons-nous supprimer la satire et nous interdire l’étude de toute une moitié de l’âme humaine ? En littérature, en art, tout ce qui existe a sa loi ; je suis à cet égard fataliste comme un Bédouin. Je n’en veux donc pas aux journaux d’avoir moralisé leur feuilleton dans l’intérêt de leurs abonnés et des filles d’iceux. Mais, franchement, d’une nécessité commerciale, d’une condition d’abonnement, doit-on faire une question littéraire ? Le livre est-il le journal ? Mais non : le journal va chercher ses lecteurs, le livre attend les siens. Et parce qu’on a publié Modeste Mignon dans le Journal des Débats et le Lys dans la vallée dans la Revue de Paris, faut-il ne pas écrire Splendeurs et Misères des courtisanes, un des plus beaux livres d’analyse sociale qui aient été écrits en langue française ?
Je vais faire une citation terrible, et l’on ne dira pas qu’à propos de littérature romantique je vais chercher mes autorités dans le camp des intéressés. Voici ce qu’écrivait en 1822, dans le Journal des Débats, Hoffmann, — non pas le fantastique, mais l’auteur des Rendez-vous bourgeois, — à propos d’une édition nouvelle de Régnier :
« Dans plusieurs cantons de la Normandie j’ai entendu désigner une jeune fille très honnête par un mot qui ferait dresser les cheveux, s’il était prononcé devant le public plein de pudeur de la capitale. Ce mot, que je n’oserais même désigner par la lettre initiale, n’est cependant que le féminin d’un autre mot que tout le monde prononce et qui indique un jeune homme non marié. Quand ce mot féminin a été appliqué à la débauche, le beau monde l’a rejeté avec horreur et lui a d’abord substitué le mot au son argentin dont j’ai parlé plus haut, et qui, dans son étymologie italienne, ne signifie qu’une très petite fille. Il a été pendant quelque temps reçu même dans la bonne société ; mais ayant enfin été proscrit comme son prédécesseur, on l’a remplacé par le mot fille, qui était encore du bon ton au milieu du siècle dernier. Mais il était écrit là-haut sans doute que tout ce qui désigne ce sexe deviendrait une injure ; et ce sont les femmes elles-mêmes qui se sont calomniées en rejetant comme indécents tous les mots qui avaient ce caractère. Aujourd’hui le mot fille est de si mauvais ton, qu’aucune mère, même dans les dernières classes du peuple, ne veut avoir de filles. J’ai deux garçons et deux demoiselles, nous dira la femme du dernier artisan. Mais voici bien autre chose : le mot demoiselle lui-même court grands risques. Les nymphes qui font espalier dans certaines rues, quand Hespérus se lève sur l’horizon, se nomment les demoiselles de la rue Saint-Honoré, les demoiselles du Panorama ou du boulevard du Temple. Il n’y aura donc bientôt plus de demoiselles ; et c’est pour cela sans doute que depuis quelque temps on emploie le terme de jeune personne, car on prévoit que, dans vingt ou trente ans, le mot demoiselle fera frémir notre pudique postérité. Malheureusement l’expression de jeune personne est une sottise, car le mot personne s’appliquant aux deux genres, un jeune garçon est aussi une jeune personne. Il faut donc chercher un autre mot, et, quel qu’il puisse être, il finira par avoir le sort de tous les autres. »
Voilà le danger signalé par un pur classique, par un écrivain qui traitait Shakespeare et Schiller de sauvages, et leurs traducteurs, MM. Guizot et de Barante, de barbares et de révolutionnaires. Certes, avec notre prétention de parler toujours pour tout le monde, — journaux pour tous, lectures pour tous, — nous finirons par ne plus faire ni livres ni journaux. À force d’avoir toujours en vue les jeunes demoiselles, on finit par manquer de respect aux hommes et à soi-même. On triche avec sa pensée, on falsifie la langue ; on se fait un langage hybride, arbitraire, tout d’allusions et de périphrases ; et cependant, comme l’observe judicieusement le feu rédacteur du Journal de l’Empire, les mots, en s’écartant de l’étymologie, perdent leur signification. On ne pourrait pas dire aujourd’hui quel tort a fait à la littérature, à la langue, combien d’intelligences, de talents a viciés cette préoccupation de plaire à toutes les classes et à tous les âges. Depuis que les mamans ont inventé qu’on ne pouvait plus conduire sa fille à l’Exposition, le commun des peintres a abandonné l’étude du nu pour s’adonner à des tricheries de costume, à des hypocrisies de sentiment bien autrement corruptrices que l’aspect de la nature vraie. Il fut un temps où les directeurs de journaux proscrivaient dans les romans jusqu’aux mots de maîtresse et d’adultère ; et, au Gymnase, un vaudeville de M. Scribe, intitulé Héloïse et Abailard, — et qui ne mentait pas à son titre, — a passé sans difficulté. Voilà où nous en sommes. M. Baudelaire s’est mis sous la protection de quatre vers de d’Aubigné. Il aurait pu y ajouter cette franche déclaration de l’auteur d’Albertus :
Et d’abord, j’en préviens les mères de familles,
Ce que j’écris n’est pas pour les petites filles
Dont on coupe le pain en tartines. —
Les petites filles ! les petites filles ! Mon Dieu ! n’y a-t-il pas une littérature pour les petites filles ? n’y a-t-il pas des écrivains qui se dévouent par vocation ou par nécessité à composer de petites historiettes sans dard et sans venin ? Est-ce qu’il n’y a pas des auteurs pour enfants et même des auteurs pour dames ? L’ignorance est une vertu pour les filles, l’art n’est donc pas fait pour elles. Faites-leur lire l’Histoire des Voyages ou les Lettres édifiantes ; abonnez-les aux bibliothèques paroissiales ; mais écartez d’elles tout livre qui a l’art ou la passion pour but ; vers, romans, pièces de théâtre ; le meilleur n’en vaut rien pour elles. N’avons-nous pas vu récemment un écrivain religieux d’un grand zèle tenter « s’il ne serait pas possible de composer un roman avec des personnages, des sentiments et un langage chrétiens[4] ? » Il a réussi à faire un bréviaire de séduction, où les filles les moins délurées et les plus pieuses apprendront à tromper la vigilance de leurs parents et à forcer, par les moyens les moins catholiques, les cœurs qu’elles ont choisis.
V
Je me laisse entraîner, je le sens, par ces considérations, un peu allongées peut-être, mais que je ne crois pas déplacées à propos d’un livre d’art, et que dans tous les cas je ne crois pas inutiles.
Il faut bien cependant que le public sache ce qu’est ce poëte terrible dont on veut lui faire peur. Pour nos lecteurs, heureusement, la connaissance est déjà faite : ils n’ont point oublié le magnifique extrait que la Revue française a donné des Fleurs du mal il y a trois mois[5]. Ils m’ont donc déjà compris lorsque j’ai cherché à indiquer le caractère de cette poésie abondante dans sa sobriété, de cette forme serrée où parfois l’image fait explosion avec l’éclat soudain de la fleur d’aloès. M. Baudelaire excelle surtout, je l’ai dit, à donner une réalité vivante et brillante aux pensées, à matérialiser, à dramatiser l’abstraction. Cette qualité est frappante dès le second morceau, intitulé Bénédiction, où l’auteur présente l’action fécondante du malheur sur la vie du poëte : il naît, et sa mère se désole d’avoir porté ce fruit sauvage, cet enfant si peu semblable aux autres et dont la destinée lui échappe ; il grandit, et sa femme le prend en dérision et en haine ; elle l’insulte, le trompe et le ruine ; mais le poëte, à travers ces misères, continue de marcher vers son idéal, et la pièce se termine par un cantique doux et grave comme un finale de Haydn :
Vers le ciel où son œil voit un trône splendide,
Le poëte serein lève ses bras pieux,
Et les vastes éclairs de son esprit lucide
Lui dérobent l’aspect des peuples furieux :
« — Soyez béni mon Dieu, qui donnez la souffrance
Comme un divin remède à nos impuretés,
Et comme la meilleure et la plus pure essence
Qui prépare les forts aux saintes voluptés !
Je sais que vous gardez une place au poëte
Dans les rangs bienheureux des saintes légions,
Et que vous l’invitez à l’éternelle fête
Des Trônes, des Vertus des Dominations.
Je sais que la douleur est la noblesse unique
Où ne mordront jamais la terre et les enfers,
Et qu’il faut pour tresser ma couronne mystique
Imposer tous les temps et tous les univers.
Mais les bijoux perdus de l’antique Palmyre,
Les métaux inconnus, les perles de la mer,
Montés par votre main, ne pourraient pas suffire
À ce beau diadème éblouissant et clair.
Car il ne sera fait que de pure lumière
Puisée au foyer saint des rayons primitifs,
Et dont les yeux mortels, dans leur splendeur entière,
Ne sont que des miroirs obscurcis et plaintifs ! »
Je ne crois pas que jamais plus beau cantique ait été chanté à la gloire du poëte, ni qu’on ait jamais exprimé en plus beaux vers la noblesse de la douleur et la résignation des âmes privilégiées.
La pièce vingt et unième (Parfum exotique) est remarquable par cette faculté d’arrêter l’insaisissable et de donner une réalité pittoresque aux sensations les plus subtiles et les plus fugaces. Le poëte assis près de sa maîtresse, par un beau soir d’automne, sent monter à son cerveau un parfum tiède qui l’enivre ; il trouve à ce parfum quelque chose d’étrange et d’exotique, qui le fait rêver à des pays lointains ; et aussitôt dans le miroir de sa pensée se déroulent des rivages heureux, éblouis par les feux du soleil, des îlots paresseux plantés d’arbres singuliers, des Indiens au corps mince et vigoureux, des femmes au regard hardi :
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine,
Pendant que le parfum des vers tamariniers,
Qui circule dans l’air et m’enfle la narine,
Se mêle dans mon âme au chant des mariniers !
Si je voulais citer d’autres preuves de cette rare faculté de magie et de création pittoresque, les exemples afflueraient sous ma plume. Contraint de me borner, pour avoir été trop bavard, je ne puis que renvoyer les lecteurs aux pièces intitulées les Phares, la Muse malade, le Guignon, la Vie antérieure, de Profundis clamavi, le Balcon, la Cloche fêlée, etc.
J’ai parlé du don d’évocation comme d’un des plus particuliers à l’auteur des Fleurs du mal. — Un crime a été commis ; la police pénètre dans un appartement clos et mystérieux, où, parmi les splendeurs du luxe et de la volupté la plus délicate, un cadavre de femme gît sur un lit, la tête séparée du tronc. — De quel crime ténébreux, se demande le poëte, cette malheureuse a-t-elle été victime ? À quelle passion monstrueuse a-t-elle été sacrifiée ? — Et tout aussitôt la chambre mystérieuse, avec son atmosphère malsaine, l’alcôve coquette où ruisselle un corps mutilé au milieu des meubles dorés, des divans soyeux, des bouquets qui se fanent dans les vases, apparaissent avec la puissance d’une ceinture sinistre et dont la mémoire gardera la terreur.
La terreur, je l’ai dit, car il est temps d’expliquer l’énigme de ce titre et de quelques-unes des inspirations de l’auteur. Nous sommes tellement accoutumés à être lâchement encensés ; on nous a tant de fois répété à tous, grands ou petits, poëtes, artistes, bourgeois, que nous sommes les plus vertueux, les plus parfaits, les plus délicats, qu’un poëte qui vient nous secouer dans notre satisfaction hypocrite ou indolente nous fait peur ou nous irrite. Les Fleurs du mal ! les voici : c’est le spleen, la mélancolie impuissante, c’est l’esprit de révolte, c’est le vice, c’est la sensualité, c’est l’hypocrisie, c’est la lâcheté. Or n’est-il pas vrai que souvent nos vertus mêmes naissent de leurs contraires ? que notre courage naît du découragement, notre énergie de la faiblesse, notre sobriété de l’intempérance, notre foi de l’incrédulité ? Aurions-nous la prétention de valoir mieux que ne valaient nos pères ? La société actuelle vaut-elle mieux que celles de Louis XIV et de Henri IV ? Pourquoi donc ne supporterait-elle pas une fois ce que celles-là ont toujours supporté de bonne grâce ? Et pourquoi ce fouet sanglant, que l’auteur des Iambes, le dernier, a manié avec tant de vigueur et de franchise, ne viendrait-il pas nous rappeler que le poëte n’est pas nécessairement un douceâtre et un thuriféraire ?
Au surplus, ce fouet, M. Baudelaire ne l’a pas toujours à la main ; il n’est pas toujours ironique ou satirique ; on l’a pu voir par les extraits que j’ai donnés plus haut ; on l’a pu voir par les pièces insérées il y a trois mois dans la Revue française.
Comme transition à des idées moins noires et comme conclusion, je citerai le sonnet suivant qui est à lui seul la clef et la moralité du livre. Il a pour titre l’Ennemi :
Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage,
Traversé ça et là par de brillants soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
Qu’il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.
Voilà que j’ai touché l’automne des idées,
Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées
Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?
Ô douleur ! ô douleur ! le temps mange la vie,
Et l’obscur ennemi qui nous ronge le cœur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie !
Je n’ai que peu de chose à dire de la plastique de M. Charles Baudelaire. Elle est souvent parfaite ; parfois aussi il se permet des audaces, des négligences, des violences qu’explique la nature toute spontanée de son inspiration.
Sa phrase poétique n’est pas, comme celle de M. Théodore de Banville, par exemple, le développement large et calme d’une pensée maîtresse d’elle-même. Ce qui chez l’un découle d’un amour savant et puissant de la forme est produit chez l’autre par l’intensité et par la spontanéité de la passion. Et puisque j’ai nommé M. Théodore de Banville, je rappellerai ce que je disais il y a un an, ici même, à propos de ses Odelettes : « Des deux grands principes posés au commencement de ce siècle, la recherche du sentiment moderne et le rajeunissement de la langue poétique, M. de Banville a retenu le second… » Dans ma pensée, je retenais le premier pour M. Charles Baudelaire.
L’un et l’autre représentent hautement les deux tendances de la poésie contemporaine. Ils pourront servir de bornes lumineuses à une nouvelle génération de coureurs poétiques.
Charles Asselineau.
________________

___________
Edition Gallimard
_____________________
Les Fleurs du Mal
Première parution en 1972
Édition de Claude Pichois
Deuxième édition revue
Collection Poésie/Gallimard (n° 85), Gallimard
Parution : 15-01-2005
______________
«Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ?
Au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau !»
Ces vers du «Voyage» éclairent à eux seuls l'entreprise du poète. Esprit vagabond, toujours mobile, Baudelaire explore les dédales de la conscience. Il atteint tantôt à l'extase, tantôt se perd dans les abîmes du péché. À travers ses poèmes, il nous fait partager le drame qui se joue en lui et qui n'est autre que la tragédie humaine. Baudelaire, premier poète moderne, donne à la poésie sa véritable dimension : exprimer, par-delà les mots, ce vertige absolu qui s'empare de l'âme. Tout chez lui, en lui affirme la nécessité de la souffrance, la fatalité du péché. Tout traduit en lui une âme profondément troublée mais charitable. Baudelaire fait des Fleurs du Mal un immense poème de la vie et du monde.
_______________
Charles Baudelaire est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands poètes du XIXe siècle. Les Fleurs du mal est l’œuvre de sa vie.
Le livre est publié le 25 juin 1857 chez Poulet-Malassis et de Broise. C’est une consécration pour le poète qui, comme en témoignent ses contemporains, aurait terminé la composition de la majeure partie de son sulfureux recueil au début des années 1850.
Avant de donner son « bon à tirer » définitif, Baudelaire retravaille plusieurs fois son recueil.
Il rectifie, se reprend, rature, sollicite l’avis de son éditeur jusqu’à l’épuisement.
Dans ce document manuscrit inédit, Baudelaire nous apparaît comme un Sisyphe de l’écriture, abandonnant douloureusement l’œuvre de sa vie et cherchant, dans les incessants remaniements de son texte, une forme de perfection esthétique.

Introduction Le poème de Baudelaire est placé en tête de son recueil : Les Fleurs du Mal publié en 1857. Dès sa parution, il fait scandale et est interdit. Baudelaire, poète du XIXe siècle, se situe à la croisée des mouvements romantique et symboliste. Il initie le mouvement symboliste en considérant que le langage poétique est une façon d’accéder à la Beauté et à un monde idéal que la réalité révèle et masque à la fois. Les Fleurs du mal montrent les tentatives successives du poète pour s'extraire de la réalité associée au spleen, et atteindre l'Idéal. Celles-ci sont vaines comme le suggère le titre de la partie sur laquelle le recueil se referme : « La Mort ».
« Au lecteur » est le premier poème et ne fait partie d’aucune des six parties qui structurent le recueil. Par cette position liminaire et par l’introduction des thèmes essentiels de la poétique baudelairienne, il semble servir d’introduction aux Fleurs du Mal. Nous étudierons donc ce poème en nous demandant en quoi celui-ci se présente comme une préface à l'ensemble du recueil. Nous verrons, dans un premier temps, comment ce poème établit un pacte de lecture, avant d'examiner en quoi le poète s'y présente comme incarnation de la condition humaine, pour, enfin, montrer comment dans ce poème il s'agit d'« extraire la beauté du mal », principe qui régit le recueil dans son ensemble. Lecture analytique Composition générale du poème 1. « Au lecteur » est constitué de dix strophes, nommées quatrains, composées en alexandrins, vers de douze syllabes. Les rimes sont embrassées tout au long du poème signifiant ainsi l’enfermement du poète et des hommes en général dans la condition humaine.
Première strophe 2. « Au lecteur » débute par un épitrochasme ("La sottise, l'erreur, le péché, la lésine") qui présente les vices de l’homme comme omnipotent. Ils sont l’objet du poème : l’homme leur est soumis comme le suggère la fonction de COD que remplissent les groupes nominaux (« nos esprits » et « nos corps ») dans la phrase. 3. L’oxymore (« aimables remords ») présente d’emblée l’homme comme déchiré entre aspiration à l’idéal, à la Beauté et jouissance de la chute, de la décadence.
Cette tension se retrouve à travers l’emploi de mots renvoyant à la trivialité (« mendiant », « vermine ») qui deviennent poétiques grâce aux jeux sur les sonorités (allitération en [r] et [m], assonanceen [en] :"Et nous alimentons nos aimables remords,Comme les mendiants nourrissent leur vermine." 4. Par ailleurs, la comparaison « Comme les mendiants nourrissent leur vermine » rend concret, palpable l’effet du remord dévorant la conscience. La seconde strophe 5.
La seconde strophe montre le tiraillement entre plaisir coupable et volonté impuissante de ne pas y céder par des couples antithétiques : péchés /repentirs ; têtus/ lâches), des expressions proches de l’oxymore (« payer grassement nos aveux », « rentrons gaiement dans le chemin bourbeux) et le champ lexical de la souffrance morale (« remords, repentirs, aveux, pleurs, taches »).
Troisième strophe 6. Par une métaphore (« le riche métal de notre volonté/Est tout vaporisé par ce savant chimiste »), le poète montre les effets du Malin sur l’homme : alors que le poète transfigure la laideur en beauté par l’emploi du langage poétique, comme un chimiste transforme le plomb en or (mythe de la pierre philosophale employée par l’alchimiste), Satan s’amuse à faire disparaître ce qu’il y a de bon en l’homme.
Quatrième strophe 7. Par l'emploi du présentatif (« c’est…qui ») employé deux fois et le titre de Trismégiste (trois fois grand) Baudelaire montre comment l’homme est voué à la damnation parce qu’il est réduit, comme l’exprime la périphrase « les fils qui nous remuent », à n’être qu’un pantin dirigé par Satan. 8
. Le goût de l’homme pour la déchéance et son aspect contradictoire réapparaît dans l’antithèse : « objets répugnant »/ « des appas » et à travers l’usage d’un vocabulaire concret (remuent/puent) et bas normalement proscrit à la rime pour mettre en avant l’idée paradoxale que l’homme se plaît à s’enfoncer dans le vice, à se perdre, comme le souligne le complément circonstanciel de manière: « Sans horreur ». Cinquième strophe 1. La cinquième strophe du poème repose sur une comparaison : le plaisir que prend l’homme, comparé à un « débauché » dans le vice est comparable à celui pris avec une prostituée : la déchéance morale est rendue plus concrète en étant ramenée à celle du corps. Le plaisir pris est d’ailleurs présenté de manière péjorative par l’emploi des adjectifs qualificatifs « pauvre », « martyrisé », « antique, « clandestin » et la comparaison dégradante : « comme une vieille orange »
. Sixième strophe 2.
Le lecteur assiste alors à une transfiguration du réel par l’emploi d’une métaphore redoublée par une comparaison le « peuple de Démons » représente nos vices, nos pensées impures et le comparant est ensuite lui-même comparé à des vers intestinaux (« comme un million d'helminthes »). Septième strophe 3. La vie, symbolisé par la respiration, est paradoxalement présentée comme une longue mort, devenue par métaphore, « fleuve invisible ». Le rejet du verbe « Descend » au début du vers suivant renvoie à l’idée de chute, de déchéance, de l’humanité. 4. Enfin, tout espoir de voir un homme échapper à cette fatalité du mal est balayée par la proposition hypothétique (« Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,/ N'ont pas encor brodé de leurs plaisants dessins ») qui montre par une série de métonymies (manifestations concrètes d’un principe abstrait), que si certains ne se comportent pas de manière immorale, c’est non parce qu’ils sont vertueux mais parce qu’ils sont trop lâches pour le faire. Ainsi, le vice se cache même derrière ce qui semble être de la vertu comme le souligne l’exclamation (« hélas ») traduisant la déception et peut-être même le dégoût du poète. Les trois dernières strophes du poème sont consacrées à celui que le poète considère comme le pire des maux, celui pour lequel il sera nécessaire d’avoir recours à la langue anglaise pour le désigner : le Spleen, ce mélange d’ennui teinté de désespoir et d’un sentiment d’enfermement. 1. Pour mettre en lumière cet ennemi de l’homme, le poète crée un effet d’attente, introduit par l’emploi du connecteur logique d’opposition (« Mais »), qui s’étend sur deux strophes. Il emploie d’abord un épitrochasme, prenant la forme d’une succession de métaphores qui présentent sous la forme d’animaux dangereux ou repoussants, repris par l’expression générique, « Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants », les vices. Il souligne ensuite la singularité de « l’Ennui » par le comparatif de supériorité, « plus », employé à trois reprises et le met en valeur par l’emploi du présentatif : « C’est » en début de strophe. L’Ennui est enfin personnifié et littéralement mis en scène : « Il rêve d'échafauds en fumant son houka ». 2. Le poème se referme alors sur une apostrophe au lecteur (« lecteur », « Hypocrite lecteur ») et des appositionssoulignant la proximité du poète et du lecteur et faisant du poète un représentant de l’humanité, scellant ainsi une fraternité suggérée tout au long du poème par l’usage du pronom personnel « nous ». Commentaire littéraire I. L’établissement d’un pacte de lecture a) Un poème ou une préface ? - Position liminaire du poème lui confère un statut particulier - Titre suppose une adresse au lecteur et une présentation du recueuil b) La complicité des damnés - Apostrophes au lecteur - Tutoiement final - Appositions font du poète et du lecteur des complices c) L'homme déchiré entre Spleen et Idéal - Couples antithétiques (péchés /repentirs ; têtus/ lâches) - Expressions proches de l’oxymore - Champ lexical de la souffrance morale : ces procédés laissent apparaître une tension entre les contraires.
Le Procès des Fleurs du Mal
________________________
____________________
https://www.youtube.com/watch?v=qbAlqvHE0Ao
Quelques jours après la sortie des Fleurs du mal, Baudelaire s’attire les foudres de la presse, notamment du critique du Figaro, Gustave Bourdin. La direction de la Sûreté publique saisit aussitôt le parquet pour offense à la morale publique et religieuse, et aux bonnes mœurs.
En dépit de l’incompréhension à laquelle il se heurte, l'auteur ne doute pas de l’avenir de son œuvre : il sait que son écriture résistera. En juillet 1857, il écrit à sa mère : « On me refuse tout, l’esprit d’invention et même la connaissance de la langue française. Je me moque de tous ces imbéciles, et je sais que ce volume, avec ses qualités et ses défauts, fera son chemin dans la mémoire du public lettré, à côté des meilleures poésies de V. Hugo, de Th. Gautier et même de Byron. »
Mais, si Les Fleurs du mal resteront, c’est aussi pour cette subordination de la sensibilité à la vérité que Proust reconnaît à Baudelaire. Ainsi, ce n’est pas un hasard si Baudelaire brosse son autoportrait de poète maudit dans Bénédiction, deuxième poème du recueil. D’emblée il prévient son lecteur que le livre est moins un ouvrage élaboré que son journal intime dans lequel il a mis, dit-il, tout son cœur, toute sa tendresse, toute sa religion (travestie), toute sa haine.
Composées essentiellement entre 1841 et 1857, Les Fleurs du mal sont annoncées plusieurs années avant leur parution d’abord sous le titre Les Lesbiennes, puis Les Limbes. Alors qu’une première version du recueil est prête en 1850, le poète n’obtient que très rarement la publication de ses poésies dans les revues. Il en offre en revanche de nombreuses lectures dans les cafés parisiens, ce qui lui permet de gagner une réputation auprès de ses pairs, notamment Th. Gautier et V. Hugo.
_______________
Quelques jours après la parution des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire le 21 juin 1857, le journaliste Gustave Bourdin en fustige le contenu le 5 juillet dans un article du Figaro, avant que des poursuites soient engagées pour « offense à la morale religieuse » et « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Baudelaire sera condamné au versement d’une amende, et son éditeur devra retrancher six poèmes dont le procureur général Ernest Pinard a demandé l’interdiction.
Bourdin écrivait ainsi : « M. Charles Baudelaire est, depuis une quinzaine d’années, un poète immense pour un petit cercle d’individus dont la vanité, en le saluant Dieu ou à peu près, faisait une assez bonne spéculation ; ils se reconnaissaient inférieurs à lui, c’est vrai ; mais en même temps, ils se proclamaient supérieurs à tous les gens qui niaient ce messie. Il fallait entendre ces messieurs apprécier les génies à qui nous avons voué notre culte et notre admiration : Hugo était un cancre, Béranger un cuistre, Alfred de Musset un idiot, et madame Sand une folle. Lassailly avait bien dit : Christ va-nu-pieds, Mahomet vagabond et Napoléon crétin.

|
« Mais on ne choisit ni ses amis ni ses admirateurs, et il serait par trop injuste d’imputer à M. Baudelaire des extravagances qui ont dû plus d’une fois lui faire lever les épaules. Il n’a eu qu’un tort à nos yeux, celui de rester trop longtemps inédit. Il n’avait encore publié qu’un compte rendu de Salon très vanté par les docteurs en esthétique, et une traduction d’Edgar Poe. Depuis trois fois cinq ans, on attendait donc ce volume de poésies ; on l’a attendu si longtemps, qu’il pourrait arriver quelque chose de semblable à ce qui se produit quand un dîner tarde à être trop servi ; ceux qui étaient les plus affamés sont les plus vite repus : l’heure de l’estomac est passée.
« Il n’en est pas de même de votre serviteur. Pendant que les convives attendaient avec une si vive impatience, il dînait ailleurs tranquillement et sainement, et il arrivait l’estomac bien garni pour juger seulement du coup d’œil. Ce serait à recommencer que j’en ferais autant. J’ai lu le volume, je n’ai pas de jugement à prononcer, pas d’arrêt à rendre ; mais voici mon opinion que je n’ai la prétention d’imposer à personne. On ne vit jamais gâter si follement d’aussi brillantes qualités. Il y a des moments où l’on doute de l’état mental de M. Baudelaire ; il y en a où l’on n’en doute plus : c’est, la plupart du temps, la répétition monotone et préméditée des mêmes mots, des mêmes pensées.
« L’odieux y coudoie l’ignoble ; le repoussant s’y allie à l’infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages ; jamais on n’assiste à une semblable revue de démons, de foetus, de diables, de chloroses, de chats et de vermine. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l’esprit, à toutes les putridités du cœur ; encore si c’était pour les guérir, mais elles sont incurables. Un vers de M. Baudelaire résume admirablement sa manière ; pourquoi n’en a-t-il pas fait l’épigraphe des fleurs du mal ?
Je suis un cimetière abhorré de la lune.
« Et au milieu de tout cela, quatre pièces, le Reniement de saint Pierre, puis Lesbos, et deux qui ont pour titre les Femmes damnées, quatre chefs-d’œuvre de passion, d’art et de poésie ; mais on peut le dire, il le faut, on le doit : si l’on comprend qu’à vingt ans l’imagination d’un poète puisse se laisser entraîner à traiter de semblables sujets, rien ne peut justifier un homme de plus de trente d’avoir donné la publicité du livre à de semblables monstruosités. »
Si deux jours plus tard la direction de la Sûreté publique saisit le parquet pour « outrage à la morale publique » et pour « outrage à la morale religieuse », cette dernière accusation est finalement abandonnée. Cependant le 20 août, le procureur Ernest Pinard, qui avait également requis contre Madame Bovary, prononce un réquisitoire devant la 6e&,nbsp ;Chambre correctionnelle.
« Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n’aboutit pas, on fait à l’auteur un succès, presque un piédestal ; il triomphe, et on a assumé, vis-à-vis de lui, l’apparence de la persécution. J’ajoute que, dans l’affaire actuelle, l’auteur arrive devant vous, protégé par des écrivains de valeur, des critiques sérieux dont le témoignage complique encore la tâche du ministère public. Et cependant, messieurs, je n’hésite pas à la remplir. Ce n’est pas l’homme que nous avons à juger, c’est son œuvre, ce n’est pas le résultat de la poursuite qui me préoccupe, c’est uniquement la question de savoir si elle est fondée.
« Charles Baudelaire n’appartient pas à une école. II ne relève que de lui-même. Son principe, sa théorie, c’est de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouillera la nature humaine dans ses replis les plus intimes ; il aura, pour la rendre, des tons vigoureux et saisissants ; il l’exagèrera surtout dans ses côtés hideux ; il la grossira outre mesure, afin de créer l’impression, la sensation. II fait ainsi, peut-il dire, la contre-partie du classique, du convenu, qui est singulièrement monotone et qui n’ obéit qu’à des règles artificielles.
« Le juge n’est point un critique littéraire, appelé à se prononcer sur des modes opposés d’apprécier l’art et de le rendre. Il n’est point le juge des écoles, mais le législateur l’a investi d’une mission définie : le législateur a inscrit dans nos codes le délit d’offense à la morale publique, il a puni ce délit de certaines peines, il a donné au pouvoir judiciaire une autorité discrétionnaire pour reconnaître si cette morale est offensée, si la limite a été franchie. Le juge est une sentinelle qui ne doit pas laisser passer la frontière. Voilà sa mission.
« Ici, dans le procès actuel, le ministère public devait-il donner l’éveil ? Voilà le procès. Pour le résoudre, citons dans ce recueil de pièces détachées celles que nous ne pouvons laisser passer sans protester. Je lis, à la page 53, la pièce 20, intitulée Les Bijoux, et j’y signale trois strophes qui, pour le critique le plus indulgent, constituent la peinture lascive, offensant la morale publique :
|
Et ses bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins S’avançaient plus câlins que les anges du mal, Je croyais voir assis, par un nouveau dessin, |
à la page 73, dans la pièce 30, intitulée Le Léthé, je vous signale cette strophe finale :
| Je sucerai, pour noyer ma rancœur, Le népenthès et la bonne ciguë Aux bouts charmants de cette gorge aiguë, Qui n’a jamais emprisonné de cœur |
Dans la pièce 39, À Celle qui est trop gaie, à la page 92, que pensez-vous de ces trois strophes, où l’amant dit à sa maîtresse :
|
Ainsi je voudrais une nuit, Pour châtier ta chair joyeuse, Et, vertigineuse douceur, |
De la page 187 à la page 197, les deux pièces 80 et 81 intitulées : Lesbos et Les Femmes damnées sont à lire tout entières. Vous y trouverez dans leurs détails les plus intimes les moeurs des tribades. À la page 206, la pièce 87, intitulée Les Métamorphoses du Vampire, débute par ces vers :
| La femme cependant, de sa bouche de fraise, En se tordant ainsi qu’un serpent sur la braise Et, pétrissant ses seins sur le fer de son busc, Laissait couler ces mots tout imprégnés de musc : « Moi, j’ai la lèvre humide et je sais la science De perdre au fond d’un lit l’antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants Et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace, pour qui me voit nue et sans voile, La lune, le soleil, le ciel et les étoiles ! Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, Lorsque j’étouffe un homme en mes bras veloutés, Ou lorsque j’abandonne aux morsures mon buste, Timide et libertine, et fragile et robuste, Que sur ces matelas, qui se pâment d’émoi, Les anges impuissants se damneraient pour moi. » |
Sans doute, Baudelaire dira qu’à la strophe suivante il a fait la contre-partie en écrivant ces autres vers :
| Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, Et que languissamment je me tournai vers elle Pour lui rendre un baiser d’amour, je ne vis plus Qu’une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus. |
« De bonne foi, croyez-vous qu’on puisse tout dire, tout peindre, tout mettre à nu, pourvu qu’on parle ensuite du dégoût né de la débauche et qu’on décrive les maladies qui la punissent ? Messieurs, je crois avoir cité assez de passages pour affirmer qu’il y a eu offense à la morale publique. Ou le sens de la pudeur n’existe pas, ou la limite qu’elle impose a été audacieusement franchie. La morale religieuse n’est pas plus respectée que la morale publique. Je signalerai sur ce second point : Le Reniement de saint Pierre, pièce 90, à la page 217 ; – Abel et Caïn, pièce 91, à la pièce 219 ; – Les Litanies de Satan, pièce 92, à la page 222 ; – Le Vin de l’Assassin, pièce 95, à la page 235.
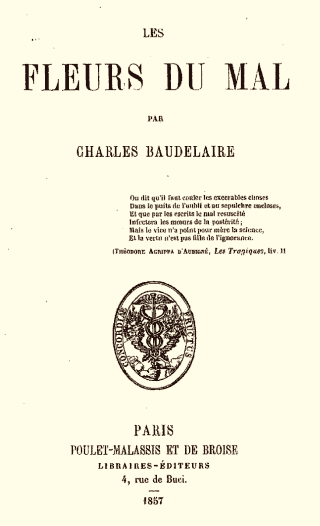
|
« Prendre parti pour le reniement contre Jésus, pour Caïn contre Abel, invoquer Satan à l’encontre des Saints, faire dire à l’assassin : Je m’en moque comme de Dieu, du Diable ou de la Sainte-Table, n’est-ce pas accumuler des débauches de langage qui justifient l’ordonnance du juge d’instruction ? Oui : il a dû renvoyer Baudelaire devant les juges correctionnels pour offense à cette grande morale chrétienne qui est en réalité la seule base solide de nos mœurs publiques. Pour justifier ce renvoi, pour amener ce débat public entre la prévention et la défense, les présomptions suffisaient et les présomptions y étaient. Mais, après les explications contradictoires de l’audience, avez-vous la certitude nécessaire pour condamner sur le second chef ? Vous apprécierez si Baudelaire, cet esprit tourmenté, qui a voulu faire de l’étrange plutôt que du blasphème, a eu conscience de cette offense-là.
« L’offense à la morale publique, voilà celle que je trouve invinciblement démontrée, et je tiens, sur ce point, à répondre à toutes les objections. La première objection qu’on me fera sera celle-ci : le livre est triste ; le nom seul dit que l’auteur a voulu dépeindre le mal et ses trompeuses caresses, pour en préserver. Ne s’appelle-t-il pas les Fleurs du Mal ? Dès lors, voyez-y un enseignement au lieu d’y voir une offense. Un enseignement ! Ce mot-là est bientôt dit. Mais, ici, il n’est pas la vérité. Croit-on que certaines fleurs au parfum vertigineux soient bonnes à respirer ? Le poison qu’elles apportent n’éloigne pas d’elles ; il monte à la tête, il grise les nerfs, il donne le trouble, le vertige, et il peut tuer aussi.
« Je peins le mal avec ses enivrements, mais aussi avec ses misères et ses hontes, direz-vous ! Soit ; mais tous ces nombreux lecteurs pour lesquels vous écrivez, car vous tirez à plusieurs milliers d’exemplaires et vous vendez à bas prix, ces lecteurs multiples, de tout rang, de tout âge, de toute condition, prendront-ils l’antidote dont vous parlez avec tant de complaisance ? Même chez vos lecteurs instruits, chez vos hommes faits, croyez-vous qu’il y ait beaucoup de froids calculateurs pesant le pour et le contre, mettant le contre-poids à côté du poids, ayant la tête, l’imagination, les sens parfaitement équilibrés ! L’homme n’en veut pas convenir, il a trop d’orgueil pour cela. Mais la vérité la voici : l’homme est toujours plus ou moins infirme, plus ou moins faible, plus au moins malade, portant d’autant plus le poids de sa chute originelle, qu’il veut en douter ou la nier. Si telle est sa nature intime tant qu’elle n’est pas relevée par de mâles efforts et une forte discipline, qui ne sait combien il prendra facilement le goût des frivolités lascives, sans se préoccuper de l’enseignement que I’auteur veut y placer.
« Pour tous ceux qui ne sont encore ni appauvris ni blasés, il y a toujours des impressions malsaines à recueillir dans de semblables tableaux. Quelles que soient les conséquences du désordre, si édifiés que soient à cet égard certains lecteurs, ils rechercheront surtout dans les pages de ce livre : La Femme nue, essayant des poses devant l’amant fasciné (pièce 20) ; – La Mégère libertine qui verse trop de flammes et qu’on ne peut, comme le Styx, embrasser neuf fois (pièce 24 Non satiata) ; – La Vierge folle, dont la jupe et la gorge aiguë aux bouts charmants versent le Lethé (pièce 30) ; – La Femme trop gaie, dont l’amant châtie la chair joyeuse, en lui ouvrant des lèvres nouvelles (pièce 39) ; – Le beau Navire, où la femme est décrite avec la gorge triomphante, provocante, bouclier armé de pointes roses, tandis que les jambes, sous les volants qu’elles chassent, tourmentent les désirs et les agacent (pièce 48) ; – La Mendiante rousse, dont les nœuds mal attachés dévoilent le sein tout nouvelet, et dont les bras, pour la déshabiller, se font prier, en chassant les doigts lutins (pièce 63) ; – Lesbos, où les filles aux yeux doux, de leurs corps amoureuses, caressent les fruits mûrs de leur nubilité (pièce 80) ; – Les Femmes damnées ou les Tribades (pièces 81 et 82) ; – Les Métamorphoses, ou la Femme Vampire, étouffant un homme en ses bras veloutés, abandonnant aux morsures son buste, sur les matelas qui se pâment d’émoi, au point que les anges impuissants se damneraient pour elle (pièce 87).
« Dans ces pièces multiples où l’auteur s’évertue à forcer chaque situation comme s’il tenait la gageure de donner des sens à ceux qui ne sentent plus, messieurs, vous qui êtes juges, vous n’avez qu’à choisir. Le choix est facile, car l’offense est à peu près partout. On me fait une seconde objection, en signalant dans le passé des livres tout aussi offensants pour la morale publique et qui n’ont pas été poursuivis. Je réponds, qu’en droit, de semblables précédents ne lient pas le ministère public, qu’en fait, il y a des questions d’opportunité qui expliquent souvent l’abstention et qui la justifient. Ainsi, on ne poursuivra pas un livre immoral qui n’aura nulle chance d’être lu ou d’être compris : le déférer à la justice, ce serait l’indiquer au public, et lui assurer peut-être un succès d’un jour qu’il n’aurait point eu sans cela.
« Mais cette réserve du ministère public ne pourra être, le lendemain, retournée contre lui. Autrement, son action ne serait plus libre. Si l’immoralité des productions s’accentue, il faut qu’il puisse toujours punir le vice, sans qu’on ait à lui reprocher de n’avoir pas antérieurement poursuivi. Sans cela le résultat final serait l’impunité absolue, à quelque degré qu’on fût descendu.
« Messieurs, j’ai répondu aux objections, et je vous dis : Réagissez, par un jugement, contre ces tendances croissantes, mais certaines, contre cette fièvre malsaine qui porte à tout peindre, à tout décrire, à tout dire, comme si le délit d’offense à la morale publique était abrogé, et comme si cette morale n’ existait pas. Le paganisme avait des hontes que nous retrouvons traduites dans les ruines des villes détruites, Pompéi et Herculanum. Mais au temple, sur la place publique, ses statues ont une nudité chaste. Ses artistes ont Ie culte de la beauté plastique ; ils rendent les formes harmonieuses du corps humain, et ne nous le montrent pas avili ou palpitant sous l’étreinte de la débauche. Ils avaient le respect de la vie sociale.
« Dans notre société imprégnée de christianisme, ayons au moins ce même respect. J’ajoute que le livre n’est pas une feuille légère qui se perd et s’oublie comme le journal. Quand le livre apparaît, c’est pour rester ; il demeure dans nos bibliothèques, à nos foyers, comme une sorte de tableau. S’il a ces peintures obscènes qui corrompent ceux qui ne savent rien encore de la vie, s’il excite les curiosités mauvaises et s’il est aussi le piment des sens blasés, il devient un danger toujours permanent, bien autrement que cette feuille quotidienne qu’on parcourt le matin, qu’on oublie le soir et qu’on collectionne rarement.
« Je sais bien qu’on ne sollicitera l’acquittement qu’en vous disant de blâmer le livre dans quelques considérants bien sentis. Vous n’aurez pas, messieurs, ces imprévoyantes condescendances. Vous n’oublierez pas que le public ne voit que le résultat final. S’il y a acquittement, le public croit le livre absolument amnistié ; il oublie vite les attendus, et s’il se les rappelait, il les réputerait démentis par le dernier mot de la sentence. Le juge n’aurait mis personne en garde contre l’œuvre, et il encourrait un reproche qu’il était loin de prévoir, et qu’il ne croyait pas mériter, celui de s’être contredit. Soyez indulgent pour Baudelaire, qui est une nature inquiète et sans équilibre. Soyez-le pour les imprimeurs, qui se mettent à couvert derrière l’auteur. Mais donnez, en condamnant certaines pièces du livre, un avertissement devenu nécessaire. »
La plaidoirie fut assurée par l’avocat Gustave Gaspard Chaix d’Est-Ange. Le Tribunal rendit le 21 août 1857 son jugement en ces termes :
« En ce qui touche le délit d’offense à la morale religieuse, attendu que la prévention n’est pas établie, renvoie les prévenus des fins des poursuites ;
« En ce qui touche la prévention d’offense à la morale publique et aux bonnes mœurs.
« Attendu que l’erreur du poète dans le but qu’il voulait atteindre et dans la route qu’il a suivie, quelque effort de style qu’il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l’effet funeste des tableaux qu’il présente au lecteur, et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur ;
« Attendu que Baudelaire, Poulet-Malassis et De Broise ont commis le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ;
« Savoir : Baudelaire en publiant, Poulet-Malassis et De Broise, en publiant, vendant et mettant en vente a Paris et à Alençon l’ouvrage intitulé : Les Fleurs du Mal, lequel contient des passages ou expressions obscènes ou immorales. Que lesdits passages sont contenus dans les pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil ;
« Vu l’article 8 de la loi du 17 mai 1819, l’article 26 de la loi du 26 mai 1819 ;
« Vu également l’article 463 du Code pénal ;
« Condamne Baudelaire à 300 francs d’amende ; Poulet-Malassis et De Broise chacun à 100 francs d’amende ; Ordonne la suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil 5 ; Condamne les prévenus solidairement aux frais. »
La suppression avait trait aux poèmes Les Bijoux, Le Léthé, À celle qui est trop gaie, Lesbos, Femmes damnées et Les Métamorphoses du vampire. C’est le 31 mai 1949 que Charles Baudelaire et ses éditeurs furent réhabilités par la cour de cassation, saisie à la requête du président de la Société des gens de lettres.
______________________________
Enfin,il faut lire le rapport et la décision de la Cour de cassation révisant le Jugement du Tribunal Correctionnel de la SEINE près de cent ans après.
Révision du jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 25 août 1857 ayant condamné Charles BAUDELAIRE pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs à raison de la publication du recueil « Les Fleurs du Mal »
_____________________
Le scandale éclate. Tout Paris en parle, beaucoup sont contre le recueil, rare, sauf quelques écrivains, sont pour. Le débat va s'amplifier et le 7 juillet, à peine 2 jours après la parution de l'article, la direction de la Sûreté publique saisit le parquet pour « outrage à la morale publique » et pour « outrage à la morale religieuse ».
______________
COUR DE CASSATION (Chambre criminelle) 31 mai 1949
Présidence de M. Battestini
La Cour de cassation, Chambre criminelle, a été saisie par son procureur général, d'ordre du ministre de la Justice agissant à la requête du président de la Société des Gens de Lettres, en vertu de la loi du 25 septembre 1946, d'une demande en révision du jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 25 août 1857 qui a condamné Charles Baudelaire à 300 fr. d'amende, et Poulet-Malassis et de Broise à 100 fr. d'amende chacun pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs à raison de la publication des Fleurs du Mal jugement rapporté à la Gazette des Tribunaux du 21 août 1857.
M. le conseiller Falco a présenté le rapport suivant :
La demande en révision du procès Baudelaire sur laquelle vous êtes aujourd'hui appelés à statuer repose sur des faits beaucoup trop connus pour qu'il soit nécessaire que je m'y attarde longuement.
Il me suffira de vous rappeler que l'année 1857 fut une année de grande pudeur judiciaire, pudeur qui choisit bien mal ses victimes puisque Flaubert et Baudelaire, après s'être assis, à quelques mois de distance, sur les bancs de la correctionnelle entrèrent dans l'immortalité, tandis que la renommée du magistrat auquel incomba la tâche de soutenir ces deux accusations n'en recueillit, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'un lustre très passager.
Ne soyons pourtant pas trop sévères à l'égard du substitut Pinard et de ses collègues du Second Empire insensibles au charme des vers chantant « les jeux latins et les voluptés grecques » ... Comment leur reprocherait-on d'avoir obéi au rigorisme d'une législation qui réprimait non seulement l'outrage aux bonnes mœurs, mais, encore l'outrage à la morale publique et à la morale religieuse ? Comment leur ferait-on grief, lorsqu'ils furent choqués par l'éclosion des « Fleurs du Mal » de n'avoir pas prévu que leurs successeurs demeureraient insensibles à la poussée des « fleurs du pire » qui depuis lors ont envahi la littérature ?
Sans doute le temps a-t-il fait son œuvre, et devant « Lady Chatterley », respectée de la justice tandis que « Madame Bovary » avait été traînée dans le prétoire, constatons simplement que nous sommes parvenus aujourd'hui, en matière d'outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, à une période de grande indifférence judiciaire.
Si bien qu'au milieu de la marée montante d'une pornographie à prétention littéraire, on éprouve un peu, en défendant Baudelaire et les « Fleurs du Mal » du reproche d'obscénité, l'impression paradoxale de plaider pour un livre de la « bibliothèque rose », et d'attribuer un prix de vertu. Aussi pouvons-nous nous demander si cette procédure était vraiment nécessaire et si elle ne risque pas d'apparaître moins comme destinée à laver le poète d'une décision déjà cassée par le jugement des lettrés et par l'arrêt de la postérité qu'à réhabiliter la justice de la condamnation qu'elle a prononcée.
Quoi qu'il en soit, vous êtes régulièrement saisis par votre procureur général, d'ordre exprès du Garde des Sceaux, agissant à la requête du Président de la Société des Gens de Lettres, dans les conditions fixées par la loi du 25 septembre 1946.
Cette loi, qui comporte un article unique, est ainsi conçue : « La révision d'une condamnation prononcée pour outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre pourra être demandée 20 ans après que le jugement sera devenu définitif. Le droit de demander la révision appartiendra exclusivement à la Société des Gens de Lettres de France agissant soit d'office, soit à la requête de la personne condamnée, et si cette dernière est décédée, à la requête de son conjoint, de l'un de ses descendants ou à leur défaut du parent le plus rapproché en ligne collatérale. La Cour de cassation, Chambre criminelle, sera saisie de cette demande par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice lui aura donné. Elle statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d'un pouvoir souverain d'appréciation. »
Ainsi, Messieurs, cette loi a pour objet de permettre, sous certaines garanties, l'annulation de décisions que l'œuvre impartiale des années et l'évolution des esprits feraient apparaître comme entachées d'erreur. Une réhabilitation morale, dit l'exposé des motifs, « fût-elle consacrée par l'unanimité de l'opinion, ne constitue pas la réparation qu'il peut convenir d'accorder à l'écrivain injustement frappé, à sa mémoire, à ses héritiers ». Et l'auteur de cet exposé ajoute que si la tolérance des parquets prouve que les magistrats sont les premiers à tenir pour précaire l'autorité qui s'attache à certaines condamnations prononcées à tort en cette matière, il n'en est pas moins vrai que contre les ouvrages ainsi condamnés, des interdictions et des poursuites restent juridiquement possibles.
Le but qu'a voulu atteindre la loi est donc de faire disparaître cette menace en mettant le droit d'accord avec la réalité, et la décision, qu'en vertu de ce texte, le Procureur général vous demande aujourd'hui de casser, est le jugement rendu le 20 août 1857 par la 7ème chambre du Tribunal correctionnel de la Seine contre Baudelaire et contre ses éditeurs, Poulet-Malassis et de Broise. La minute de ce jugement et le dossier de la procédure ont été détruits en 1871 lors de l'incendie du greffe du Palais de justice de Paris, mais vous en trouverez la trace dans le numéro du 21 août 1857 de la « Gazette des tribunaux » , qui donne le texte du jugement.
Quant aux pièces principales du procès, c'est à dire les poésies condamnées, malgré leur condamnation et l'interdiction dont elles sont encore frappées, elles figurent aujourd'hui à la place d'honneur avec les « Fleurs du mal » dans toutes les bibliothèques. Vous possédez donc les documents nécessaires pour vous prononcer en connaissance de cause après un rappel historique que vous me permettrez de faire succinctement.
C'est au début de juillet 1857 qu'apparut pour la première fois l'œuvre dont Victor Hugo a dit qu'elle avait créé « un frisson nouveau ». Presque aussitôt après, certains articles d'une âpreté et d'une violence extrême, parus dans le journal « Le Figaro », déjà fort respectable, mais devenu depuis plus modéré, donnèrent le signal de la tempête. Le ministre de l'Intérieur s'en émut. Songeant peut être à prendre sa revanche de l'acquittement de Flaubert, en obtenant la condamnation d'un poète à défaut de celle d'un romancier, il s'attaquera au nouveau scandale. En vain Baudelaire écrivit-il à un membre de ce gouvernement vertueux pour affirmer que son livre « ne respirait que la terreur et l'horreur du mal » ; le glaive de la justice s'abattit sur l'auteur de cette abomination et sur ceux qui l'avait mise au jour.
Le jeudi 20 août 1857, les délinquants comparurent en correctionnelle. Des débats proprement dits, nous connaissons peu de choses puisque la loi interdisait le compte rendu des procès de cette nature, mais, par le réquisitoire et la plaidoirie qui ont été publiés, (Revue des grands procès contemporains, 1885 p. 387), on sait qu'assagi par son récent échec contre « Madame Bovary », le substitut Pinard, après avoir lu les passages de l'œuvre qu'il jugeait les plus audacieux, montra en termes modérés mais non sans emphase, les dangers du parfum issu de certaines fleurs et qui, dit-il, « monte à la tête, grise les nerfs, donne le trouble, le vertige et peut tuer aussi ! ». Vainement Me Chaix d'Estanges, fils du procureur général, et peut être un peu écrasé par ce grand nom, fit-il, sur les conseils de Sainte-Beuve, appel à l'exemple des libertés déjà prises avec la pudeur par Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Béranger, Musset, voire même par Montesquieu et Lamartine. Rien n'y fit. Une peine de 300 fr. d'amende fut infligée au poète et de 100 fr. à chacun de ses complices pour avoir en écrivant et en publiant « les Fleurs du Mal » commis le délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. La suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil fut ordonnée. Enfin, les prévenus furent condamnés aux. frais liquidés à 17 fr. 35, plus, heureux temps, 3 fr. pour droit de Poste !
Par la suite, l'amende, trop lourde pour la bourse de Baudelaire, fut réduite à 50 fr. et depuis lors les poèmes proscrits ont fait une lente mais glorieuse carrière. D'abord supprimés dans la seconde édition des « Fleurs du Mal », du consentement de l'auteur, pourtant meurtri dans sa fierté, malgré la lettre que lui avait adressé du haut de son rocher l'exilé de Guernesey pour le féliciter de sa condamnation, ils apparurent 9 ans plus tard en Belgique dans une plaquette intitulée « Les épaves », dont Poulet–Malassis, en mauvaise situation financière, avait pris l'initiative, et qui lui valut devant le Tribunal de Lille une condamnation à un an de prison et 500 fr. d'amende. Mais finalement, après la mort du poète et un certain temps de purgatoire, les poèmes infernaux réapparurent au ciel littéraire, tantôt en chapitre séparé, et, le plus souvent à leur place originelle dans les éditions et les réimpressions successives de l'ouvrage, sans que la justice songeât désormais à s'en inquiéter.
Aujourd'hui, Messieurs, malgré le jugement qui a condamné ces pièces pour leur perversité, vous êtes, si je puis dire, devant un terrain vierge. La loi de 1946 fait de vous, en la matière, une véritable juridiction de jugement, investie, pour statuer définitivement sur le fond, d'un pouvoir souverain d'appréciatio
Contrairement à vos habitudes, vous n'avez pas ici à dire uniquement le droit, mais à juger aussi le fait. Les poèmes condamnés constituaient-ils véritablement des outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs, voilà ce que l'on vous demande, délaissant la prose austère de votre « Bulletin criminel » pour les licences de la poésie érotique, d'examiner à nouveau, mais cette fois irrévocablement.
Certes, je n'aurai pas la candeur d'analyser devant vous les six poèmes que tout le monde connaît, que vous ayez déjà lus et que vous relirez encore avant de rendre votre arrêt. Tout a été dit de l'œuvre de Baudelaire et de sa spiritualité ardente cachée derrière le réalisme de ses vers. Aussi, qu'il s'agisse des « Bijoux », du « Léthé », de « À celles qui sont trop gaies », de « Lesbos », des « Femmes damnées » ou des « Métamorphoses d'un vampire », je crois, qu'au risque d'encourir le reproche baudelérien de vouloir « aux choses de l'amour mêler l'honnêteté », nous pouvons proclamer aujourd'hui que ces poèmes ne dépassaient pas en leur forme expressive, les libertés permises à un poète de génie, qu'au fond, loin d'outrager la morale, ils étaient d'inspiration probe et comportaient, sous leur apparente audace, la leçon qui se dégage des contradictions d'une âme inquiète et d'un esprit tourmenté, qu'enfin certains d'entre eux, devenus immortels, ont pris définitivement place parmi les plus beaux morceaux de la langue française et les chefs d'œuvre poétique de tous les temps.
Rien ne subsiste donc des éléments que votre jurisprudence a toujours considérés comme nécessaires pour constituer l'outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre, c'est à dire outre la publication, l'obscénité de l'écrit et l'intention coupable de l'écrivain (Cass.crim. 7 novembre 1879, Bull.crim. n°342 ; 14 mars 1889, Bull.crim. p.159 ; 17 novembre 1892, Bull.crim. p. 449 ; 28 septembre 1911, Bull.crim. p. 870).
Les juges de 1857, par une singulière contradiction des motifs, loin d'affirmer cette volonté délictuelle dont la constatation semble cependant exigée par vos arrêts, avait au contraire déclaré qu'en dépit des intentions du poète et des efforts déployés par lui pour atténuer l'effet de ses peintures, elles « conduisaient nécessairement à l'exaltation des sens par un réalisme grossier et offensant la pudeur », mais cette grossièreté et ce pouvoir aphrodisiaque, les hommes de notre temps, sans doute plus blasés, ne peuvent les y découvrir, si bien que le délit reproché à l'auteur des « Fleurs du mal » et à ses éditeurs, ne peut plus, ni sur le terrain des faits, ni sur celui des intentions, être considéré comme juridiquement établi.
Je vous demande en conséquence de faire droit à la requête qui vous est présentée en cassant le jugement du 20 août 1857 et en déchargeant la mémoire de Baudelaire, de Poulet-Malassis et de de Broise, de la condamnation prononcée contre eux.
Ce faisant vous rectifierez l'erreur commise par des magistrats trompés par l'esprit de leur époque sur une œuvre dont le temps a sculpté le vrai visage, vous montrerez aux mânes du poète qui, sans attendre vingt-quatre heures pour les maudire, écrivait à la veille de sa comparution : « J'ai vu mes juges, ils sont abominablement laids et leur âme doit ressembler à leur visage », que la justice est tout au moins sans rancune ; et vous restituerez enfin leur véritable parfum à ces « fleurs maladives », objet malheureux d'une poursuite injuste dont le grand artiste ulcéré avait coutume de dire qu'elle lui apparaissait surtout comme « l'occasion d'un malentendu... »
M. l'avocat général Dupuich a développé ensuite les conclusions suivantes :
Le 20 août 1857, il y a de cela 92 ans ou presque, la 6ème chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, sous la présidence de M. Dupaty et sur les réquisitions de M. le substitut Pinard, condamnait Baudelaire à 300 fr. d'amende, MM. Poulet-Malassis et de Broise en 100 fr. chacun, pour « outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre », plus suppression d'un certain nombre de poèmes, à l'occasion de la publication d'un recueil de poèmes intitulé « Les Fleurs du mal »... qui est peut-être le plus célèbre, certainement le plus connu des livres de la poésie française... Un seul volume a suffi à faire de Baudelaire l'un des premiers poètes de notre langue et dont la notoriété a de beaucoup dépassé nos frontières...
Et cependant, dès la publication, à l'été de 1855, de certains des poèmes qui allaient figurer dans le recueil au titre étrange « Les Fleurs du Mal », la revue de Buloz (« Les Deux-Mondes ») qui les avait fait paraître, croyait devoir excuser certaines « outrances verbales » en y voyant « l'expression vive et curieuse -- même dans sa violence – de douleurs morales que l'on doit tenir à connaître puisqu'elle sont le signe de notre temps... », ajoutant que leur publication avait pour objet et pour but « d'aider un vrai talent à se dégager et à se fortifier ».
Ces précautions feutrées n'empêchèrent point l'éclat qu'allait produire la publication du livre. Baudelaire s'était donné pour but la peinture des misères de l'existence humaine ; peinture dégagée de toute convention de style. Dans la langue aux sonorités rythmées où il est maître, sans fard, sans voiles, avec toutes ses tares, ses hideurs, ses pièges, ses vices, ses beautés aussi... . « Enfer et ciel... qu'importe... », il veut porter à chacun son message. Et pour mieux atteindre, le mot ne l'effraie pas.
Cependant, il fallait un « éditeur ». Ce fut à Ploulet-Malassis, curieux personnage, élève de l'école des Chartres, érudit, écrivain à ses heures et qui ne manquait pas d'élégance, que Baudelaire s'adressa. Ce Poulet-Malassis, que la malveillance des échotiers de l'époque avait pourvu d'un « sobriquet » caricaturant son nom (Poulet-mal-Perché), était éditeur à Alençon. Il avait 32 ans, s'était lié d'amitié avec Baudelaire, de quelques années son aîné. Il avait un « associé », de Broise, qui apportait l'indispensable élément financier. Un contrat fut signé. Il devait être tiré 10 000 exemplaires qui parurent en juin 1857 au prix de 3 fr. l'unité, sur lesquels l'auteur percevait 0 fr. 25.
Et l'orage éclata... . « Le Figaro » qui se posait en défenseur de la « morale » invita le Parquet à se saisir. Certes, Baudelaire, qui avait connu à l'occasion de la publication, à l'été de 1855, de certains de ses poèmes quelques vives attaques, n'était point sans s'attendre à ce que le « recueil » fit quelque éclat. Mais l'expérience Bulloz n'ayant point été, après tout, si mauvaise, il est à présumer qu'il n'envisageait point que son livre dût « déclencher les foudres judiciaires ». Je me suis laissé dire qu'un des tenants majeurs de cette École nouvelle qu'on appelle l'Existentialisme, professerait « qu'il n'osait pas les espérer ». Ce n'est peut-être qu'un mot cruel, mais au surplus, je n'ai pas eu la possibilité de le contrôler, faisant à cet égard confiance à notre rapporteur de qui je le tiens.
Cependant tel n'est point mon avis, si je retiens les efforts qui furent entrepris pour épargner à Baudelaire les bancs de la Police correctionnelle. Le numéro du 14 juillet 1857 du « Moniteur » publiait, sous la signature d'Edmond Thierry, un article favorable au poète. Mais MM. Abbatucci et Billault, respectivement ministres de la Justice et de l'Intérieur, estimaient que c'était « consolider le régime que défendre la morale bourgeoise... ». Et Baudelaire dut se choisir un défenseur. Ce fût Me Chaix d'Estange qui, au lendemain du procès – ou presque – allait coiffer la toque aux quatre minces galons d'or du procureur général.
On rapporte également que Baudelaire avait pensé « émouvoir ses juges » ou les « adoucir » en leur faisant « hommage » d'une « plaquette » réunissant quelques-uns de ses poèmes, assortis des commentaires favorables de quelques critiques de l'époque. Sainte-Beuve lui-même, critique officiel et bien en cour aux Tuileries, avait « promis son aide ». Promis seulement... Flaubert, logé à la même enseigne que Baudelaire, lui marquait toute « sa solidarité », écrivant – ou à peu près – ceci : « Pas de danger que pareille mésaventure soit arrivée à ce sale bourgeois de Béranger » (qui mourait en cette même année 1857). Et pourtant il en écrivit bien d'autres... et combien plus suggestives... à commencer par « sa grand-mère, qui le soir à sa fête, de vin pur ayant bu deux doigts, nous disait en hochant la tête... que d'amoureux j'eus autrefois... Mais à ce chantre des amours faciles, honneur, gloire et argent... ».
Et l'affaire vint devant le Tribunal. Le Parquet n'avait « incriminé » que 13 poèmes sur une centaine. « Néfaste indulgence, disait Baudelaire. Dix mots d'un homme, et je le fais pendre. C'est la totalité de l'œuvre qu'il fallait juger, l'ensemble de l'édifice. C'est de la masse qu'il constitue que se dégage l'idée qui l'a fait naître, la leçon qu'il veut donner, la moralité qui l'éclaire. Vous me faites grief d'un meneau mal ajouré, d'une architrave mutilée. Quelle injustice. Elle vous masque la terrible leçon que j'ai voulu mettre dans mon œuvre. Et combien de livres n'avez-vous pas poursuivis, qui ne respirent pas comme le mien, l'horreur du mal. Et la liberté du poète, voire la licence de son verbe, pourquoi voulez-vous les atteindre et punir en moi. A côté de la « morale » de la vie courante, il y a celle de l'art. Et l'agitation de l'esprit dans le Mal, pourquoi voulez-vous la priver de sa libre expression, aussi osée qu'elle vous semble. Votre « morale prude et bégueule », où conduit-elle ? À faire croire que tout est bien, que tout est bon, que tout est beau... Quelle abominable hypocrisie... ».
Voilà – ou peu s'en faut – ce que l'on peut lire dans les « notes » (ou ce qu'il en reste) établies par Baudelaire pour sa défense, notations que, non sans habileté, Me Chaix d'Estange allait reprendre et développer, Me Lançon plaidant pour MM. Poulet-Malassis et de Broise.
Cependant notre « prédécesseur », médiat au Parquet de la Seine, M. Pinard, poussait son « attaque ». Oh ! en magistrat fort parisien, n'ignorant pas la valeur de l'encens d'un compliment. « L'auteur, disait-il, arrive devant vous protégé par des écrivains de valeur ; des critiques sérieux, dont le témoignage complique ma tâche. Et pourtant, poursuivait-il, je n'hésite pas à la remplir. Ce n'est pas l'homme que nous jugeons, mais son œuvre... Baudelaire n'appartient pas à une École. Il ne relève que de lui-même. Son principe, c'est de tout dire, de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouille la nature humaine dans ses replis les plus intimes. Ses tons sont vigoureux et saisissant ; il les exagère, les grossit outre mesure à seule fin de créer l'impression, la sensation... Cela est-il possible ? Et suffit-il, pour tout faire admettre, de parler ensuite du dégoût né de la débauche ? Croit-on que certaines fleurs, au parfum vertigineux, soient bonnes à respirer ? Le parfum qu'elles dégagent n'éloigne pas d'elles, il grise monte à la tête... ».
Et, tout en abandonnant implicitement l'inculpation d'outrage à la morale religieuse que la prévention visait en vertu des lois de 1819 et 1822, mais en citant un certain nombre de poèmes, ceux précisément que le Tribunal allait retenir, M. Pinard demandait la condamnation de Baudelaire, le juge étant, selon son expression, « une sentinelle qui ne doit pas laisser passer la frontière ».
Cette condamnation, il l'obtint nonobstant la défense de Me Chaix d'Estange dont j'ai dit qu'elle ne manquait point d'habileté, encore que certains commentateurs l'aient critiquée. Il montra la « hauteur » de la poésie de son client, évoqua Béranger, Gautier et bien d'autres, depuis Rabelais, en passant par Casanova et Restif de la Bretonne, et réclama l'acquittement de Baudelaire. Le Tribunal écarta l'inculpation d'outrage à la morale religieuse et retint celle d'outrage à la morale publique, prononçant une amende de 300 fr. contre Baudelaire ; Poulet-Malassis et de Broise « recueillaient » 100 fr. chacun. De plus, 6 poèmes : « Les bijoux », « Le Léthé », « A celle qui est trop gaie », « Lesbos », « Les femmes damnées », « Les métamorphoses du vampire » devaient disparaître des éditions ultérieures de l'œuvre.
Baudelaire se « résigna ». Il ne fit même point appel. Et l'Impératrice, à la requête de l'avocat devenu procureur général, fit ramener l'amende à 50 fr.
Certes, ce « procès » ne fut pas, somme toute, une si mauvaise affaire pour l'œuvre qui prit l'attrait du fruit défendu et se vendit sous le manteau à beaucoup plus que 3 fr. l'exemplaire. Mais l'activité de Baudelaire se transforma. Anglicisant remarquable, il fit paraître d'excellentes traductions des œuvres d'Edgar Poe. Mais Poulet-Malassis n'abandonna pas la partie. Réfugié en Belgique, il fit paraître, sous le titre « Les épaves », une édition corrigée et accrue des « Fleurs du Mal » et qui comportait, bien entendu, les 6 poèmes susvisés. Mal lui en prit. Le Parquet de Lille intenta de nouvelles poursuites contre Poulet-Malassis seul, lequel fut condamné le 6 mai 1868 à un an d'emprisonnement et 500 fr. d'amende par le Tribunal correctionnel de Lille. Baudelaire venait de mourir à 46 ans.
Et « Les fleurs du Mal » ont poursuivi leur chemin. Louées par les uns et de moins en moins censurées par les autres, jamais elles n'ont rencontré « l'indifférence », maladie mortelle de toute œuvre littéraire. Et je retiens le mot de notre rapporteur qui, il n'y a qu'un instant, nous disait qu'il n'est point en France de bibliothèque, si modeste fut-elle, dont elle n'orne les rayons.
Cependant, les admirateurs de Baudelaire ont voulu plus. Reprenant, pourrais-je dire à leur compte l'apostrophe de Victor Hugo qui, au lendemain du procès écrivait à Baudelaire : « Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Vous venez de recevoir une des plus rares décorations que le régime actuel puisse accorder. Ce qu'il a appelé « sa justice » vient de vous condamner au nom de ce qu'il appelle « sa morale ». C'est une couronne de plus. Je vous serre la main, poète. » Ils ont voulu que même la trace de cette condamnation disparût.
Un fin lettré de la Troisième République, M. Louis Barthou, présentait, le 29 octobre 1929, à M. Gaston Doumergue, pour lors président de la République, un « projet de loi » ayant pour objet d'ouvrir à la Société des Gens de Lettres un recours en révision des condamnations prononcées pour « outrages aux bonnes mœurs » commis par la voie du livre. L'exposé des motifs indiquait que la compréhension d'une œuvre littéraire n'était pas toujours immédiate, que si nos « gens » des siècles passés admettaient, sans être choqués la verdeur de la plume et du langage, des temps moins éloignés de nous avaient été lus sévères et avaient qualifié d'attentatoires à la morale des œuvres dont les auteurs n'avaient nullement cherché à la blesser, qu'en définitive, et au regard des œuvres de l'esprit, le pouvoir d'appréciation du juge du fait était « précaire et instable », condamné qu'il était par le jugement de la postérité, que cependant une réhabilitation morale, pour être opérée qu'elle fut déjà dans les esprits, était insuffisante, même en se « doublant » de la « bénévolence des Parquets » qui s'abstiennent en cas pareil de poursuivre la réédition d'œuvres condamnées ; que c'était encore trop que « pareille menace demeurât suspendue et qu'il convenait, dans un soucis de moralité supérieure, de faire disparaître, par le moyen de la procédure de « révision » régulière, limitée aux seules décisions judiciaires prononcées pour outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, la trace même de ces condamnations. L'opinion de la postérité favorable à l'œuvre condamnée, et le jugement également favorable des lettrés constituant « le fait nouveau » justifiant semblable procédure, étant entendu qu'elle ne serait possible que 20 ans révolus après le jour où la condamnation avait acquis le caractère définitif.
Ce projet ne vit pas le jour. Il n'était cependant qu'en « sommeil ». Il était repris 17 ans plus tard. Sur la proposition de M. Cogniot, au rapport de M. Guillon, l'Assemblée Nationale, dans sa séance du 12 septembre 1946, l'adoptait sans la moindre dissension. (Ass. Nat. 12 septembre 1946, 2ème séance, JO 13 septembre 1946, débats parlementaires p. 3693). Et c'est tout juste si « l'analytique » lui consacre une demi-colonne en précisant que la loi nouvelle permettra de réviser les condamnations prononcées « contre les ouvrages qui ont enrichi notre littérature et que le jugement des lettrés a déjà réhabilités ».
Et c'est ainsi que fut promulguée la loi qui porte la date du 25 septembre 1946, accordant « exclusivement » à la Société des Gens de Lettres le droit de demander la révision d'une condamnation prononcée pour outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre. Cette loi, publiée au Journal Officiel du 25 septembre 1946 (Gaz.Pal. 1946 2357) ne comporte qu'un unique article, divisé en 3 alinéas. Le premier dispose que la « révision » d'une condamnation prononcée pour outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre peut être demandée 20 ans après l'époque à laquelle le jugement est devenu définitif. Le second décide que le droit de demander la révision appartient exclusivement à la Société des Gens de Lettres, agissant soit d'office, soit à la requête des intéressés, du conjoint, des descendants ou du parent le plus rapproché en ligne collatérale. Le troisième enfin, et c'est à mon avis le plus redoutable, fait de votre Chambre criminelle, saisie par le procureur général agissant d'ordre exprès du garde des Sceaux, la « juridiction de jugement » investie d'un pouvoir souverain d'appréciation quand au « mérite » du pourvoi.
C'est un honneur, dont je perçois la charge, que celui de vous soumettre les conclusions du Ministère public. Le principe « sacro-saint » de l'autorité de la chose jugée, dont nos anciens disaient qu'il est essentiel fondement de la stabilité des États, inscrit aux articles 1350 et suivants de notre Code civil, ne risque-t-il pas d'être quelque peu mis à mal ? Et pourtant, n'est-il pas équitable, lorsque les voies de recours ont été épuisées et que s'acquiert la conviction de la vraisemblance de l'innocence du condamné, qu'un procédé juridique régulier offre à l'innocence, reconnue ou présumée, la possibilité de se faire jour ? Certes, et ce n'est point à vous, Messieurs, qui chaque semaine faites l'application des articles 443 et suivants du Code d'instruction criminelle, survivance de certaines parties de l'ordonnance de 1670, qu'il est séant de le rappeler. Et c'est pourquoi, au défaut d'un texte « normal », le législateur est intervenu.
Il lui est apparu que, parce que les livres durent plus que les hommes, il y avait quelque iniquité à ce que les sanctions dont leurs auteurs avaient pu être l'objet dans le passé, ne bénéficiassent pas, sous certaines conditions, du « revirement » du sentiment public à leur égard. Et comme les lois sont « la conscience publique de la Nation », l'extériorisation (au moins dans le principe) du vœu majoritaire du pays, nous avons le devoir de les accepter et de nous y soumettre. C'est votre tâche de tous les jours de veiller à leur stricte, exacte et correcte application.
Vous voilà donc « les juges de fait » d'un nouveau procès Baudelaire, introduit dans le « recul » de près d'un siècle, ayant à décider de l'innocence ou de la culpabilité au regard de la législation régissant l'outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre, du poète qui écrivit « Les Fleurs du Mal ». Car, au lendemain, ou presque, de la promulgation de la loi du 25 septembre 1946 et très précisément le 21 octobre 1946, le Comité de la Société des Gens de Lettres décidait à l'unanimité moins une voix de demander « la révision » du procès Baudelaire. La Chancellerie, saisie dès le début de l'année 1947, échangeait des lettres avec la Société des Gens de Lettres, et, le 3 novembre 1947, invitait le procureur général près la Cour de cassation à introduire un « pourvoi en révision » du jugement du 20 août 1857.
Je succède donc à M. Pinard. Et cela m'inquiète fort. Nos professions qui, depuis de longues années, nous mettent au contact des réalités, souvent fort sombres, de la vie, ne nous conduisent guère dans les jardins de Muses. Je vous laisse donc le soin de relire les poèmes censurés. Mon prédécesseur avait été plus « complet » et peut-être devrais-je suivre son cheminement, donner, comme il le fit, lecture des pièces jugées offensantes pour la morale publique. Cette dernière, disait-il, étant particulièrement atteinte et la culpabilité de leur auteur invinciblement démontrée.
Sur ses réquisitions, qui atteignaient 13 poèmes sur une centaine, le Tribunal retint, en les citant, les six qu'il jugeait attentatoires à la morale publique. C'était dire, par voie de retranchement, que les 94 autres méritaient la lecture de l'honnête homme et qu'ils rejoignaient le « but moral » que le poète prétendait avoir poursuivi puisque, disait-il, il s'était proposé de donner à ses lecteurs l'horreur du vice, en en peignant les « turpitudes », le « blasphémateur » demeurant, de par son blasphème même, un croyant. Et quant à « l'outrance » du verbe, retenons que Baudelaire a pris soin de dire :
Et d'abord, j'en préviens les mères de famille,
Ce que j'écris n'est pas pour leurs filles,
Dont on coupe le pain en tartines...
Écrivait-il pour la démonstration d'une thèse suivant les « normes » d'une école ? Nullement. Et M. Pinard l'a fort bien vu. « C'est, dit-il, un artiste qui fait de l'art pour l'art, au gré de sa vision, mû par les forces intérieures qui le guident ».Sa vie, dira Asselineau, son fidèle ami, c'était sa poésie, mais avec tout ce que la vie postule de sujétion aux misérables conditions humaines.
Et c'est pourquoi nous voyons Baudelaire suivre les méandres des éléments les plus divers dès lors qu'ils ont prise sur chaque être : la beauté, l'ivresse, le vin, les femmes, l'opium, le rêve... Et tout cela le conduit à cette conclusion désenchantée : « Je sais que la douleur est la noblesse unique ». C'est elle qui nous mène au « saint foyer des rayons primitifs ». Et voilà pourquoi aussi Baudelaire a pu dire que « pour ce qu'il engendrait de bon », le mal, lui aussi, avait « sa part de beauté ». Et enfin , la mort apaisante (Edition Crépet, projet de préface).
Dans tout cela, voyons-nous apparaître les éléments constitutifs du délit d'outrages aux mœurs par la voie du livre ?
Ce serait énoncer une contrevérité que de dire que la première partie des « Fleurs du Mal » ne contient point de poèmes érotiques au sens étymologique du mot. Une certaine Jeanne Duval (La Vénus noire), lui apportait des Antilles une ardeur dont il eu particulièrement à souffrir et qu'il traduisit en vers douloureux. Vers dont cependant « la facture » sait toujours écarter le mot vulgaire ou grossier, l'obscénité verbale à tout dire. C'est vif coloré, puissant même. Le jugement d'août 1857 le reconnaît déjà. Pour conclure, il est vrai, que « quelque effort de style qu'il ait pu faire, de quelque blâme qu'il ait assorti ses peintures... » on ne saurait nier (c'est M. Pinard qui parle) que ces vers conduisent « nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme offensant la pudeur ».
Et ceci nous conduit à un second caractère que peut présenter le délit d'outrages aux mœurs. Nous venons d'indiquer que le premier, l'obscénité dans les termes, ne se rencontrait pas dans « l'écriture » du poète. Mais le caractère attentatoire à la « moralité » peut fort bien résulter, ou s'évincer, de la langue la plus « chaste », dès lors qu'elle est utilisée pour la peinture et la description de faits « immoraux » ou obscènes. C'est du reste à cet élément, caractérisant l'infraction, que s'est arrêté le juge de 1857. Sans doute, pour nos arrière-grands-parents de l'époque, cette conception présentait-elle sa part de vérité. Dois-je dire que nos nerfs sont moins à « fleur de peau ». Nous avons fort bien « franchi » les deux Tropiques, tant celui du Cancer que celui du Capricorne, et même digéré les prouesses de l'amant-jardinier de lady Chaterley. Vous me direz qu'il s'agit là d'écrivains de langue anglaise et de traductions., D'accord, mais ceci m'est une occasion de dire que Baudelaire qui ne s'en cachait du reste pas, a emprunté à Longfellow et Thomas Gray, et souvent nourri son inspiration de leurs poésies. Son œuvre ne comporte pas moins de trois pièces intitulées « Spleen ».
Et Baudelaire ne fera pas tenir à Louis Veuillot qui « l'éreinte » dans « l'Univers », la lettre pleine de violence qu'il a rédigée à son intention. Pourquoi ? Parce que, dit-il, il veut rester un « dandy », c'est à dire un homme d'éducation raffinée (car, fait assez curieux, ce mot est passé dans notre langue, avec une acception sensiblement différente que celle légèrement péjorative que lui accorde la langue anglaise). Mais je m'égare. C'est donc ce « spleen » naturel, ou même acquis de la puritaine Angleterre, qui donna à la. poésie de Baudelaire cette « désespérance » que seules la nuit et la mort apaiseront.
La nuit voluptueuse monte
Apaisant tout, même la faim
Effaçant tout, même la honte.
Le poète se dit : Enfin.
Et plus loin :
Quand veux-tu m'enterrer... Débauche aux bras immondes ;
Ô mort !, Quand viendras-tu... Sa rivale en attraits
Sur ses myrtes infectes... Entre tes noirs cyprès.
Car c'est à la mort que tout conduit :
Ô mort ! Vieux capitaine... Il est temps, levons l'ancre ;
C'est la mort qui console... C'est le but de la vie
Et c'est le seul espoir qui, comme un élixir,
Nous monte et nous enivre...
Et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir.
Et combien d'autres extraits seraient opportunément retenus par un « analyste » plus qualifié et mieux averti. Nous apporteraient-ils l'élément qui, de nos jours, viendrait appuyer ce qui fut, en 1857, la thèse de M. Pinard ? Nous donneraient-ils l'outrage aux mœurs, optique 1949, C'est à dire l'exagération intentionnelle et malicieuse dans le cynisme et l'obscénité du verbe, doublé de la création d'image, attentatoires à un minimum de pudeur.
Aux yeux de notre temps, je ne le crois pas. Que les oreilles de nos anciens aient été plus effarouchables que les nôtres, d'accord. Que M. Pinard se soit fait l'interprète de leurs pudeurs inquiètes, je n'en disconviens pas. Mais l'homme et le poète sont morts. L'œuvre reste. Elle a trouvé des audiences plus libérales, non seulement en France, mais dans le monde entier. Un concert de louanges s'est élevé. Il émane des meilleurs. Les uns soulignent la probité intellectuelle et morale du poète. Les autres la richesse inégalable de ses vers. Tels, enfin le savant emploi du mot, même trop haut en couleur. Ce sont là de bons guides. Ils nous démontrent que Baudelaire a depuis longtemps l'estime des bonnes gens de France et qui seraient attristé, je le crois, que l'opprobre, même lointaine d'une condamnation flétrît plus longtemps la mémoire d'un des écrivains qui a le mieux servi son pays.
Baudelaire, qui, jusqu'au bout avait cru à son acquittement, attendait du Tribunal « une réparation d'honneur ». Reprenant à mon tour les conclusions de votre rapporteur, j'ai confiance que la plus haute juridiction du pays voudra, aujourd'hui, la lui accorder.
J'ai, en conséquence, l'honneur de conclure qu'il vous plaise décharger la mémoire des condamnés du 20 août 1857 de la condamnation prononcée contre eux.
Arrêt de la Cour de Cassation
Vu la requête du procureur général en date du 4 novembre 1947 ; -- Vu l'article unique de la loi du 25 septembre 1946 ;
Sur la recevabilité : Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général, en vertu d'un ordre exprès du ministre de la Justice, agissant à la requête du président de la Société des Gens de Lettres ; que la demande en révision entre dans les cas prévus par la loi du 25 septembre 1946 susvisée ; qu'elle a été introduite après la période de 20 années et dans les conditions fixées par la dite loi ; qu'enfin la décision dont la révision est sollicitée, a acquis l'autorité de la chose jugée ;
-- Déclare la demande recevable ;
Sur l'état de la procédure : Attendu que les pièces produites sont suffisantes pour permettre à la Cour de Cassation de statuer ; que, dès lors, il n'y a lieu d'ordonner ni enquête nouvelle, ni apport de pièces supplémentaires ;
Au fond : Attendu que Charles Baudelaire, Poulet-Malassis et de Broise ont été traduits devant le Tribunal correctionnel de la Seine, comme prévenus d'avoir commis des délits d'offense à la morale publique et aux bonnes mœurs, et d'offense à la morale religieuse, prévus et punis par les articles 1er et 8 de la loi du 17 mai 1819, Baudelaire en publiant, Poulet-Malassis et de Broise en publiant, vendant et mettant en vente l'ouvrage intitulé Les Fleurs du Mal ; -- Que par jugement du 20 août 1857, le Tribunal a dit non établie la prévention d'offense à la morale religieuse et a renvoyé les prevenus des fins de la poursuite de ce chef, mais les a déclarés coupables d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, les a condamnés : Baudelaire à 300 francs d'amende, Poulet-Malassis et de Broise à 100 francs de la même peine, et a ordonné la suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil ; -- Que pour justifier cette condamnation, le jugement énonce que « l'erreur du poète dans le but qu'il voulait atteindre et dans la route qu'il a suivien quelque effort de style qu'il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou suit ses peintures ; ne saurait détruire l'effet funeste des tableaux qu'il présente aux lecteurs et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier offensant pour la pudeur » ;
-- Attendu qu'aux termes de la loi du 27 septembre 1946, la Cour de Cassation, saisie de la demande en révision, statue sur le fond comme juridiction de jugement, investie d'un pouvoir souverain d'appréciation ;
-- Attendu que le délit d'outrage aux bonnes mœurs se compose de trois éléments nécessaires : le fait de la publication, l'obscénité du livre et l'intention qui a dirigé son auteur ;
-- Attendu que le fait de la publication n'est pas contestable ; -- Mais, en ce qui touche le second élément de l'infraction, attendu que les poèmes faisant l'objet de la prévention ne renferment aucun terme obscène ou même grossier et ne dépassent pas, en leur forme expressive, les libertés permises à l'artiste ; que si certaines peintures ont pu, par leur originalité, alarmer quelques esprits à l'époque de la première publication des « Fleurs du Mal » et apparaître aux permiers juges comme offensant les bonnes mœurs, une telle appréciation ne s'attachant qu'à l'interprétation réaliste de ces poèmes et négligeant leur sens symbolique, s'est révélée de caractère arbitraire ; qu'elle n'a été ratifiée ni par l'opinion publique, ni par le jugement des lettrés ;
-- Attendu, en ce qui concerne le troisième élément, que le jugement dont la révision est demandée a reconnu les efforts faits par le poète pour atténuer l'effet de ses descriptions ; que les poèmes incriminés, que n'entache, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune expression obscène, sont manifestement d'inspiration probe ;
-- Attendu, dès lors, que le délit d'outrage aux bonnes mœurs relevé à la charge de l'auteur et des éditeurs des Fleurs du Mal n'est pas caractérisé ; qu'il échet de décharger la mémoire de Charles Baudelaire, de Poulet-Malassis et de de Broise, de la condamnation prononcée contre eux ;
Par ces motifs : Casse et annule le jugement rendu le 27 août 1857 par la 6ème Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, en ce qu'il a condamné Baudelaire, Poulet-Malassis et de Broise pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ; -- Décharge leur mémoire de la condamnation prononcée ; -- Ordonne que le présent arrêt sera affiché et publié conformément à la loi ; -- Ordonne, en outre, son impression et sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal correctionnel de la Seine.
M. Battestini, président ; Falco, rapporteur ; Dupuich, avocat général.
Quand un Sculpteur rencontre un Poète
Charles Baudelaire
 Auguste Rodin
Auguste Rodin
________________________
Les Fleurs du Mal
______________________
Édition originale de 1857,
________________
illustrée par Rodin en 1887-1888
H. 18,7 cm ; L. 12 cm
D.7174
_____________
Une rencontre avec Rodin
En 1887,
Auguste Rodin, passionné par la poésie de Baudelaire, décide d’illustrer son propre exemplaire des Fleurs du mal.
Nous avons décidé d'insérer ces 13 dessins inédits dans le volume, afin de l’illustrer et d’en faire un objet unique.
Nous avons décidé d'insérer ces 13 dessins inédits dans le volume, afin de l’illustrer et d’en faire un objet unique.

______________
Paris, Poulet-Malassis et de Broise.
Cet exemplaire de l’édition originale de 1857 appartenait à l’éditeur et bibliophile Paul Gallimard. C’est grâce aux interventions de l’architecte et critique d’art Frantz Jourdain que Rodin reçoit la commande pour l’illustrer. La reliure en maroquin brun est réalisée par Henri Marius Michel. Sur le premier plat, un cuir incisé et mosaïqué représente en demi-relief une tête de mort de ton ivoire sur un pied de chardon vert foncé.
En à peine quatre mois, à la fin de l’année 1887- début 1888, Rodin, dont on connaît l’attachement à la poésie et à Baudelaire, travaille sur ce projet, et ses dessins au trait ou ombrés, au fond hachuré et aux cinq lavis sur papier japon, chargés d’encre et de gouache qui furent insérés par la suite. Conçus pour l’occasion, ou antérieurs, comme ceux inspirés de Dante, ces dessins apparaissent en frontispice des poèmes ou envahissent parfois le texte.
Cet exemplaire unique a pu être acquis en 1931 par le musée Rodin, grâce à la participation de MM. David Weill et Maurice Fenaille
Paris, Poulet-Malassis et de Broise.
Cet exemplaire de l’édition originale de 1857 appartenait à l’éditeur et bibliophile Paul Gallimard. C’est grâce aux interventions de l’architecte et critique d’art Frantz Jourdain que Rodin reçoit la commande pour l’illustrer. La reliure en maroquin brun est réalisée par Henri Marius Michel. Sur le premier plat, un cuir incisé et mosaïqué représente en demi-relief une tête de mort de ton ivoire sur un pied de chardon vert foncé.
En à peine quatre mois, à la fin de l’année 1887- début 1888, Rodin, dont on connaît l’attachement à la poésie et à Baudelaire, travaille sur ce projet, et ses dessins au trait ou ombrés, au fond hachuré et aux cinq lavis sur papier japon, chargés d’encre et de gouache qui furent insérés par la suite. Conçus pour l’occasion, ou antérieurs, comme ceux inspirés de Dante, ces dessins apparaissent en frontispice des poèmes ou envahissent parfois le texte.
Cet exemplaire unique a pu être acquis en 1931 par le musée Rodin, grâce à la participation de MM. David Weill et Maurice Fenaille.
____________
Cet exemplaire unique a pu être acquis en 1931 par le musée Rodin, grâce à la participation de MM. David Weill et Maurice Fenaille.
Cet exemplaire unique a pu être acquis en 1931 par le musée Rodin, grâce à la participation de MM. David Weill et Maurice Fenaille.
Les Fleur du Mal et la Peinture
______________
164 poèmes issus des Fleurs du mal (édition de 1861),
des Epaves (1866) et de l'édition posthume
(1868) mis en regard avec les peintures. En regard?
______________

Les Fleurs Du Mal De Charles Baudelaire
; Illustrées Par La Peinture Symboliste Et Décadente
_______________
Georges Le Feur
____________
La voix du mal
(1895).
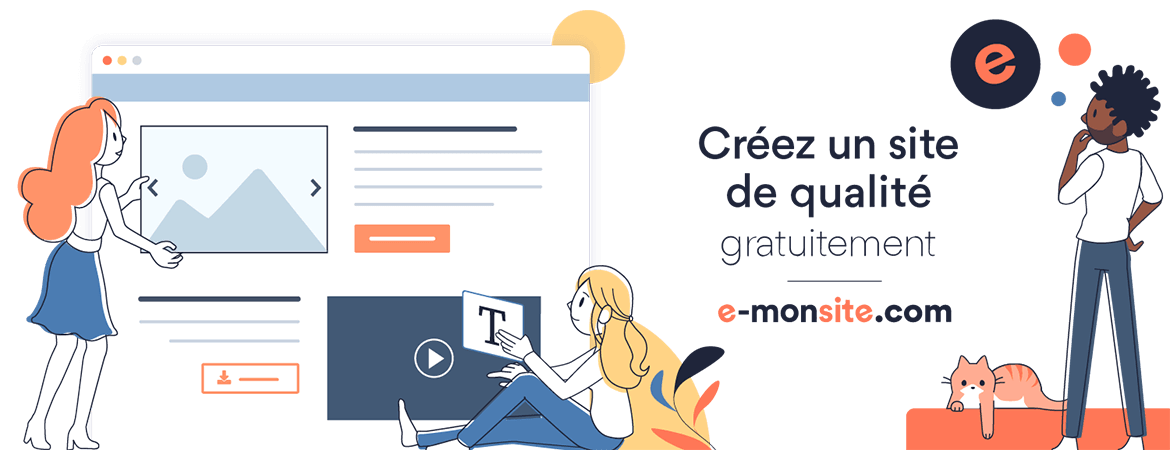







 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa
 Swedish
Swedish
 Romanian
Romanian
 Polish
Polish
 Norwegian
Norwegian
 Finnish
Finnish
 Bulgarian
Bulgarian
 Danish
Danish
 Czech
Czech
 Croatian
Croatian
 Hindi
Hindi
 Russian
Russian
 Chinese (Simplified)
Chinese (Simplified)
 Japanese
Japanese
 Arabic
Arabic