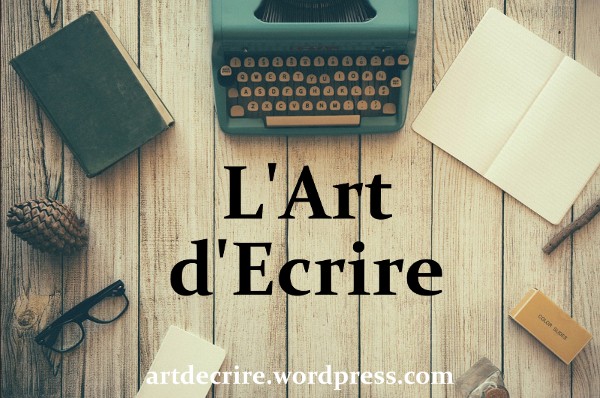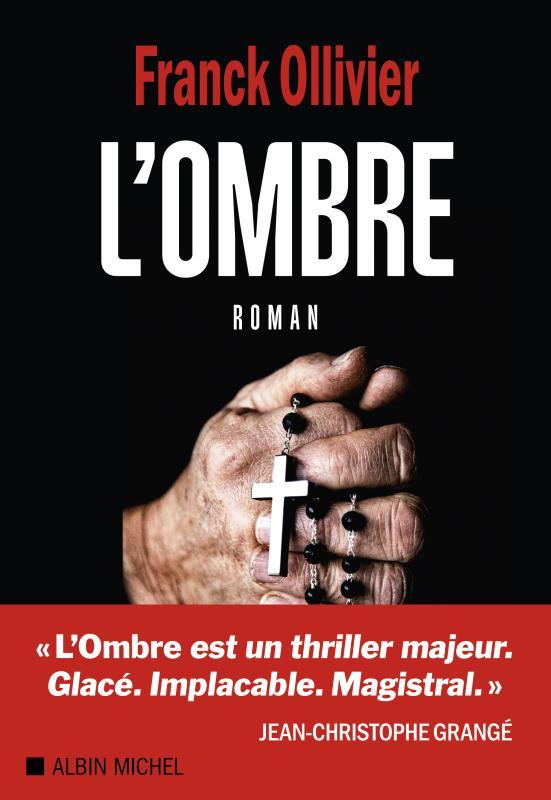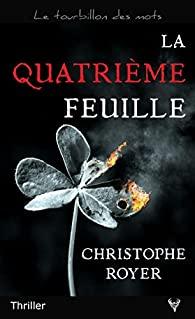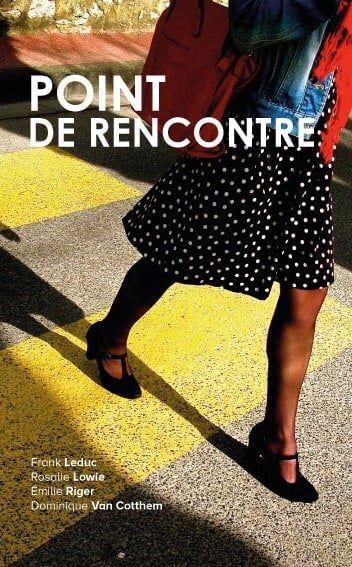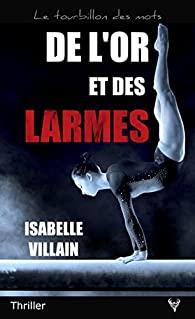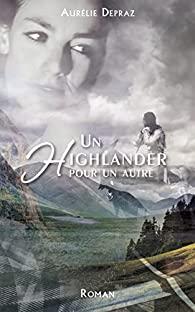Actualités Medievales
- Par frederique Roustant
- Le 02/12/2024
- 0 commentaire
Aujourd'hui 16 Novembre

Le recherche dans Gallica vous emblait fastidieuse et vous vouliez accéder à tous les manuscrits de Christine de Pisan conservés à la BNF ? Gallica les a rassemblés pour vous :https://gallica.bnf.fr/.../manuscrits-de-christine-de...

Andrea Valentini, La Cité des dames de Christine de Pizan. Entre philologie auctoriale et génétique textuelle (Librairie Droz, November 2023)
https://www.droz.org/.../ValentiniAndrea5e6f787e985fd4...
Andrea Valentini étudie la genèse et l’évolution linguistique et stylistique des deux versions de la Cité des dames de Christine de Pizan, œuvre majeure de la littérature médiévale et de l’histoire des femmes. L’analyse s’appuie sur une édition génétique d’extraits étendus du texte, fondée sur les manuscrits dont la préparation a été surveillée par l’autrice. La philologie s’y double de l’examen des miniatures pour dater à la fois l’œuvre et les manuscrits. Plus largement, l’approche interdisciplinaire aide à mettre au jour la conscience linguistique et le processus créateur d’une autrice à la fois extraordinaire et représentative du début du XVe siècle, une période charnière pour le développement de la langue française et de sa littérature. Cette monographie novatrice est entièrement consacrée à des aspects linguistiques et philologiques de l’œuvre de Christine de Pizan.

Jeudi 23 novembre 2023 à 18h30 :
Ajouter un commentaire

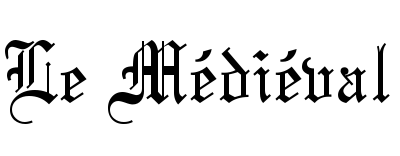
 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa
 Swedish
Swedish
 Romanian
Romanian
 Polish
Polish
 Norwegian
Norwegian
 Finnish
Finnish
 Bulgarian
Bulgarian
 Danish
Danish
 Czech
Czech
 Croatian
Croatian
 Hindi
Hindi
 Russian
Russian
 Chinese (Simplified)
Chinese (Simplified)
 Japanese
Japanese
 Arabic
Arabic