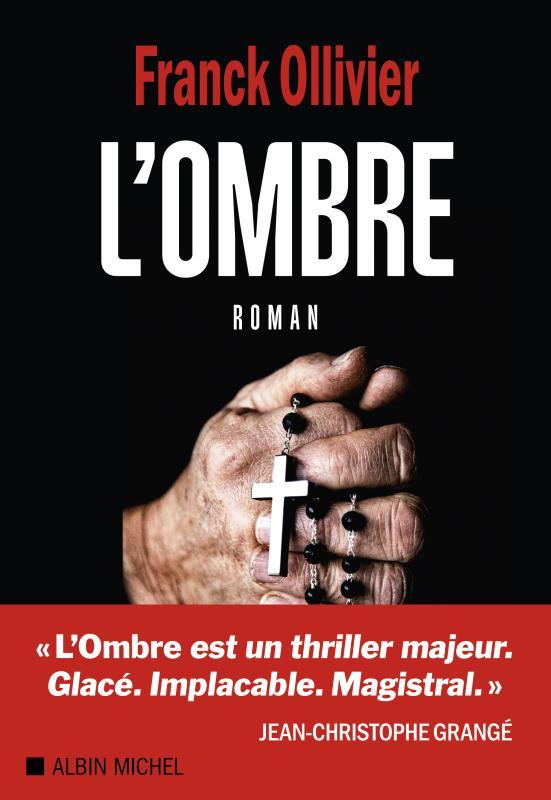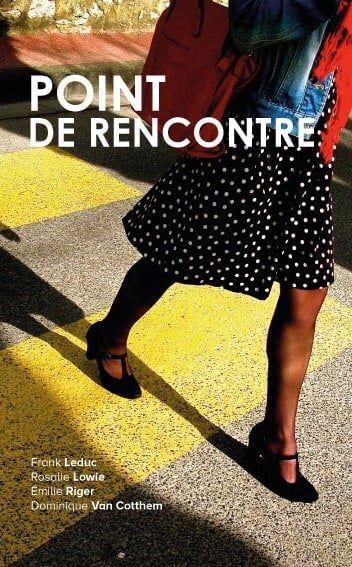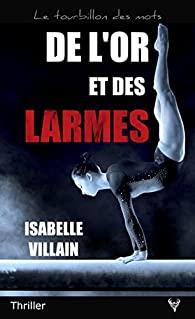Charles Nodier une vie
_____________________
On assiste, depuis une trentaine d’années, à une progressive renaissance de Charles Nodier : les écrits de celui qui fut tout ensemble conteur, romancier, poète, mémorialiste, critique, bibliographe, voire entomologiste, sont peu à peu réédités ; les biographies et les travaux se multiplient ; pour la première fois, une édition des Œuvres littéraires complètes est mise en chantier. Les articles ici rassemblés, rédigés entre 1981 et 2003, marquent les stations d’un cheminement aux côtés de l’écrivain et accompagnent ce renouveau des recherches nodiériennes : consacrés à l’histoire du livre et à la bibliographie, à l’aventure illyrienne, aux cercles et cénacles où la pensée de Nodier s’élabora ou fit autorité, aux prises de position philosophiques et littéraires, souvent inattendues, qui furent les siennes, ils visent à dégager des voiles dont l’avait emmailloté une histoire littéraire routinière la haute figure du maître de Hugo, Nerval et Dumas ; s’ils osent manifester une ambition, c’est bien, à force d’exigence et de précision, celle de rendre possible, sur un plan non confusionnel, la lecture et l’étude de l’œuvre d’un des inventeurs du romantisme français.
_________________
Le 3 janvier 1824, Charles Nodier, homme de lettres reconnu -il a déjà publié Stella ou les proscrits, Jean Sbogar, Thérèse Aubert, Smarra ou les démons de la nuit…) mais qui peine à vivre de sa plume, obtient, en remplacement de l’abbé Grosier, le poste de « bibliothécaire en chef de Monsieur », frère du Roi et futur Charles X. Cette charge assortie d’un logement est plutôt honorifique : Nodier est contraint de partager ses fonctions avec Antoine-Jean Saint-Martin, alors conservateur administrateur. Bien qu’ayant déjà exercé de telles fonctions à Besançon, sa ville natale, et en Illyrie, Nodier s’implique assez peu dans la gestion de la bibliothèque et des ses collections.
Les richesses de la Bibliothèque de l’Arsenal lui permettent cependant d’assouvir la passion sans borne qui l’anime. Ses goûts le portent tant vers les érudits de la Renaissance que vers les raretés bibliographiques, « petits rogatons » ou « curiosités infimes » auxquels il confère, par ses célèbres notices, un statut bibliophilique. S’inspirant des Mélanges tirés d’une grande bibliothèque de Paulmy (1779-1788), il publie par exemple les Mélanges tirés d’une petite bibliothèque (1829). La réhabilitation de ces textes passe surtout par la reliure, dont Nodier est un fervent défenseur : parmi les nombreux relieurs de son temps, ses préférences iront à Joseph Thouvenin. Chaque matin, Nodier reçoit à l’Arsenal ses amis bibliophiles : Paul Lacroix, Gabriel Peignot, Pixérécourt, ou encore le libraire Techener, avec qui il fonde en 1834, le célèbre Bulletin du Bibliophile.
Le cénacle romantique de l’Arsenal
Charles Nodier, de la même façon qu’il continue d’enrichir sa collection personnelle en étant à l’Arsenal, poursuit son œuvre d’homme de lettres. Depuis l’Arsenal, il publie notamment l’Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, La Seine et ses bords, Journal de l'expédition des Portes de Fer, ou encore Franciscus Columna. Il travaille également, avec Taylor, Cailleux et Blanchard, aux célèbres Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Il entre d’ailleurs à l’Académie en 1833.
Mais ce qui fait la renommée de Nodier, et avec lui, de l’Arsenal, c’est bien sûr son célèbre salon, réunissant toute la première génération romantique. De 1824 à 1830, artistes et écrivains se retrouvent chaque dimanche pour assister à une lecture poétique ou une discussion littéraire, avant que Marie, fille de leur hôte et muse de cette belle société, ne retrouve son piano, invitant joueurs et danseurs à poursuivre la soirée. Ce ce salon a notamment accueilli Hugo, Lamartine, Balzac, Janin, Vigny, Nerval, Gautier, Delacroix, David d’Angers, Liszt et plusieurs saint-simoniens. Alexandre Dumas, également présent, a écrit à son sujet : « Ces soirées de l’Arsenal, c’était quelque chose de charmant, quelque chose qu’aucune plume ne rendra jamais » (La femme au collier de velours, A.Cadot, 1850)
La collection Charles Nodier à l'Arsenal
Lorsque Charles Nodier disparaît, en 1844, sa collection est mise en vente (deux ventes avaient déjà eu lieu de son vivant). Si le « bibliothécaire de Monsieur » n’a fait don ni de ses éditions ni de ses propres œuvres à la bibliothèque de l’Arsenal, un fonds assez important a depuis été constitué, grâce à plusieurs dons (Don Montarby, Bryan) ou acquisitions, qui continue de s’enrichir. L’Arsenal possède aujourd’hui plusieurs manuscrits autographes, une importante correspondance, la plupart des éditions des œuvres de l’auteur et des ouvrages critiques le concernant, mais également bon nombre d’exemplaires provenant de sa propre collection.

Élu en 1833 au fauteuil 25
___________________________________________
Officier de la Légion d’honneur
Philologue
Poète
Romancier

Discours de réception de Charles Nodier
_____________________
http://www.academie-francaise.fr/
___________________
Le 26 décembre 1833
M. Charles Nodier ayant été élu par l’Académie française à la place vacante par la mort de M. Laya,
y est venu prendre séance le 26 décembre 1833, et a prononcé le discours qui suit :
Messieurs,
L’honneur d’être admis parmi vous, et de faire entendre ma faible voix dans cette enceinte où a retenti celle de tant de grands hommes, était trop au-dessus de mes espérances pour que je fusse préparé à le reconnaître dignement par mes paroles. La longue étude que j’ai faite de l’art et des ressources du langage ne m’a pas fourni des expressions assez vives et assez puissantes pour peindre les sentiments que votre bonté m’inspire, et je ne l’avais pas prévu dans mon avenir, ce moment glorieux où je dois regretter de n’être pas assez éloquent pour ne pas paraître ingrat. L’indulgence qui a daigné accueillir mes titres littéraires et les couronner d’un si haut prix, peut seule faire grâce aux efforts inhabiles de ma reconnaissance, et me tenir compte d’une-pensée profondément empreinte dans mon cœur, quoique je ne sache la manifester que par des démonstrations imparfaites. La langue du bonheur ne m’a jamais été bien familière ; j’en suis presque aujourd’hui à mon apprentissage, et c’est une des innombrables choses qu’il m’était réservé de venir apprendre auprès de vous.
Le choix que vous avez bien voulu faire de moi, Messieurs, a sans doute acquis dans les actes de l’Académie l’autorité de la chose jugée ; et les abnégations de la modestie manqueraient de bienséance dans un homme qui a été honoré de vos suffrages. Quelques-uns de mes travaux vous ont paru dignes de la plus éminente des récompenses, et le témoignage éclatant que vous leur avez rendu sera désormais à mes yeux la mesure de leur valeur. Cependant, je ne me fais pas assez d’illusion sur mes droits pour méconnaître dans l’arrêt de votre justice une secrète faveur dont le mystère pourrait bien vous avoir échappé à vous-mêmes ; et comment l’amitié serait-elle restée tout-à-fait étrangère à la détermination de cette illustre assemblée où j’ai le bonheur de compter tant d’amis ? – C’est un de vous, Messieurs, qui m’a ouvert la carrière des lettres, qui a encouragé mes premiers pas dans cette voie difficile, et qui m’a rendu l’étude plus chère que tous les plaisirs, par la douce autorité de ses leçons. C’est un de vous qui m’affermit dans les essais de l’enseignement, quand j’étais repoussé d’une chaire nomade, et proscrite comme moi par l’intolérance des partis. C’est un de vous qui me rappela de l’exil et qui me redonna une patrie. Plusieurs ont été mes émules et m’ont vu heureux de leurs triomphes. Tous ont été mes maîtres et m’ont vu fier de leurs conseils. Non, Messieurs, ce n’est pas à moi seul, ce n’est pas seulement au zèle assidu de quelques travaux utiles que je dois la gloire de prendre place au milieu de mes modèles. Je la dois aussi à des sympathies qui me sont plus précieuses que mes succès, et en m’enlevant cette ‘croyance, vous me forceriez à répudier la plus flatteuse de mes vanités.
Ah ! si vous me permettiez de lui donner un plus libre essor dans une circonstance qui l’explique du moins, et qui l’excuse peut-être, je m’efforcerais de rassurer la conscience de mes juges, en réclamant l’aveu anticipé de quelques-uns des hommes célèbres dont ils occupent si justement la place. En effet, Messieurs, je ne peux arrêter mes regards sur vos rangs sans me rappeler que je les ai vus remplis par une autre génération où j’ai admiré d’autres talents et chéri d’autres amis, car je suis parvenu à l’âge où le cœur entretient déjà plus de tendres affections parmi les morts que parmi les vivants. —
La Harpe ne dédaigna- pas de m’éclairer des lumières de cette dialectique ingénieuse et savante qu’il faudrait offrir pour modèle à tous les critiques, si des préventions contradictoires n’en avaient pas deux fois obscurci l’éclat. — Volney m’enhardit et me soutint dans l’investigation pénible et cependant délicieuse de cette belle science de la parole qui se lie à toutes les sciences humaines pour les enrichir et pour les expliquer. — Chénier m’admit souvent à la confidence de ses vers, et sa plume, ordinairement moins humble, corrigea quelquefois les miens. — Suard, dont j’étais né le voisin dans une des plus antiques et dés plus illustres de nos cités, m’a fait plus d’une fois goûter le charme de ces causeries ravissantes où revivaient avec tant de grâce l’atticisme élégant et l’exquise politesse d’une littérature patricienne. — Le bon Sicard et le noble Ségur accueillirent mes essais. — Collin et Legouvé me reçurent en partage de la fidèle amitié qu’ils avaient conservéeà mon père… Et je sens qu’il faut que je m’arrête à cette pensée, car elle vient d’absorber toutes les autres ! J’ai nommé mon père qui ne m’entend plus, mon père dont les yeux se sont fermés dans les larmes de ma destinée incertaine, mon père dont l’espoir du bonheur qui me comble aujourd’hui n’a pas pu consoler les derniers moments ! Ah ! puisse du moins un rêve heureux en porter l’image à mon sommeil !
Pardonnez-moi, Messieurs, si quelques émotions douloureuses viennent de mêler à la joie qui devrait remplir aujourd’hui mon âme tout entière ! C’est de ce mélange que la vie de l’homme se compose, et il n’et point, hélas ! de prospérité si achevée qu’elle ne soit corrompue par quelque secrète amertume. Pourquoi m’en défendre d’ailleurs dans cette solennité dont le retour est toujours accompagné d’un souvenir de deuil, et où la première obligation que vous imposiez à ceux qu’honore votre choix est l’accomplissement d’un devoir funèbre ?
Les éloquentes paroles du directeur de l’Académie au tombeau de M. Laya ne m’ont pas laissé une longue tâche à remplir. Le nom de mon respectable prédécesseur est lui-même un éloge assez complet de son talent et de sa vie. La gloire littéraire de l’homme de goût qui a recueilli avec une chaste admiration les préceptes des maîtres de son art, qui les a pratiqués avec une invariable fidélité, qui les a transmis deux fois à deux générations studieuses, tantôt par ses exemples, et tantôt par ses leçons ; cette gloire fondée sur de sages écrits, et qu’avouera l’estime équitable de la postérité, ne peut soulever dans ses travaux réguliers et modestes aucune des questions animées et souvent orageuses de la critique.
L’existence de l’homme de bien qui a placé tout son bonheur dans un constant exercice de la vertu, est peu sujette d’ailleurs à ce choc d’évènements et à ce tumulte de contrastes qui fournissent de longs détails à l’histoire. Vouée à de paisibles études et à de saines doctrines, elle bille de tout l’éclat d’un siècle, mais elle brille comme la surface de ces fleuves au cours grave et doux, bienfaisant et majestueux, qui déploient leurs eaux transparentes sur une pente insensible, et qui doivent une partie du charme dont ils embellissent la nature à leur calme et à leur limpidité.
Le trait distinctif de la biographie de M. Laya, c’est celui que vous avez signalé par une heureuse expression dans le vénérable Ducis, l’accord d’un beau talent et d’un beau caractère. — Et que pourrait-on ajouter à l’éloge de l’écrivain éloquent et sensible dont chaque ouvrage fut une bonne action ? — C’est peu pour lui d’accomplir une composition souvent élégante, et quelquefois vigoureuse, s’il n’en voit résulter une induction morale dont l’effet peut contribuer au bonheur de la société. — Dans les Dangers de l’opinion, il lutte contre le préjugé cruel qui flétrissait de la honte d’un coupable une famille innocente. — Dans Jean Calas, sa plume destinée à combattre tous les genres de fanatisme, livre à l’horreur publique les fureurs de l’intolérance religieuse. — Dans Falkland, il sonde avec Godwin les replis les plus cachés d’un cœur bourrelé de souvenirs vengeurs, et il met les remords à nu pour en épouvanter le crime. — Dans des écrits d’une moins grande portée, dans des pages presque fugitives, on le retrouve encore inspiré par cette philanthropie sans faste qui était la règle de ses ouvrages comme celle de ses mœurs. Telle est cette excellente Épître à un jeune cultivateur nouvellement élu député, qui ne saurait être méditée avec trop de soin par tous les hommes que le suffrage de leurs concitoyens élève à la direction des affaires du pays. — Napoléon regrettait, dit-on, que le grand Corneille n’eût pas vécu de son temps pour en faire un ministre d’État. Heureux le peuple, enfin éclairé sur ses précieux intérêts, qui regrettera que l’écrivain philosophe n’existe plus, pour le compter au nombre de ses mandataires. Le véritable ami du peuple, c’est le sage.
Mais le titre immortel de M. Laya, celui qui révèle dans le littérateur modeste le ressort d’une âme forte, celui qui atteste à la fois l’élan d’une verve hardie et le dévouement d’une intrépide vertu, celui qui a fait dire à un roi spirituel et judicieux qu’en ouvrant ses rangs à M. Laya, l’Académie avait acquitté la dette de la France entière, vous l’avez nommé avant moi, Messieurs, c’est le drame de l’Ami des lois, œuvre héroïque, œuvre magnanime, dont l’auteur livrait sans crainte sa pensée à l’émeute souveraine et sa vie aux bourreaux. L’Ami des lois fût représenté le 2 janvier 1703, aux acclamations d’une foule transportée qu’un seul éclair de la vérité éternelle venait consoler un moment de ses malheurs. Vous savez, Messieurs, quelle récompense était promise alors aux accents d’une muse courageuse et sincère. Les Sphynx de ce temps-là ne souffraient pas avec patience qu’on osât leur arracher le mot terrible de leurs énigmes. Aussi ces derniers cris de nos mourantes libertés, quelques tendres et suppliantes paroles de modération et de pitié, suscitèrent des excès où se manifestait assez tout ce qu’on pouvait attendre d’une république sortie, les bras rouges de sang, des massacres de septembre. La consternation régna dans Paris. La Commune souleva pour la première fois, sans masque, sa tête hideuse et menaçante au-dessus de tous les pouvoirs qui conservaient quelque apparence de légalité. La convention non encore décimée, mais déjà soumise par l’audace, présenta un spectacle tout-à-fait nouveau dans l’histoire des grandes assemblées politiques. Elle suspendit pendant trois jours le procès d’un roi de France pour libeller l’acte d’accusation d’un poète. Le plus populaire des tribuns de la Montagne s’écria vainement que c’était perdre trop de temps à une comédie, quand le salut du peuple attendait pour être consommé la représentation d’une tragédie sanglante. La faction, impatiente de victimes, ne renonçait pas facilement au plaisir atroce d’en saisir une de plus en passant, et le généreux Laya fut mis hors de la loi qu’il avait invoquée, par les tyrans qu’il avait peints. Il ne parvint pas sans peine à sauver sa tête proscrite, longtemps réclamée par une voix formidable, une voix qui imposait silence à celle de la justice et de l’humanité, par une voix qui ne faisait d’appel qu’à la mort, et qui trouvait toujours la mort docile à ses commandements. C’était la voix de Marat.
Ce respect des formes classiques et des doctrines éprouvées, que je viens de remarquer en M. Laya, forment le caractère le plus distinctif de l’académicien, car ils sont l’objet véritable de l’institution académique. L’essor d’un esprit progressif qui s’élance dans l’avenir, est l’acte individuel d’une pensée solitaire, et les académies, loin de les réprimer dans ce qu’il a de sublime, en retirent au contraire une gloire toujours nouvelle qui s’accroît à chaque siècle. Il ne faut donc pas craindre qu’elles désavouent l’œuvre du temps sanctionnée par l’usage, qu’elles repoussent l’œuvre du génie consacrée par une admiration réfléchie, car, le jour où ceci arriverait, elles cesseraient d’être elles-mêmes et trahiraient leur destinée ; mais leur but, comme autorité littéraire, est essentiellement conservateur ; mais elles n’y seraient pas moins infidèles, le jour où entraînées par l’aveugle ferveur du changement, elles livreraient leurs lois et leurs dieux au sort d’une tentative incertaine, sans avoir reconnu si le terrain où l’on entreprend de les conduire, n’appartient pas aux barbares.
Arrivées à la suite des règles établies, au milieu d’une littérature illustrée par des chefs-d’œuvre qu’il paraît impossible de surpasser, elles furent préposées à la défense de la littérature et des règles comme une garde tutélaire. Protectrices vigilantes des acquisitions du passé, elles attendent de la seule postérité l’aveu solennel qui peut agrandir leur domaine. Elles ne récusent pas sans doute le jugement de l’avenir, mais elles ne le préviennent point. En présence du siècle qui fonde quelque chose peut-être, mais qui détruit pour fonder, elles n’ont d’obligation que de maintenir : c’est une assez noble tâche, et l’Académie l’a très-dignement comprise.
Je devais cette profession de foi à l’Académie ; je la devais aux lettres françaises, puisque je suis souvent cité parmi les écrivains qui ont donné quelques gages à l’esprit d’innovation. Cette accusation est grave, Messieurs, dans le sein d’une assemblée dont je viens de définir et d’honorer autant qu’il était en moi le glorieux ministère ; mais il n’est pas dans mon caractère de l’éluder par de timides défaites, où l’on chercherait plutôt les concessions d’un candidat qui s’humilie que la résipiscence d’une opinion qui s’éclaire. Mon opinion n’a point changé. Elle est aujourd’hui ce qu’elle était dans le jeune enthousiasme de mes études classiques. Elle est ce qu’elle a été dans l’application de mes théories littéraires à la composition de mes ouvrages, et je ne crains pas de la professer sans détour ; j’ai souscrit aux efforts de l’esprit d’innovation, Messieurs, je l’approuve et je le défends, mais je vous prie de me permettre de développer ma pensée et de faire ma part.
Oui, Messieurs, je suis partisan de cette innovation nécessaire, de cette innovation irrésistible, qui se conforme, obéissante, aux progrès reconnus de l’intelligence sociale ; qui procède, comme une émanation naïve, des innovations pratiques de la civilisation ; qui seconde par une expression bien faite, ou par une forme heureusement appropriée à sa nature, l’énonciation d’une idée utile et populaire qui n’a pas encore de nom ; qui prête l’éclat et la vie d’une création nouvelle à tout ce qui porte un sceau de nouveauté et de création dans les conceptions de l’homme ; et tel est le génie des sociétés qu’aucune révolution fondamentale ne peut s’opérer dans leur antique organisation, qu’un mouvement analogue ne s’opère en même temps dans leur parole. Ce phénomène indivisible est une des lois de l’espèce : il n’y a rien à lui opposer.
Oui, Messieurs, je suis partisan de cette innovation éclairée, de cette innovation réparatrice ; qui proteste contre l’oubli dédaigneux où deux grands siècles de notre littérature ont injustement laissé les siècles antérieurs ; qui dispute à la poussière du moyen âge les titres méconnus d’une de nos plus belles gloires nationales ; qui exhume laborieusement, pour les rendre à la lumière, ces chefs-d’œuvre de délicatesse, d’ingénieuse simplicité, de merveilleuse imagination, de magnifique éloquence, dont les peuples les plus perfectionnas se seraient enorgueillis, et qui leur rend le même culte que les artistes de la renaissance aux dieux ressuscités de Polydore et de Praxitèle : étrange innovation, si c’en était une, que cette innovation du passé, qui ne construit pas, mais qui répare, et qui borne son ambition bienfaisante à relever des ruines sublimes pour en illustrer les souvenirs de la patrie !
Oui, Messieurs, je suis partisan de cette innovation conquérante, de cette innovation cosmopolite, qui ne tient pas dans un injuste mépris les productions du génie de l’étranger ; qui s’enrichit avec joie des inventions qu’elle admire, sans s’informer de leur origine ; qui ne soumet pas un génie exotique au tarif chicaneur de la douane littéraire ; qui revendique au contraire comme sien tout ce qui est grand et tout ce qui est beau, parce que le génie n’appartient pas en propre à une région privilégiée, mais à l’humanité tout entière ; qui appelle tous les talents à ses fêtes nationales ; qui convoque toutes les muses à ses concerts ! Le Parnasse d’une nation vraiment civilisée est ouvert, comme le Panthéon d’Alexandre Sévère, aux grands hommes de tous les pays.
Oui, Messieurs, je suis partisan de cette innovation aventureuse elle-même qu’une confiance trop tôt déçue égare à la recherche du nouveau, loin des sentiers tracés par l’expérience et par le goût. Elle marche dans les ténèbres où la lumière ne sera peut-être jamais faite, mais elle marche. Elle n’arrivera pas où elle va, je le crois, mais il lui reste assez de temps pour revenir sur ses pas, tenter une autre carrière, et la fournir jusqu’au bout. Telle est du moins l’espérance que j’en ai conçue et à laquelle je ne renoncerais pas sans douleur. Il faut rappeler le génie qui se trompe, Messieurs ; il faut lui tendre les bras ; il ne faut pas le proscrire ! Le génie est trop rare pour qu’il soit permis de le traiter comme un banni obscur et méprisé. L’ostracisme qui el frappe est une calamité publique ! S’il s’obstinait cependant, contre mon atteinte, à franchir toutes les bornes raisonnables et légitimes de la forme et de l’invention, s’il arrivait à l’abyme qu’il peut déjà mesurer sans m’amender de son erreur et sans discerner ses périls, la poésie aura alors des pleurs bien amers à répandre, car je doute que la poésie eût jamais perdu davantage ; et vous ne me blâmeriez pas d’accorder à tant d’infortune quelques regrets respectueux. Les enfants mêmes savent le juste châtiment de ce prince téméraire qui exposa ses ailes de cire aux feux trop voisins du soleil, mais il est admirable d’avoir approché du soleil, et Icare a donné son nom à la mer où il est tombé.
J’attacherai peu d’importance dans ce genre d’innovation à ces témérités purement matérielles qui n’intéressent que l’apparence la plus extérieure d’un ouvrage d’esprit. Je ne m’irriterai point contre la fantaisie d’un rhythme inaccoutumé, s’il rachète sa bizarrerie par quelques avantages qui flattent mon oreille ou mon esprit ; s’il est d’ailleurs naturel, harmonieux, pittoresque, et surtout correct. Je ne me piquerai pas enfin d’être moins indulgent qu’Horace pour quelques taches légères, dans une composition que relèveront de toutes parts des beautés éblouissantes. Mais ici se bornera cette condescendance déjà bien vaste et bien facile qu’on ne saurait cependant refuser aux essais d’une époque de transition. On ne me verra donc pas approuver l’innovation audacieuse qui violerait à plaisir les lois de notre belle langue, et qui se ferait un jeu sauvage de la remplacer par un idiome de convention étranger à toutes les grammaires. On ne m’accusera point, j’espère, d’avoir prêté la faible autorité de mon exemple à cette innovation, plus dangereuse encore, qui va jusqu’à menacer les principes de la morale universelle, et dont j’ai le premier anathématisé le funeste délire, en signalant, il y a douze ans, à la critique de mon temps, l’invasion et les progrès d’une école frénétique. Renfermé par choix, dans des études solitaires qui me réduisent le plus souvent au commerce des anciens, je n’en sais rien aujourd’hui de ce pernicieux abus de l’art d’écrire, ou plutôt quelque facilité qui tient lieu d’art, que par la terreur et l’indignation qu’il a soulevées. Il est du moins consolant de penser qu’aucun talent vrai ne restera souillé de ces excès, même quand il aurait été entraîné un moment à les partager, par la fougue des passions ou l’approbation corruptrice des méchants. Les talents vrais peuvent s’égarer, mais ils ne peuvent pas se perdre, parce qu’il n’y a point de talent vrai hors d’une bonne conscience. Le mépris des mœurs publiques, des affections généreuses et des nobles sentiments, a pu gâter quelques beaux esprits d’une portée médiocre, mais il n’a jamais fait fort d’un grand homme à l’admiration et aux respects de la postérité.
Et comment ne serait-il pas juste et vertueux, le poète qui comprend sa mission, le poète qui se reconnaît assez de forces pour l’accomplir ? Comment pourrait-il oublier qu’aux jours malheureux où nous sommes, et quand les croyances ébranlées par l’ignorance malignité des sophistes ont perdu leur autorité salutaire sur la multitude, c’es dans ses nobles mains que la providence des sociétés a placé le sacerdoce ? Par quelle insigne méprise plongerait-il dans l’abyme le vol de sa muse créée pour les cieux ? Hélas ! il ne renoncerait pas à la plus vulgaire des qualités de son âme, sans abdiquer une des parties essentielles de son génie ; car c’est un caractère religieux et solennel, c’est un caractère auguste et sacré que celui dont la nature a investi les grands écrivains ! c’est un ministère d’élection qui leur donne le sceptre des âges ! Notre vieille mythologie nationale avait figuré leur empire par cet Hercule gaulois qui tient tous les peuples enchaînés à sa parole, et ce pouvoir sublime de l’éloquence, ne nous y laissons pas tromper sur la foi de quelques exceptions dont le temps a déjà fait justice, il n’appartiendra jamais qu’à des mœurs innocentes et austères.
Le poète dirait-il pour se justifier qu’il n’a fait que céder à l’exigence brutale d’un siècle avide de ce genre d’émotions ? Dieu le garde à jamais d’une humiliation aussi honteuse ! Qu’importe le caprice féroce des siècles mauvais ? Qu’importe leur suffrage ou leur blâme, leur faveur ou leur colère ? La fin des civilisations, ainsi que leur commencement, a des bacchantes pour les Orphées, je le veux croire, et Laya le savait. Eh bien ! cela est encore une consécration ! C’est une destinée différente pour le poète, mais ce n’est pas une moindre destinée ! Il y a des apothéoses sanglantes, et le ministre des sacrifices a distribué pour le moins autant de palmes que le ministre des triomphes. Oh ! qu’alors une chaste lyre est un précieux trésor, et que les victimes sont belles, quand elles sont pures !
Je le répète, Messieurs ! Hors de la ligne des devoirs moraux de l’homme, il ne faut plus chercher le talent. Il n’y est pas ! Et s’il pouvait s’y trouver une fois par un déplorable hasard, il vaudrait mieux que la littérature n’existât point, il vaudrait mieux qu’elle n’eût jamais existé ! La littérature est l’interprète des nobles sentiments. Elle est faite pour diriger les nations dans leur marche, et non pour les suivre dans leurs égarements. Elle porte un flambeau qui éclaire et non une torche qui dévore ! — Le sage qui vous a légué le devoir touchant de répartir ses bienfaits, appréciait avec justesse l’alliance du sublime instinct qui produit les beaux ouvrages et celui qui produit les belles actions. — Le génie et la vertu, c’est peut-être la même chose.
Je n’ai pas craint, Messieurs, de vous ouvrir toute mon âme, et elle n’a pas un mystère que je ne vous eusse révélé avec la même sincérité. Je sais que votre haute raison ne s’informe pas des vaines nuances de l’opinion, et je serais peu tenté de hasarder mes pas sur cette cendre ardente et mobile, si le dernier devoir qui me reste à remplir aujourd’hui ne me forçait à y passer en courant. — Après bien des combats obscurs dont ma vie civile porte encore les profondes cicatrices, je crois savoir enfin, et faites grâce à mon scepticisme si vous ne l’approuvez pas, que la plupart des secrets de la politique se résument pour le peuple en orgueilleuses déceptions, que les hommes de notre temps ont follement substituées à d’autres chimères, pour conserver des motifs apparents de se haïr et de se déchirer. J’ai placé le dernier asyle de mes jours fatigués bien loin de cette arène trompeuse. J’ai appris à fuir le présent pour le passé, pour l’avenir peut-être ! et c’est sans doute à ce désintéressement complet de position que j’ai dû l’avantage d’esquisser quelques scènes de l’histoire avec une candeur qui m’a quelquefois tenu lieu de talent, mais en m’isolant des choses humaines par mes théories, je suis resté homme par tous les sentiments qui attachent l’homme à l’humanité. J’ai perdu des illusions en grand nombre ; je n’ai point perdu d’affections. J’aime tout ce que j’aimais, et vous ne reconnaîtriez pas en moi le confrère que vous avez cru vous donner, si vous me trouviez capable de souiller cette gloire unique de ma vie par les basses palinodies d’un transfuge. Non, Messieurs, ma mémoire reconnaissante ne sera jamais infidèle à la vieillesse et à l’exil. Je sais trop, pour tomber dans cette indignité, qu’il n’y a point de crime plus lâche que la trahison, et point de trahison plus impie que celle qui renie l’infortune. Là cependant finissent les devoirs de l’homme, et je ne méconnais point les devoirs du citoyen qui se soumet avec respect aux pouvoirs établis par le suffrage des nations et affermis par l’invisible main qui les dirige à son gré. Heureux de vivre à une époque unique dans les annales du monde où il n’y a ni courage à braver la puissance royale, ni faiblesse à la défendre, je rends hommage sans effort à l’autorité protectrice qui laisse le droit de franchise à mon cœur, et il n’en coûte rien à mon indépendance de révérer dans un prince honnête homme le modèle de toutes les vertus privées, le protecteur des lettres et le modérateur des partis.
M. Droz
M. Arnault
M. Etienne
Inauguration de la statue de Cuvier, à Montbéliard
___________________________________
POUR L’INAUGURATION DE LA STATUE DE CUVIER,
À MONTBÉLIARD,
LE 23 AOûT 1835.
La députation était composée de MM. Charles NODIER, MICHAUD et ROGER.
Messieurs
Quand l’Académie française nous a chargés de la représenter dans cette cérémonie, elle n’ignorait point qu’au moment où nous prendrions la parole, Cuvier aurait déjà été dignement apprécié devant vous par l’orateur de l’Académie des sciences. C’est aux savants émules de cet homme immortel qu’il appartient de vous tracer le tableau de ses laborieuses conquêtes, de le suivre pas à pas dans ses sublimes découvertes, de vous le montrer, observateur assidu et patient architecte, sur les ruines du vieux monde, ressuscitant les créations passées, avec la Genèse et la nature, génie immense et complet dont la Providence avait marqué la place à la suite de nos philosophies ambitieuses et insensées, pour éclaircir tout ce qu’elles avaient obscurci, et pour démontrer tout ce qu’elles avaient nié !
Ce n’était point à ce titre, Messieurs, que l’Académie française crut devoir décorer son front glorieux d’une nouvelle couronne. Juge de la parole, de cette magnifique puissance qui est aussi une des belles créations de Dieu elle honora en Cuvier la faculté d’exprimer avec une élégante correction, et souvent avec une éloquente énergie les idées et les détails qui semblent se prêter le moins aux combinaisons du style et aux ornements du langage. L’Académie française avait admiré en lui, avec l’Europe entière, l’homme de savoir et de génie, qui donnait un autre univers à la pensée. Elle associa l’écrivain qui assouplissait notre langue à ces notions nouvelles sans l’appauvrir d’un faux luxe, comme l’aurait fait la médiocrité, si la médiocrité découvrait quelque chose. Cette double illustration du savant et de l’écrivain n’a jamais été fort commune dans nos fastes littéraires.
C’est que le privilège de rendre sensibles à toutes les intelligences les conceptions d’une intelligence élevée comme Cuvier l’a fait dans ses ouvrages techniques ; c’est que la propriété de raconter des faits vulgaires avec un charme entraînant, et d’exposer des théories sévères et profondes avec une lumineuse simplicité, comme Cuvier l’a fait dans ses excellents éloges académiques ; c’est que l’alliance du talent qui embrasse une méthode avec puissance, et du talent qui la développe avec les grâces vigoureuses d’un bon style, ne se trouve que chez ces esprits d’élite qui comprennent leur pensée dans tous ses éléments, qui la possèdent dans toute son étendue, qui la suivent dans toutes ses applications, et qui épanchent comme ils l’ont reçue, avec ordre et avec clarté. Bien concevoir et bien juger, dit le plus sage des poètes anciens, c’est l’art même de bien écrire. Descartes, Leibnitz, Malebranche, Buffon, Laplace, Cuvier, sont les modèles du langage comme les maîtres de la science. Un exemple tout récent a pu vous prouver que leur précieux secret n’était du moins pas perdu.
Il nous resterait une tâche bien difficile à remplir, Messieurs, si nous avions entrepris de peindre nos impressions dans cette noble ville qui s’enorgueillit si justement d’avoir vu naître Cuvier au pied de cette statue qui nous rappelle des traits si chers à notre mémoire et oserais-je le dire à notre amitié ; devant ce concours de citoyens pour lesquels sa perte, hélas ! est d’un souvenir si récent ! Ah ! nos discours n’ajouteraient rien à la pompe de cette inauguration le nom de Cuvier dit assez ; il est plus éloquent que nous !
Conservez bien, Messieurs, ce digne monument de la reconnaissance et de l’admiration d’un peuple éclairé et sensible monument durable, sans doute, et qui verra de longs siècles s’écouler sans subir les outrages du temps, mais moins durable cependant que la haute et pure renommée de Cuvier, qui se maintiendra vénérée dans la mémoire des hommes, quand tous les monuments des arts seront retombés sans forme dans ce monde matériel dont il a exhumé les débris.
Discours sur les prix de vertu 1836
_______________________________________________
Messieurs
II est impossible de s’occuper de la distribution des prix décernés à des actions vertueuses, sans se rappeler le fondateur de cette touchante institution. Consacrer une partie de sa fortune, je ne dis pas à récompenser la vertu, car la vertu n’attend point de récompense sur la terre, mais à la seconder dans ses bienfaits et à l’encourager dans ses sacrifices, c’est pratiquer aussi la vertu, et en laisser des marques dignes de louanges éternelles. Le riche qui use ainsi des biens que la Providence lui a départis, se rend digne de la représenter auprès des hommes, autant que le permet notre condition d’hommes, si impuissante et si bornée. Honneur soit donc rendu avant tout à M. de Montyon !
Vous savez pourquoi, Messieurs, l’Académie fut chargée de la gestion de ce legs pieux. M. de Montyon pensait qu’il n’appartient qu’à l’intelligence d’apprécier convenablement la vertu, qui n’est elle-même qu’une intelligence accomplie de nos devoirs et de notre destinée. La sensibilité, dit un poëte, c’est tout notre génie ; et la vertu, c’est le génie dans toute sa puissance, appliqué à la vie morale. Ses actes ont seulement cela de particulier qu’ils ne sont pas sujets à controverse comme les ouvrages du talent, parce qu’ils tombent d’eux-mêmes sous les sens de tout le monde ; et c’est ce qui m’a permis de croire qu’on pouvait se passer des ressources d’un grand talent pour les raconter.
Je n’ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que toutes les actions vertueuses qui signalent une nation comme la nôtre dans le cours d’une année, ne viennent pas s’offrir aux rémunérations de l’Académie. C’est un des caractères de la vertu de tenir ses bonnes œuvres dans l’ombre et le silence, et ce mystère délicat ajoute encore pour la plupart des âmes généreuses au charme qu’elles trouvent à les pratiquer ; mais la vertu la plus modeste ne peut se soustraire à l’éclat qui s’attache aux faits publics, et c’est sur les faits de ce genre que se fondent nos jugements. Les autres, qui sont bien plus communs, reçoivent leur prix dans le jugement particulier de la conscience, et n’ont rien à envier aux jouissances que procure la publicité. Nous devons toutefois, dans nos rétributions annuelles, des regrets respectueux à ces vertus cachées dont une curiosité indiscrète n’a pas soulevé le voile. Il y avait dans le Panthéon des anciens un autel réservé aux dieux inconnus.
L’Académie éprouve d’autres regrets encore quand le temps ramène la solennité qui nous rassemble. Quelque larges que soient les munificences du bienfaiteur de la vertu, la vertu dépasse heureusement ses prévisions, et nous sommes obligés de choisir entre une multitude d’actions presque également recommandables, pour ne pas rendre tout à fait illusoires les volontés libérales du donateur qui s’est proposé de porter une amélioration réelle dans l’existence de l’homme de bien. Ce choix a quelque chose de pénible pour nous, cette préférence quelque chose de cruel envers ceux qui n’en sont pas l’objet, et nous nous consolerions difficilement de ne pouvoir couronner tant d’actes généreux qui s’offrent de toutes parts à notre admiration si nous pensions que la vertu s’en offensât mais la vertu ne s’offense point d’être tenue au second rang, parce qu’elle n’ambitionne point de rang. La vertu n’est pas sujette aux irritations de l’esprit littéraire que les comparaisons humilient, et qui s’indigne de l’oubli. La vertu s’étonne plus du vain renom qu’on lui donne qu’elle ne s’en enorgueillit ; la vertu ne se décourage pas, quand on omet de lui rendre un témoignage qu’elle n’attend jamais ; la vertu sait à peine ce qu’elle est, et pourquoi elle est la vertu.
La distribution des actions vertueuses en différentes catégories, que l’Académie a pu se croire prescrite par la nature même de son mandat, n’est réellement qu’artificielle. En dernière analyse, toutes les vertus sont égales, quant au sentiment qui les fait agir. Les diversités qui se remarquent dans leur manifestation, résultent presque toujours du hasard des temps, des localités, des circonstances. L’occasion des dévouements héroïques se présente rarement ; mais il n’y a point d’âme vertueuse qui ne l’eût saisie avec empressement, si elle s’était présentée. Il y a aussi dans la vertu de la destinée et du bonheur. Ce qui a frappé surtout l’Académie, ce qui a paru mériter d’être distingué d’une manière spéciale, c’est la multiplicité dans les faits, c’est la persévérance dans la pratique. La vertu a des élans qui étonnent ; mais ce qu’il y a de plus admirable dans la vertu, c’est la patience d’une vie de résignation dont elle est devenue la seule pensée, parce que cette constance dans le bien est elle-même la plus rare des vertus. C’est d’après ce principe que l’Académie a distribué cette année la somme de 20,000 fr., dont le legs de M. de Montyon l’a rendue dépositaire. L’ordre qu’elle a suivi dans ses répartitions est celui que je vais suivre dans mon récit.
Louise-Renée Ménard, demeurant à Rennes, département d’Ille-et-Vilaine, est née en cette ville le 29 vendémiaire an VI. On a dit, avec quelque raison, que la vie des gens de bien était courte à raconter, mais cela ne serait point vrai de mademoiselle Ménard, dont la biographie demanderait un volume, si on voulait rapporter les innombrables actions de bienfaisance dont se compose cette vie consacrée à la charité. Qu’on s’imagine une âme intelligente et active, dont toute l’activité, dont toute l’intelligence est dirigée vers le bien, et qui ne connaît d’autre occupation que le soin de chercher le malheur pour le soulager. Le meilleur des princes regrettait un jour perdu ; mademoiselle Ménard n’a jamais eu à regretter un de ses moments, et les faits sont si pressés dans ce dévouement de toutes les minutes, qu’il semble qu’elle n’ait pu en accomplir un, sans se préparer à un autre. Nous citerons au hasard, et nous abrégerons beaucoup.
Mademoiselle Ménard, tourmentée depuis l’enfance de cette vocation de sacrifices qu’elle a si dignement remplie, aspirait, dès l’âge de treize ans, à entrer parmi les saintes filles de la charité. Elle avait obtenu dès lors l’autorisation de s’associer aux pénibles sollicitudes des dames de Saint-Vincent, de panser les plaies des malades, de laver le linge des pauvres et de consacrer à leurs besoins les petites économies qu’elle pouvait faire, c’est-à-dire l’argent réservé à sa toilette et à ses menus plaisirs. Sa mère, qui avait rêvé pour elle un autre avenir, obtint facilement de son confesseur qu’il l’arracherait à cette vertueuse abnégation d’elle-même, pour la rendre à la société, et son évêque daigna la détourner par de tendres et respectueuses paroles. Elle obéit, car elle n’ignorait pas que le premier de ses devoirs était d’obéir à sa mère ; mais elle ne put se soustraire à son insurmontable vocation, et resta, au milieu du monde qui ne l’avait reconquise qu’en apparence, la servante des malheureux. Sa réputation était si bien établie à cet égard, que les administrateurs de la ville de Rennes lui confièrent, en 1816, la direction d’un bureau de bienfaisance, et le droit de choisir les personnes qui devaient la seconder. Mademoiselle Ménard était à l’époque de la vie où le bonheur d’être jeune se fait sentir avec des séductions invincibles. Elle avait dix-huit ans.
Mademoiselle Ménard n’a dès lors plus de vœux à former. Elle entre en possession du seul bonheur qu’elle comprenne. Elle est, à dix-huit ans, la mère de neuf cents familles indigentes. Elle se multiplie pour les aider et pour les servir. Elle a deux cent cinquante distributions de soupe et de viande à faire aux infirmes toutes les semaines ; elle les élève à cinq cents. Et qu’on ne s’imagine pas qu’elle croie son ministère borné à quelques soins matériels qui ne pourvoient qu’aux nécessités du corps ; elle a les secrets du cœur, le langage qui se fait entendre de l’infortune, les paroles de l’espérance et de la consolation. Jamais elle n’a quitté la chaumière du pauvre ou le grabat du malade sans le laisser meilleur et plus heureux. On cite même des exemples d’infortunés qu’elle a réconciliés avec la vertu. Et qui fut jamais plus digne de la faire aimer ! Cependant, elle ne se contente point des bienfaits quotidiens que ses attributions l’autorisent à dispenser. La charité est insatiable comme l’ambition.
Tout ce qui souffre sur la terre, tout ce qui pleure, tout ce qui gémit, relève delà charité. C’est son empire, à elle, et il embrasse le monde. Un incendie réduit neuf familles à la misère ; mademoiselle Ménard adopte neuf familles de plus, obtient l’autorisation de quêter, mendie pour elles, et répare bientôt leurs pertes. Une salle d’asile où sont réunis de malheureux enfants qui gagnent quelques sous à la fabrication de la dentelle, est délaissée par la personne qui la dirige mademoiselle Ménard la remplace. Les rigueurs de l’hiver de 1830 font redouter l’irritation, hélas ! trop naturelle de la classe pauvre. Dans ces extrémités douloureuses et presque désespérées, le conseil municipal appelle mademoiselle Ménard ; des travaux sont distribués à ceux qui ont la force de travailler, huit mille quatre cents soupes à ceux qui ne l’ont plus ou qui ne l’ont pas encore. Et remarquez bien, Messieurs, ce grave sénat de la cité qui ouvre ses séances à une femme simple et obscure ; la vertu convoquée à l’administration des peuples, et reprenant, sans orgueil, des droits qu’elle n’aurait jamais dû perdre, entre la politique et l’éloquence impuissantes ! Quelque temps après, arrive le terrible fléau du choléra. L’héroïsme de mademoiselle Ménard a de nouvelles occasions de se déployer. Mademoiselle Ménard est partout où la mort menace une victime, et la mort est partout. Un malade s’échappe de l’hôpital, court en furieux dans les rues, où les plus hardis cherchent à éviter son approche, et tombe dans les bras de mademoiselle Ménard qui le suit. Il était mort.
Ai-je besoin d’ajouter, Messieurs, que tant de vertus sont encore relevées de cette modestie touchante qui accompagne toujours la vertu ? Vous en jugerez par les admirables expressions de M. l’évêque de Rennes : « Si elle devait lire, dit-il ce que j’écris avec connaissance de cause et la plus intime conviction, je me condamnerais au silence, tant est grand le respect que j’ai pour son humilité. »
Laurent Queter, âgé de trente-trois ans, est un poissonnier de Douai, qui s’est jeté trente-six fois dans la Scarpe, au hasard de sa propre vie, pour sauver la vie d’un de ses semblables. Sept fois il eut la douleur de ne ramener qu’un cadavre, mais vingt-neuf personnes lui ont dû l’existence en quinze ans. Il y a quelque chose d’instinctif dans le zèle courageux de Laurent Queter, quelque chose de providentiel dans son infaillible apparition au lieu du danger. C’est que, de nuit comme de jour, l’hiver comme l’été, il est toujours aux aguets d’un malheur à prévenir. Les circonstances les plus inattendues le trouvent si prompt à y pourvoir, qu’on croirait qu’il les devine. Laurent Queter est pauvre cependant, et son dévouement de tous les jours, une seule fois trahi par ses forces, laisserait sa famille sans ressources et sans appui ; mais rien ne peut le détourner de l’idée qu’il appartient avant tout au malheureux qui va mourir. Le Roi l’a récemment décoré de l’étoile de l’honneur. Les Romains lui auraient décerné vingt-neuf fois la couronne civique. L’Académie française n’a pas vingt-neuf couronnes à lui donner, mais elle a cru faire pour lui davantage, en l’admettant à partager la modeste couronne de Louise-Renée Ménard.
Elle a décidé qu’un premier prix de 8,000 francs serait divisé en deux parties égales, entre Louise-Renée Ménard, de Rennes, et Laurent Queter, de Douai.
La vertu de Queter est, si l’on peut s’exprimer ainsi, une vertu virile, qui implique la condition de la force. Revenons aux femmes, et occupons-nous d’un autre genre de courage, le courage patient de la charité. Jeanne Buo, fille d’un capitaine au long cours, est née au Croisic, le 14 mars 1763. Elle épousa, en 1802, François Aucoin, maître au cabotage, alors âgé de quarante-sept ans, et mort dernièrement plus qu’octogénaire, après plusieurs années de cécité complète. Comme il ne paraît pas qu’ils aient jamais eu d’enfants, ils s’accordèrent volontiers à consacrer leurs modiques épargnes au soulagement des pauvres. Vous savez, Messieurs, que les belles âmes ont dû penchant à s’associer, et que toutes leurs pensées se confondent dès lors dans une volonté commune.
Leur premier bienfait fut l’adoption d’une petite fille sans ressources appelée Marie Heurtin et qui, parvenue à l’âge de dix ans, allait tomber bientôt en proie à toutes les mauvaises inspirations de la misère. Ils lui donnèrent, avec cette tendre affection de la famille, qui vaut mieux que toutes choses, l’existence matérielle, l’éducation morale, et plus tard un ménage et un mari. Ce mariage ne fut pas heureux quant à la fortune, mais il fut extrêmement fécond. La pauvre Marie Heurtin, emportée en 1832, par le choléra, mourut dans les bras de sa bienfaitrice, et lui légua six enfants pour tout héritage. À cette époque, le vieux marin, aveugle depuis quatre ans, n’était dans la maison qu’un enfant de plus. Madame Aucoin supplée à tout, place les deux aînés en apprentissage, nourrit et habille les petits, et on les remarque pour leur propreté comme pour leur sagesse. Il fallait travailler pour fournir à tant de dépenses, et madame Aucoin avait soixante-neuf ans ; elle était borgne et infirme. Elle loue un four sans devenir boulangère, car elle n’était pas assez riche pour cela, mais elle fait cuire le pain des particuliers, et le pain qu’elle prélève, c’est le pain de ses charités. Il y a même du luxe ; une des domestiques du périt établissement, morte il y a deux ans, laissa deux jolis orphelins en bas âge, qui viennent tous les matins au four de madame Aucoin recevoir du pain et des caresses. Les autres libéralités de madame Aucoin sont sans nombre ; mais nous avons tant de choses à dire !
L’année dernière, la ville entière du Croisic avait demandé une couronne pour les époux Aucoin. Cette couronne, hélas ! trop tardive, madame Aucoin sera obligée de la rompre. Elle en déposera une moitié sur la fosse encore récente de son mari.
Il n’y a heureusement point de profession dont les devoirs ne puissent se concilier avec amour et la pratique de la vertu, mais il en est quelques-unes qui rendent cette alliance plus difficile et plus rare. Si les obstacles que la vertu rencontre dans ses développements, selon les circonstances où elle est placée, doivent ajouter à son mérite, vous partagerez sans effort le vif intérêt qu’inspire à l’Académie la noble conduite de Joseph-Nicolas Plège, né à Troyes en 1808, et acrobate de province. Plège avait manifesté dès l’enfance un excellent naturel qui s’est fortifié avec l’âge. Le pauvre funambule, à peine adulte, s’avisa tout à coup que sa vigueur et sa dextérité pouvaient être bonnes à autre chose qu’à l’amusement du peuple, et que le plus beau des tours de force était celui qui sauvait la vie d’un homme. À dix-huit ans, et sachant à peine nager, il retire du Rhône, à Lyon, deux ouvrières qui allaient périr. Un an après, il se distingue à Chinon dans un incendie, et arrache aux flammes des valeurs considérables qu’il remet intactes à leur propriétaire. En 1835, un incendie plus désastreux se déclare à la halle au blé d’Alençon, Piège, exercé à marcher sur des surfaces étroites et mobiles, se trouve partout où il y a des secours à porter. Le nommé Gérard est tombé, suffoqué par une épaisse fumée, dans une pièce que le feu entoure de toutes parts. Plège le rapporte vivant dans ses bras, et le plancher s’écroule derrière eux. Le nommé Alleaume est renversé par une poutre brûlante qui le blesse grièvement ; Piège le ramène vivant au milieu d’une pluie de feu qui n’est pas factice et inoffensive comme celles de son théâtre. Pour la troisième fois de cette nuit, le feu a gagné ses vêtements.
La troupe de Plège est dissoute à Caen. Le funambule regagne Alençon où il a laissé d’autres souvenirs que ceux de son agilité. La multitude est accourue pour le voir encore ; mais il a donné sa représentation de clôture ; il doit partir le lendemain, quand, pendant la nuit du 30 au 31 mai, un nouvel incendie se manifeste dans les écuries du sieur Maréchal, commissionnaire de roulage. Vous imaginez bien que Plège y est encore. Où serait Plège, si ce n’est où est le danger ? Un honnête ouvrier l’a cependant devancé pour détacher un soliveau que la flamme menace. La fumée l’entoure et le suffoque, il tombe, il disparaît. Plège se précipite après lui, et le sauve pour la seconde fois : car c’était ce brave Gérard qu’il avait déjà sauvé, Gérard qui lui doit deux fois la vie, après son père et après Dieu.
Ce n’est pas tout. Pour diriger plus utilement le jeu d’une pompe, il monte sur un toit prêt à crouler, qui surmonte encore, par une espèce de miracle, le foyer de l’incendie. Un autre digne homme, Hurel neveu, y était seul debout alors sur une solive qui se rompt. Plège le soutient d’un bras assuré au-dessus d’un abîme de feu et redescend avec lui du milieu des flammes, au grand étonnement et à la grande joie du peuple. Il était temps, dit le rapport qui nous a été adressé par les habitants, car le toit s’affaissait tout entier au moment où ils ont reparu.
L’auteur innocent de cette catastrophe, un domestique nommé François Brébion, en a été la première victime, et l’infortuné laisse une femme avec trois petits enfants. Plège, à demi privé de l’usage de ses pieds et de ses mains, Plège couvert de brûlures et de contusions, retarde son départ d’un jour, et donne une représentation à leur bénéfice. Il est assez touchant de voir cet homme qui vient d’accomplir les devoirs d’un héros, se croyant encore en arrière avec les malheureux, et leur payant pour adieu le tribut du funambule.
Plège a des mœurs douces et pures ; il est honnête homme et bon père de famille. Quel que soit son rang dans la société, il s’est donné dans l’ordre moral une place qui n’a rien à envier aux honneurs et aux dignités du monde. Ce funambule est un très-noble citoyen.
Jean-Baptiste Febvre, charron à Gripport, département de la Meurthe, est, comme Plège, un de ces hommes intrépides qui ne mettent jamais l’intérêt de leur vie en balance avec les devoirs de l’humanité, qui se multiplient par leur dévouement, et qu’une Providence attentive semble protéger contre les périls, parce qu’elle les réserve de loin pour d’autres actes de vertu. Il faut abattre la toiture d’une maison incendiée pour sauver celles qui l’environnent. Febvre abat la charpente, il s’abîme avec elle, et se relève. Joseph Maudru est tombé dans un puits profond de quarante pieds, dont la maçonnerie toute pleine n’offre pas un vide, pas une fente, pas un interstice où se cramponner ; Febvre s’abandonne à la faible corde du tour, soutenue seulement par les enfants du malheureux Maudru, car il est une heure du matin. Il le retire, il le fixe, évanoui, au seau mal assuré. Plongé dans une eau glaciale, il attend pour le suivre, qu’il soit certain de l’avoir sauvé. Si le tour échappe à la main débile des enfants, sa mort est cependant presque inévitable.
C’est d’un semblable accident que faillit être victime quelques années après un pauvre manœuvre, nommé Dominique Carnet. Au moment où il se faisait remonter du fond d’un puits de soixante-dix pieds qu’il venait de curer, le tour est retombé avec violence sur lui-même ; on n’a entendu qu’un cri accompagné d’un bruit sourd. Carnet doit être mort. Febvre apporte d’autres cordes, rajuste à la hâte l’instrument ébranlé par une si rude secousse, descend renvoie au dehors un corps sanglant, asphyxié, sans vie, dans lequel les spectateurs ne voient qu’un cadavre. Mais Febvre est retiré à son tour ; il se penche sur ce corps presque inanimé, il y sent battre un cœur, il l’emporte, il le lave, il le frictionne, il le ressuscite, ce n’est pas trop dire ; et quinze jours après, Dominique Carnet est rendu à ses enfants.
Il faudrait avoir quelque chose de l’infatigable activité de ce brave homme pour le suivre dans toutes les occasions où il signale son courage et son humanité, soit qu’il se précipite dans la Moselle pour en retirer un enfant, soit qu’il relève sur le grand chemin un malheureux saisi par le froid, et qu’il le porte de maison en maison, à d’assez grandes distances, trop souvent rebuté, faut-il le dire, par les refus de l’égoïsme ; soit qu’il arrête dans sa course un cheval furieux, en le saisissant par les narines, à l’instant où il va traverser des champs couverts de moissonneurs, et se laisse entraîner avec lui pendant l’espace de quelque cent toises, plutôt que de l’abandonner. On frémit de penser que ce cheval était chargé d’une faux posée en travers.
Vous plaindrez l’Académie, Messieurs, de n’être pas assez riche pour pouvoir attacher des prix égaux aux premiers à des actions qui doivent si peu de chose aux premières. Elle a éprouvé ce regret comme vous, en partageant, par portions égales, un prix de 6,000 francs entre la veuve Aucoin, Joseph-Nicolas Plège et Jean-Baptiste Febvre.
Six médailles de 1,000 francs chacune ont été distribuées aux six personnes dont il me reste à vous entretenir et il faut répéter encore que ces divisions obligées du petit trésor de M. de Montyon n’ont rien d’humiliant pour la vertu, car il n’y a pas de catégories dans la vertu.
Parmi tant de vertus que l’Académie s’est plu à couronner, il n’a pas été question jusqu’ici de piété filiale, et je n’ai pas besoin de vous en dire la raison. La piété filiale n’est pas une vertu, c’est un sentiment, c’est un devoir auquel on ne saurait se dérober sans ingratitude et sans crime. Veuille le ciel nous épargner l’affreux malheur de voir des jours où les enfants qui aiment et qui honorent leurs parents méritent d’être loués ! Il y a cependant telle ou telle circonstance où l’exercice de ce devoir exige une constance et un courage qui paraissent au-dessus des forces de l’humanité, et cette patience que rien n’a jamais lassée, ce dévouement qui ne s’effraye d’aucun sacrifice et d’aucune douleur, appartiennent aussi à la noble histoire des efforts et des triomphes de la vertu. Je chercherai à vous en donner un exemple, dont vous serez peut-être tentés de faire honneur à mon imagination.
Une pauvre fille de vingt-cinq ans a perdu à l’armée deux frères jeunes et forts, qui étaient le seul espoir des cinq frères et sœurs qui lui restent. Sa mère est infirme, son père est vieux. Elle quitte une bonne condition et de bons gages pour les aider de ses services. Presque au même temps, le père est attaqué d’une maladie étrange et horrible. Ses membres se rendissent, ses dents se resserrent, la vie l’abandonne si une main adroite et vigoureuse ne les sépare, et ne donne passage au sang qui va l’étouffer. Par un instinct qui vient de Dieu, la fille aînée a deviné ce mystère plutôt qu’elle ne l’a compris. Pendant dix ans, tous les jours, elle renouvelle ce terrible office. Elle s’y obstine, malgré la généreuse défense du vieillard qui ne revient à lui-même que pour pleurer sur les doigts déchirés, sanglants, presque mutilés de sa fille, l’ouvrière et le gagne-pain du ménage. Ils sont dépouillés jusqu’aux os, qu’elle s’obstine encore ; mais elle les lui cache avec soin. Elle avance un peu plus, un peu moins ; elle change de main ; elle ne se décourage pas, elle continue à traire, à couper l’herbe, à filer.
Le père meurt, la mère est sourde et aveugle, un troisième frère succombe à une maladie produite par de pénibles travaux, une sœur devient hydropique. La généreuse fille reste la mère de tous, la mère de sa famille et de sa mère, qu’elle appelle sa pauvre affligée. Ce qu’il y a de tendre dans son dévouement, d’héroïque dans sa patience, de naïf et d’éloquent dans ses paroles, ne peut se développer ici ; mais l’Académie verrait avec plaisir la publication du touchant mémoire qui lui a été adressé sur ce sujet, et que je resserre avec regret dans quelques lignes trop rapides ; car cette noble fille existe, Messieurs ; c’est Jeanne Parelle, de Coulange, près de Montrésor, département d’Indre-et-Loire.
Ce que Jeanne Parelle a fait pour accomplir les devoirs sacrés de la nature, Madeleine Lambert, de Tours, Indre-et-Loire, s’est prescrit de le faire pour remplir ceux de la reconnaissance. Des partis assez avantageux se sont offerts pour elle, car l’état de lingère qu’elle exerce lui pouvait tenir lieu de dot ; mais cet état, qui lui fournirait le moyen de vivre pauvrement sans être à charge à personne, c’est à Marie-Madeleine Laboureau qu’elle le doit, et Marie-Madeleine Laboureau est tombée depuis vingt ans en paralysie. Depuis vingt ans Madeleine Lambert se partage entre sa profession et celle de garde-malade, pour nourrir sa vieille maîtresse et pour la soigner. Je m’en tiens à ce fait ; mais les détails qui l’accompagnent ont prouvé à l’Académie que Madeleine Lambert est digne d’être associée à Jeanne Parelle.
Claudine Treille, de Saint-Just en Chevalet, département de la Loire, est âgée de quatre-vingts ans. Il faut se hâter de lui donner une couronne, car ces âmes bienveillantes qui devraient être immortelles sur la terre, sont sujettes comme les autres à remonter vers leur patrie céleste, avant d’avoir exécuté tous leurs desseins. La vie entière de Claudine Treille n’est qu’une longue pensée de vertu mise en action. Née d’une famille honorable et aisée, elle s’est consacrée depuis son enfance, comme Louise-Renée Ménard, aux devoirs de la charité ; mais ce qui paraît l’avoir frappée d’abord, c’est le défaut d’instruction du peuple, et je dois ajouter, pour la responsabilité de mon opinion personnelle, que cette excellente fille a compris ce que nous appelons l’instruction dans un sens plus restreint que ne le font quelques hardis théoriciens : elle entend par ce mot la lecture et le catéchisme. Plus libre de son temps et de sa petite fortune, elle établit une école gratuite où les enfants pauvres venaient chercher l’enseignement, et lui donna pour auxiliaire une espèce d’école nomade où elle portait elle-même l’enseignement à ceux qui ne pouvaient le recevoir chez elle. Les enfants retenus à la garde des troupeaux, c’étaient les externes du pensionnat de Claudine Treille ; institution touchante et sublime, dont elle était à la fois fondatrice, économe et professeur. Sa clientèle s’était agrandie. Les soins et les sacrifices d’un bon curé l’aidèrent à la placer sous une direction plus étendue, en appelant au secours de ses bonnes œuvres les respectables sœurs de Saint-Charles. Moins occupée dès lors, elle donna ses loisirs aux malades, car les loisirs de la vertu ne sont pas perdus pour l’infortune. Elle plaça ses religieuses entre une école et un hôpital, qu’elle enrichit d’une pharmacie avec l’aide des bonnes gens. Aujourd’hui encore vous verriez la vieille Claudine, appuyée sur deux bâtons, visiter tous les jours ses pieux établissements, et se délasser à filer sa quenouille, pour faire des draps et des chemises à ses pauvres. Ne croiriez-vous pas, Messieurs, que je viens de vous raconter l’histoire d’une sainte du moyen âge ?
Dans l’arrondissement de Coulommiers, près du village de Touquin, il y avait un endroit nommé les Boulets, et en cet endroit une pauvre chaumière habitée par quatre pauvres gens. C’est la famille Wist. Cette famille est portée pour 6 francs au rôle des contributions.
Il y a dix-huit ans que la femme Wist était venue chercher un nourrisson à Paris, dans l’espérance de se créer un moyen d’existence de plus. Bientôt le père de l’enfant disparut, sans que depuis on ait entendu parler de lui. Les mois de nourrice ne furent plus payés. Vaincue par la douleur et la misère, la mère mourut peu de temps après. Heureusement, il restait encore une mère à l’orphelin. C’était la femme Wist.
L’hospice pouvait s’ouvrir pour ce malheureux enfant ; mais il avait six ans ; il avait été entretenu de sentiments affectueux dont il ne pouvait plus se passer, car il savait aimer déjà ; il s’écria en pleurant : Je ne veux pas m’en aller ; et la mère pleurait aussi. Le père réfléchit un moment sur sa profonde misère, prit la main de sa femme et lui dit avec fermeté : « Je travaillerai davantage, s’il est possible ! Nous le garderons. »
C’est peu Messieurs. Cet infortuné, d’une belle et heureuse espérance est atteint d’une maladie affreuse dont le nom échappe à la médecine. Ses traits gracieux se contractent et se renversent, ses membres se tordent et se recourbent ; il devient incapable de porter la main à ses aliments, incapable de se mouvoir dans ses lambeaux. Il n’y a plus rien qui rappelle en lui une créature humaine, si ce n’est au cœur de sa mère. Aucune fatigue ne la rebute, aucun dégoût n’affaiblit son courage, aucune plainte n’échappe à sa bouche, et cependant ses épreuves se sont aggravées par des circonstances bien cruelles. Son mari est mort à la peine. Sa vache, autre nourrice de cette pauvre famille, est morte aussi. La généreuse veuve s’est soumise avec résignation à toutes les conséquences de son dévouement. Elle n’a pas même appelé la charité des autres à l’appui de la sienne. Une seule fois elle a prié son curé de lui procurer quelque linge, parce que le sien était usé, consommé, détruit, « parce qu’elle n’avait plus de quoi tenir blanchement son pauvre infirme. »
Il y a un genre de piété qui s’est, depuis quelques années surtout, profondément naturalisé dans le peuple, et qui mérite trop d’intérêt pour qu’on ne lui accorde pas tous les ans une mention. C’est la constante affection du domestique à un maître tombé dans l’infortune ; et permettez-moi, Messieurs, de rentrer ici dans mes attributions habituelles, pour vous rappeler que les Latins avaient merveilleusement caractérisé cette vertu, en donnant à leurs famuli et à leurs famulae un nom générique qui les rattachait à la famille. Le peuple, qui ne sait pas les étymologies, agit toutefois comme s’il les savait ; ce qui prouve au moins que les mots ne sont pas faits si arbitrairement qu’on le pense.
Marguerite Vanez, des Vosges, s’engagea, jeune encore, en qualité de cuisinière et de bonne d’enfants, au service de M. Bénit, lieutenant général au bailliage de Mirecourt. Il paraît que c’était en ce temps-là tout le domestique d’un président de cour.
Elle éleva cinq enfants ; elle prodigua ses soins les plus tendres à son vieux maître aveugle ; elle resta au service du fils aîné. Il s’était mis dans les affaires, elle lui confia ses épargnes, il subit une banqueroute qui lui enleva tout ; elle ne plaignit que lui. Son jeune maître, qui commençait à vieillir, sentit le besoin de réformer ses domestiques Marguerite ne voulut pas s’en aller.
M. Bénit le fils fut contraint de s’expatrier. Il avait fait des études fortes et utiles qui lui donnaient l’espérance de réparer ses pertes. Son trajet fut immense ; il ne s’arrêta qu’à Fernambouc au Brésil, où il trouva le moyen d’exister de sa profession de médecin. Mais avait-il tout ce qu’il faut, bon souper, bon gîte, et le reste, c’est-à-dire, quelqu’un qui l’aimât et qui le soignât à son gré ? Marguerite Vanez emballe le nécessaire, elle vend le superflu, elle se sépare de ses vieilles amies, elle dit un adieu qui doit être éternel à l’église où elle a coutume de prier pour l’âme de son maître mort ou pour la prospérité de son maître vivant. Marguerite s’embarque navigue et revoit M. Bénit, qui la baigne de larmes de reconnaissance et de joie. Elle avait soixante-douze ans.
Marguerite est revenue, après avoir adouci le sort de son protégé par sa tendresse, et l’avoir amélioré par son économie. Je ne la suivrai pas dans tous ses voyages ; mais que vous dirais-je de plus ? Voilà une pauvre créature qui a traversé plus de mers que Fernand Cortez, Colomb ou Gama, et ce n’était pas pour conquérir un monde : c’était pour remplir un devoir, et pour satisfaire un sentiment.
Sur six médailles de mille francs, vous voyez, Messieurs, qu’il en a été accordé cinq à des femmes. C’est qu’une femme, une bonne femme, est l’expression vivante de la charité. Mais cette douce vertu n’est pas étrangère aux hommes les plus énergiques, dans le pays même où l’énergie, exaltée par l’influence du ciel, de la nature et des mœurs, n’est souvent qu’une puissance aveugle au service des passions. Orso-Giuseppe Pieri, du village des Prunelli de Fiumorbo, département de la Corse, ne connaît de passion que la charité.
Quoique peu aisé, il recueille un pauvre inconnu, accablé de fatigue, de vieillesse et de maladies il lui donne des vêtements, des aliments, des remèdes ; il le garde pendant un an dans sa modeste maison ; il le sauve de la misère et du désespoir.
Un homme va périr dans le Fiumorbo. Pieri s’y précipite tout vêtu, et rend un père de famille à ses enfants. Une maison brûle, et l’incendie est près d’atteindre le réduit où se cachent deux enfants de cinq à six ans. Pieri s’enveloppe d’un linge mouillé, traverse la maison enflammée, et les rend à leurs parents.
Cela, c’est le courage de quelques circonstances extraordinaires ; mais la charité de Pieri est de tous les jours. Sa porte n’est jamais fermée au voyageur, sa main ne l’est jamais à l’indigent. Le digne curé de Pieri compare son habitation hospitalière à celle du patriarche Abraham. C’est que du temps de Pieri, comme de celui d’Abraham, une piété solide est la source la plus sûre de la vertu.
Ces nombreux récits, Messieurs, trop longs pour l’espace qui m’était donné, trop courts pour des développements auxquels la mesure et la forme de ce rapport ne me permettaient pas de me livrer, et dont j’ai eu souvent peine à me défendre, vous feront assez comprendre les incertitudes et l’embarras de l’Académie.
Entre tant de faits qui honorent au même degré la vertu et l’humanité, tout le monde aurait hésité comme nous ; c’était déjà l’opinion d’un vieil académicien qui vivait longtemps avant l’institution des prix Montyon et qui s’appelait Jean de la Fontaine. Il exprimait les mêmes doutes dans une fable délicieuse que vous n’avez pas oubliée, et nous nous arrêtons à son jugement
À qui donner le prix ? Au cœur, si l’on m’en croit.
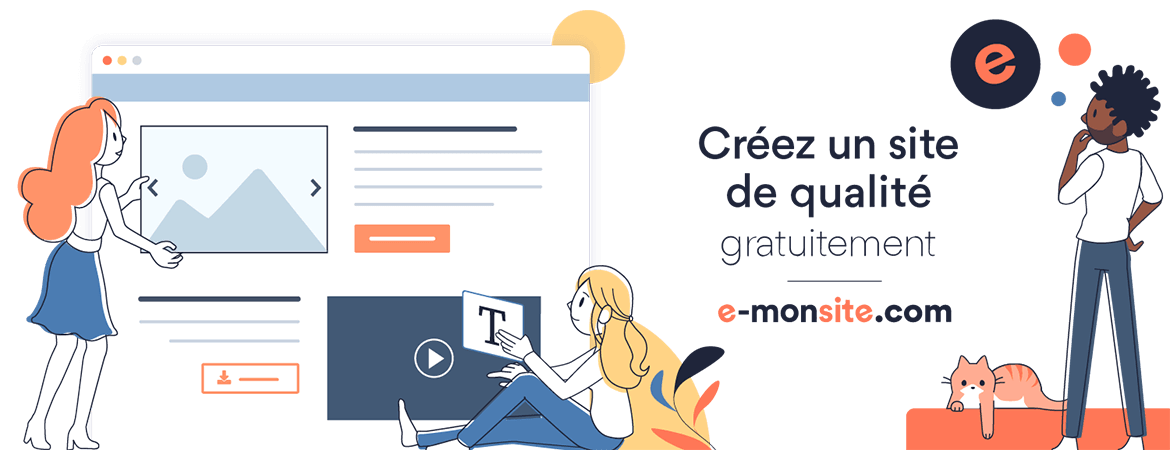

 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa
 Swedish
Swedish
 Romanian
Romanian
 Polish
Polish
 Norwegian
Norwegian
 Finnish
Finnish
 Bulgarian
Bulgarian
 Danish
Danish
 Czech
Czech
 Croatian
Croatian
 Hindi
Hindi
 Russian
Russian
 Chinese (Simplified)
Chinese (Simplified)
 Japanese
Japanese
 Arabic
Arabic