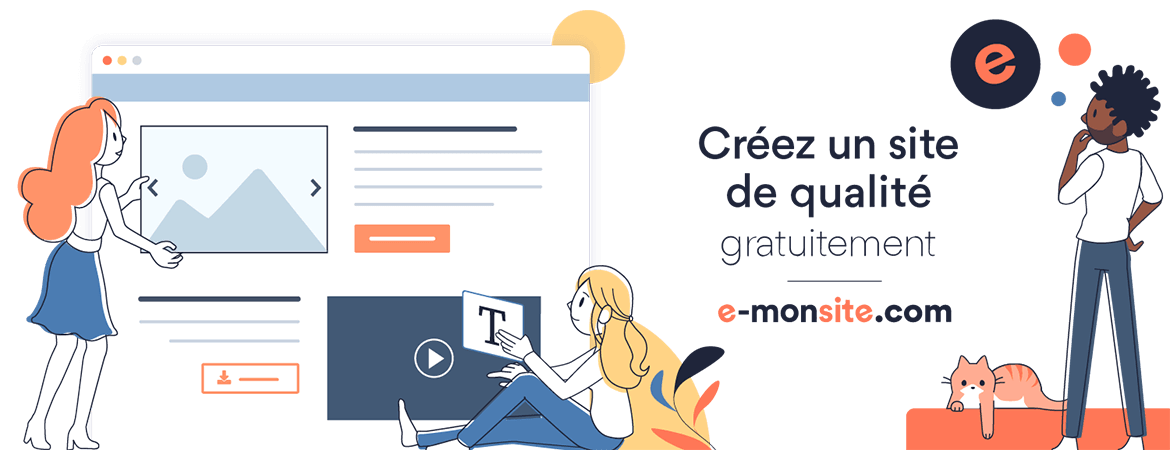- Accueil
- Portraits d'écrivains
- Montesquieu
Montesquieu

Personnalité essentielle du siècle des Lumières, Montesquieu a marqué le monde intellectuel en tant que philosophe de l’Histoire et figure fondatrice de la science politique. Il a laissé l’image d’un aristocrate impassible, sagace et pondéré, à l’instar des vieux sages Romains qu’il a fait ressurgir dans la culture de son temps. Cette représentation correspond à une certaine réalité, qui est cependant beaucoup plus complexe. Car Montesquieu possède plusieurs facettes, tant il est éclectique et son œuvre bigarrée, à l’exemple de sa vie qui semble si lisse et est pourtant bien plus animée qu’il n’y paraît.
Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède (il n’héritera le titre de Montesquieu qu’à la mort de son oncle, en 1716) naît dans la propriété familiale en Guyenne, en 1689. Après des études chez les Oratoriens, puis à l’université de droit de Bordeaux dont il sort licencié en 1708, il monte à Paris pour s’initier à la pratique des affaires tout en complétant sa culture littéraire. La mort de son père en 1713 le ramène à La Brède, où il reprend la gestion de ses vignobles qui périclitaient pour en faire une affaire extrêmement rentable, le mettant à l’abri du besoin. Sa fortune augmente encore par son mariage avec une riche héritière protestante, qui lui apporte 100 000 livres de dot et lui donnera trois enfants. Devenu conseiller du Parlement de Bordeaux (1714), Président à mortier (1716) et membre de l’Académie de la ville, il devient un notable incontournable de la région. Outre ses différentes charges, il écrit beaucoup, sur des sujets très divers : économie, religion, histoire, et surtout sur les sciences : écho, éclair, aimant, pesanteur. Il envisage même une Histoire physique de la Terre, qui ne verra jamais le jour.
Illustration pour Le Temple de Gnide
Carte d’Europe divisée en ses empires et royaumes
Tout change en 1721. Il publie un roman épistolaire, les Lettres persanes, qui connaît un succès foudroyant. Ce récit de deux orientaux venant en Europe donne une vision décalée et ironique de la société française et rend son auteur célèbre. Sa réputation lui permet d’être introduit dans la haute société parisienne. Délaissant La Brède, il fréquente assidument les salons de la capitale, notamment celui de Madame Lambert qui l’aidera à devenir membre de l’Académie Française en 1727. Il continue d’écrire, notamment le Temple de Gnide qui obtient en 1725 un triomphe. Durant cette période, il côtoie les Grands du royaume, la fine fleur de la littérature et de l’art, et poursuit quelques aventures galantes, sans lendemain. En 1726 il quitte brusquement Paris et cette vie mondaine, suite peut-être à une rupture amoureuse avec une mystérieuse « belle Comtesse ».
Libre professionnellement (il a vendu sa charge de Président à mortier), riche (sa fortune est évaluée à 550.000 livres), curieux, à la recherche aussi d’un poste diplomatique (mais le ministère ne donnera pas suite), il se lance dans un grand périple, suivant la tradition aristocratique du « Grand Tour » qui voyait les nobles sillonner l’Europe. Parti à Vienne en avril 1728, cette expédition dure trois ans : il visite la Hongrie, séjourne en Italie, notamment à Rome où il reste six mois, traverse l’Allemagne et les Pays-Bas avant de s’installer à Londres pendant un an et demi. Même s’il se divertit en chemin (théâtre, opéra), c’est avant tout un voyage d’études. Tout l’intéresse, de l’éruption du Vésuve à la franc-maçonnerie à laquelle il sera initié en Angleterre, des fortifications aux visages des gens rencontrés, des paysages à la diplomatie. Il enquête, discute, observe, et note tout, accumulant ainsi un ensemble phénoménal de connaissances.
Londres, vue de la Bourse royale
Son retour en France en mai 1731 inaugure une nouvelle phase de sa vie, studieuse, calme et posée. Retiré à La Brède, il agrandit son domaine, établit ses enfants, et continue d’écrire. Des contes : Arsace et Isménie, Histoire véritable, mais surtout ses réflexions sur le monde, la politique, le pouvoir. Dès 1734, Les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence sont une méditation sur l’Histoire à travers celle de la Rome antique. On y trouve déjà quelques idées force : l’évolution des sociétés dépend de l’interrelation entre plusieurs facteurs concrets, comme la géographie, la culture, la religion, etc. Il est très critiqué, et certains, pastichant le titre de son livre, parlent de la « décadence » de Montesquieu. Mais celui-ci élargit son horizon, appliquant au monde entier les principes décrits dans son ouvrage. Il s’attelle à un travail de quinze ans : cela donne L’Esprit des lois.
De l’Esprit des lois
De l'Esprit des lois
Publié à Genève en 1748, cette vaste composition mêle sociologie, droit, économie, politique, institutions. Il y analyse les différents types de gouvernements, développe ses théories sur le climat, la séparation des pouvoirs, l’éloge des corps intermédiaires, etc.
C’est peu dire que l’accueil de l’Esprit des lois fut froid. Certains, comme Voltaire ou Fréron, furent très réservés. Madame Du Deffand alla jusqu’à persifler que ce livre ne faisait que de « l’esprit sur les lois ». Mais les attaques les plus virulentes vinrent de l’Eglise, qui ne pouvait accepter que l’action des hommes soit détachée de la volonté divine. Le livre fut mis à l’Index en 1751, et condamné par la Sorbonne en 1754. Affaibli, devenu presque aveugle, Montesquieu va pourtant se battre : en 1750 il expose une Défense de L’Esprit des lois. Il met également en ordre toutes ses notes, qui seront publiées plus tard sous les titres Mes Pensées et Spicilège, revoit certaines de ses œuvres, rédige pour l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert un article sur le Goût. Il décède le 12 février 1755 à Paris, d’une fièvre maligne, refusant sur son lit de mort des corrections à L’Esprit des lois que lui tendait un jésuite. Seul de tous les gens de lettres Diderot assistera à son enterrement.
Montesquieu est depuis sa mort continuellement étudié, analysé, critiqué, tant son influence a été et est encore immense. Mais son héritage est ambigu. D’un côté, il est totalement inséré dans l’élite sociale et culturelle de son temps. Loin d’être subversif, c’est un grand seigneur, dont le but est la perpétuation du nom, la continuité de la lignée, l’agrandissement de ses terres. Certains l’ont même catalogué comme réactionnaire, expliquant que sa défense des corps intermédiaires ne fait que camoufler une apologie de sa classe sociale et une défense des privilèges nobiliaires. À l’inverse, Montesquieu rompt radicalement avec l’idéologie de son temps en évacuant Dieu, le hasard ou le rôle prédominant des grands hommes dans l’Histoire. Il défend également et systématiquement la liberté, la tolérance, l’universalisme. C’est un précurseur dont se réclameront les philosophes des Lumières qui écriront après lui.
Mirabeau, l’orateur du peuple
Au-delà du portrait de théoricien qu’a sculpté pour lui la postérité, Montesquieu est également un écrivain. Son œuvre littéraire est abondante, car il n’a cessé toute sa vie de rédiger contes, romans, nouvelles. Les Lettres persanes qui n’étaient considérées pendant deux siècles que comme un brouillon de son chef d’œuvre, un délassement de l’auteur, sont maintenant réévaluées, comme ses écrits plus personnels, Mes Pensées et Spicilège, publiés seulement au XXe siècle et depuis souvent réédités et longuement analysés. On a beaucoup glosé sur son style, assez différent de celui de ses contemporains : phrases simples, logique démonstrative, éliminant le superflu pour aller à l’essentiel : « Pour bien écrire, disait-il, il faut sauter les idées intermédiaires, assez pour n’être pas ennuyeux ; pas trop de peur de n’être pas entendu ». Et toujours un humour sous-jacent, qui transparaît dans sa façon de justifier l’originalité et la nouveauté de son écriture : « Un homme qui écrit bien n’écrit pas comme on a écrit, mais comme il écrit, et c’est souvent en parlant mal qu’il parle bien. »

À bien des égards, Montesquieu peut apparaître comme le type même du « philosophe » de la première moitié du XVIIIe siècle. À un intérêt précoce et persévérant pour la spéculation appliquée aux problèmes bien concrets du bonheur des hommes et des équilibres de leur vie en groupe, il allia en effet une pratique sociale qui le mit en contact expérimental avec à peu près toutes les réalités possibles : la culture classique, le nouvel élan « moderne », l'exercice du droit, les objets de l'histoire naturelle, l'exploitation de terres et de vignes, la gestion d'un patrimoine, la dissipation mondaine, le succès parisien, le « grand tour » européen, le monde des livres, le divertissement d'une écriture libertine, la maturation longue et épuisante d'un immense projet intellectuel. Sur tout ce qui pouvait occuper un homme de ce temps il exerça une curiosité tenace (« Tout m'intéresse, tout m'étonne », fera-t-il dire à Usbek), si bien qu'il aborda à lui seul dans sa vie tous les objets qu'on a vu retenir chacun de ses contemporains. Cela n'alla certes pas sans contradictions : malgré la sérénité dont il est resté une sorte d'emblème, malgré la jouissance d'un bonheur qui semble lui avoir été donné avec une évidence tranquille, et dont témoignent ses Pensées, il n'ignore pas que ces merveilleuses acquisitions dont il voit tout le monde autour de lui s'emparer, s'orner, se targuer, la nature, la raison, la liberté, ne sont que des principes ; que le savoir n'est lui-même qu'une virtualité et que ses constructions sont toujours relatives. Le plus grand Montesquieu est peut-être le moraliste – quoiqu'il n'ait écrit aucun ouvrage suivi de morale – parce que tout chez lui a dépendu de cette exigence avec laquelle il a habité ces principes, incarné cette virtualité, maintenu les équilibres par l'exercice d'une volonté lucide et vigilante. En cela aussi il accomplit dans sa vraie et totale dimension le projet des Lumières naissantes : mettre l'homme au centre du monde, c'était lui reconnaître des droits nouveaux, mais aussi lui découvrir de nouveaux devoirs. Morale moins austère et grave (« la gravité est le bouclier des sots ») qu'enjouée et stimulante, car c'est elle qui va mettre en branle une enquête passionnée sur tout, sur les rapports de chaque chose avec les autres, pour l'intelligence du monde humain. La philosophie, pour Montesquieu, c'est ce qui « a des rapports avec tout ».
Dessiner la perspective ordonnée de cette œuvre multiple n'est pas facile pour trois raisons principales, dont l'énoncé même, pourtant, suggère une perspective possible, dans un autre ordre où la rationalité joue moins le rôle de repère fixe et d'instrument sûr que de leurre indispensable et toujours insaisissable : une raison idéologique (la poursuite d'une lisibilité complète du politique est toujours à la fois interrompue et relancée par le refus de tout système totalisant), une raison éthique (l'analyste ne fait jamais abstraction de lui-même et croit de sa dignité d'homme de réintroduire le jugement subjectif dans l'examen objectif des faits), et une raison esthétique (grand artiste rococo, Montesquieu professe que « pour bien écrire, il faut sauter les idées intermédiaires »). Le postulat de base est simple : « Ce n'est pas la fortune qui domine le monde. » Il renvoie dos à dos ceux qui sont toujours prêts à donner à cette fortune le nom de Providence (Bossuet par exemple) et ceux qui, la référant au pur hasard, renoncent à toute possibilité de la connaître, de la prévoir ou d'agir sur elle (les pyrrhoniens convaincus, ou simplement tactiques comme Pascal). Non la fortune, donc, mais un enchaînement de causes et d'effets, un système de gravitation qu'on devrait pouvoir calculer. Les trois grands ouvrages de Montesquieu sont autant de jalons de ce calcul, ou plutôt d'expériences visant à en affiner la méthode.
Dossier des Lettres persanes
Les Lettres persanes
Expérience, d'abord, d'un départ. Riche et puissant seigneur d'Ispahan, Usbek décide de voyager en Europe « pour aller chercher la sagesse », accompagné de son jeune ami Rica. Leur voyage les mène de Perse en Turquie, puis à Livourne et enfin à Paris, où ils découvrent une société inconnue et déroutante. Elle exerce à la fois leur verve satirique (surtout celle du jeune Rica) et leur réflexion philosophique (surtout celle d'Usbek, qui s'est mis en tête de rechercher « quel était le gouvernement le plus conforme à la raison »). L'échange épistolaire entre eux et avec leurs amis restés en Orient leur permet de confronter toutes sortes d'expériences historiques, géographiques, religieuses, sociales, politiques, et les pousse à la recherche des principes susceptibles de rendre compte de cette prodigieuse diversité. Cependant l'absence du maître a troublé la marche habituelle de son sérail, sur laquelle il ne s'était jamais posé de questions. Ce trouble amène ses femmes et ses eunuques à décrire dans le détail les principes, de plus en plus bafoués, du fonctionnement du sérail. Trop pris par ce à quoi il assiste en France, où la Régence vient de bouleverser l'ancien système politique, Usbek ne répond pas aux appels pressants qui lui sont adressés pour son retour, jusqu'au moment où, par la volonté d'une femme, sa favorite Roxane, tout explose et se termine dans un bain de sang. La structure du livre rend plausible l'hypothèse selon laquelle cette révolution finale constituerait la dernière et la plus importante des leçons qu'Usbek était allé chercher au loin, qu'il n'avait pas su voir dans sa propre maison, et qui n'a pu lui être administrée que parce que, justement, il en était parti. Mais la même structure invite aussi à mettre en relation cette catastrophe orientale et l'effondrement de l'expérience occidentale (échec du « libéralisme » politique et économique de la Régence).
L'inégalable génie des Lettres Persanes tient à une équivoque qu'aucune lecture critique ne peut lever, parce qu'elle est fondatrice de l'écriture même du livre et se retrouve à tous les niveaux de sa facture : entre le sérieux (la recherche d'un « esprit » des lois a déjà commencé et nombre de lettres sont de véritables dossiers pour cette recherche) et le plaisant (la verve satirique et parodique est insolente à souhait et comble les rieurs de tout poil) ; entre le roman (« une espèce de roman », dit ironiquement l'Avertissement de 1754) et le traité (onze lettres par exemple, de la 112e à la 122e, ne sont que le découpage d'une véritable étude sur la « dépopulation », c'est-à-dire le recul de la démographie sur le globe) ; entre la description réaliste (qui fait de ce texte un précieux document pour les historiens de la période) et le recours au mythe (à trois reprises : les fameux Troglodytes de la 11e à la 14e lettre, l'histoire d'Aphéridon et d'Astarté à la 67e lettre, et le conte d'Anaïs à la 141e lettre; entre la lucidité naïve (d'un regard non prévenu sur les mœurs françaises) et le naïf aveuglement (hérité d'une culture orientale non distanciée) ; entre Usbek et Rica, le vieil homme et l'homme nouveau, les deux poches de la même besace ? L'instrument principal de cette réussite est sans doute la forme épistolaire, qui rend actives toutes ces équivoques, et bien d'autres. Par le succès et l'exemple de son livre, Montesquieu a beaucoup contribué à la fortune, dans tout le siècle, de cette forme qui exalte, plus que tel message ou sa nature ou sa vérité ou sa beauté, la fonction d'échange interactif de la littérature : une relecture des « Tableaux chronologiques » des chapitres du présent ouvrage permettra de mesurer la remarquable extension de la forme-lettre dans tous les genres et au cœur vibrant du mouvement philosophique.

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
La deuxième expérience est celle d'un retour. Retour aux sources de la civilisation de l'Europe chrétienne : Rome. Après l'aventure d'un voyage ouvert à toutes les surprises, c'est maintenant le regard surplombant sur le champ entier d'une histoire close sur elle-même, celle de la croissance, de la grandeur et de la décadence des Romains. Beaucoup moins originale que la précédente, cette initiative valut aux Considérations... de Montesquieu beaucoup moins de faveur qu'aux Lettres persanes. Un grand nombre d'histoires de la Rome antique avaient fleuri, fleurissaient et devaient fleurir encore, et cela sentait son exercice d'école. L'histoire romaine de Montesquieu, pourtant, se différencie radicalement de toutes les autres. La méthode qui s'y cherche vise à faire dépendre les vicissitudes de la Cité, non plus d'un cycle fatal menant toute chose vivante successivement à l'accroissement, à la maturité, à la déperdition et à la mort, ni d'une action décisive des grandes personnalités historiques (Scipion, Caton pour la grandeur, César et ses successeurs pour la décadence), mais de la logique interne d'un jeu de causes complexes, matérielles et morales, dont le dispositif d'ensemble, composant les variations de chacun de ses éléments, finit par entraîner la Cité dans un sens ou dans l'autre. Tenant encore du roman (l'examen d'une seule civilisation aligne ses expériences successives comme une histoire à rebondissements, et, comme le Fénelon de Télémaque avec les sages Grecs, Montesquieu suit avec un intérêt passionné les aventures de ses chers Romains »), les Considérations annoncent déjà, malgré leur spécification historique, la généralisation de l'enquête et son inscription dans toute l'amplitude de l'espace philosophique.
De l’Esprit des lois
De l'Esprit des lois
La troisième expérience, en effet, mobilisa plus de moyens et d'énergie que les deux autres réunies, trop même sans doute pour un seul homme, qui s'y épuisa. Elle aboutit à une somme magistrale (prise en charge de toutes les institutions et habitudes sociales de l'Antiquité, du Moyen Age, de l'Europe moderne, du Proche-, du Moyen- et de l'Extrême-Orient, des Amériques, de l'Afrique : une documentation énorme et si disparate !) qui, comme toujours chez Montesquieu, ne se présente pas comme telle, ni dans la facture (chapitres inégaux et émiettés, ruptures du propos, fragments), ni dans les conclusions (suspendues, relatives, voire contradictoires). De même qu'on simplifie couramment son titre (De l'esprit des lois ou Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, etc.), il est nécessaire, pour présenter L'Esprit des lois, d'en simplifier le contenu sans en trahir la démarche. L'objet est de découvrir la règle – positive, valable en tous temps et en tous lieux, déterminée par des facteurs contrôlables et mesurables – selon laquelle se constituent, fonctionnent et évoluent les institutions que fabriquent les hommes pour organiser leur vie collective.
L'idée même de soumettre cet ordre de faits à une juridiction scientifique était hardie et nouvelle. Les appels à la « loi naturelle » prenaient volontiers celle-ci comme un absolu et rejetaient dans une relativité à peu près indifférenciée toutes les lois positives. Pour Montesquieu, c'est cette relativité même qu'il convient de différencier, pour que l'étude de ses variations puisse donner quelque prise sur elle, puisque aussi bien elle est la seule que rencontrent les hommes dans leur existence empirique. Relatives si l'on veut, mes lois me sont chères car c'est d'elles que dépendent ma vie et mon bonheur. Et puisqu'elles sont relatives, regardons quelles sont ces relations et comment elles agissent. Le programme épistémologique, on le voit, ne craint pas d'être à la fois historique, géographique, psychologique, sociologique, juridique, économique, politique, philosophique, moral et esthétique, bref, de postuler pour tout ce qu'on n'appelle pas encore les sciences humaines la même cohérence que celle démontrée par Newton dans le monde physique. Sans aboutir à une formulation unique et claire de cette « loi des lois », Montesquieu a fourni à ceux qui, comme lui et après lui, croient utile de la chercher nombre de concepts opératoires qui sont autant de figures poétiques. Parmi eux, la célèbre définition des divers gouvernements possibles selon la nature du pouvoir exercé, le principe de leur bon fonctionnement dans le comportement des gouvernés et la cause de leur corruption :
« Comme il faut de la vertu dans une république et dans la monarchie de l'honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despotique : pour la vertu, elle n'est point nécessaire, et l'honneur y serait dangereux. Le pouvoir immense du prince y passe tout entier à ceux à qui il le confie. Des gens capables de s'estimer seraient en état d'y faire une révolution. Il faut donc que la crainte y abatte tous les courages et y éteigne jusqu'au moindre sentiment d'ambition (III, 9). »
« Il faut » ? C'est le ton de la description fonctionnelle. Il est bien certain que Montesquieu accorde plus de valeur à la vertu ou à l'honneur qu'à la crainte. Mais la meilleure façon de lutter contre le despotisme, comme ailleurs contre le colonialisme et surtout l'esclavage (XV, 5), n'est-ce pas d'en connaître les conditions et les mécanismes ? Au reste, si ses préférences avouées vont à la monarchie, également éloignée des deux excès que sont la violence du peuple et celle du tyran, mais aussi intermédiaire entre le regret nostalgique d'un passé républicain révolu et le danger toujours menaçant de la dérive absolutiste, il ne la fige pas en un modèle abstrait et immuable : il y en eut et il y en a plusieurs réalisations, dont la française – qu'il vaut mieux s'abstenir de juger –, dont l'anglaise – que rien n'empêche d'admirer. La séparation des pouvoirs – législatif, exécutif, judiciaire – lui semble en effet avoir atteint, dans la monarchie anglaise issue de la Glorious Revolution, son degré maximum d'efficacité dans la sauvegarde des équilibres, toujours menacés.
Autre concept opératoire, celui des « climats » : par ce terme on doit entendre l'ensemble des déterminations géographiques (nature et étendue du sol, température et météorologie, productions pour la subsistance). Selon que le pays est plus grand ou plus petit, plus chaud ou plus froid, plus apte à la navigation, à l'agriculture ou à la chasse, il recourra plutôt à telle ou telle forme de gouvernement. Le despotisme, par exemple, convient davantage aux contrées chaudes, à cause du relâchement de la volonté et du goût de la mollesse voluptueuse que provoque la chaleur. Les petits territoires s'accommodent mieux de la République, où tous se connaissent, que les grands, etc. En ajoutant à ces déterminations des climats celles des traditions, des mœurs, de la démographie, des ressources, du commerce et même de la religion – qu'il ne craint pas de traiter comme un facteur parmi d'autres –, Montesquieu construit un modèle extrêmement complexe qu'il appelle l'« esprit général » d'une nation. Celui-ci influence le choix du gouvernement, est à son tour modifié par la manière dont ce gouvernement agit, et une modification significative de l'équilibre des forces qui le constituent ne peut manquer d'entraîner la chute du régime établi et son remplacement par un autre. Si on ne cantonne pas cet « esprit général » dans son rôle politique, c'est à peu près ce qu'on désignerait aujourd'hui par le terme de « culture », à condition de le situer au point de départ des énergies créatrices d'une collectivité et non au point d'arrivée de ses célébrations officielles : précisément la situation qu'occupent L'Esprit des lois et son auteur dans notre horizon culturel, si on les enlève aux théoriciens pour les rendre à la littérature.
Contrairement à ce qu'en ont dit certains, hostiles ou trop enthousiastes, L'Esprit des lois n'est pas une bible. C'est, équipé de mille appareillages et dispositifs textuels performants, un laboratoire de la chose politique, où l'on peut fabriquer à loisir une monarchie bien tempérée par les pouvoirs intermédiaires des notables (c'était, semble-t-il, le choix de Montesquieu), un idéal républicain (la Révolution l'a élu parmi ses textes fondateurs), un libéralisme conséquent (ils ne le sont pas tous). Ni finaliste ni mécaniste, son déterminisme est de ceux – Diderot saura s'en souvenir – qui laissent la part belle à la liberté et à l'invention des hommes. Il est bien digne de ce modèle d'homme de laboratoire, de texte et de générosité qu'on appelait alors « le philosophe ».
Personnalité essentielle du siècle des Lumières, Montesquieu a marqué le monde intellectuel en tant que philosophe de l’Histoire et figure fondatrice de la science politique.

De L'esprit des lois est aujourd'hui reconnu comme un modèle en termes d'argumentation et d'ironie, notamment pour dénoncer la rhétorique utilisée pour justifier l'esclavage au XVIIIe siècle. De l'esprit des lois est en effet considéré comme un des textes antiesclavagistes les plus importants en Europe.
Une famille d'aristocrates
Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède (il n’héritera le titre de Montesquieu qu’à la mort de son oncle, en 1716) naît dans la propriété familiale en Guyenne, en 1689. Après des études chez les Oratoriens, puis à l’université de droit de Bordeaux, il monte à Paris pour s’initier à la pratique des affaires tout en complétant sa culture littéraire.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Un notable bordelais
À la mort de son père en 1713, il reprend la gestion de ses vignobles et devient conseiller du Parlement de Bordeaux (1714), Président à mortier (1716) et membre de l’Académie de la ville : il devient un notable incontournable de la région. Parallèlement, il écrit sur des sujets très divers.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
une Oeuvre majeure
les Lettres Persannes
Les Français ne parlent presque jamais de leurs femmes ; c'est qu'ils ont peur d'en parler devant des gens qui les connaissent mieux qu'eux. »
Lettre LV. Rica à Ibsen
Le succès fulgurant des Lettres persanes, en 1721, lui ouvre les portes des salons parisiens et de l'Académie française. L'étonnement des deux persans découvrant Paris est le prétexte à une critique des mœurs et des institutions politiques et religieuses.
Deux voyageurs Persans, Usbek et Rica, visitent la France entre 1712 et 1720. Ils font part de leurs impressions à leurs amis avec lesquels ils échangent des lettres. C’est avec un regard neuf, amusé, parfois stupéfait, qu’ils observent les mœurs et les coutumes françaises. Bien des habitudes paraissent absurdes ou ridicules.
-------------------------------------------------------
Paroles
----------------------------------------------

« Ceux qui mettent au jour quelque proposition nouvelle sont d'abord appelés hérétiques. »
Lettre XXIX. Rica à Ibben
---------------------------------------------------------
Les hommes sont comme les plantes, qui ne croissent jamais heureusement, si elles ne sont bien cultivées. »
Lettre CXXIII. Usbek à Rhedi.
---------------------------------------------------------
« Rien ne contribue plus à l’attachement mutuel que la faculté du divorce : un mari et une femme sont portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu’ils sont maîtres de les faire finir. »
Lettre CXVII. Usbek à Rhedi.
----------------------------------------------------------
« On dit que l'homme est un animal sociable. Sur ce pied-là, il me paraît qu'un Français est plus homme qu'un autre, c'est l'homme par excellence; car il semble être fait uniquement pour la société. »
Lettre LXXXVIII. Rica à ***
--------------------------------------------------------
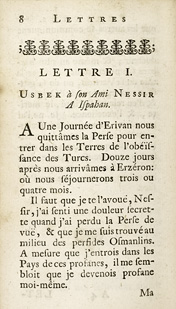
Premières impressions des Persans à Paris
________________________________________________________________________________
Lettre XXIV.
Rica à Ibben.
À Smyrne.
Les embarras de Paris. Critique de la monarchie française et du pape.
------------------------------------------------------------------------------
Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois.
Paris est aussi grand qu'Ispahan: les maisons y sont si hautes, qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a six ou sept maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée; et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras.
Tu ne le croirais pas peut-être, depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a pas de gens au monde qui tirent mieux partie de leur machine que les Français; ils courent, ils volent: les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien: car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête; mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour; et un autre qui me croise de l'autre côté me remet soudain où le premier m'avait pris; et je n'ai pas fait cent pas, que je suis plus brisé que si j'avais fait dix lieues.
Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes: je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner.
Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son voisin; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre; et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées.
D'ailleurs ce roi est un grand magicien: il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets; il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. S'il a une guerre difficile à soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.
Ce que je dis de ce prince ne doit pas t'étonner: il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape: tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu'un; que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce
Et, pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l'habitude de croire, il lui donne de temps en temps, pour l'exercer, de certains articles de croyance. IL y a deux ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appela constitution, et voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l'égard du prince, qui se soumit aussitôt, et donna l'exemple à ses sujets; mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent, et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte qui divise toute la cour, tout le royaume et toutes les familles. Cette constitution leur défend de lire un livre que tous les chrétiens disent avoir été apporté du ciel: c'est proprement leur Alcoran. Les femmes, indignées de l'outrage fait à leur sexe, soulèvent tout contre la constitution: elles ont mis les hommes de leur parti, qui, dans cette occasion, ne veulent point avoir de privilège. Il faut pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal; et, par le grand Ali, il faut qu'il ait été instruit des principes de notre sainte loi: car, puisque les femmes sont d'une création inférieure à la nôtre, et que nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point dans le paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un livre qui n'est fait que pour apprendre le chemin du paradis?
J'ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent du prodige, et je ne doute pas que tu ne balances à les croire.
On dit que, pendant qu'il faisait la guerre à ses voisins, qui s'étaient tous ligués contre lui, il avait dans son royaume un nombre innombrable d'ennemis invisibles qui l'entouraient; on ajoute qu'il les a cherchés pendant plus de trente ans, et que, malgré les soins infatigables de certains dervis qui ont sa confiance, il n'en a pu trouver un seul. Ils vivent avec lui: ils sont à sa cour, dans sa capitale, dans ses troupes, dans ses tribunaux; et cependant on dit qu'il aura le chagrin de mourir sans les avoir trouvés. On dirait qu'ils existent en général, et qu'ils ne sont plus rien en particulier: c'est un corps; mais point de membres. Sans doute que le ciel veut punir ce prince de n'avoir pas été assez modéré envers les ennemis qu'il a vaincus, puisqu'il lui en donne d'invisibles, et dont le génie et le destin sont au-dessus du sien.
Je continuerai à t'écrire, et je t'apprendrai des choses bien éloignées du caractère et du génie persan. C'est bien la même terre qui nous porte tous deux; mais les hommes du pays où je vis, et ceux du pays où tu es, sont des hommes bien différents.
De Paris, le 4 de la lune de Rebiab, 2, 1712
Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes, 1721.
Texte intégral sur Gallica : Paris, Baudouin frères, 1828
__________________________________________________
Lettre XLVI.
Usbek à Rhedi.
À Venise.
En quoi consiste l’essence de la religion.
------------------------------------------------------------
Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la religion ; mais il me semble qu’ils combattent en même temps à qui l’observera le moins.
Non seulement ils ne sont pas meilleurs chrétiens, mais même meilleurs citoyens, et c’est ce qui me touche : car, dans quelque religion qu’on vive, l’observation des lois, l’amour pour les hommes, la piété envers les parents, sont toujours les premiers actes de religion.
En effet, le premier objet d’un homme religieux ne doit-il pas être de plaire à la divinité, qui a établi la religion qu’il professe ? Mais le moyen le plus sûr pour y parvenir est sans doute d’observer les règles de la société et les devoirs de l’humanité ; car, en quelque religion qu’on vive, dès qu’on en suppose une, il faut bien que l’on suppose aussi que Dieu aime les hommes, puisqu’il établit une religion pour les rendre heureux ; que s’il aime les hommes, on est assuré de lui plaire en les aimant aussi, c’est-à-dire en exerçant envers eux tous les devoirs de la charité et de l’humanité, et en ne violant point les lois sous lesquelles ils vivent.
Par là, on est bien plus sûr de plaire à Dieu qu’en observant telle ou telle cérémonie : car les cérémonies n’ont point un degré de bonté par elles-mêmes ; elles ne sont bonnes qu’avec égard et dans la supposition que Dieu les a commandées. Mais c’est la matière d’une grande discussion : on peut facilement s’y tromper ; car il faut choisir les cérémonies d’une religion entre celles de deux mille.
Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière : "Seigneur, je n’entends rien dans les disputes que l’on fait sans cesse à votre sujet. Je voudrais vous servir selon votre volonté ; mais chaque homme que je consulte veut que je vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière, je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais pas non plus en quelle posture je dois me mettre : l’un dit que je dois vous prier debout ; l’autre veut que je sois assis ; l’autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n’est pas tout : il y en a qui prétendent que je dois me laver tous les matins avec de l’eau froide ; d’autres soutiennent que vous me regarderez avec horreur si je ne me fais pas couper un petit morceau de chair. Il m’arriva l’autre jour de manger un lapin dans un caravansérail. Trois hommes qui étaient auprès de là me firent trembler : ils me soutinrent tous trois que je vous avais grièvement offensé ; l’un, parce que cet animal était immonde ; l’autre, parce qu’il était étouffé ; l’autre enfin, parce qu’il n’était pas poisson. Un brachmane qui passait par là, et que je pris pour juge, me dit : " Ils ont tort : car apparemment vous n’avez pas tué vous-même cet animal. — Si fait, lui dis-je. — Ah ! vous avez commis une action abominable, et que Dieu ne vous pardonnera jamais, me dit-il d’une voix sévère. Que savez-vous si l’âme de votre père n’était pas passée dans cette bête ? " Toutes ces choses, Seigneur, me jettent dans un embarras inconcevable : je ne puis remuer la tête que je ne sois menacé de vous offenser ; cependant je voudrais vous plaire et employer à cela la vie que je tiens de vous. Je ne sais si je me trompe ; mais je crois que le meilleur moyen pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la société où vous m’avez fait naître, et en bon père dans la famille que vous m’avez donnée."
De Paris, le 8 de la lune de Chahban 1713.
Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes, 1721.
Texte intégral sur Gallica : Paris, Baudouin frères, 1828
______________________________________________________________________________________________
Lettre XXX.
Rica au même.
À Smyrne.
Curiosité des Parisiens.
-------------------------------------------
Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel: vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi; les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui m'entourait. Si j'étais aux spectacles, je voyais aussitôt cent lorgnettes dressées contre ma figure: enfin jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux: Il faut avouer qu'il a l'air bien persan. Chose admirable! Je trouvais de mes portraits partout; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu.
Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à la charge: je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare; et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan, et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique ; car j'entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche ; mais, si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais Persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement: Ah! ah! monsieur est Persan? C'est une chose bien extraordinaire! Comment peut-on être Persan?
A Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712.
Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes, 1721.
Texte intégral sur Gallica : Paris, Baudouin frères, 1828
___________________________________________________________________
Lettre XCIX.
Rica à Rhedi.
À Venise.
Inconstance des mœurs et des modes en France.
Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais, surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode.
Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leurs parures? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers, et, avant que tu n’eusses reçu ma lettre, tout serait changé.
Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s’y était oubliée trente ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l’habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger; il s’imagine que c’est quelque Américaine qui y est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu’une de ses fantaisies.
Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d’une femme au milieu d’elle-même. Dans un autre, c’étaient les pieds qui occupaient cette place : les talons faisaient un piédestal, qui les tenait en l’air. Qui pourrait le croire ? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d’élargir les portes, selon que les parures des femmes exigeaient d’eux ce changement, et les règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit quelquefois sur le visage une quantité prodigieuse de mouches1, et elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents ; aujourd’hui, il n’en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu’en disent les mauvais plaisants, les filles se trouvent autrement faites que leurs mères.
Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes : les Français changent de mœurs selon l’âge de leur roi. Le Monarque pourrait même parvenir à rendre la Nation grave, s’il l’avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la Cour; la Cour, à la Ville, la Ville, aux provinces. L’âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres.
De Paris, le 8 de la lune de Saphar, 1717
Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes, 1721.
Texte intégral sur Gallica : Paris, Baudouin frères, 1828
____________________________________________________
Lettre CXXXVIII.
Rica à Ibsen.
À Smyrne.
Les effets du système de Law, tentative de réforme financière sous la Régence en 1720.
----------------------------------------------------------------
Les ministres se succèdent et se détruisent ici comme les saisons. Depuis trois ans j'ai vu changer quatre fois de système sur les finances […] Il faut que de grands génies travaillent nuit et jour ; qu'ils enfantent sans cesse, et avec douleur , de nouveaux projets ; qu'ils écoutent les avis d'une infinité de gens qui travaillent pour eux sans en être priés ; qu'ils se retirent et vivent dans le fond d'un cabinet impénétrable aux grands, et sacré aux petits; qu'ils aient toujours la tête remplie de secrets importants, de desseins miraculeux, de systèmes nouveaux; et qu'absorbés dans les méditations, ils soient privés de l'usage de la parole, et quelquefois même de celui de la politesse.
[…] La France, à la mort du feu roi, était un corps accablé de mille maux : Noailles prit le fer à la main, retrancha les chairs inutiles, appliqua quelques remèdes topiques. Mais il restait toujours un vice intérieur à guérir. Un étranger est venu qui a entrepris cette cure : après bien des remèdes violents, il a cru lui avoir rendu son embonpoint ; et il l'a seulement rendue bouffie.
Tous ceux qui étaient riches il y a six mois sont à présent dans la pauvreté ; et ceux qui n'avoient pas de pain regorgent de richesses. Jamais ces deux extrémités ne se sont touchées de si près. L'étranger a tourné l'état comme un fripier tourne un habit : il fait paraitre dessus ce qui était dessous ; et ce qui était dessus il le met à l'envers. Quelles fortunes inespérées, incroyables même à ceux qui les ont faites ! Dieu ne tire pas plus rapidement les hommes du néant. Que de valets servis par leurs camarades, et peut-être demain par leurs maîtres !
Tout ceci produit souvent des choses bizarres.
Les laquais, qui avoient fait fortune sous le règne passé, vantent aujourd'hui leur naissance : ils rendent à ceux qui viennent de quitter leur livrée dans une certaine rue, tout le mépris qu'on avait pour eux il y a six mois : ils crient de toutes leurs forces : La noblesse est ruinée ! quel désordre dans l'état! quelle confusion dans les rangs ! on ne voit que des inconnus faire fortune ! Je te promets que ceux - ci prendront bien leur revanche sur ceux qui viendront après eux, et que dans trente ans ces gens de qualité feront bien du bruit.
De Paris, le premier de la lune de Zilcadé, 1720.
Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes, 1721.
Texte intégral sur Gallica : Paris, Baudouin frères, 1828
_________________________________________________
Lettre CLXI.
Roxane à Usbek.
À Paris.
Lettre de défi de Roxane à Usbek.
-----------------------------------------------------
Oui, je t’ai trompé ; j’ai séduit tes eunuques ; je me suis jouée de ta jalousie ; et j’ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs.
Je vais mourir ; le poison va couler dans mes veines. Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n’est plus ? Je meurs ; mais mon ombre s’envole bien accompagnée : je viens d’envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde.
Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices ? que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d’affliger tous mes désirs ?
Non : j’ai pu vivre dans la servitude, mais j’ai toujours été libre : j’ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s’est toujours tenu dans l’indépendance.
Tu devrais me rendre grâces encore du sacrifice que je t’ai fait ; de ce que je me suis abaissée jusqu’à te paraître fidèle ; de ce que j’ai lâchement gardé dans mon cœur ce que j’aurais dû faire paraître à toute la terre ; enfin, de ce que j’ai profané la vertu, en souffrant qu’on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies.
Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l’amour. Si tu m’avais bien connue, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine.
Mais tu as eu longtemps l’avantage de croire qu’un cœur comme le mien t’était soumis. Nous étions tous deux heureux : tu me croyais trompée, et je te trompais.
Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu’après t’avoir accablé de douleurs, je te forçasse encore d’admirer mon courage ? Mais c’en est fait : le poison me consume ; ma force m’abandonne ; la plume me tombe des mains ; je sens affaiblir jusqu’à ma haine ; je me meurs.
Du sérail d’Ispahan, le 8 de la lune de Rébiab 1, 1720.
Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes, 1721.
Texte intégral sur Gallica : Paris, Baudouin frères, 1828
Explications de Montesquieu sur son livre.
Rien n'a plu davantage dans les Lettres persanes que d'y trouver, sans y penser, une espèce de roman. On en voit le commencement, le progrès, la fin ; les divers personnages sont placés dans une chaîne qui les lie. A mesure qu'ils font un plus long séjour en Europe, les mœurs de cette partie du monde prennent dans leur tête un air moins merveilleux et moins bizarre; et ils sont plus ou moins frappés de ce bizarre et de ce merveilleux, suivant la différence de leurs caractères. D'un autre côté, le désordre croît dans le sérail d'Asie, à proportion de la longueur de l'absence d'Usbek, c'est-à-dire à mesure que la fureur augmente, et que l'amour diminue.
D'ailleurs, ces sortes de romans réussissent ordinairement, parce que l'on rend compte soi-même de sa situation actuelle; ce qui fait plus sentir les passions que tous les récits qu'on en pourrait faire. Et c'est une des causes du succès de quelques ouvrages charmants, qui ont paru depuis les Lettres persanes.
Enfin, dans les romans ordinaires, les digressions ne peuvent être permises que lorsqu'elles forment elles-mêmes un nouveau roman. On n'y saurait mêler des raisonnements, parce qu'aucuns des personnages n'y ayant été assemblés pour raisonner, cela choquerait le dessein et la nature de l'ouvrage. Mais, dans la forme des lettres, où les acteurs ne sont pas choisis, et où les sujets qu'on traite ne sont dépendants d'aucun dessein ou d'aucun plan déjà formé, l'auteur s'est donné l'avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et de la morale, à un roman et de lier le tout par une chaîne secrète, et en quelque façon inconnue.
Les Lettres persanes eurent d'abord un débit si prodigieux, que les libraires mirent tout en usage pour en avoir des suites. Ils allaient tirer par la manche tous ceux qu'ils rencontraient « Monsieur, disaient-ils, faites-moi des Lettres « Persanes. »
Mais ce que je viens de dire suffit pour faire voir qu'elles ne sont susceptibles d'aucune suite encore moins d'aucun mélange avec des lettres écrites d'une autre main, quelque ingénieuses qu'elles puissent être.
Il y a quelques traits que bien des gens ont trouvés trop hardis; mais ils sont priés de faire attention à la nature de cet ouvrage. Les Persans, qui devaient y jouer un si grand rôle, se trouvaient tout-à-coup transplantés en Europe, c'est-à-dire dans un autre univers. Il y avait un temps où il fallait nécessairement les représenter pleins d'ignorance et de préjugés on n'était attentif qu'à faire voir la génération et le progrès de leurs idées. Leurs premières pensées devaient être singulières il semblait qu'on n'avait rien à faire qu'à leur donner l'espèce de singularité qui peut compatir avec de l'esprit; on n'avait à peindre que le sentiment qu'ils avoient eu à chaque chose qui leur avait paru extraordinaire. Bien loin qu'on pensât à intéresser quelque principe de notre religion, on ne se soupçonnait pas même d'imprudence. Ces traits se trouvent toujours liés avec le sentiment de surprise et d'étonnement, et point avec l'idée d'examen, et encore moins avec celle de critique. En parlant de notre religion ces Persans ne devaient pas paraitre plus instruits que lorsqu'ils parlaient de nos coutumes et de nos usages. Et s'ils trouvent quelquefois nos dogmes singuliers, cette singularité est toujours marquée au coin de la parfaite ignorance des liaisons qu'il y a entre ces dogmes et nos autres vérités. On fait cette justification par amour pour ces grandes vérités, indépendamment du respect pour le genre humain, que l'on n'a certainement pas voulu frapper par l'endroit le plus tendre. On prie donc le lecteur de ne pas cesser un moment de regarder les traits dont je parle comme des effets de la surprise de gens qui devaient en avoir, ou comme des paradoxes faits par des hommes qui n'étaient pas même en état d'en faire. Il est prié de faire attention que tout l'agrément consistait dans le contraste éternel entre les choses réelles et la manière singulière, naïve ou bizarre dont elles étaient aperçues. Certainement la nature et le dessein des Lettres persanes sont si à découvert, qu'elles ne tromperont jamais que ceux qui voudront se tromper eux-mêmes
Montesquieu
Lettres persanes, 1721.
Texte intégral sur Gallica : Paris, Baudouin frères, 1828
Ils en ont parlé
Marivaux
« Je ne vois qu’un homme d’esprit qui badine, mais qui ne songe pas assez qu’en se jouant il engage quelquefois un peu trop la gravité respectable de ces matières [Marivaux parle ici de la religion] »
(Le Spectateur français, 8 septembre 1722)
Diderot
« Quel livre contraire aux bonnes mœurs, à la religion, aux idées reçues de philosophie et d’administration, en un mot à tous les préjugés vulgaires et par conséquent plus dangereux que les Lettres persanes ? Que nous reste-t-il à faire de pis ? Cependant il y a cent éditions des Lettres persanes, et il n’y a pas un écolier des Quatre-Nations qui n’en trouve un exemplaire sur le quai pour ses douze sols »
(Lettre sur le commerce de la librairie, 1763)
Abel Villemain
« C’est le plus profond des livres frivoles, ce livre si bien écrit, si vif, si moqueur, si fait pour amuser le public, après l’ennui des dernières années de Louis XIV, et pour le faire réfléchir, après l’orgie de la Régence »
(Cours de littérature française, XVIIIe siècle, 1847)
Gustave Lanson
« Montesquieu est tout juste apte à railler la curiosité frivole des badauds parisiens, la brillante banalité des conversations mondaines, à noter que les femmes sont coquette, et les diverses formes de fatuité qui se rencontrent dans le monde. Il n’y a pas ombre de pénétration psychologique dans les Lettres Persanes »
(Histoire de la littérature française, 1903)
Fortunat Strowski
« C’est un récit, c’est un roman. Pardon ! c’est plus qu’un roman. Si l’on compare ces amusantes Lettres avec l’Esprit des Lois, leur vraie valeur apparaît sans incertitude. Non seulement elles soulèvent, chemin faisant, les divers problèmes que l’Esprit des lois va analyser, mais encore elles traitent un même problème essentiel ».
(Montesquieu, 1912)
Georges Ascoli
« Il y a dans les Lettres Persanes un roman. Nous ne nous y intéressons plus guère : il affadit la verte âpreté de tant de pages »
(Histoire de la littérature française, 1923).
Paul Valéry
« Entre un Orient de fantaisie et un Paris réduit à ses facettes, instituer un commerce de lettres par quoi le sérail, les salons, les intrigues des sultanes et les caprices des danseuses, les Guèbres, le Pape, les muftis, les propos de café, les rêves du harem, les constitutions imaginaires, les observations politiques s’entrecroisent, c’était donner le spectacle d’un esprit dans sa pleine vivacité, quand il n’a pas d’autre loi que d’étinceler »
(Variété 2, 1930)