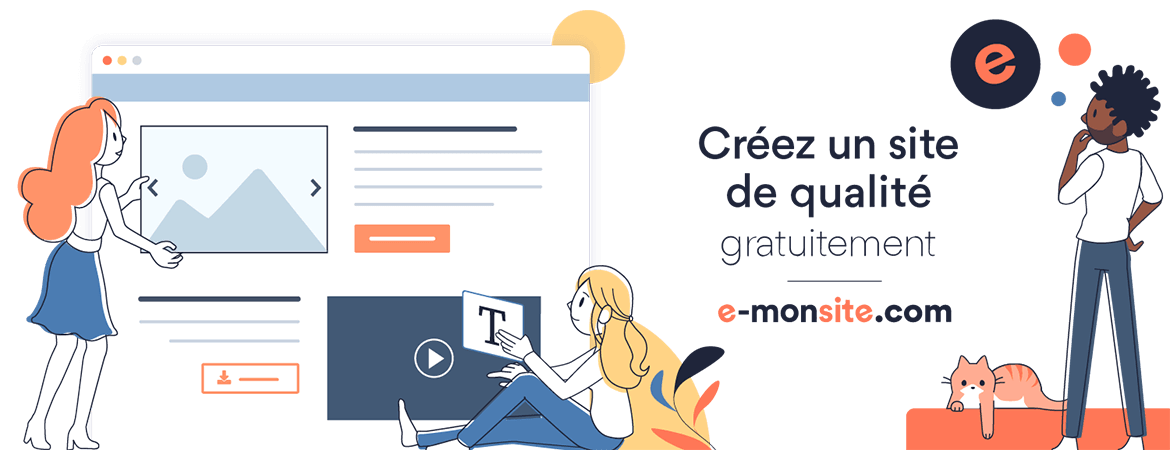- Accueil
- Pages
- Carnet des auteurs de Théâtre
- Carlo Goldoni
Carlo Goldoni
Portrait de
Carlo Goldoni
 arlo Goldoni est né en 1707 à Venise. Sa carrière de juriste sera vite éclipsée par sa passion du théâtre. Mais il rêve d'une grande "réforme". En effet, seule la Commedia dell'arte règne encore en maître dans les théâtres italiens et fait figure de tradition nationale. Or, il critique avec virulence ce théâtre, comme l'illustre sa phrase qui suit : "il ne passait sur les scènes publiques que de dégradantes arlequinades, de honteuses et scandaleuses galanteries, d'immondes jeux de mots, des intrigues mal venues et, de plus, malmenées, sans moeurs, sans ordre..." (A noter toutefois qu'il parle ici de la Commedia dell'arte française en pleine décadence à son arrivé en 1762 au pays de Molière.)
arlo Goldoni est né en 1707 à Venise. Sa carrière de juriste sera vite éclipsée par sa passion du théâtre. Mais il rêve d'une grande "réforme". En effet, seule la Commedia dell'arte règne encore en maître dans les théâtres italiens et fait figure de tradition nationale. Or, il critique avec virulence ce théâtre, comme l'illustre sa phrase qui suit : "il ne passait sur les scènes publiques que de dégradantes arlequinades, de honteuses et scandaleuses galanteries, d'immondes jeux de mots, des intrigues mal venues et, de plus, malmenées, sans moeurs, sans ordre..." (A noter toutefois qu'il parle ici de la Commedia dell'arte française en pleine décadence à son arrivé en 1762 au pays de Molière.)
Carlo Goldoni, que l'on surnomme le "Molière italien", d'abord fidèle à la tradition, va petit à petit parvenir à supplanter les pièces à canevas par des pièces écrites de bout en bout, à retirer les masques des acteurs et composer de véritables "comédies de caractère". En 1750, dans la pièce "Pamela", pour la première fois, les acteurs jouent à visage découvert.
Admirateur de Molière, il est également fasciné par la société et ses travers, comme l'illustre bien "La trilogie de la villégiature". Selon lui, le 18ème siècle est celui de la femme, régnant incontestablement dans tous les domaines, que ce soit des arts, de la politiques et des relations sociales. Son Arlequin déclare d'ailleurs, dans "Femmine puntigliose" : "Le sexe triomphe et les hommes sont réduits au rang d'esclaves enchaînés." Ses héroïnes de caractère sont nombreuses : le nombre de ses pièces portant des noms féminins le prouve. Elles incarnent le charme et la vivacité de la pièce, et aussi une nouvelle conception de la vie, par les héroïnes, qui, cette fois, ne repose pas uniquement sur le mariage. Les héroïnes de Goldoni annoncent l'émancipation et le réveil de la femme : elle a une situation sociale, sait diriger les affaires et prend en main son avenir.
Goldoni arrive en France en 1762 et y passe ses trentes dernières années. Il présente au roi Louis XV sa réforme du théâtre. Il meurt en 1793.
Goldoni ne tue pas pour autant la Commedia dell'arte. Il apporte un nouveau théâtre en Italie, comme Molière l'a fait en France.
Au total, Carlo Goldoni a écrit en 20 ans plus de 200 pièces d’importances diverses et dans différents genres : tragédies, intermèdes, drames, livrets d’opéra ou saynètes de carnaval ; mais ce sont ses comédies, écrites après 1744 qui assurent sa célébrité.
Carlo Goldoni a transformé la comédie italienne par ses productions plus que par ses écrits théoriques (Il teatro comico, 1750). Il a su garder le dynamisme de la commedia dell'arte et le jeu des masques en les associant à la comédie d’intrigue et en recherchant un certain réalisme dans la représentation des comportements. En Italie, il s'était heurté aux choix esthétiques de ses confrères, s'étant fait moquer par le dramaturge traditionaliste Carlo Gozzi, qui condamnait son réalisme dangereux, et critiqué par les partisans du théâtre baroque comme Chiari avec son théâtre bouffon et poétique. Ces oppositions et la désaffection du public le conduisirent à l’exil en France.
Il se proclamait toujours admirateur de Molière, tout en reconnaissant ne pouvoir égaler son génie. Il s’en différencie cependant par la légèreté des thèmes et par l’absence de pessimisme. Son œuvre est en effet marquée par sa confiance dans l’homme, et son approche humaniste défend les valeurs de l’honnêteté, de l’honneur, de la civilité et de la rationalité. Certains de ses thèmes le rapprochent également de Marivaux.
Les personnages qu’il a créés ne sont ni des abstractions vertueuses, ni des monstres immoraux, mais des représentants ordinaires du peuple et de la bourgeoisie. Ce regard amusé et moqueur sur les classes sociales dans un monde changeant fait toujours le charme de ses comédies, qui s’inscrivent aussi dans le courant des Lumières en luttant contre l’intolérance et les abus de pouvoir. Toutefois, dans ses pièces italiennes, Goldoni n’aborde jamais les sujets touchant l’Église et la religion, alors que ses comédies en français ont souvent un ton anticlérical et critiquent l’hypocrisie des moines et du clergé.
Les pièces italiennes sont écrites en toscan littéraire, à la base de l’italien moderne, ou en dialecte vénitien, selon les moments et les lieux où elles ont été écrites
L’époque moderne a redécouvert les œuvres de Carlo Goldoni et des mises en scène brillantes ont marqué les mémoires comme celle, hyperréaliste, de La locandiera par Visconti en 1952, reprise à Paris en 1956, ou comme les spectacles inventifs de Giorgio Strehler au Piccolo Teatro de Milan, repris plusieurs fois à Paris au théâtre de l’Odéon, en particulier Arlequin serviteur de deux maîtres entre 1977 et 1998. Au xviiie siècle, Le Valet de deux maîtres devient une comédie en 1 acte et en prose, mêlée d'ariettes composées par François Devienne, sur un livret de Jean-François Roger (1799).
Statue à Venise par Antonio Dal Zotto (1883).
Buste sous la neige à Paris, square Jean-XXIII
Statue à Florence
Les pièces de Goldoni sont toujours régulièrement jouées aujourd’hui par de nombreuses troupes.
Un théâtre de Venise porte aujourd’hui le nom de Teatro Carlo Goldoni.
Il existe depuis 1994 une place Goldoni dans le 2e arrondissement de Paris, proche de la maison où il mourut, dont l’adresse actuelle est le 21, rue Dussoubs.
- Tragédies
- Amalasunta, 1733 (brûlée par Goldoni après la première)
- Rosmonda, 1734
- Griselda, 1734
- Enrico re di Sicilia, 1736
- Gli amori de Alessandro Magno, 1759
- Enea nel Lazio, 1760
- Nerone, 1760
- Artemisia (jamais représentée)
- Tragi-comédies
- Belisario, 1734
- Don Giovanni Tenorio o sia il dissoluto (Don Juan Tenorio ou le Dissolu), 1735
- Rinaldo di Montalbano, 1736
- Giustino, 1734-1740
- La sposa persiana (L'Épouse persane), 1753 (en vers)
- Ircana in Julfa (Ircana à Jaffa), 1755
- Ircana in Ispaan (Ircana à Ispahan), 1756
- La peruviana (La Péruvienne), 1754
- La bella selvaggia (La Belle Sauvage), 1758
- La dalmatina (La Dalmatienne), 1758
- Gli amori di Alessandro Magno (Les Amours d'Alexandre le Grand), 1759
- Artemisia (Artémise)
- Enea nel Lazio (Énée au Latium), 1760
- Zoroastro (Zoroastre)
- La bella giorgiana (La Belle Géorgienne)
- Comédies
- La pupilla (La Pupille), 1734
- L'uomo di mondo (L'Homme du monde), 1738
- Il prodigo (Le Prodigue), 1739
- Il Momolo cortesan (Momolo courtisan), 1739 (partiellement improvisée)
- Il mercante fallito o sia la bancarotta (Le Failli ou la Banqueroute), 1741
- La donna di garbo (La Brave Femme), 1743
- Il servitore di due padroni (ou Arlecchino servitore di due padroni ; Arlequin serviteur de deux maîtres), 1745 (pour le canevas, entièrement rédigée en 1753)
- Il frappatore (Le Trompeur), 1745
- I due gemelli veneziani (Les Deux Jumeaux vénitiens), 1745
- L'uomo prudente (L'Homme prudent)
- La vedova scaltra (La Veuve rusée), 1748
- L'avvocato veneziano (L'Avocat vénitien), 1748
- La putta onorata (L'Honnête Fille), 1749
- La buona moglie (La Bonne Épouse), 1749
- Il cavaliere e la dama (Le Chevalier et la Dame), 1749
- Il padre di famiglia (Le Père de famille), 1750
- La Famiglia dell'antiquario ossia La Suocera e la nuora (La Famille de l'antiquaire), 1750
- L'erede fortunata (L'Héritière fortunée), 1750
- Le femmine puntigliose (Les Femmes pointilleuses), 1750-1751
- La bottega del caffè (Le Café), 1750-1751
- Il bugiardo (Le Menteur), 1750-1751
- L'adulatore (Le Flatteur), 1750
- Il poeta fanatico (Le Poète fanatique), 1750
- La Pamela (Pamela nubile), 1750
- Il cavaliere di buon gusto (Le Gentilhomme de bon goût), 1750
- Il giocatore (Le Joueur), 1751
- Il vero amico (L'Ami véritable), 1751
- La finta ammalata (La Fausse Malade), 1751
- La dama prudente (La Dame prudente), 1751
- L'incognita (L'Inconnue), 1751
- L'avventuriere onorato (L'Honnête Aventurier), 1751
- I pettegolezzi delle donne (Les Cancans), 1750-1751
- Il Moliere (Molière), 1751
- La castalda (L'Administratrice), 1751
- L'amante militare (L'Amant militaire), 1751
- Il tutore (Le Tuteur), 1752
- La moglie saggia (Une sage épouse), 1752
- Il feudatario (Le Feudataire), 1752
- Le donne gelose (Les Femmes jalouses), 1752
- La serva amorosa (La Servante amoureuse), 1752
- I puntigli domestici (Les Tracas domestiques), 1752
- La figlia obbediente (La Fille obéissante), 1752
- I mercanti (Les Marchands), 1753
- La locandiera, 1753
- Le donne curiose (Les Femmes curieuses), 1753
- Il contrattempo o sia il chiacchierone imprudente (Le Contretemps ou le Bavardage imprudent), 1753
- La donna vendicativa (La Femme vindicative), 1753
- Il geloso avaro (L'Avare jaloux), 1753
- La donna di testa debole o sia la vedova infatuata (La Femme fantasque), 1753
- La cameriera brillante (La Brillante soubrette), 1754
- Il filosofo inglese (Le Philosophe anglais), 1754
- Il vecchio bizzarro (Le Vieil Original), 1754
- Il festino (Le Banquet), 1754
- L'impostore (L'Imposteur)
- La madre amorosa (La Mère amoureuse), 1754
- Terenzio (Térence), 1754
- Il marchese di Montefosco (Le marquis de Montefosco), 1754
- Torquato Tasso (Le Tasse), 1755
- Il cavaliere giocondo (Le Joyeux Gentilhomme), 1755
- Le massere (Les Cuisinières), 1755
- I malcontenti (Les Mécontents), 1755
- La buona famiglia (La Bonne Famille), 1755
- Le donne de casa soa (Les Femmes de chez lui), 1755
- La vedova spiritosa (La Veuve spirituelle), 1755
- La donna stravagante (La Femme fantasque), 1756
- Il campiello (Le Carrefour), 1756
- L'avaro (L'Avare), 1756
- L'amante di sé medesimo (L'Amoureux de lui-même), 1756
- Il medico olandese (Le Médecin hollandais), 1756 En ligne [archive]
- Il Matrimonio discorde (Le Mariage de la discorde), 1756 En ligne [archive]
- La donna sola (La Femme seule), 1757
- Il cavaliere di spirito o sia la donna di testa debole (Le Gentilhomme d'esprit ou la Faible d'esprit), 1757
- Il padre per amore (Le Père par amour), 1757
- Lo spirito di contraddizione (L'Esprit de contradiction), 1758
- Il ricco insidiato (Le Riche convoité), 1758
- Le morbinose, 1758
- Le donne di buon umore (Les Femmes de bonne humeur), 1758
- L'apatista o sia l'indifferente (L'Apathique ou l'Indifférent), 1758
- La donna bizzarra (La Femme bizarre), 1758
- La sposa sagace (L'Épouse sagace), 1758
- La donna di governo (Les Femmes de gouvernement), 1758
- La donna forte (La Forte Femme)
- La scuola di ballo (L'École de danse)
- Gl'innamorati (Les Amants), 1759
- Un curioso accidente (Un curieux accident), 1759
- Pamela maritata (Pamela mariée), 1760
- L'impresario delle Smirne (L'Impresario de Smyrne), 1760
- La guerra (La Guerre civile), 1760
- Un curioso accidente (Un curieux accident), 1760
- I rusteghi (Les Rustres), 1760
- La donna di maneggio (La Femme de ménage), 1760
- La burla retrocessa nel contraccambio (La Plaisanterie retournée), 1760
- La casa nova (Le Nouvel Appartement), 1761
- La buona madre (La Bonne Mère), 1761
- La villeggiatura (La Villégiature) trilogie, 1761 :
- Le smanie per la villeggiatura (La Manie de la villégiature)
- Le avventure della villeggiatura (Les Aventures de la villégiature)
- Il ritorno dalla villeggiatura (Le Retour de la villégiature)
- Lo scozzese (L'Écossais), 1761
- L'amore paterno o sia la serva riconoscente (L'Amour paternel ou la Suivante reconnaissante), 1761
- Il buon compatriotto (Le Bon Compatriote)
- Sior Todero brontolon o sia il vecchio fastidioso (Théodore le Grincheux), 1762
- Le baruffe chiozzotte (Barouf à Chioggia), 1762
- Una delle ultime sere di carnevale (Une des dernières soirées de carnaval), 1762
- L'osteria della posta (L'Auberge de la poste), 1762
- Il matrimonio per concorso (Le Mariage sur concours)
- Les Amours d'Arlequin et de Camille, Paris, 1763
- La Jalousie d'Arlequin, Paris, 1763
- L'Inquiétude de Camille, Paris, 1763
- Gli amori di Zelinda e Lindoro (Les Amours de Zélinde et de Lindor), 1764
- La gelosia di Lindoro (La Jalousie de Lindor), 1763-1764
- L'inquietudini di Zelinda (Les Inquiétudes de Zelinda)
- Gli amanti timidi o sia l'imbroglio dei due ritratti (Les Amants timides ou l'Affaire des deux portraits), 1765
- Il ventaglio (L'Éventail), 1765
- Chi la fa l'aspetta o sia i chiassetti del carneval, 1765
- Il genio buono e il genio cattivo (Le Bon Génie et le Mauvais Génie), 1768
- Le Bourru bienfaisant, Paris, 1771
- L'Avare fastueux, Paris, 1776
- Opéras serias
- Amalasunta, 1732
- Gustavo, vers 1738
- Oronte re de' Sciti, 1740
- Statira, vers 1740
- Opéras bouffes
- La fondazione di Venezia, 1736
- Lugrezia romana in Costantinopoli (Lucrèce romaine à Constantinople), 1737
- La contessina (La Jeune Comtesse, musique de Giacomo Maccari), 1743
- Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, d'après le recueil de nouvelles du même nom, musique de Vincenzo Legrenzio Ciampi, 1748
- La favola de' tre gobbi, 1749
- L'Arcadia in Brenta (L'Arcadie à Brenta, musique de Galuppi), 1749
- Il negligente (Le Négligent), 1749
- Il finto principe (Le Faux Prince), 1749
- Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, 1749
- Arcifanfano re de' matti (Arcifanfano, roi des fous), 1750
- Il mondo alla rovescia o sia le donne che comandano (Le Monde à l'envers ou les Femmes qui commandent), 1750
- Il paese della cuccagna (Le Pays de cocagne), 1750
- La mascherata (La Masquée), 1751
- Il conte Caramella, 1751
- Le virtuose ridicole (Les Vertueux ridicules), 1752
- I portentosi effetti della madre natura (Les Effets de mère nature), 1752
- Le pescatrici (Les Pêcheurs), 1752
- La calamità de' cuori (La Peine de cœur), 1753
- I bagni di Abano (Les Bains d'Abano), 1753
- Il filosofo di campagna (Le Philosophe de campagne, musique de Galuppi), 1754
- Il festino (Le Festin), 1754
- Lo speziale (L'apothicaire) (mis en musique par Vincenzo Pallavicini et Domenico Fischietti, Carnaval 1755, Venise; mis en musique par Joseph Haydn, , Eszterháza)
- Le nozze (Les Noces), 1755
- La buona figliuola (La Bonne Fille, musique de Piccinni), 1757
- L'isola disabitata (L'Île inhabitée), 1757
- Il mercato di Malmantile (Le Marché de Malmantile, musique de Domenico Fischietti), 1758
- La donna di governo (La Femme de gouvernement), 1758
- Gli uccellatori, 1759
- Buovo d'Antona, 1759
- La fiera di Sinigaglia (La Foire de Sinigaglia), 1760
- I viaggiatori ridicoli (Les voyageurs ridicules ), 1761
- La Vittorina, 1772
- Il re alla caccia (Le Roi à la chasse)
- La Bouillotte
- I volponi
- L'astuzia felice (L'Heureuse Astuce)
- Cantates et sérénades
- La ninfa saggia (La Nymphe sage)
- Gli amanti felici (Les Heureux Amants)
- Le quattro stagioni (Les Quatre Saisons)
- Il coro delle muse (Le Chœur des Muses)
- La pace consolata (La Paix consolée)
- L'amor della patria (L'Amour de la patrie)
- L'oracolo del Vaticano (L'Oracle du Vatican)
- Oratorio
- Magdalena conversio (La Conversion de Madeleine)
- Pièce religieuse
- L'unzione del reale profeta Davide (L'Onction du prophète royal David)
- Poésie
- Il colosso (Le Colosse), 1725, satire contre les filles de Pavie qui firent expulser l’auteur du Collège Ghislieri
- Il quaresimale in epilogo, 1725-1726
- Intermezzi
- Il buon padre (Le Bon Père), 1729
- La cantatrice, 1729
- Il gondoliere veneziano o sia gli sdegni amorosi (Le Gondolier vénitien ou les mépris amoureux), 1733
- La pupilla (La Pupille), 1734
- La birba, 1734
- Il quartiere fortunato, 1734-1744
- L'amor fa l'uomo cieco (L'Amour rend aveugle)
- Il disinganno (La Déception)
- Tragédies
- Amalasunta, 1733 (brûlée par Goldoni après la première)
- Rosmonda, 1734
- Griselda, 1734
- Enrico re di Sicilia, 1736
- Gli amori de Alessandro Magno, 1759
- Enea nel Lazio, 1760
- Nerone, 1760
- Artemisia (jamais représentée)
- Tragi-comédies
- Belisario, 1734
- Don Giovanni Tenorio o sia il dissoluto (Don Juan Tenorio ou le Dissolu), 1735
- Rinaldo di Montalbano, 1736
- Giustino, 1734-1740
- La sposa persiana (L'Épouse persane), 1753 (en vers)
- Ircana in Julfa (Ircana à Jaffa), 1755
- Ircana in Ispaan (Ircana à Ispahan), 1756
- La peruviana (La Péruvienne), 1754
- La bella selvaggia (La Belle Sauvage), 1758
- La dalmatina (La Dalmatienne), 1758
- Gli amori di Alessandro Magno (Les Amours d'Alexandre le Grand), 1759
- Artemisia (Artémise)
- Enea nel Lazio (Énée au Latium), 1760
- Zoroastro (Zoroastre)
- La bella giorgiana (La Belle Géorgienne)
- Comédies
- La pupilla (La Pupille), 1734
- L'uomo di mondo (L'Homme du monde), 1738
- Il prodigo (Le Prodigue), 1739
- Il Momolo cortesan (Momolo courtisan), 1739 (partiellement improvisée)
- Il mercante fallito o sia la bancarotta (Le Failli ou la Banqueroute), 1741
- La donna di garbo (La Brave Femme), 1743
- Il servitore di due padroni (ou Arlecchino servitore di due padroni ; Arlequin serviteur de deux maîtres), 1745 (pour le canevas, entièrement rédigée en 1753)
- Il frappatore (Le Trompeur), 1745
- I due gemelli veneziani (Les Deux Jumeaux vénitiens), 1745
- L'uomo prudente (L'Homme prudent)
- La vedova scaltra (La Veuve rusée), 1748
- L'avvocato veneziano (L'Avocat vénitien), 1748
- La putta onorata (L'Honnête Fille), 1749
- La buona moglie (La Bonne Épouse), 1749
- Il cavaliere e la dama (Le Chevalier et la Dame), 1749
- Il padre di famiglia (Le Père de famille), 1750
- La Famiglia dell'antiquario ossia La Suocera e la nuora (La Famille de l'antiquaire), 1750
- L'erede fortunata (L'Héritière fortunée), 1750
- Le femmine puntigliose (Les Femmes pointilleuses), 1750-1751
- La bottega del caffè (Le Café), 1750-1751
- Il bugiardo (Le Menteur), 1750-1751
- L'adulatore (Le Flatteur), 1750
- Il poeta fanatico (Le Poète fanatique), 1750
- La Pamela (Pamela nubile), 1750
- Il cavaliere di buon gusto (Le Gentilhomme de bon goût), 1750
- Il giocatore (Le Joueur), 1751
- Il vero amico (L'Ami véritable), 1751
- La finta ammalata (La Fausse Malade), 1751
- La dama prudente (La Dame prudente), 1751
- L'incognita (L'Inconnue), 1751
- L'avventuriere onorato (L'Honnête Aventurier), 1751
- I pettegolezzi delle donne (Les Cancans), 1750-1751
- Il Moliere (Molière), 1751
- La castalda (L'Administratrice), 1751
- L'amante militare (L'Amant militaire), 1751
- Il tutore (Le Tuteur), 1752
- La moglie saggia (Une sage épouse), 1752
- Il feudatario (Le Feudataire), 1752
- Le donne gelose (Les Femmes jalouses), 1752
- La serva amorosa (La Servante amoureuse), 1752
- I puntigli domestici (Les Tracas domestiques), 1752
- La figlia obbediente (La Fille obéissante), 1752
- I mercanti (Les Marchands), 1753
- La locandiera, 1753
- Le donne curiose (Les Femmes curieuses), 1753
- Il contrattempo o sia il chiacchierone imprudente (Le Contretemps ou le Bavardage imprudent), 1753
- La donna vendicativa (La Femme vindicative), 1753
- Il geloso avaro (L'Avare jaloux), 1753
- La donna di testa debole o sia la vedova infatuata (La Femme fantasque), 1753
- La cameriera brillante (La Brillante soubrette), 1754
- Il filosofo inglese (Le Philosophe anglais), 1754
- Il vecchio bizzarro (Le Vieil Original), 1754
- Il festino (Le Banquet), 1754
- L'impostore (L'Imposteur)
- La madre amorosa (La Mère amoureuse), 1754
- Terenzio (Térence), 1754
- Il marchese di Montefosco (Le marquis de Montefosco), 1754
- Torquato Tasso (Le Tasse), 1755
- Il cavaliere giocondo (Le Joyeux Gentilhomme), 1755
- Le massere (Les Cuisinières), 1755
- I malcontenti (Les Mécontents), 1755
- La buona famiglia (La Bonne Famille), 1755
- Le donne de casa soa (Les Femmes de chez lui), 1755
- La vedova spiritosa (La Veuve spirituelle), 1755
- La donna stravagante (La Femme fantasque), 1756
- Il campiello (Le Carrefour), 1756
- L'avaro (L'Avare), 1756
- L'amante di sé medesimo (L'Amoureux de lui-même), 1756
- Il medico olandese (Le Médecin hollandais), 1756 En ligne [archive]
- Il Matrimonio discorde (Le Mariage de la discorde), 1756 En ligne [archive]
- La donna sola (La Femme seule), 1757
- Il cavaliere di spirito o sia la donna di testa debole (Le Gentilhomme d'esprit ou la Faible d'esprit), 1757
- Il padre per amore (Le Père par amour), 1757
- Lo spirito di contraddizione (L'Esprit de contradiction), 1758
- Il ricco insidiato (Le Riche convoité), 1758
- Le morbinose, 1758
- Le donne di buon umore (Les Femmes de bonne humeur), 1758
- L'apatista o sia l'indifferente (L'Apathique ou l'Indifférent), 1758
- La donna bizzarra (La Femme bizarre), 1758
- La sposa sagace (L'Épouse sagace), 1758
- La donna di governo (Les Femmes de gouvernement), 1758
- La donna forte (La Forte Femme)
- La scuola di ballo (L'École de danse)
- Gl'innamorati (Les Amants), 1759
- Un curioso accidente (Un curieux accident), 1759
- Pamela maritata (Pamela mariée), 1760
- L'impresario delle Smirne (L'Impresario de Smyrne), 1760
- La guerra (La Guerre civile), 1760
- Un curioso accidente (Un curieux accident), 1760
- I rusteghi (Les Rustres), 1760
- La donna di maneggio (La Femme de ménage), 1760
- La burla retrocessa nel contraccambio (La Plaisanterie retournée), 1760
- La casa nova (Le Nouvel Appartement), 1761
- La buona madre (La Bonne Mère), 1761
- La villeggiatura (La Villégiature) trilogie, 1761 :
- Le smanie per la villeggiatura (La Manie de la villégiature)
- Le avventure della villeggiatura (Les Aventures de la villégiature)
- Il ritorno dalla villeggiatura (Le Retour de la villégiature)
- Lo scozzese (L'Écossais), 1761
- L'amore paterno o sia la serva riconoscente (L'Amour paternel ou la Suivante reconnaissante), 1761
- Il buon compatriotto (Le Bon Compatriote)
- Sior Todero brontolon o sia il vecchio fastidioso (Théodore le Grincheux), 1762
- Le baruffe chiozzotte (Barouf à Chioggia), 1762
- Una delle ultime sere di carnevale (Une des dernières soirées de carnaval), 1762
- L'osteria della posta (L'Auberge de la poste), 1762
- Il matrimonio per concorso (Le Mariage sur concours)
- Les Amours d'Arlequin et de Camille, Paris, 1763
- La Jalousie d'Arlequin, Paris, 1763
- L'Inquiétude de Camille, Paris, 1763
- Gli amori di Zelinda e Lindoro (Les Amours de Zélinde et de Lindor), 1764
- La gelosia di Lindoro (La Jalousie de Lindor), 1763-1764
- L'inquietudini di Zelinda (Les Inquiétudes de Zelinda)
- Gli amanti timidi o sia l'imbroglio dei due ritratti (Les Amants timides ou l'Affaire des deux portraits), 1765
- Il ventaglio (L'Éventail), 1765
- Chi la fa l'aspetta o sia i chiassetti del carneval, 1765
- Il genio buono e il genio cattivo (Le Bon Génie et le Mauvais Génie), 1768
- Le Bourru bienfaisant, Paris, 1771
- L'Avare fastueux, Paris, 1776
- Opéras serias
- Amalasunta, 1732
- Gustavo, vers 1738
- Oronte re de' Sciti, 1740
- Statira, vers 1740
- Opéras bouffes
- La fondazione di Venezia, 1736
- Lugrezia romana in Costantinopoli (Lucrèce romaine à Constantinople), 1737
- La contessina (La Jeune Comtesse, musique de Giacomo Maccari), 1743
- Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, d'après le recueil de nouvelles du même nom, musique de Vincenzo Legrenzio Ciampi, 1748
- La favola de' tre gobbi, 1749
- L'Arcadia in Brenta (L'Arcadie à Brenta, musique de Galuppi), 1749
- Il negligente (Le Négligent), 1749
- Il finto principe (Le Faux Prince), 1749
- Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, 1749
- Arcifanfano re de' matti (Arcifanfano, roi des fous), 1750
- Il mondo alla rovescia o sia le donne che comandano (Le Monde à l'envers ou les Femmes qui commandent), 1750
- Il paese della cuccagna (Le Pays de cocagne), 1750
- La mascherata (La Masquée), 1751
- Il conte Caramella, 1751
- Le virtuose ridicole (Les Vertueux ridicules), 1752
- I portentosi effetti della madre natura (Les Effets de mère nature), 1752
- Le pescatrici (Les Pêcheurs), 1752
- La calamità de' cuori (La Peine de cœur), 1753
- I bagni di Abano (Les Bains d'Abano), 1753
- Il filosofo di campagna (Le Philosophe de campagne, musique de Galuppi), 1754
- Il festino (Le Festin), 1754
- Lo speziale (L'apothicaire) (mis en musique par Vincenzo Pallavicini et Domenico Fischietti, Carnaval 1755, Venise; mis en musique par Joseph Haydn, , Eszterháza)
- Le nozze (Les Noces), 1755
- La buona figliuola (La Bonne Fille, musique de Piccinni), 1757
- L'isola disabitata (L'Île inhabitée), 1757
- Il mercato di Malmantile (Le Marché de Malmantile, musique de Domenico Fischietti), 1758
- La donna di governo (La Femme de gouvernement), 1758
- Gli uccellatori, 1759
- Buovo d'Antona, 1759
- La fiera di Sinigaglia (La Foire de Sinigaglia), 1760
- I viaggiatori ridicoli (Les voyageurs ridicules ), 1761
- La Vittorina, 1772
- Il re alla caccia (Le Roi à la chasse)
- La Bouillotte
- I volponi
- L'astuzia felice (L'Heureuse Astuce)
- Cantates et sérénades
- La ninfa saggia (La Nymphe sage)
- Gli amanti felici (Les Heureux Amants)
- Le quattro stagioni (Les Quatre Saisons)
- Il coro delle muse (Le Chœur des Muses)
- La pace consolata (La Paix consolée)
- L'amor della patria (L'Amour de la patrie)
- L'oracolo del Vaticano (L'Oracle du Vatican)
- Oratorio
- Magdalena conversio (La Conversion de Madeleine)
- Pièce religieuse
- L'unzione del reale profeta Davide (L'Onction du prophète royal David)
- Poésie
- Il colosso (Le Colosse), 1725, satire contre les filles de Pavie qui firent expulser l’auteur du Collège Ghislieri
- Il quaresimale in epilogo, 1725-1726
- Intermezzi
- Il buon padre (Le Bon Père), 1729
- La cantatrice, 1729
- Il gondoliere veneziano o sia gli sdegni amorosi (Le Gondolier vénitien ou les mépris amoureux), 1733
- La pupilla (La Pupille), 1734
- La birba, 1734
- Il quartiere fortunato, 1734-1744
- L'amor fa l'uomo cieco (L'Amour rend aveugle)
- Il disinganno (La Déception)
1748 - Le putta honoré
1748 - La veuve astucieuse
1749 - Le chevalier et la dame
1750 - Le théâtre comique
1750 - Le café
1750 - La famille des antiquaires
1750 - Les femelles pointilleuses
1750 - Le menteur
1752 - L'aubergiste
1753 - La mariée perse
1756 - L'avare
1756 - Le Campiello
1759 - gl'innamorati
1760 - Les rusteghi
1762 - Les querelles
1764 - Les amours de Zelinda et Lindoro
1765 - Le fan
Vous trouverez, cher lecteur, cette comédie très différente de la mienne, que vous aurez lue jusqu'à présent. Elle n'est pas de caractère, sauf si nous considérons que le caractère est celui de Truffaldino , qu'un serviteur stupide et rusé représente à la fois pour nous: idiot, c'est-à-dire dans ces choses qu'il travaille sans réflexion et sans étude, mais très conscientes alors quand l'intérêt et la malice l'entraîne, qui est le vrai personnage du méchant.
Elle peut plutôt être qualifiée de comédie ludique, car le jeu de Truffaldino en constitue la majorité. Elle ressemble beaucoup aux comédies habituelles des Istrioni, sauf qu'elle me semble être de toutes ces grossières irrégularités, que j'ai condamnées dans mon théâtre comique , et qui sont maintenant généralement détestées par le monde.
L'irrégularité pourrait sembler au scrupuleux que Truffaldino maintient l'incompréhension de sa double servitude, même face aux deux maîtres eux-mêmes uniquement pour cette raison, car aucun d'eux ne l'appelle jamais par son nom; que si Truffaldino ne disait qu'une seule fois, ou Florindo, ou Béatrice , dans le troisième acte , au lieu de toujours dire mon serviteur , le malentendu serait dissous et la comédie serait alors terminée. Mais de ces malentendus, soutenus par l'art de l'inventeur, non seulement les comédies en sont pleines, mais les tragédies encore; et bien que j'essaie d'être attentif à la vraisemblance dans une comédie ludique, je crois que quelque chose, qui n'est pas impossible, peut être facilité.
Il semblera encore à quelqu'un que la ruse de Truffaldino était trop loin de la bagatelle ; par exemple: déchirer une lettre de change pour dessiner le creux d'une table, semble être l'excès de maladresse. Servir deux maîtres, dans deux pièces, à la fois, avec une telle rapidité et une telle rapidité, semble être l'excès de méfait. Mais juste ce que j'ai dit au début du personnage de Truffaldino : idiot quand il travaille sans réfléchir, comme quand il déchire la facture; très intelligent quand il agit avec méchanceté, comme en servant deux tables il apparaît.
Si l'on considère alors la catastrophe de la Comédie, les vicissitudes, l'intrigue, Truffaldino n'apparaît pas comme un protagoniste, en effet, si l'on exclut nous voulons la supposée mort mutuelle des deux amoureux, crue par le travail de ce serviteur, la Comédie pourrait se faire sans de lui; mais aussi de cela nous avons des exemples infinis, que je ne donne pas pour ne pas trop remplir les feuilles; et parce que je ne crois pas à la dette pour prouver ce que je me flatte, je ne peux pas être contredit; par contre, le célèbre Molière lui-même servirait d'escorte pour me justifier.
Lorsque j'ai composé la comédie actuelle, qui était en l'an 1745, à Pise, entre les traitements légaux, pour la détention et pour le génie, je ne l'ai pas déjà écrite, comme nous pouvons le voir actuellement. En réserve de trois ou quatre scènes par acte, la plus intéressante pour les parties sérieuses, le reste de la Comédie n'a été mentionné que, de la manière que les comédiens appellent généralement "un sujet"; c'est-à-dire un scénario détendu, dans lequel, en faisant allusion au but, aux traces, à la conduite et au but du raisonnement, que les acteurs devaient faire, était alors libre de le faire pour le rattraper soudainement, avec des mots adaptés et des blagues acclamées, pleines d'esprit concepts. En fait, c'est cette comédie à moi si soudainement si bien interprétée par les premiers acteurs qui l'ont représentée, que j'en ai été très heureuse, et je ne doute pas qu'ils feraient mieux de ne pas l'avoir orné d'un coup, de ce que j'aurais pu faire en l'écrivant. Les sels deLe truffaldino , les blagues, les vivacités sont des choses qui sont plus savoureuses lorsqu'elles sont produites sur le fait de l'état d'esprit, de l'occasion, du panache. Cet excellent comédien célèbre, connu en Italie sous le nom même de Truffaldino , a une telle vivacité d'esprit, une telle abondance de sels et un naturel de termes, ce qui est surprenant: et vouloir prendre soin de lui. Cette comédie l'a conçue expressément pour lui, ou plutôt il a lui-même le sujet proposé, un sujet quelque peu difficile en vérité, qui a mis tout mon génie à l'épreuve de la comédie artificielle, et tout son talent pour fonctionnement.
Je l'ai ensuite vue dans d'autres parties par d'autres comédiens pour représenter, et peut-être par manque de mérite, mais de ces nouvelles que, d'après le scénario, ils ne pouvaient pas, il me semble qu'elle a beaucoup décliné du premier aspect. Pour cette raison, j'ai induit à tout écrire, non pas pour forcer ceux qui soutiendront le personnage de Truffaldino à dire mes mots, quand ils savent mieux, mais pour déclarer mon intention, et pour une très les mener tout droit à la fin.
Fatigué, je dois détendre toutes les blagues les plus nécessaires, toutes les moindres observations, pour le rendre aussi facile que jamais, et si cela n'a pas le mérite de la critique, de la morale, de l'éducation, avoir au moins celle d'une conduite raisonnable et un jeu juste et raisonnable.
Je prie, cependant, que ceux-ci, cette partie du Truffaldino représentent, chaque fois qu'ils ajouteront les siens, ils s'abstiendront de mots sales, de blagues sales; sûr que seuls ceux de la vile plèbe se moquent de ces choses, et les gens gentils sont offensés.
PERSONNAGES
| PANTALON DE 'BISOGNOSI | |
| CLARICE sa fille . | |
| DOCTEUR LOMBARDI | |
| SILVIO son fils . | |
| BEATRICE de Turin, en costume masculin sous le nom de Federigo Rasponi . | |
| FLORINDO ARETUSI, un amoureux de Turin . | |
| BRIGHELLA aubergiste . | |
| EMERALDINA La femme de chambre de Clarice . | |
| TRUFFALDINO serviteur de Béatrice, puis de Florindo . | |
| Un serveur de l'auberge qui parle . | |
| Un serviteur de Pantalone qui parle . | |
| Deux porteurs discutent . | |
| Des serveurs qui ne parlent pas . | |
La scène est représentée à Venise.
ACT ONE
SCENE I
Chambre dans la maison de Pantalone
Pantalone, le docteur, Clarice, Silvio, Brighella, Smeraldina, un autre serviteur de Pantalone .
Silvio - Voici ma main droite, et avec cela je vous donne tout mon cœur ( à Clarice, lui tendant la main ).
Pantalon - Via, no ve vergognè; dèghe la man anca vu. Cusì sera promis, et bientôt sera maridai ( à Clarice ).
Clarice - Oui cher Silvio, voici mon droit. Je promets d'être ta fiancée.
Silvio - Et je promets d'être à toi. ( Ils se serrent la main. )
Docteur - Très bien, cela se fait aussi. Maintenant, il n'y a plus de retour possible.
Smeraldina - (Oh belle chose! J'en ai vraiment envie aussi).
Pantalone - Vualtri sera témoin de cette promesse, un suivi entre Clarice mia fia et el sior Silvio, très digne de notre sior dottor Lombardi ( à Brighella et le Serviteur ).
Brighella - Sior oui, sior apparaît, et merci de sto honneur que la digne de moi ( à Pantalone ).
Pantalon - Vedeu? Il m'apparaît lors de votre mariage, et si vous témoignez lors du mariage de ma fia. Je ne voulais pas appeler des copains, envier des parents, car même le docteur Si X et mon tempérament; il aimait faire les bosses sans rugissement, sans grandeur. Nous nous agrandirons ensemble si nous apprécions entre de nu, et rien ne le dérangera. Cossa diseu, putti, fais-moi nettoyer? ( à Clarice et Silvio ).
Silvio - Je ne veux rien de plus que d'être proche de ma chère épouse.
Smeraldina - (bien sûr, c'est la meilleure nourriture).
Docteur - Mon fils n'est pas un amoureux de la vanité. C'est un jeune homme de bon cœur. Aimez votre fille et ne pensez à rien d'autre.
Pantalone - Il faut vraiment dire que je me marie et qu'elle est destinée du ciel, car si Turin n'est pas mort, mon correspondant Federigo Rasponi, a savé que ma fia ghe l'avait promis à elo, et il n'était pas possible de le toucher à mon cher sior zenero ( vers Silvio ).
Silvio - Bien sûr, je peux dire que j'ai de la chance. Je ne sais pas si Mme Clarice le dira.
Clarice - Cher Silvio, tu me fais du tort. Tu sais si je t'aime; pour obéir à mon père, j'aurais épousé cette Turin, mais mon cœur a toujours été pour vous.
Docteur - Et pourtant c'est vrai; quand le ciel a décrété quelque chose, il le fait naître par des voies inattendues. Comment la mort de Federigo Rasponi s'est-elle produite? ( à Pantalone ).
Pantalon - Pauvre gars! Il y a des mazzà de nuit à cause d'une sœur ... Je ne sais pas. I gh'ha fait une blessure et el xè restera sur le coup.
Brighella - Elo est arrivé à Turin, ai-je fini? ( à Pantalone ).
Pantalon - A Turin.
Brighella - Oh, pauvre monsieur! Il me méprisait infiniment.
Pantalon - Connaissiez-vous sœur Federigo Rasponi? ( à Brighella ).
Brighella - Siguro qui le connaissait. Je sais qu'il est à Turin depuis trois ans et je connais la hanche de sa sœur. Un zovene de spirit, de corazo; s'il s'habillait en homme, il partait à cheval, et il était déjà amoureux de sa sœur. Oh! qui l'a jamais touché!
Pantalon - Mais! Les malheurs sont toujours prêts. Allez, ne parlons pas de mélancolie. Saveu cossa que dois-je dire, chère Miss Brighella? Je sais que tu le connais bien à Cusina. Il voulait que je fasse un plat à votre goût.
Brighella - Je serai ravi de vous servir. Pas idiot pour le moins, mais dans mon auberge tout le monde est content. Je n'aimais pas cela dans aucun logo i magna, comme si magna da mi. Certains goûts le ressentiront.
Pantalon - Bravo. Des trucs trempés, vous voyez, que si ça peut être mouillé avec la molène de casserole. ( Il est battu ). Oh! les battements. Voyez qui c'est, Smeraldina.
Smeraldina - Immédiatement ( partie, puis retour ).
Clarice - M. le père, avec votre bonne licence.
Pantalon - Aspettè; nous allons tous. Écoutons qui est.
Smeraldina - ( retour ) Monsieur, c'est le serviteur d'un étranger qui voudrait faire de vous une ambassade. Il ne voulait rien me dire. Il dit qu'il veut parler au maître.
Pantalon - Diseghe that el vegna devant. Nous entendrons que el vol.
Smeraldina - Je vais le faire venir (en partie ).
Clarice - Mais je m'en irais, monsieur le père.
Pantalon - Où?
Clarice - Qu'est-ce que je sais? Dans ma chambre.
Pantalon - Siora no, siora no; reste ici. (Sti novizzi vous ne voulez pas être laissé seul à nouveau) ( lentement au docteur ).
Docteur - (sauvagement, avec prudence) ( plan à Pantalone ).
SCÈNE II
Truffaldino, Smeraldina et dictons .
Truffaldino - Fazz humble respect à chacun d'eux. Oh, quelle belle compagnie! Oh, quelle belle conversation!
Pantalon - Chi seu, amigo? Cossa comandeu? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Qui est-elle, gentille dame? ( à Pantalone, mentionnant Clarice ).
Pantalon - La xè mia fia.
Truffaldino - Me ralegher.
Smeraldina - Et en plus elle est mariée ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Je me console. Et qui est-elle? ( à Smeraldina ).
Smeraldina - Je suis votre femme de chambre, monsieur.
Truffaldino - Je vous félicite.
Pantalone - Oh allez, sior, en amont des cérémonies. Cossa voleu da mi? Qui seu? Qui t'envoie?
Truffaldino - Adasio, adasio, colle bone. Trois questions à la fois, c'est trop pour un pauvre.
Pantalone - (je pense que el est un simple costù) ( plan pour le docteur ).
Docteur - (Il me semble plutôt un farceur) ( lentement à Pantalone ).
Truffaldino - VS est la mariée? ( à Smeraldina ).
Smeraldina - Oh! ( soupirant ) Monsieur non.
Pantalone - Voulez-vous dire qui vous êtes, ou allez-vous faire votre propre truc?
Truffaldino - Que voulez-vous d'autre savoir qui je suis, en des mots je me dépêche. Je suis serviteur de mon maître ( à Pantalone ). Et cusì, revenant à notre but ... (se tournant vers Smeraldina ).
Pantalon - Mo chi xèlo el tuo padron?
Truffaldino - C'est un travailleur forestier qui aimerait rendre visite ( à Pantalone ). Nous discuterons du but des conjoints ( à Smeraldina, comme ci-dessus ).
Pantalon - je suis forestier qui xèlo? Comme si vous l'appeliez?
Truffaldino - Oh, c'est long. L'el sior Federigo Rasponi de Turin, el me padron, qui l'a révérée, qui est vegnù exprès, qui est d'en bas, qui el envoie l'ambassada, qu'el veut passer, qui el m'attend avec la réponse . Es-tu heureux? Voulez-vous autre chose? ( à Pantalone. Chacun fait des actes d'admiration ). Nous reviendrons à nu ... (à Smeraldina, comme ci-dessus).
Pantalon - Mo vegni qui, a parlé avec moi. Cossa diable diseu?
Truffaldino - Et si vous voulez savoir qui je suis, je suis Truffaldin Batocchio, de la Vallade de Bergame.
Pantalon - Je me fiche de qui vous êtes. Voria que je suis retourné pour dire qui je suis ton maître. J'ai peur d'avoir mal compris.
Truffaldino - Pauvre vieillard! El sera dur de recchie. El me padron l'è el sior Federigo Rasponi de Turin.
Pantalon - Andè away, qui est un morceau de fou. Sior Federigo Rasponi de Turin et x est mort.
Truffaldino - Est-il mort?
Pantalon - Les morts sont morts. Trop pour elo.
Truffaldino - (Diavol! Que mon maître soit mort? Je l'ai là-haut vivant d'en bas!). At-il dit qu'il était mort?
Pantalon - Je digère absolument qu'el x est mort.
Docteur - Oui, c'est la vérité; est mort; il n'est pas nécessaire de la remettre en question.
Truffaldino - (Oh, pauvre el me padron! Ghe sera un accident). Avec une si bonne grâce ( il tire ).
Pantalon - Vous vouliez autre chose de moi?
Truffaldino - À sa mort, je n'ai besoin de rien d'autre. (Vous irez voir si la vérité est vraie) (par elle-même, elle démarre puis revient).
Pantalone - Cossa pensez-vous qu'el est costù? Un rusé ou un fou?
Docteur - je ne sais pas. Il semble qu'il ait un peu de l'un et un peu de l'autre.
Brighella - A mi el me semble plutôt un niais. C'est Bergame, pas de fédération qui el fuss un baron
Smeraldina - L'idée est bonne aussi. (Je ne me dérange pas que morettino).
Pantalon - Mais cossa si insonielo de sior Federigo?
Clarice - S'il était vrai que vous étiez ici, ce serait dommage pour moi.
Pantalon - Quelle erreur! Vous n'avez pas vu les lettres aussi? ( à Clarice ).
Silvio - Même s'il était vivant et était ici, il serait arrivé en retard.
Truffaldino - (revient) Me maraveio de lor siori. Non s'il traite avec le pauvre pauvre homme. Non s'il a trompé les étrangers. Non, ce sont les actions de galantomeni. Et je m'en rendrai compte.
Pantalone - (Vardemose, qui est fou). Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous fait?
Truffaldino - Allez me dire que sœur Federigh Rasponi est morte?
Pantalon - Et qu'en est-il?
Truffaldino - Et cusì est ici, vivant, san, plein d'esprit et brillant, qui el vol reverirla, s'il est heureux.
Pantalon - Sior Federigo?
Truffaldino - Sior Federigo.
Pantalon - Rasponi?
Truffaldino - Rasponi.
Pantalon - De Turin?
Truffaldino - De Turin.
Pantalon - Fio mio, est allé à l'hôpital, ce qui est fou.
Truffaldino - Corps du diable! Tu m'as maudit comme un zogador. Mo est ici, dans la maison, dans la salle à manger, qui vegna el malanno.
Pantalon - Maintenant, il se casse le visage.
Docteur - Non, Signor Pantalone, faites une chose; dites-lui de faire venir ce type, qu'il croit être Federigo Rasponi.
Pantalone - Allez, laisse-moi aller de l'avant, je suis ressuscité.
Truffaldino - Cet el est mort et qu'il y aura une résurrection, je n'ai rien contre. Mais maintenant il est vivant, et je le verrai avec tes yeux. Vagh dirghe that el vegna. Et à partir de là, il a appris à traiter avec les étrangers, avec les hommes de mon destin, avec l'honorable Bergame ( à Pantalone, avec colère ). Ce jeune homme, à temps si nous parlons ( à Smeraldina, et en partie ).
Clarice - (Silvio mio, je tremble partout) ( lentement à Silvio ).
Silvio - (ne doutez pas, en tout cas vous serez à moi) ( prévoyez Clarice ).
Docteur - Maintenant, nous allons clarifier la vérité.
Pantalon - Pol vegnir quelques barons à darme pour comprendre les mensonges.
Brighella - Mi, comme ghe diseva, sior compare, je le connaissais el sior Federigo; si el sera lu, nous verrons.
Smeraldina - (Et pourtant, Morettino n'a pas de physionomie menteuse. Je veux voir si je peux ...). Avec la bonne grâce de leurs messieurs ( partie ).
SCÈNE III
Béatrice en costume d'homme, sous le nom de Federigo, et dictons .
Béatrice - Signor Pantalone, la gentillesse que j'admirais dans vos lettres ne correspond pas au traitement que vous me donnez en personne. Je t'envoie le domestique, je te fais passer l'ambassade, et tu me fais rester en plein air, sans daigner me laisser entrer au bout d'une demi-heure?
Pantalon - La compatissa ... Mais qui est-elle, mécène?
Beatrice - Federigo Rasponi de Turin, pour vous obéir. ( Tout le monde fait de l'admiration ).
Brighella - (Cossa vedio? Qu'est-ce que cette boutique? Ce n'est pas Federigo, je suis la sœur Béatrice je connais la sœur. Tu regardes où je trompe).
Pantalon - Je suis étonné ... Je me console de la voir en bonne santé et vivante, quand nous avons eu un mauvais neuf. (Mais gnancora no ghe creed, savè) ( lentement au Docteur ).
Béatrice - Je sais: on disait que dans un combat j'étais éteint. Dieu merci, je n'ai été blessé que; et dès que je me suis remis, je me suis embarqué pour le voyage à Venise, qui était déjà depuis longtemps concerté avec vous.
Pantalon - No so cossa dir. Je sais que c'est comme un galantome: mais je suis sûre et sûre que sœur Federigo est morte; d'où il le voit bien ... sinon il me donne une preuve du contraire ...
Béatrice - Votre doute est le plus juste; Je connais le besoin de me justifier. Voici quatre lettres de vos amis correspondants, dont une de notre ministre des banques. Vous reconnaîtrez les signatures et assurez-vous que vous êtes à moi (il donne à Pantalone quatre lettres qu'il lit lui-même ).
Clarice - (Ah Silvio, nous sommes perdus!) ( Lentement à Silvio ).
Silvio - (je vais perdre ma vie, mais pas toi!) ( Lentement à Clarice ).
Béatrice - (Hélas! Ici Brighella? Comment diable ici se retrouve-t-il? Il est certain que je le sais; je ne voudrais pas de discoprisse I) ( en soi, percevant Brighella ). Ami, il me semble que tu te connais ( fort à Brighella ).
Brighella - Oui, monsieur, non, êtes-vous d'accord avec Turin Brighella Cavicchio?
Béatrice - Ah oui, maintenant je te reconnais (va à Brighella) Bon gars, que fais-tu à Venise? (Pour l'amour du ciel, vous ne me découvrez pas) (lentement à Brighella).
Brighella - (Il n'y a aucun doute) ( plan à Béatrice ). Fazzo el locandier, pour le servir ( fort en même temps ).
Béatrice - Oh, précisément; puisque j'ai le plaisir de vous rencontrer, je vais venir séjourner dans votre auberge.
Brighella - Le moi fera grâce. (Une contrebande, je signe).
Pantalon - j'ai tout entendu. Bien sûr, ces lettres m'accompagnent toi et sœur Federigo Rasponi, et si tu me les présentes, tu dois croire que c'était ... comme si tu avais écrit ces lettres.
Béatrice - S'il reste un doute, voici Messer Brighella; il me connaît, il peut vous assurer d'être à moi.
Brighella - Bien sûr, sœur apparaît, je vous assure.
Pantalone - Avec le xè cusì, avec moi, au-delà de mes lettres, Brighella apparaît, chère sœur Federigo, je me console avec elle, et je m'excuse si je doute.
Clarice - M. le père, êtes-vous alors M. Federigo Rasponi?
Pantalon - Mo el xè elo lu.
Clarice - (Malheur à moi, que deviendrons-nous?) ( Plan à Silvio ).
Silvio - (ne doute pas, je te le dis; tu es à moi et je te défendrai) ( lentement à Clarice ).
Pantalone - (Cossa diseu, dottor, xèlo vegnù chronométré?) (Lentement au docteur ).
Médecin - Accidit in puncto, quod non contingit in year .
Beatrice - Signor Pantalone, qui est cette dame ( mentionnant Clarice ).
Pantalon - La xè Clarice mia fia.
Béatrice - Celui qui m'est destiné en mariage?
Pantalon - Sior oui, juste ça. (Maintenant, je suis dans une belle intrigue).
Béatrice - Madame, permettez-moi d'avoir l'honneur de vous vénérer ( à Clarice ).
Clarice - Serviteur dévoue ( pris en charge ).
Béatrice - Très froidement elle m'accueille ( à Pantalone ).
Pantalon - Cossa veut le faire? Le x est timide de la nature.
Béatrice - Et ce monsieur est-il un de vos proches? ( à Pantalone, mentionnant Silvio ).
Pantalon - Sior oui; el x est ma neige.
Silvio - Non monsieur, je ne suis pas votre neveu sinon, je suis l'époux de Signora Clarice ( à Béatrice ).
Docteur - (Bravo! Ne vous perdez pas. Dites votre raison, mais sans tomber) ( lentement à Silvio ).
Béatrice - Comment! Êtes-vous marié à Mme Clarice? N'est-elle pas destinée à moi?
Pantalon - Via, via. Je vais tout scoverzero. Chère sœur Federigo, s'il croyait que votre malheur était vrai que j'étais morte, et qu'il avait donné ma fia à sœur Silvio; qua no ghe x est une mauvaise chose dans le monde. Enfin, il arrive à l'heure. Clarice est à vous, si elle le voulait, et je suis ici pour tenir parole. Sior Silvio, no so cossa dir; il a vu la vérité avec vos yeux. Savè cossa que je te doigte, et de mi no ve podè se plaignent.
Silvio - Mais le signataire Federigo ne se contentera pas de prendre une épouse, qui a tendu la main aux autres.
Béatrice - Je ne suis pas délicate. Je le prendrai néanmoins. (Je veux aussi prendre du plaisir).
Docteur - (Quel bon mari à la mode! Cela ne me dérange pas).
Béatrice - J'espère que Mme Clarice ne refusera pas ma main.
Silvio - Allez, monsieur, vous êtes arrivé en retard. Signora Clarice doit être à moi, et n'espère pas que je vous la donnerai. Si le seigneur Pantalone me fait du tort, je saurai me venger; et celui qui veut Clarice, devra faire face à cette épée ( partie ).
Docteur - (Bravo, Bacchus corps!).
Béatrice - (Non, non, comme ça je ne veux pas mourir).
Docteur - Mon maître, VS est arrivé un peu en retard. Mme Clarice est mariée à mon fils. La loi est claire. Prior in tempore, potior in iure ( partie ).
Béatrice - Mais toi, demoiselle mariée, tu ne dis rien? ( à Clarice ).
Clarice - Je dis que tu es venu me tourmenter (en partie ).
SCÈNE IV
Pantalone, Béatrice et Brighella, puis la servante de Pantalone .
Pantalon - Comment, potins? Cossa distu? (il veut courir après elle ).
Beatrice - Stop, Signor Pantalone; Je la plains. Il n'est pas commode de le prendre sévèrement. Avec le temps, j'espère que je pourrai mériter sa grâce. En attendant, nous allons examiner nos comptes, ce qui est l'une des deux raisons pour lesquelles, comme vous le savez, je suis allé à Venise.
Pantalon - Tous les x sont en commande pour notre compte. Je vais montrer le compte courant; je sais que le bon x est parechiai, et nous ferons l'équilibre avec la volonté.
Béatrice - Sanglier avec plus de confort à la révérence; pour l'instant, si vous me le permettez, j'irai avec Brighella pour m'envoyer quelques petites affaires qui m'ont été recommandées. Il connaît la ville, il pourra me bénéficier dans mon souci.
Pantalone - Si vous en avez besoin comme si vous le vouliez; et si le ghn a besoin de gnente, il le commande.
Béatrice - Si vous me donnez un peu d'argent, vous me ferez plaisir; Je ne voulais pas les emporter avec moi pour ne pas me décapiter dans les pièces.
Pantalon - je serai ravi de vous servir. Maintenant pas de gh'è el cassier. Dès el vien, ghe j'enverrai les goodies à la maison. Cela ne vaut-il pas la peine de rester avec mon amie Brighella?
Béatrice - Bien sûr, je vais vers lui; puis j'enverrai mon serviteur; il est très digne de confiance, on peut lui faire confiance avec tout.
Pantalon - Très bien; Je le servirai comme tu le commandes, et si je veux y rester pour faire pénitence, la xè parona.
Béatrice - Pour aujourd'hui je vous remercie. Une autre fois, je vais te déranger.
Pantalon - Donca vous attendra.
Pantalone - Mesdames, est demandé ( à Pantalone ).
Pantalons - Par qui?
Pantalone - De là ... je ne sais pas ... (Il y a de la triche) ( lentement à Pantalone, et en partie ).
Pantalon - je vérifierai tout de suite. Avec une si bonne grâce. L'excuse, sinon le compagnon. Brighella, vu sè de casa; servez-lui vu Federor.
Béatrice - Ne t'inquiète pas pour moi.
Pantalon - Nous devons errer. Un bon reverirla. (Je n'ai pas peur qu'un diable soit né) ( partie ).
SCÈNE V
Béatrice et Brighella .
Brighella - Se pol saver, Siora Beatrice? ...
Beatrice- Calme, pour l'amour du ciel, ne me trouve pas. Mon pauvre frère est mort et a été tué soit par les mains de Florindo Aretusi, soit par quelqu'un d'autre pour sa raison. Vous serez surpris que Florindo m'aimait, et mon frère ne voulait pas que je le rembourse. Je ne sais pas comment ils ont attaqué: Federigo est mort et Florindo, par peur de la justice, s'est enfui sans pouvoir me dire adieu. Le ciel sait si je suis désolé pour la mort de mon pauvre frère et combien j'ai pleuré à cause de lui; mais maintenant il n'y a plus de remède, et je regrette la perte de Florindo, je sais qu'à Venise il s'est endormi et j'ai pris la résolution de le suivre. Avec les vêtements et les références de mon frère, me voici avec l'espoir de trouver votre amant là-bas. M. Pantalone, grâce à ces lettres, et merci beaucoup plus que votre affirmation, Federigo me croit déjà. Nous allons équilibrer nos comptes, collecter de l'argent et je peux également aider Florindo, s'il en a besoin. Regardez où l'amour mène! Secondatemi, chère Brighella, aidez-moi; vous serez largement récompensé.
Brighella - Tout va bien, mais aucun vorave ne me cause cette sœur Pantalon, de bonne foi, qui a payé l'argent et ce petit el est resté moqueur.
Béatrice - Comment moqué? Mon frère est mort, ne suis-je pas l'héritier?
Brighella - La vérité est. Mais pourquoi ne pas le découvrir?
Béatrice - Si je me retrouve, je ne fais rien. Pantalone commencera à vouloir être mon tuteur, et tout le monde me dérangera, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas pratique, et que sais-je? Je veux ma liberté. Cela ne durera pas longtemps, mais patience. En attendant, quelque chose arrivera.
Brighella - En fait, madame, un esprit bizarre l'a toujours. Lassa loin a mi, staga sur ma foi. Cela vous servira.
Béatrice - Allons à ton auberge.
Brighella - El so servitor où est-il?
Béatrice - Il a dit qu'il m'attendrait sur la route.
Brighella - Où l'aile a-t-elle décollé ce marteau? Nol sa gnanca parlar.
Béatrice - Je l'ai pris pour le voyage. Cela semble parfois idiot, mais ce n'est pas le cas; et je ne peux pas être désolé pour la fidélité.
Brighella - Ah, la loyauté est une bonne chose. Allez, elle reste servante, vardè amor cossa qui lui fait faire ça.
Béatrice - Ce n'est rien. Amor aggrave (en partie ).
Brighella - Eh, nous avions bien des principes. Entrer là-bas, non s'il sait que cossa pourrait arriver (en partie ).
SCÈNE VI
Rue avec l'auberge de Brighella .
Truffaldino- J'en ai assez d'attendre, que je ne peux plus. Je suis mécène si je reçois un petit magna, et ce petit el me fait sucer. La demi-corne de la ville est le fils qui est une demi-heure, et la demi-corne de mes tripes est le fils qui sera des heures. Almanco savesse où il faut aller à alozar. Je change de sous-sol j'arrive dans une ville, le premier cossa je vais à la taverne. Lu, sior no, el pose les malles dans le bateau du corrier. el va visiter, et s'il n'enregistre pas le pauvre serviteur. Quand je dis, je dois servir les maîtres avec amour! Il faut dire aux maîtres que j'ai un peu de charité pour les domestiques. Voici une auberge; presque presque pour aller voir si ghe remue de devertir el dente; mais si el padron me cherche? Je connais des dégâts, que j'ai un peu de discrétion. Tu vas; mais maintenant qu'est-ce que je pense, il y a une autre petite difficulté, que je ne fais pas arrecordava; Je n'ai pas de quattrine. Oh pauvre Truffaldin! Plus de pain grillé que le serviteur, le corps du diable, veux-tu me mettre dans ... cossa mo? Par la grâce du ciel, je ne sais pas comment agir
SCÈNE VII
Voyage Florindo avec un porteur avec un tronc sur l'épaule, et dit .
Porter - Ghe digo que je ne peux plus; il pèse que el mazza.
Florindo - Voici une enseigne de taverne ou d'auberge. Ne pouvez-vous pas suivre ces quatre étapes?
Porter - Aide; el baul va sur terre.
Florindo - J'ai dit que vous n'auriez pas été au hasard: vous êtes trop faible: vous n'avez pas de force ( tient le tronc sur les épaules du Facchino ).
Truffaldino - (Se podess vadagnar diese soldi) (en observant le Porter ). Monsieur, commandez quelque chose de moi? Puis-je vous servir? ( à Florindo ).
Florindo - Cher monsieur, aidez à amener ce coffre à cet hôtel.
Truffaldino - Immédiatement, la lassa loin a mi. Il la regarde comme s'il le faisait. Il décède (il passe l'épaule sous le coffre, le prend par-dessus tout et pousse le Porter au sol avec une poussée ).
Florindo - Très bien.
Truffaldino - Se nol pnnente! ( entre dans l'auberge avec le coffre ).
Florindo - Voyez-vous comment cela se fait? ( al Facchino ).
Porter - Je ne peux pas faire plus. Fazzo el facchin par malheur; mais je suis fier d'une personne civilisée.
Florindo - Que faisait ton père?
Porter - Mon père? El a escorté les agneaux jusqu'à la ville.
Florindo - (C'est un fou; rien d'autre) (il veut aller à l'auberge ).
Porter - Lustrissimo, la favorissa.
Florindo - Quoi?
Porter - Le bezzi de la portadura.
Florindo - Combien dois-je vous donner pour dix étapes? Voici le bus ( indices à l'intérieur de la scène ).
Porter - Je ne compte pas les étapes; payez-moi ( tend la main ).
Florindo - Voici cinq pièces ( met une pièce dans sa main ).
Porter - Il me paie ( tend la main ).
Florindo - Ou quelle patience! Voici cinq autres ( faites comme ci-dessus ).
Porter - Payez-moi ( comme ci-dessus ).
Florindo - ( lui donne un coup de pied ) Je m'ennuie.
Porter - Maintenant, je suis payé (en partie ).
SCÈNE VIII
Florindo, puis Truffaldino .
Florindo - Quel genre d'humeur donnent-ils! Il n'attendait que moi pour le maltraiter. Oh, allons voir de quel hôtel il s'agit ...
Truffaldino - Signor, l'è restada servida.
Florindo - De quel logement s'agit-il?
Truffaldino - C'est une bonne auberge, monsieur. Bons lits, beaux miroirs, une belle cusina, avec une odeur qui console. Ho parle au serveur. Elle la servira de roi.
Florindo - Que fais-tu?
Truffaldino - El serviteur.
Florindo - Êtes-vous vénitien?
Truffaldino - Non, je suis vénitien, mais je suis ici de l'État. Je viens de Bergame, pour vous servir.
Florindo - Avez-vous un maître maintenant?
Truffaldino - Maintenant ... je ne l'ai vraiment pas.
Florindo - Êtes-vous sans maître?
Truffaldino - Le voici; il le voit, je suis sans maître. (Qua nol gh'è el me padron, mi no digo busie).
Florindo - Voulez-vous venir me servir?
Truffaldino - Pour vous servir? Pourquoi pas? (Si les pactes étaient pires, changez-moi de camisa).
Florindo - Au moins pour le temps que je suis à Venise.
Truffaldino - Très bien. Combien voulez-vous me donner?
Florindo - Combien attendez-vous?
Truffaldino - Ghe je dirai: un autre propriétaire qui en avait, et qui maintenant je n'ai plus ici, m'a donné un felippo par mois et les dépenses.
Florindo - Eh bien, et je vais vous donner tellement.
Truffaldino - Vous devez m'avoir donné quelque chose de plus.
Florindo - Que pourriez-vous attendre de plus?
Truffaldino - Un soldat zorn pour le tabac el.
Florindo - Oui, volontiers; Je te le donnerai.
Truffaldino - Co l'è cusì, stago con lu.
Florindo - Mais vous voudriez un peu d'informations sur vos faits.
Truffaldino - Pour toute autre information que les faits Mii, allez à Bergame, qui dira à tout le monde qui je suis.
Florindo - N'avez -vous personne à Venise qui vous connaisse?
Truffaldino - Son arrivera ce matin, monsieur.
Florindo - Orsù; Je mure un homme bon. Je vais vous essayer.
Truffaldino - Essayez-le et vous le verrez.
Florindo - Tout d'abord, je veux voir s'il y a des lettres pour moi à la Poste. Voici un demi-bouclier; allez au bureau de poste de Turin, demandez s'il y a des lettres de Florindo Aretusi; s'il y en a, prenez-les et apportez-les immédiatement, ce que je vous attends.
Truffaldino - En attendant, le parachimique affolé de démêler.
Florindo - Oui, bien, je vais me préparer. (C'est facétieux: je ne suis pas désolé. Petit à petit je vais le prouver) ( entre dans l'auberge ).
SCÈNE IX
Truffaldino, puis Béatrice pour les hommes et Brighella .
Truffaldino - Un sou au zorno de plus, j'ai trente dollars par mois; non, il n'est pas vrai que l'alter me dague un felippo; el me donne diese pauli, Pol ess qui a donné à pauli i fazza un felippo, mais je ne connais pas de seguro. Et je ne vois plus ce Turinois sior. Il est fou. Il y a un bidonville qui n'a ni barbe ni jugement. Lassemolo va; nous irons à la poste pour sto sior ... (il veut partir et rencontre Béatrice ).
Béatrice - Très bien. Alors tu m'attends?
Truffaldino - Je suis ici, monsieur. Je t'attends toujours.
Béatrice - Et pourquoi m'attends-tu ici, et pas dans la rue où je te l'ai dit? C'est un accident qui vous a trouvé.
Truffaldino - Je me suis un peu amusé parce que j'avais faim.
Béatrice - Allez, allez tout de suite au bateau du courrier. Faites livrer ma malle et apportez-la à l'auberge de Messer Brighella ...
Brighella - Voici mon auberge; pas pol échouer.
Béatrice - Alors, dépêche-toi, je t'attends.
Truffaldino - (Enfer! Dans cette auberge!).
Béatrice - Ici, en même temps, vous irez à la Poste de Turin et vous demanderez s'il y a des lettres de ma part. En effet, il demande s'il y a des lettres de Federigo Rasponi et Beatrice Rasponi. Ma sœur a également dû venir avec moi et, pour des inconvénients, elle est restée dans la villa, des amis ont pu lui écrire; voyez s'il y a des lettres pour vous ou pour moi.
Truffaldino - (je ne sais pas quoi faire. Je suis l'homme le plus imbroià de ce monde).
Brighella - (Comment attendez-vous des lettres à mon vrai nom et mon faux nom, si vous l'avez laissé secrètement?) ( Lentement à Beatrice ).
Béatrice - (j'ai laissé l'ordre d'écrire à un de mes fidèles serviteurs qui administre les choses dans ma maison; je ne sais pas avec quel nom il peut m'écrire. Mais allez, je vais tout vous dire confortablement) ( plan à Brighella ). Dépêchez-vous, allez au bureau de poste et allez dans le bus. Prenez les lettres, apportez le coffre à l'auberge, attendez-vous ( entrez dans l'auberge ).
Truffaldino - Sì vu el padron della inn? ( à Brighella ).
Brighella - Oui, eh bien, je le suis. Porteve ben, et no ve dubitè, que je te ferai magnar ben ( entrez dans l'auberge ).
SCÈNE X
Truffaldino, puis Silvio .
Truffaldino - Oh magnifique! Il y en a beaucoup qui recherchent un maître, et j'ai trouvé quelque chose à voir avec eux. Comment diable faire? Je peux tous les servir. Non? Pourquoi pas? Non, la saria est une bonne chose pour tous les servir, et gagner un salaire, et magnar el double? La belle saria, sinon je le remarquerais. Et si je remarque, cossa pèrdio? Noffink. Si l'un me renvoie, je reste avec l'autre. De galantomo, que tu ailles essayer moi. Si cela ne dure qu'un jour, je vais essayer. Au final, j'aurai toujours un bon truc. Animo; andemo le Mail for All do ( Incamminandosi ).
Silvio - (Ceci est le serviteur de Federigo Rasponi). Galantuomo ( à Truffaldino ).
Truffaldino - M.
Silvio - Où est notre maître?
Truffaldino - El me padron? Il est là dans cette auberge.
Silvio - Va immédiatement chez ton maître, dis-lui que je veux lui parler; s'il est un homme d'honneur, descends, je t'attends.
Truffaldino - Mais cher monsieur ...
Silvio - Allez immédiatement (à haute voix ).
Truffaldino - Mais sachez qu'el me padron ...
Silvio - Moins de réponses, je jure au paradis.
Truffaldino - Mais qu'a-t-il à vegnir? ...
Silvio - Tout de suite, ou ils vous suffisent.
Truffaldino - (je ne sais pas, je vais envoyer le premier que je trouve) ( entre dans l'auberge ).
SCÈNE XI
Silvio, puis Florindo et Truffaldino .
Silvio - Non, il ne sera jamais vrai que je souffre de voir un rival sous mes yeux. Si Federigo a échappé une fois à sa vie, le même sort ne lui arrivera pas toujours. Soit il doit renoncer à toute prétention sur Clarice, soit il devra me faire ... D'autres personnes sortent de l'auberge. Je ne veux pas être dérangé (se retire du côté opposé ).
Truffaldino - Voici ce sior qui jette du fogo de tous les groupes ( Silvio fait allusion à Florindo ).
Florindo - Je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Je ne sais pas. Je vais tor les lettres; avec une si bonne grâce. (Pas d'engagements voggio) ( en soi et en partie ).
Silvio - (Et Federigo ne vient pas).
Florindo - (je veux clarifier la vérité). Seigneur, es-tu celui qui m'a demandé? ( à Silvio )
Silvio - Moi? Je n'ai même pas l'honneur de vous rencontrer.
Florindo - Pourtant, ce serviteur, qui est maintenant parti d'ici, m'a dit cela d'une voix impérieuse et avec des menaces que vous faisiez semblant de me provoquer.
Silvio - Il m'a mal compris; J'ai dit que je voulais lui parler maître.
Florindo - Eh bien, je suis son maître.
Silvio - Vous, son maître?
Florindo - Bien sûr. Il est à mon service.
Silvio - Pardonnez donc, soit votre serviteur est semblable à un autre que j'ai vu ce matin, soit il sert une autre personne.
Florindo - Il me sert, n'y pense pas.
Silvio - Quand c'est le cas, je reviens pour m'excuser.
Florindo - Il n'y a aucun mal. Les malentendus se cachent toujours.
Silvio - Êtes-vous un étranger, monsieur?
Florindo - Turinois, à votre disposition.
Silvio - Turinois était précisément celui avec qui il voulait me décharger.
Florindo - S'il est mon paysan, il se peut que je le connaisse, et s'il vous a dégoûté, je vous utiliserai volontiers pour vos justes satisfactions.
Silvio - Connaissez-vous un certain Federigo Rasponi?
Florindo - Ah! Je le connais trop.
Silvio - Il réclame un mot de son père pour me retirer une épouse qui a juré cette foi par moi.
Florindo - Ne doutez pas, mon ami, Federigo Rasponi ne peut pas invoquer la mariée. Il est mort.
Silvio - Oui, tout le monde croyait qu'il était mort, mais ce matin il est arrivé vivant et en bonne santé à Venise, pour mes malades, pour mon désespoir.
Florindo - Seigneur, tu me fais rester stupéfait.
Silvio - Mais! J'y suis resté aussi.
Florindo - Federigo Rasponi Je vous assure qu'il est mort.
Silvio - Federigo Rasponi Je vous assure qu'il est vivant.
Florindo - Veillez à ce que vous soyez trompé.
Silvio - Signor Pantalone de'Bisognosi, père de la fille, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'en assurer, et a la preuve très certaine que c'est lui-même.
Florindo - (Il n'a donc pas été tué, comme tout le monde le croyait, dans le combat!).
Silvio - Soit lui ou moi devons renoncer aux amours ou à la vie de Clarice.
Florindo - (Ici Federigo? J'échappe à la justice, et je fais face à l'ennemi!).
Silvio - Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Il devait rester dans cette auberge.
Florindo - Je ne l'ai pas vu; ici, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'étranger.
Silvio - Cela aura changé la façon de penser. Monsieur, désolé si je vous ai dérangé. Si vous le voyez, dites-lui que de son mieux il abandonnera l'idée d'un tel mariage. Silvio Lombardi est mon nom; J'aurai l'honneur de vous vénérer.
Florindo - J'apprécierai grandement votre amitié. (Je reste plein de confusion).
Silvio - Votre nom, en grâce, puis-je le savoir?
Florindo - (je ne veux pas le savoir). Orazio Ardenti pour vous obéir.
Silvio - M. Horace, je suis à votre disposition (partie).
SCÈNE XII
Florindo seul .
Florindo - Comment se fait-il qu'un coup qui passait du côté aux reins ne l'ait pas tué? Je l'ai également vu étendu par terre, enveloppé de son propre sang. Je voulais dire qu'il a expiré, il était sur place. Pourtant, il se peut qu'il ne soit pas mort. Le fer touché ne l'aura pas dans les parties vitales. La confusion vous fait voir. Le fait que j'ai fui Turin immédiatement après les faits, ce qui m'était attribué pour notre inimitié, ne m'a pas permis de détecter la vérité. Donc, comme il n'est pas mort, il vaudrait mieux que je retourne à Turin, si je vais consoler ma bien-aimée Béatrice, qui vit peut-être dans la douleur, et pleure pour mes distances.
SCÈNE XIII
Truffaldino avec un autre porteur qui porte la malle de Béatrice, et dit .
Truffaldino avance de quelques pas avec le Facchino, réalisant alors Florindo et doutant d'être vu, il retire le Facchino .
Truffaldino - Allons avec moi ... Oh diable! Cet autre maître est ici. Retirez-vous, au Cameroun, et attendez ce canton ( le Porter prend sa retraite ).
Florindo - (Oui, bien sûr. Je reviendrai à Turin).
Truffaldino - Je suis ici, monsieur ...
Florindo - Truffaldino, voulez-vous venir à Turin avec moi?
Truffaldino - Quand?
Florindo - Maintenant, immédiatement.
Truffaldino - Sans disnar?
Florindo - Non; nous déjeunerons, puis nous partirons.
Truffaldino - Très bon; disnando ghe pense.
Florindo - Êtes-vous allé au bureau de poste?
Truffaldino - M. oui.
Florindo - Avez-vous trouvé mes lettres?
Truffaldino - Ghe je l'ai trouvé.
Florindo - Où suis-je?
Truffaldino - Maintenant, je vais les trouver (il sort trois lettres de sa poche ). (Oh enfer! J'ai confondu ceux d'un propriétaire avec ceux de l'autre. Comment puis-je trouver un phare fora le soe? Mi no so lezer).
Florindo - Animo, donnez mes lettres ici.
Truffaldino - Maintenant, monsieur. (Je triche). Ghe dira, monsieur. Avec trois lettres il ne vient pas tout à VS Ho il trouve un domestique qui me connaît, qui sert en même temps à Bergame; gh'ho a dit qu'il allait au bureau de poste, et il m'a demandé de voir s'il y avait quelque chose pour el so padron. Il me semble que c'était un, mais je ne le sais plus, je ne sais pas ce que c'est.
Florindo - Laisse-moi faire; Je prendrai la mienne, et l'autre je te la rendrai.
Truffaldino - Tolì pur. Me press de servir amigo.
Florindo - (Que vois-je? Une lettre directe à Béatrice Rasponi? À Béatrice Rasponi à Venise!).
Truffaldino - Avez-vous trouvé celui de ma camerada?
Florindo - Qui est votre camarade qui vous a confié une telle tâche?
Truffaldino - C'est un serviteur ... qui s'appelle Pasqual.
Florindo - De qui a-t-il besoin?
Truffaldino - Je ne sais pas, monsieur.
Florindo - Mais s'il vous a dit de chercher les lettres de son maître, il vous aura donné le nom.
Truffaldino - Bien sûr. (L'escroc grandit).
Florindo - Eh bien, quel nom vous a-t-il donné?
Truffaldino - Je ne suis pas d'accord.
Florindo - Comment! ...
Truffaldino - El l'a écrit sur un morceau de papier.
Florindo - Et où est la carte?
Truffaldino - Je l'ai laissé au bureau de poste.
Florindo - (je suis dans une mer de confusion).
Truffaldino - (je m'en vais).
Florindo - Où est ce Pasquale à la maison?
Truffaldino - Je ne sais pas vraiment.
Florindo - Comment pouvez-vous récapituler la lettre qui lui est adressée?
Truffaldino - El m'ha doigt que si on voit sur la place.
Florindo - (je ne sais pas quoi penser).
Truffaldino - (Si je le rends propre, c'est un miracle). Je privilégie cette lettre, que je verrai de la trouver.
Florindo - Non, je veux ouvrir cette lettre.
Truffaldino - Ohibò; non, le fazza est cossa. Vous savez, cependant, quelle douleur c'est d'avoir les lettres.
Florindo - Tant pis, cette lettre m'intéresse trop. Il s'adresse à une personne qui m'appartient pour un titre. Sans scrupule je peux l'ouvrir (l'ouvrir).
Truffaldino - (Slave siori. El l'a fait).
Florindo - ( lit )
La plus illustre femme propriétaire.
Son départ de cette ville a donné raison de parler à tout le pays; et tout le monde comprend qu'elle a pris cette résolution pour suivre le signataire Florindo. La Cour a pénétré qu'elle s'est enfuie en costume d'homme et ne lui permet pas de faire diligence pour la retrouver et la faire arrêter. Je n'ai pas envoyé la présente lettre de ce bureau de poste de Turin à Venise, afin de ne pas couvrir le pays où elle m'a confié qu'elle pensait qu'elle allait; mais je l'ai envoyé à un ami de Gênes, pour qu'il l'envoie ensuite à Venise. Si j'ai de nouvelles fonctionnalités, je ne vous laisserai pas les communiquer avec la même méthode, et je me résigne humblement.
Serviteur très humble et fidèle
Tognin de Doira .
Truffaldino - (Quelle belle action! Lezer les faits des autres).
Florindo - (Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai lu? Béatrice a quitté sa maison? En robe d'homme? Pour venir après moi? Elle m'aime vraiment. Elle voulait que le paradis la trouve à Venise!). Allez, cher Truffaldino, utilisez toutes les diligences pour trouver Pasquale; il essaie d'obtenir de lui qui est son maître, s'il est homme, si femme. Détectez où il réside, et si vous le pouvez, amenez-le ici pour moi, qui vous donnera, à vous et à lui, un pourboire très généreux.
Truffaldino - Deme la lettre; Je vais essayer de le trouver.
Florindo - Le voici, je vous le recommande. Cette chose me presse infiniment.
Truffaldino - Mais que dois-je donner à la cusì averta?
Florindo - Dis-lui que c'était un malentendu, un accident. Ne me trouve pas difficile.
Truffaldino - Et à Turin si tu y vas plus pour l'instant?
Florindo - Non, nous n'y allons plus. Ne perdez pas de temps. Pouvoir de retrouver Pasquale. (Béatrice à Venise, Federigo à Venise. Si son frère la trouve, elle est misérable; je ferai tout le possible pour la retrouver) (en partie ).
SCÈNE XIV
Truffaldino seul, puis le Porter avec le coffre .
Truffaldino - J'ai un goût galantomien, pas si je m'en vais. J'ai la volonté de voir comment je gère ce service. Vous allez essayer ma compétence. Il y a une lettre, qui va me st'alter me padron, me despias de averghela porter. Je vais vous apprendre à le plier (il fait plusieurs mauvais plis ). Maintenant, nous devons l'apposer. Si saviez comment faire! J'ai vu ma grand-mère siora, qui tamponnait parfois ses lettres de pan mastegà. Voio provar ( sort un morceau de pain de sa poche ). Me despiase consumar sto tantin de pan; ma ghe vol pazenzia ( mâche du pain pour sceller la lettre, mais ne veut pas l'avaler ). Oh l'enfer! Le est parti zo. Un autre boccon doit être du mastegarghène (il fait de même et l'avale). Pas de remède gh'è, la nature est répugnante. Je vais réessayer ( mâcher, comme ci-dessus. Il aimerait avaler le pain, mais il s'abstient, et avec beaucoup de difficulté s'il le sort de sa bouche ). Oh, c'est vegnù. J'accepterai la lettre ( scellez-la avec du pain ). Il me semble que ça stague bien. Super mi pour rendre le cosse propre! Oh, non, ça ne me convenait pas plus que le portier. Camerada, gauche devant, enlevée sur el baul ( vers la scène ).
Porter - ( avec le tronc sur l'épaule ) Je suis là, où dois-je le porter?
Truffaldino - Portel dans cette auberge, que je me vends maintenant.
Porter - Et qui paiera?
SCÈNE XV
Béatrice, qui quitte l'auberge, et dit .
Béatrice - C'est ma malle? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - M. oui.
Béatrice - Emmenez-le dans ma chambre ( al Facchino ).
Porter - Quelle est ma chambre?
Béatrice - Demandez au serveur à ce sujet.
Porter - Semo accepte trente dollars.
Béatrice - Allez, je vais vous payer.
Porter - Quel imbécile bientôt.
Béatrice - Ne me dérange pas.
Porter - Maintenant, ghe butto el baul au milieu de la rue ( entrez dans l'auberge ).
Truffaldino - Des gens super gentils qui sont porteurs!
Béatrice - Avez-vous été au bureau de poste?
Truffaldino - M. oui.
Béatrice - Y a-t-il des lettres de moi?
Truffaldino - Ghe était l'une de vos sœurs.
Béatrice - Eh bien, où est-elle?
Truffaldino - La voici ( lui donne la lettre ).
Béatrice - Cette lettre a été ouverte.
Truffaldino - Averta? Oh! pas de pol ess.
Béatrice - Ouvert et scellé maintenant avec du pain.
Truffaldino - Mi no saveria jamais tel qu'il était.
Béatrice - Tu ne sais pas, hein? Briccone, indigne; qui a ouvert cette lettre? Je veux le savoir.
Truffaldino - Ghe dira, monsieur, ghe avouera la vérité. Ils sont tous capables d'échouer. Au bureau de poste, il y avait une lettre de moi; Je connais le petit lezer; et en faute, au lieu d'avoir le mien, j'ai eu le soa. Ghe demande pardon.
Béatrice - S'il en était ainsi, il n'y aurait aucun mal.
Truffaldino - C'est si pauvre fiole.
Béatrice - Avez-vous lu cette lettre? Savez-vous ce qu'il contient?
Truffaldino - Pas du tout. C'est un personnage que je ne comprenais pas.
Béatrice - Quelqu'un l'a vue?
Truffaldino - Oh! ( émerveillé ).
Béatrice - Attention, véh!
Truffaldino - Euh! ( comme ci-dessus ).
Béatrice - (je ne veux pas qu'il me trompe) ( lit lentement ).
Truffaldino - (C'est aussi tacconada).
Béatrice - (Tognino est un fidèle serviteur. J'ai une obligation pour lui). Allez, je pars pour un intérêt pas loin. Tu vas à l'auberge, ouvre le coffre, voici les clés et donne un peu d'air à mes vêtements. Quand je reviendrai, nous déjeunerons (Signor Pantalone n'est pas vu, et ces pièces sont pressées par moi) ( partie ).
SCÈNE XVI
Truffaldino, puis Pantalone .
Truffaldino - Mo l'è andada ben, che non podeva mear meio. Je suis un homo de garbo; J'estime cent écus de plus que ce qu'il n'a pas estimé.
Pantalon - Disè, amigo et votre maître xèlo à la maison?
Truffaldino - Sior no, nol ghe xè.
Pantalon - Saveu où est-il?
Truffaldino - Gnanca.
Pantalon - Vous rentrez chez vous pour vous déshabiller?
Truffaldino - Croyez-moi oui.
Pantalone - Tolè, avec sa maison, vaut un sac avec une centaine de ducats. Non, je ne peux pas me retenir, car je dois le faire. Ve reverisso ( partie ).
SCÈNE XVII
Truffaldino, puis Florindo .
Truffaldino - Le barrage, sentez-le. Bon viazo. Je n'ai aucun doigt sur lequel des maîtres je dois donner.
Florindo - Eh bien, avez-vous retrouvé Pasquale?
Truffaldino - Sior non, non je l'ai trouvé Pasqual, mais j'en ai trouvé un, qui m'a donné un sac avec une centaine de ducats.
Florindo - Cent ducats? Pour faire ça?
Truffaldino - Disim la vérité, sior padron, attendre de l'argent de n'importe quel groupe?
Florindo - Oui, j'ai présenté une lettre à un marchand.
Truffaldino - Donca sti quattrini sera à vous.
Florindo - Que vous ont dit ceux qui les ont donnés?
Truffaldino - El m'ha dit, qui les dague à mon maître.
Florindo - Ils sont donc certainement les miens. Suis-je pas votre maître? Quel doute y a-t-il?
Truffaldino - (Nol savnente de cet autre padron).
Florindo - Et vous ne savez pas qui vous les a donnés?
Truffaldino - je ne sais pas; Il me semble avoir revu ce visage, mais je ne m'en souviens pas.
Florindo - Ce sera un marchand, à qui je suis recommandé.
Truffaldino - El sera certainement lu.
Florindo - N'oubliez pas Pasquale.
Truffaldino - Après disnar je le trouverai.
Florindo - Alors allons-y et demandons le déjeuner ( entrez dans l'auberge ).
Truffaldino - Andemo pur. Je m'ennuie beaucoup cette fois je n'échoue pas. Je donne le sac à tous ceux qui l'ont ( entre dans l'auberge ).
SCÈNE XVIII
Chambre dans la maison de Pantalone Pantalone et Clarice, puis Smeraldina .
Pantalons - Beaucoup; sior Federigo doit être votre mario. Ho donne la parole, et non je suis un bambozzo.
Clarice - Vous êtes maître de moi, monsieur le père; mais cela, pitié de moi, est une tyrannie.
Pantalone - Lorsque sœur Federigo vous l'a demandé, je l'ai touché; vu ne m'a pas répondu de pas le vouloir. Il fallait ensuite parler; maintenant plus à temps.
Clarice - La crainte et le respect m'ont rendu sans voix.
Pantalone - Fè that el respetto et la suggestion souffle la même hanche maintenant.
Clarice - Je ne peux pas, monsieur le père.
Pantalon - Non? par cossa?
Clarice - Federigo Je ne vais certainement pas l'épouser.
Pantalons - Méprisez-vous beaucoup?
Clarice - C'est odieux à mes yeux.
Pantalon - Hip, oui, je vous apprends comment faire cette piasa el ve?
Clarice - Comment ça se fait, monsieur?
Pantalone - Desmenteghève sior Silvio, et vous verrez que el ve piaserà.
Clarice - Silvio est trop fortement imprimé dans mon âme; et vous, avec votre approbation, l'avez enraciné encore plus.
Pantalon - (d'un groupe le compact). Il faut faire de nécessité vertù.
Clarice - Mon cœur n'est pas capable d'un si grand effort.
Pants - Feve soul, vous devez le faire ...
Smeraldina - Maître, voici Signor Federigo, qui veut vous vénérer.
Pantalon - Ch'el vegna, qui est le patron.
Clarice - Hélas! Quel tourment! ( pleure ).
Smeraldina - Qu'avez-vous, maîtresse maîtresse? Pleurer? En vérité, vous vous trompez. Vous n'avez pas vu à quel point le signor Federigo est beau? Si une telle chance m'arrivait, je ne voudrais pas pleurer, non; Je voudrais rire de ma bouche (en partie ).
Pantalon - Allez, fia mia, ne te montre pas de pleurer.
Clarice - Mais si je sens mon cœur éclater.
SCENE XIX
Beatrice pour hommes, et dictons .
Beatrice - Je vénère M. Pantalone.
Pantalon - vénéré Padron. Àla portait-elle un sac avec une centaine de ducats?
Béatrice - Moi non.
Pantalon - je l'ai donné un peu à mon serviteur. Mon doigt veut que el x soit un homme de confiance.
Béatrice - Oui, il n'y a pas de danger. Je ne l'ai pas vu: ça me les donnera quand je rentrerai. (Qu'est-ce que Mme Clarice pleure?) ( Doucement à Pantalone ).
Pantalone - (Chère sœur Federigo, tu dois te sentir désolée pour elle. La nova de ma mort xè stada causa de sto mal. Avec le temps j'espère qu'elle l'échangera) ( plan à Béatrice ).
Béatrice - (Faites quelque chose, Signor Pantalone, laissez-moi un moment avec vous, pour voir si je pourrais avoir un bon mot) ( comme ci-dessus ).
Pantalon - Sior Oui; vague et vegno. (Voggio les essayer tous). Fia mia, attends-moi, que maintenant je reviens. Gardez une petite compagnie au novice. (Allez, porte un jugement) ( plan pour Clarice, et part ).
SCÈNE XX
Béatrice et Clarice .
Béatrice - Eh bien, Mme Clarice ...
Clarice - Eloignez-vous, et n'osez pas me déranger.
Béatrice - Si sévère avec qui ta femme est-elle destinée?
Clarice - Si je suis forcément attiré par votre mariage, vous aurez ma main, mais pas mon cœur.
Béatrice - Vous vous indignez de moi, mais j'espère vous apaiser.
Clarice - Je t'abhorrerai pour toujours.
Béatrice - Si tu me connaissais, tu ne le dirais pas.
Clarice - Je vous connais assez pour le fauteur de troubles de ma paix.
Béatrice - Mais j'ai un moyen de vous consoler.
Clarice - Vous êtes trompé; d'autres que Silvio consulaire ne pouvait pas.
Béatrice - Bien sûr, je ne peux pas te donner cette consolation que ton Silvio pourrait te donner, mais je peux contribuer à ton bonheur.
Clarice - Il me semble beaucoup, monsieur, qu'en vous parlant de la manière la plus dure du monde, vous voulez toujours me tourmenter.
Béatrice - (Ce pauvre jeune homme a pitié de moi; je n'ai pas le cœur de la voir souffrir).
Clarice - (La passion me rend audacieux, téméraire, non civilisé).
Béatrice - Mme Clarice, j'ai un secret à vous dire.
Clarice - Je ne te promets pas le secret. N'oubliez pas de me le dire.
Béatrice - Votre austérité m'enlève le moyen de vous rendre heureux.
Clarice - Vous ne pouvez que me rendre malheureux.
Béatrice - Tu es trompé; et pour vous convaincre, je vais parler franchement. Si tu ne veux pas de moi, je ne saurais pas quoi faire de toi. Si vous avez commis le droit aux autres, moi aussi j'ai engagé mon cœur.
Clarice - Maintenant tu commences à m'aimer.
Béatrice - N'avais-je pas dit que j'avais le moyen de vous consoler?
Clarice - Ah, j'ai bien peur que tu me déçois.
Béatrice - Non, madame, je ne fais pas semblant. Vous avez parlé avec le cœur sur les lèvres; et si vous me promettez ce secret que vous m'avez refusé il y a un instant, je vous confierai un arcane, qui vous assurera la paix.
Clarice - Je jure d'observer le silence le plus rigoureux.
Béatrice - Je ne suis pas Federigo Rasponi, mais Béatrice de sa sœur.
Clarice - Oh! que me dis-tu jamais! Toi femme?
Béatrice - Oui, je suis telle. Pensez, si j'aspirais de tout cœur à votre mariage.
Clarice - Et quel nouveau frère nous donnez-vous?
Béatrice - Il est mort encore trop d'un coup d'épée. Un de mes amants serait l'auteur de sa mort, dont je suis en train de retrouver la trace dans ces restes. Priez pour toutes les lois sacrées de l'amitié et de l'amour pour ne pas me trahir. Je sais à quel point je vous ai fait confiance avec un tel arcane, mais je l'ai fait pour plusieurs raisons; premièrement, parce que cela me faisait de la peine de vous voir affligé; deuxièmement, parce que je semble savoir en vous que vous êtes une fille qui peut transiger sur le secret; enfin, parce que votre Silvio m'a menacé et je ne voudrais pas, à votre demande, de me juger.
Clarice - Permettez-vous à Silvio de me le dire?
Béatrice - Non, en fait je t'interdis absolument.
Clarice - Eh bien, je ne parlerai pas.
Béatrice - Attention, je te fais confiance.
Clarice - Je te le jure encore, je ne parlerai pas.
Béatrice - Maintenant tu ne me regarderas plus mal.
Clarice - En effet, je serai ton amie; et si je peux vous aider, faites-moi.
Béatrice - Moi aussi, je jure éternellement mon amitié. Donne-moi ta main.
Clarice - Eh, je ne veux pas ...
Béatrice - As-tu peur que je ne sois pas une femme? Je vais vous donner des preuves claires de la vérité.
Clarice - Croyez-moi, cela me semble toujours être un rêve.
Béatrice - En fait, la chose n'est pas ordinaire.
Clarice - C'est extravagant.
Béatrice - Allez, je veux y aller. Touchons notre main en signe de bonne amitié et de loyauté.
Clarice - Voici la main; Je ne doute pas que tu me trompes.
SCENE XXI
Pants et dit .
Pantalon - Bravo! Je me réjouis infiniment. (Fia mia, il a raison très bientôt) ( à Clarice ).
Béatrice - Je n'ai pas dit, signor Pantalone, que je la calmerais?
Pantalon - Bravo! Il avait fait plus de vu en quatre minutes, qu'il ne m'avait pas fait en quatre ans.
Clarice - (maintenant je suis dans un labyrinthe majeur).
Pantalone - Donca nous allons bientôt établir ce mariage ( avec Clarice ).
Clarice - Ne soyez pas si pressé, monsieur.
Pantalon - Comment! Si s'il touche les petites mains de scondon, et que je n'ai pas de presse? Non, non, non, je suppose que ça ne m'arrive pas. Doman s'il fait tout.
Béatrice - Il faudra, monsieur Pantalone, que nous réglions d'abord nos jeux, que nous voyions notre compte.
Pantalon - Nous ferons tout. Ces xè cosse qu'il fait en deux heures. Nous donnerons la bague demain.
Clarice - Oh, monsieur le père ...
Pantalon - Siora fia, vago in sto ponto pour dire les mots à sœur Silvio.
Clarice - Ne l'irritez pas, pour l'amour du ciel.
Pantalon - Qu'est-ce que c'est? Ghe ne vustu do?
Clarice - Je ne dis pas ça. Mais...
Pantalon - Mais et mo, le x est terminé. Esclave, siori ( veut partir ).
Béatrice - Écoutez ... ( à Pantalone ).
Pantalone - Sè mario et muggier (au départ ).
Clarice - Plutôt ... ( à Pantalone ).
Pantalon - Nous le décrirons ce soir ( partie ).
SCÈNE XXII
Béatrice et Clarice .
Clarice - Ah, Madame Beatrice, je sors d'un effort pour en entrer un autre.
Béatrice - Ayez de la patience. Tout peut arriver, à moins que je ne t'épouse.
Clarice - Et si Silvio me croit infidèle?
Béatrice - La tromperie durera peu de temps.
Clarice - Si je pouvais lui révéler la vérité ...
Béatrice - Je ne vous dégagerai pas du serment.
Clarice - Que dois-je faire alors?
Béatrice - Souffrir un peu.
Clarice - Je doute qu'une telle souffrance soit trop douloureuse.
Béatrice - Ne doutez pas, qu'après les peurs, après les soucis, les heureux amants soient plus les bienvenus (partie).
Clarice - Je ne peux pas me flatter de me sentir heureuse tant que je ne me vois pas entourée de douleurs. Ah, malheureusement, il est vrai: dans cette vie, pour la plupart, c'est douloureux, ou plein d'espoir, et peu de fois est apprécié (partie).
ACTE DEUX
SCÈNE I
Cour dans la maison de Pantalone.
Silvio et le docteur.
Silvio - Monsieur le père, veuillez me laisser tranquille.
Docteur - Arrêtez; réponds-moi un peu.
Silvio - je suis hors de moi.
Docteur - Pourquoi êtes-vous venu dans la cour de M. Pantalone?
Silvio - Parce que je veux, ou qu'il gardera ce mot qu'il m'a donné, ou qu'il réalisera l'affront très grave.
Docteur - Mais c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait dans votre maison Pantalone. Vous êtes un imbécile d'être emporté par la colère.
Silvio - Ceux qui nous traitent mal ne méritent aucun respect.
Docteur - C'est vrai, mais cela ne signifie pas que vous devez vous précipiter. Laisse-moi, mon Silvio, laisse-moi un peu lui parler; il se peut que je l'éclaire et lui fasse prendre conscience de son devoir. Ramassez quelque part et attendez-moi; sortir de cette cour, on ne fait pas de scènes. J'attendrai M. Pantalone.
Silvio - Mais moi, monsieur le père ...
Docteur - Mais moi, mon fils, je veux alors être obéi.
Silvio - Oui, je vais vous obéir. Je partirai. Parlez-lui. Je t'attends de l'apothicaire. Mais si M. Pantalone persiste, il devra s'occuper de moi (en partie ).
SCÈNE II
Le docteur, puis Pantalone .
Docteur - Pauvre fils, je le plains. Le signataire Pantalone n'aurait jamais dû le flatter devant un tel signe, avant d'être certain de la mort de Turin. Je voudrais aussi que cela se calme, et je ne voudrais pas que la colère la précipite.
Pantalon - (Cossa fait le docteur dans ma maison?).
Docteur - Oh, M. Pantalone, je vous révère.
Pantalon - Schiavo, sior Dottor. En ce moment, il cherchait du vu et du fio.
Docteur - Oui? Bravo, je suppose que vous avez dû nous retrouver, pour vous assurer que Signora Clarice sera la femme de Silvio.
Pantalone - Au contraire, il est venu dire ... ( montrant des difficultés à parler ).
Docteur - Non, il n'y a pas besoin d'autres justifications. Je suis désolé pour le cas où vous vous êtes retrouvé. Tout passe par la bonne amitié.
Pantalone - Seguro, qui vu la promesse faite à sœur Federigo ... ( hésitant, comme ci-dessus ).
Docteur - Et soudain attrapé par lui, vous n'avez pas eu le temps de réfléchir; et vous n'avez pas pensé à l'affront que nous avons fait à notre maison.
Pantalone - Non si pol dir affront, quand avec un autre contrat ...
Docteur - je sais ce que vous voulez dire. Il semblait à première vue que la promesse avec les Turinois était indissoluble, car elle était stipulée par contrat. Mais c'était un contrat entre vous et lui; et le nôtre est confirmé par la fille.
Pantalon - Xè true; mais...
Docteur - Et vous savez bien qu'en matière de mariage: Consensus et non concubitus facit virum .
Pantalon - Mi no so de latin; mais je digère ...
Docteur - Et les filles ne doivent pas être sacrifiées.
Pantalons - Aveu plus à dire?
Docteur - Pour moi, j'ai dit.
Pantalon - Aveu fenio?
Docteur - j'ai fini.
Pantalon - Puis-je parler?
Docteur - Parlez.
Pantalon - Sior cher docteur, avec toute votre doctrine ...
Docteur - A propos de la dot, nous ajusterons. Un peu plus, un peu moins, je ne regarderai pas.
Pantalon - Semo da capo. Voleu lassarme parlar?
Docteur - Parlez.
Pantalone - Je digère que ta doctrine est belle et bonne; mais dans ce cas, non.
Docteur - Et vous m'impliquerez après un tel mariage?
Pantalon - Pour moi, il est déjà occupé, avec lequel je ne pouvais pas m'en tirer. Mon fia x est heureux; quelle difficulté puis-je avoir? Il était en route pour chercher Silvio de vu ou de sior, pour dire que c'est du cossa. Moi despiase assae, mais je ne vois pas de remède.
Docteur - Je ne m'émerveille pas de votre fille; Je m'émerveille que tu te gâtes avec moi. Si vous n'étiez pas sûr de la mort de M. Federigo, vous n'aviez pas à vous engager envers mon fils; et si vous êtes attaché à lui, vous devez tenir parole au prix de tout. La nouvelle de la mort de Federigo justifiait suffisamment, même avec lui, votre nouvelle résolution, ni ne pouvait-il vous faire de reproches, ni ne réclamait aucune satisfaction. Le contrat conjugal ce matin entre Mme Clarice et mon fils coram testibusils ne pouvaient pas être dissous par un simple mot donné par vous à un autre. Cela me ferait plaisir avec les raisons de mon fils d'annuler tout nouveau contrat et d'obliger votre fille à le prendre pour mari; mais j'aurais honte d'avoir dans ma maison une belle-fille de si peu de réputation, une fille d'homme sans parole, comme vous. Monsieur Pantalone, souvenez-vous que vous êtes arrivé à moi, que vous êtes arrivé à la maison Lombardi, le temps viendra où vous devrez peut-être me payer: oui, le temps viendra: omnia tempus habent (en partie ).
Pantalon SCÈNE III , puis Silvio .
Pantalon - Andè, que je vous envoie. Non, je m'en fiche, et non j'ai peur du vu. J'apprécie plus la maison Rasponi que cent maisons lombardes. Une fleur unique et riche de qualité si elle a du mal à la trouver. Il faut que ce soit cussì.
Silvio - (Mon père a une bonne parole. Celui qui peut se garder, se garder).
Pantalon - (Maintenant, à l'échange d'échange) ( voir Silvio ).
Silvio - Votre esclave, monsieur ( brusquement ).
Pantalon - Patron vénéré. ( Le ghe fume ).
Silvio - J'ai compris de mon père un certain je ne sais pas quoi; croyons-nous alors que c'est la vérité?
Pantalone - Co ghe doigt je connais son père, ce sera vrai.
Silvio - Les conjoints de Signora Clarice et Signor Federigo sont-ils donc établis?
Pantalon - Sior oui, établi et conclu.
Silvio - Je suis surpris que vous me le disiez sans crainte. Homme sans parole, sans réputation.
Pantalon - Comment parlez-vous cela, maître? Avec un vieil homme de mon destin, il vous traite?
Silvio - Je ne sais pas qui me garde, que tu ne vas pas d'un côté à l'autre.
Pantalon - Non, je suis une grenouille, maître. Dans ma maison si vous venez faire du ste bulae?
Silvio - Sortez de cette maison.
Pantalon - Me maraveggio de ella, sior.
Silvio - Dehors, si vous êtes un homme d'honneur.
Pantalon - Aux présages de mon sort, si vous respectez.
Silvio - Vous êtes un lâche, un lâche, un plébéien.
Pantalon - C'est une touche de casse-cou.
Silvio - Eh, je jure au ciel ... ( met sa main à l'épée ).
Pantalon - Agiuto ( met sa main au Pistolese ).
SCÈNE IV
Béatrice avec l'épée à la main, et dit .
Béatrice - Me voici; Je suis à ta défense ( à Pantalone, et j'ai tourné l'épée contre Silvio ).
Pantalone - Sior zenero, s'il vous plaît ( à Béatrice ).
Silvio - Avec toi, je voulais juste me battre ( avec Béatrice ).
Béatrice - (je suis dans l'engagement).
Silvio - Tournez cette épée vers moi ( vers Béatrice ).
Pantalon - Ah, m'sieur zenero ... ( peur ).
Béatrice - Ce n'est pas la première fois que je m'essaye. Je suis là, je n'ai pas peur de toi ( présente l'épée à Silvio ).
Pantalons - Aide. Non gh'è nissun? (Il commence à courir vers la rue ). Béatrice et Silvio se battent. Silvio tombe et laisse l'épée au sol, et Béatrice présente la pointe à sa poitrine.
SCÈNE V
Clarice et dictons .
Clarice - Hélas! Arrêtez ( à Béatrice ).
Béatrice - Bella Clarice, grâce à votre don à la vie Silvio; et vous, en récompense de ma pitié, souvenez-vous du serment ( partie ).
SCÈNE VI
Silvio et Clarice .
Clarice - Êtes-vous en sécurité ou ma chère?
Silvio - Ah, trompeur perfide! Cher à Silvio? Cher à un amant moqué, à un conjoint trahi?
Clarice - Non, Silvio, je ne mérite pas tes reproches. Je t'aime, je t'adore, je te suis fidèle.
Silvio - Ah mensonge! Es-tu fidèle à moi, hein? La loyauté appelez-vous la promesse de foi à un autre amant?
Clarice - Ce que je n'ai pas fait, je ne le ferai jamais. Je mourrai avant de t'abandonner.
Silvio - Je sens qu'il vous a engagé sous serment.
Clarice - Le serment ne m'oblige pas à l'accepter.
Silvio - Qu'avez-vous juré alors?
Clarice - Cher Silvio, désolé pour moi, je ne peux pas le dire.
Silvio - Pour quelle raison?
Clarice - Parce que j'ai juré de me taire.
Silvio - Un signe donc que vous êtes coupable.
Clarice - Non, je suis innocente.
Silvio - Les innocents ne se taisent pas.
Clarice - Et pourtant, cette fois, je me parlerais à moi-même.
Silvio - À qui avez-vous juré ce silence?
Clarice - À Federigo.
Silvio - Et avec tant de zèle, l'observerez-vous?
Clarice - Je vais l'observer pour ne pas devenir parjure.
Silvio - Et tu dis que tu ne l'aimes pas? Simple qui te croit. Je ne te crois pas déjà, barbare, trompeur! Sors de mes yeux.
Clarice - Si je ne t'aimais pas, je ne me serais pas précipité ici pour défendre ta vie.
Silvio - Je déteste aussi la vie, si je dois la reconnaître d'un ingrat.
Clarice - Je t'aime de tout mon cœur.
Silvio - Je vous abhorre de toute mon âme.
Clarice - Je mourrai si tu ne te calmes pas.
Silvio - Je verrais ton sang plus volontiers que ton infidélité.
Clarice - Je serai en mesure de vous satisfaire ( enlève l'épée de la terre ).
Silvio - Oui, cette épée pourrait venger mes torts.
Clarice - Si barbare envers votre Clarice?
Silvio - Tu m'as appris la cruauté.
Clarice - Alors tu as soif de ma mort?
Silvio - Je ne peux pas dire ce dont tu as envie.
Clarice - Je saurai te plaire ( tourne la pointe vers ta poitrine ).
SCÈNE VII
Smeraldina et dictons .
Smeraldina - Arrêtez; Mais que fais-tu? ( lève l'épée de Clarice ). Et toi, chien renégat, la laisserais-tu mourir? ( à Silvio ). Quel cœur as-tu du tigre, du lion, du diable? Regardez la jolie petite suggestion, pour que les femmes doivent éventrer! Oh tu es bonne, maîtresse maîtresse. Peut-être qu'il ne veut plus de toi? Qui ne te veut pas, ne te mérite pas. Allez en enfer avec cet assassin, et vous venez avec moi, qu'il ne manque pas d'hommes; Je m'engage à en trouver une dizaine avant la soirée ( jette l'épée par terre, et Silvio la prend ).
Clarice - ( pleure ) ingrat! Se pourrait-il que ma mort ne vous ait pas fait soupirer? Oui, la douleur me tuera; Je mourrai, tu seras heureux. Mais un jour mon innocence vous sera connue, et plus tard, regrettant de ne pas me croire, vous pleurerez mon malheur et votre cruauté barbare ( partie ).
SCÈNE VIII
Silvio et Smeraldina .
Smeraldina - C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Voyez une fille qui veut se suicider et restez là à la regarder, comme si vous voyiez une scène de comédie.
Silvio - Tu es fou! Pensez-vous qu'elle voulait vraiment se suicider?
Smeraldina - Je ne sais rien d'autre, je sais que si je n'arrivais pas à temps, le pauvre serait ça.
Silvio - Il vous voulait bien avant que l'épée n'atteigne sa poitrine.
Smeraldina - Écoutez ce menteur! S'il était là pour entrer.
Silvio - Toutes les fictions de vous autres femmes.
Smeraldina - Oui, si nous étions comme toi. Je dirai, comme le dit le proverbe: nous avons des voix, et vous autres, des noix. Les femmes sont réputées infidèles et les hommes commettent des infidélités autant que possible. Nous parlons de femmes et d'hommes ne disent rien. On nous critique, et vous autres, on vous donne tout. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que les hommes ont fait les lois; que si les femmes le faisaient, le contraire se ferait sentir. Si je commandais, j'aimerais que tous les infidèles portent une branche d'arbre à la main, et je sais que toutes les villes deviendraient des bois ( partie ).
SCÈNE IX
Silvio seul .
Silvio - Oui, cette Clarice est infidèle, et sous prétexte d'un serment affecté de vouloir cacher la vérité. Elle est perfide, et le fait de vouloir être blessé a été une invention pour me tromper, bouger avec pitié pour elle. Mais si le destin m'a fait tomber devant mon rival, je ne quitterai jamais l'idée de vengeance. Cet indigne mourra et Clarice ingrat verra en lui du sang le fruit de ses amours ( partie )
SCÈNE X
Chambre de l'auberge avec deux portes d'entrée et deux côtés
Truffaldino, puis Florindo .
Truffaldino - Mo grande desgrazia qui est à moi! De do padroni nissun est toujours vegnudo à dénouer. Cela fait des heures depuis qu'il est en demi-corne, et personne ne le voit. Je vendrai tout d'un coup, et je serai dupe; Je les ferai tous et les servirai, et s'ils trouvent la fazenda. Tais-toi, tais-toi, quel ghe est ici. Ça me manque beaucoup.
Florindo - Eh bien, avez-vous retrouvé ce Pasquale?
Truffaldino - Non, mon doigt, monsieur, que vais-je chercher après avoir disnà?
Florindo - Je suis impatient.
Truffaldino - El a dû venir dénoncer un peu plus tôt.
Florindo - (Il n'y a aucun moyen que je puisse m'assurer si Béatrice est ici).
Truffaldino - El me dis, nous irons commander le déjeuner, puis rentrerons à la maison. Le truc sera andada de mal.
Florindo - Pour l'instant je n'ai aucune envie de manger. (Je veux retourner au bureau de poste. Je veux aller chez moi; peut-être que je trouverai quelque chose).
Truffaldino - Sachez, monsieur, que dans ce pays, vous devez magnar, et quiconque n'est pas grand tombe malade.
Florindo - Je dois sortir pour une entreprise. Si je retourne au déjeuner, très bien; sinon, je mangerai ce soir. Vous, si vous voulez, soyez nourri.
Truffaldino - Oh, rien d'autre. Ce qui est là, qui est confortable, qui est maître.
Florindo - Cet argent me pèse; ici, mettez-les dans ma malle. Voici la clé (il donne à Truffaldino le sac des cent ducats et la clé ).
Truffaldino - Je vous sers et je porte la clé.
Florindo - Non, non, tu me le donneras. Je ne veux pas me retenir. Si je ne retourne pas déjeuner, viens sur la place; J'attendrai avec impatience que vous trouviez Pasquale ( pièce ).
SCÈNE XI
Truffaldino, puis Béatrice avec un drap à la main .
Truffaldino - Son doigt me manque beaucoup, ce qui me donne envie d'être un magnar; on va bien s'entendre. Se nol vol magnar lu, che el lassa star. Ma complainte n'est pas faite pour dezunar. Vous rangez son sac, et peu de suite ...
Béatrice - Hé, Truffaldino!
Truffaldino - (Oh enfer!).
Beatrice - Signor Pantalone de'Bisognosi vous a-t-il donné un sac avec cent ducats?
Truffaldino - Sior oui, el dada l'a.
Béatrice - Alors pourquoi tu ne me la donnes pas?
Truffaldino - Mo vienla a vussioria?
Béatrice - Si tu viens à moi? Qu'a-t-il dit quand il vous a donné le sac?
Truffaldino - El m'ha dit che dagga al me padron.
Béatrice - Eh bien, qui est ton maître?
Truffaldino - Vussioria.
Béatrice - Et pourquoi demandez-vous si le sac est à moi?
Truffaldino - Donca sera soa.
Béatrice - Où est le sac?
Truffaldino - Le voici ( lui donne le sac ).
Béatrice - Ils ont raison?
Truffaldino - Je ne les ai pas touchés, monsieur.
Béatrice - (je les compterai plus tard).
Truffaldino - (Il m'avait laissé tomber avec son sac; mais j'ai un remède. Est-ce que Cossa dira l'autre? Sinon, je le dirai, il ne dira rien).
Béatrice - Le propriétaire de l'auberge est-il là?
Truffaldino - El gh'è è, signor si.
Béatrice - Dites-lui que j'aurai un ami pour déjeuner avec moi, qu'il essaiera bientôt d'augmenter la table autant qu'il le pourra.
Truffaldino - Comment aimeriez-vous rester serviteur? Combien de plats le commandez-vous?
Beatrice - Signor Pantalone de'Bisognosi n'est pas un homme de grande admiration. Dites-lui de faire cinq ou six plats; quelque chose de bien.
Truffaldino - Si tu le mets en moi?
Béatrice - Oui, vous commandez, faites-vous honneur. Je vais chercher mon ami, qui n'est pas loin d'ici; et quand je reviens, qu'il soit préparé ( en train de partir ).
Truffaldino - Il vous verra, comment il vous servira.
Béatrice - Gardez cette feuille, mettez-la dans le coffre. Attention, veh, qui est une lettre d'échange pour quatre mille scudi.
Truffaldino - Non, si vous en doutez, je vais le ranger immédiatement.
Béatrice - Que tout soit prêt. (Pauvre Signor Pantalone, il avait très peur. Il a besoin d'être amusé) ( partie ).
SCÈNE XII
Truffaldino, puis Brighella .
Truffaldino - Ici, nous devons voir l'honneur de farse. La première fois que je suis moi maître, ordonnez-moi un disnar, vous farghe pour voir si je suis de bon goût. Je vais ranger le papier, puis ... Je le rangerai plus tard, pas de temps à perdre. Oe de là; est nissun? Appelez-moi missel Brighella, diseghe che ghe vòi talar ( vers la scène ). Il n'y a pas tellement une belle saveur en vous les plats, mais dans l'ordre tel bon; une belle disposition vaut plus qu'une montagne de plats.
Brighella - Cossa gh'è, sœur Truffaldin? Cossa comandeu da mi?
Truffaldino - El me padron el gh'ha un amigo a disnar con lu; el vol qui a doublé la table, mais bientôt, immédiatement. Aveu el besoin à cusina?
Brighella - J'ai toujours tout eu de moi. En une demi-heure, je peux trier n'importe quel signal.
Truffaldino - Ben donca. Disìme cossa che ghe darè.
Brighella - Pour les gens, nous ferons de la portade de quatre plats chacun; ça ira bien?
Truffaldino - (Il a cinq ou six doigts plats; six ou huit, pas une mauvaise chose). Ça ira bien. Est-ce que Cossa ghe sera dans ces plats?
Brighella - Dans la première portada ghe, nous donnerons la soupe, les alevins, les bouillis et un fracandò.
Truffaldino - Trois plats les cognosso; Je ne sais pas que le quatrième est el.
Brighella - Un plat français, une sauce, une bonne nourriture.
Truffaldino - Très bien, la première portada est très bien; à la segonda.
Brighella - La segonda ghe nous donnerons le rôti, la salade, un morceau de pastizzada de viande et un bodin.
Truffaldino - Anca qua gh 'est un plat qui n'est pas cognosso; quel est ce budellin?
Brighella - Je doigte un bodin, un plat anglais, un cossa bona.
Truffaldino - Ben, je suis heureux; mais comment pourrais-je avoir la nourriture sur la table?
Brighella - C'est un moyen facile. Le serveur le fera.
Truffaldino - Non, amigo, ma scalcaria est pressante; tout consiste à bien le mettre en tola.
Brighella - Si vous mettez, par exemple, ici la soppa, qua el fritto, ici l'alesso et qua el fracandò (il mentionne une certaine distribution ).
Truffaldino - Non, je ne l'ai pas aimé; et au milieu non ghe mis gnente?
Brighella - Nous avons dû préparer cinq plats.
Truffaldino - Ben, fais cinq plats.
Brighella - Au milieu, nous mettrons une sauce pour la viande bouillie.
Truffaldino - Non, pas de savèn gnente, cher amigo; la sauce ne va pas bien au milieu; entre la soupe.
Brighella - Et d'un groupe nous mettrons la viande bouillie, et de l'autre la sauce ...
Truffaldino - Oibò, nous n'agirons pas. Vous autres aubergistes savì cusinar, mais pas sage de mettre en tola. Je vais t'apprendre. Il a réalisé que c'était la table (il s'agenouille avec un genou et pointe vers le sol ). Il a observé comme s'il distribuait cinq plats; par exemple: ici au milieu la soupe ( déchirer un morceau de la lettre d'échange, et figure pour mettre une assiette au milieu par exemple ). Voici la partie bouillie (elle fait de même, déchire un autre morceau de lettre et met le morceau de côté ). El st'altra parte fritto ( fait de même avec un autre morceau de lettre, en le plaçant à la rencontre de l'autre ). Ici la sauce, et ici le plat qu'aucun cognosso (avec deux autres morceaux de la lettre, il complète la figure de cinq planches ). Cossa ve par? Comment ça s'est bien passé? ( à Brighella ).
Brighella - Ça va bien; mais la sauce est trop loin de la viande bouillie.
Truffaldino - Maintenant, nous allons voir comme si pol pour le tirer plus visin.
SCÈNE XIII
Béatrice, Pantalone et dictons .
Béatrice - Qu'est-ce que tu fais à genoux? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Il dessinait ici la scalcaire (se lève ).
Béatrice - Quelle feuille est-ce?
Truffaldino - (Oh enfer! La lettre qu'il me donne!).
Béatrice - C'est mon billet à ordre.
Truffaldino - La compatissa. Nous reviendrons vous rejoindre ...
Béatrice - Briccone! Vous tenez donc compte de mes affaires? Des choses d'une telle importance? Vous méritez que je vous batte. Que dites-vous, monsieur Pantalone? Pouvez-vous voir plus de bêtises que cela?
Pantalon - En vérité, le x est un cavalier. Sarave mal se no ghe fusse case de remediarghe; mais avec moi, j'en baise un autre, le x est parfait.
Béatrice - Tant que le billet à ordre venait d'un pays lointain. Ignorantaccio!
Truffaldino - Tout est mal vegnù, car Brighella ne sait pas comment mettre les plats en tola.
Brighella - El trouve des difficultés dans tout.
Truffaldino - Je suis un homme qui sait ...
Béatrice - Sortez d'ici ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Val più el bon commander ...
Béatrice - Va-t'en, je te dis.
Truffaldino - En matière de scalcheria no ghe je le donne au premier maréchal du monde (pièce).
Brighella - Je n'ai pas compris cet homme: parfois il est intelligent et parfois il est auréole.
Béatrice - L'imbécile, le coquin le fait. Eh bien, tu vas nous donner le déjeuner? ( à Brighella ).
Brighella - S'il y avait cinq plats par portada, cela prenait du temps.
Pantalon - Coss'è ste portade? Coss est sti cinq plats? Au bona, au bona. Quatre riz, un pour les assiettes et un esclave. Je ne suis pas homo à suggérer.
Béatrice - Entendez-vous? Régulez-vous ( à Brighella ).
Brighella - Très bien; mais ayez le goût, si vous le saviez, que vous ne l'aimiez pas.
Pantalon - Si ghe étaient des boulettes de viande pour moi, quelle mauvaise dent, la magneria volontiers.
Béatrice - Entendez-vous? Boulettes de viande ( à Brighella ).
Brighella - Elle sera servante. Il est confortable dans cette pièce, que j'envoie maintenant en tola.
Béatrice - Dites à Truffaldino de venir servir.
Brighella - Ghe je dirai, Signor ( partie ).
SCÈNE XIV
Béatrice, Pantalone, puis Serveurs, puis Truffaldino .
Beatrice - Signor Pantalone sera satisfait du peu qu'ils donneront.
Pantalon - Me maraveggio, ma chère, parce que la hanche inconfortable est trop; ce que j'avais à faire avec elo, el fait elo avec mi; mais il le voit bien, j'ai ce putti dans la maison; tant qu'il n'est pas tout fait, il n'est pas licite qu'il stigmatise ensemble. J'ai un peu accepté mes remerciements pour devertirme; Je tremble encore de peur. Sinon, hier, ma chère, ce cagadonao était méprisant.
Béatrice - Je suis heureuse d'être arrivée à l'heure. ( Les serveurs apportent tout le nécessaire pour préparer la table dans la salle indiquée par Brighella, avec verres, vin, pain, etc. )
Pantalon - Le xè est très rapide à l'auberge.
Beatrice - Brighella est un homme gentil. A Turin, un grand chevalier était nécessaire, et il porte toujours sa livrée.
Pantalons - Ghe x est aussi une certaine auberge sora Canal Grando, dans le siège de la Fabbriche de Rialto, où ça magna très bien; Je suis plusieurs fois avec certains galantomènes, de ceux de la bonne presse, et je suis bien persuadé qu'avec moi l'arrangement, je me console encore. Entre autres, je me souviens d'un certain vin de Bourgogne qui lui a donné son bec aux étoiles.
Béatrice - Il n'y a pas de plus grand plaisir au monde que celui d'être en bonne compagnie.
Pantalone - Oh si l'entreprise c'est celle qui sauve! Si elle savait ce que les cœurs faisaient tant! Quelle sincérité! Quelle franchise! Quelles belles conversations il a faites sur la Zuecca! Tu es béni. Sept ou huit galantomènes, qui ne sont pas des camarades dans ce monde.
( Les serveurs quittent la pièce et retournent dans la cuisine .)
Béatrice - Alors, ça vous a beaucoup plu?
Pantalon - C'est ce que j'espère apprécier à nouveau.
Truffaldino - ( avec l'assiette à la main de la soupe ou de la soupe ) Il reste servida dans la chambre, que j'apporte en tola ( à Béatrice ).
Béatrice - Allez-y; mettre la soupe.
Truffaldino - Eh, la servida ( fait les cérémonies ).
Pantalon - El x est curieux, je suis tellement serviteur. Allons-y ( entre dans la pièce ).
Béatrice - Je voudrais moins d'esprit et plus d'attention ( à Truffaldino et entrez ).
Truffaldino - Guardè quels beaux traitements! Un plat à la fois! Je dépense de l'argent, et pas de gh'ha niente de bon gusto. Qui sait gnanca s'il est soupe ne sera bon à rien; vous entendrez ( goûtez la soupe, en la prenant avec une cuillère dans votre poche ). J'ai toujours mes armes dans ma poche. Eh! non c'est mauvais; le poderave pour être pezo ( entre dans la pièce ).
SCÈNE XV
Un serveur avec une assiette, puis Truffaldino, puis Florindo, puis Béatrice et d'autres serveurs .
Serveur - Combien de temps va-t-il obtenir la nourriture?
Truffaldino - ( de la chambre ) Son qua, camerada; cossa me deu?
Serveur - Voici la viande bouillie. Je vais prendre un autre plat ( partie ).
Truffaldino - Que el est castrà, ou que el est vedèllo? El par par castrà. Sentez-vous un peu (goûtez-en). Il n'y a ni castrà, ni vedèllo: la pegora est belle et belle (elle se dirige vers la chambre de Béatrice ).
Florindo - Où aller? (la rencontrer ).
Truffaldino - (Oh pauvre moi!).
Florindo - Où allez-vous avec ce plat?
Truffaldino - Il était sur la table, monsieur.
Florindo - À qui?
Truffaldino - A vussioria.
Florindo - Pourquoi mettez-vous sur la table avant de rentrer?
Truffaldino - Je t'ai vu vegnir par la fenêtre. (Vous devez le trouver).
Florindo - Et à partir de la viande bouillie, commencez-vous à mettre sur la table, et non à partir de la soupe?
Truffaldino - Ghe dira, monsieur, à Venise la soupe la se magna en dernier.
Florindo - J'ai un coût différent. Je veux la soupe. Ramenez ce plat dans la cuisine.
Truffaldino - Monsieur oui, elle sera servante.
Florindo - Et dépêche-toi, alors je veux me reposer.
Truffaldino - Immédiatement ( montre retour à la cuisine ).
Florindo - (Béatrice ne la retrouvera-t-elle jamais?) (Elle entre dans l'autre pièce de l'élévation ).
Truffaldino, Florindo entra dans la pièce, court avec l'assiette et l'apporte à Béatrice.
Serveur - ( revient avec un aliment ) Et vous devez toujours l'attendre. Truffaldino ( appelle ).
Truffaldino - ( quitte la chambre de Béatrice ) Je suis là. Bientôt, il est allé se garer dans cette autre pièce, que cet autre forestier est arrivé, et a apporté la soupe immédiatement.
Serveur - Immédiatement (en partie ).
Truffaldino - La planéité est-elle coss'èla mo? Il faut qu'el be el fracastor ( goût ). Bona, bona, de galantomo ( la porte de la chambre de Béatrice. Les serveurs passent et apportent le nécessaire pour préparer la table dans la chambre de Florindo ). Bravo. Nettoyer. Je suis rapide comme des chats ( vers les serveurs ). Oh, si je pouvais servir des maîtres à table; mo saria la gran bella cossa. (Les serveurs quittent la chambre de Florindo et vont dans la cuisine ). Bientôt, fioi, la menestra.
Serveur - Pensez à votre table, et nous y penserons ( partie ).
Truffaldino - Voria pense à tout faire, si ça podesse. (Le serveur revient avec la soupe Florindo ). Dites-moi ici que je vais me l'apporter; il est allé chercher les trucs pour cette autre pièce. (Elle prend la soupe de la main du serveur et la ramène dans la chambre de Florindo ).
Serveur - C'est curieux. Il veut servir ici et là. Je vous laisse faire: mon conseil devra déjà être donné. Truffaldino quitte la chambre de Florindo.
Béatrice - Truffaldino (l' appelle de la pièce ).
Garçon - Eh! servez votre maître ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Son qua ( entre dans la chambre de Béatrice; les serveurs apportent la viande bouillie à Florindo ) .
Serveur - Donnez-le ici (le prend ). Les serveurs partent.
Truffaldino - quitte la chambre de Béatrice avec les cercles sales.
Florindo - Truffaldino (l' appelle fort depuis la pièce ).
Truffaldino - De qua ( veut prendre la viande bouillie du serveur ).
Serveur - Cela dépend de moi.
Truffaldino - Non, tu m'as entendu m'appeler? ( il lui prend la viande bouillie et l'apporte à Florindo ).
Serveur - Elle est belle. Il veut tout faire. ( Les serveurs apportent une assiette de boulettes de viande, la donnent au serveur et partent ).
Serveur - Je l'emmènerais dans ma chambre, mais je ne veux rien avoir à faire avec lui. ( Truffaldino quitte la chambre de Florindo avec les rondes sales ). Ici, monsieur, homme d'affaires; apportez ces boulettes de viande à votre maître.
Truffaldino - Boulettes de viande? ( prenant le pot en main ).
Serveur - Oui, les boulettes de viande qu'il a commandées (en partie ).
Truffaldino - Oh magnifique! À qui allez-vous les emmener? À qui le diable de ces maîtres les fera-t-il commander? Si ghel erre pour s'enquérir à cusina, aucun voria ne les a mis dans la méchanceté; si vous le faites et qui ne les apporte pas à la personne qui les a commandées, l'autre vous demandera et si vous trouverez l'escroc. Je ferai cussi ... Eh, super mi! Je vais faire cusì; Je vais les diviser en tours C, je les prendrai moitié par un, et cusì qui les fera commander, ils les verront (prenez un autre tour de ceux dans la salle, et divisez les boulettes de viande par moitié). Quatre et quatre. Mais il y en a un de plus. Qui est là pour donner? Non vous qui n'en avez pas à cause de votre mauvaise santé; Je vais l'agrandir moi-même (mange des boulettes de viande). Maintenant ça va bien. Apportons les boulettes de viande à cela ( mettre l'autre rond sur le sol, et en apporter un à Béatrice ).
Serveur - ( avec un bodino anglais ) Truffaldino ( appel )
Truffaldino - Son qua ( sort de la chambre de Béatrice ).
Garçon - Apportez ce bodino ...
Truffaldino - Attendez que je vienne (il prend l'autre tour de boulettes de viande et l'apporte à Florindo ).
Serveur - Mauvais; les boulettes de viande vont au-delà.
Truffaldino - Sior oui, je sais, je les ai amenés de là; et el me padron envoie le quatre pour donner à forestier ( entrer ).
Serveur - Ils se connaissent, ce sont des amis. Ils pourraient dîner ensemble.
Truffaldino - ( retourne dans la chambre de Florindo ) Et cusì, coss'elo je suis un magasin? ( au serveur ).
Serveur - Ceci est un bodino anglais.
Truffaldino - Qui suis-je?
Serveur - À votre maître ( partie ).
Truffaldino - Qu'est-ce que c'est que ce bodin? L'odeur est précieuse, el par polenta. Oh, si el fuss polenta, la saria est une bonne chose! Vous entendrez ( sortez une fourchette de sa poche ). La polenta ne l'est pas, mais el ghe someia ( mange ). Le meio de polenta ( mange ).
Béatrice - Truffaldino (l' appelle de la pièce ).
Truffaldino - Vegno ( réponses bouche pleine ).
Florindo - Truffaldino (l' appelle de sa chambre ).
Truffaldino - Son qua ( répond avec la bouche pleine, comme ci-dessus ). Oh quel truc précieux! Un autre bocconcin, et vegno ( continue de manger ).
Béatrice - ( quitte sa chambre et voit Truffaldino manger; il lui donne un coup de pied et dit ) Viens servir ( retourne dans sa chambre ). Truffaldino met le bodino au sol et entre dans la chambre de Béatrice.
Florindo - ( quitte sa chambre ) Truffaldino ( appelle ). Où diable est-il?
Truffaldino - ( quitte la chambre de Béatrice ) L'è qua ( voir Florindo ).
Florindo - Où es-tu? Où vous perdez-vous?
Truffaldino - Era est allé au tor des plats, signor.
Florindo - Y a-t-il autre chose à manger?
Truffaldino - J'irai voir.
Florindo - Dépêchez-vous, je vous le dis, que je dois me reposer ( retournez dans sa chambre ).
Truffaldino - immédiatement. Serveurs, quoi d'autre? ( appeler ). Je suis bodin je le range pour moi (le cache ).
Serveur - Voici le rôti ( apportez une assiette avec le rôti ).
Truffaldino - Bientôt les fruits ( prend le rôti ).
Garçon - Grande fureur! Immédiatement (en partie ).
Truffaldino - Le rôti, je vais y apporter ( entrez de Florindo ).
Garçon - Voici les fruits, où êtes-vous? ( avec une assiette de fruits ).
Truffaldino - Son qua ( de la chambre de Florindo ).
Serveur - Gardez ( lui donne le fruit ). Voulez-vous autre chose?
Truffaldino - Aspettè ( apporte le fruit à Béatrice ).
Serveur - Sautez par ici, sautez par là; c'est un diable.
Truffaldino - Rien d'autre. Nissun vol vol.
Serveur - je suis content.
Truffaldino - Parecchiè pour moi.
Serveur - Immédiatement (en partie ).
Truffaldino - Togo sur el me bodin; hourra, je l'ai surmonté, tout le monde est content, aucun vol alter, je suis des étapes servidi. J'ai servi des maîtres à table, et l'un n'a aucun savant de l'autre. Mais si je servido per do, maintenant voio va magnar pour quatre ( partie ).
SCÈNE XVI
Rue avec vue sur l'auberge.
Smeraldina, puis le serveur de l'auberge .
Smeraldina - Oh, regardez quelle discrétion de ma maîtresse! Envoyez-moi avec un petit garçon dans une auberge, une jeune femme comme moi! Servir une femme amoureuse est une très mauvaise chose. Cette mienne fait mille extravagances; et ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'elle est amoureuse de Signor Silvio comme signe de se éventrer pour elle-même, et pourtant elle envoie les cartes à un autre. Quand ce n'est pas qu'il en voulait un pour l'État et l'autre pour l'hiver. Assez ... Je ne vais pas à l'auberge. Je vais appeler; quelqu'un sortira. Ou à la maison! ou l'auberge!
Garçon - Que voulez-vous, cette jeune femme?
Smeraldina - (j'ai vraiment, vraiment honte). Dites-moi .. Un certain M. Federigo Rasponi est-il logé dans cette auberge?
Serveur - Oui, bien sûr. Il a fini de déjeuner, ce qui n'est pas beaucoup.
Smeraldina - J'ai quelque chose à lui donner.
Serveur - Une ambassade? Tu peux passer.
Smeraldina - Hé, qui penses-tu que je suis? Je suis la femme de chambre de ta fiancée.
Garçon - Eh bien, allez.
Smeraldina - Oh, je n'y vais pas.
Garçon - Voulez-vous que je le fasse venir sur la route? Cela ne me semble pas bien fait; d'autant plus qu'il est en compagnie du Signor Pantalone de 'Bisognosi.
Smeraldina - Mon maître? Pire! Oh, je ne pars pas.
Serveur - J'enverrai son serviteur si vous le souhaitez.
Smeraldina - Cette brune?
Serveur - Exactement.
Smeraldina - Oui, envoyez-le.
Serveur - (je comprends. Elle aime le garçon noir. Elle a honte d'entrer. Elle n'aura pas honte d'être vue au milieu de la rue) ( entre ).
SCÈNE XVII
Smeraldina, puis Truffaldino .
Smeraldina - Si le maître me voit, que vais-je lui dire? Je dirai que je le suivais; ici, elle est belle et décontractée. Oh, je ne manque pas de reculer.
Truffaldino - ( avec une fiole à la main, un verre et une serviette ) Qui me demande?
Smeraldina - C'est moi, monsieur. Je suis désolé de t'avoir dérangé.
Truffaldino - Rien; Je suis ici pour recevoir mes commandes.
Smeraldina - J'imagine que vous étiez à table, autant que je sache .
Truffaldino - Il était à table, mais je reviendrai.
Smeraldina - Je le regrette vraiment.
Truffaldino - Et j'y ai goûté. Pour vous dire, j'ai le ventre plein et ces jolis petits yeux sont sur le point de me faire digérer.
Smeraldina - (Il est aussi gracieux!).
Truffaldino - J'ai mis zo et le flacon et je suis là par vu, cher.
Smeraldina - (Elle m'a dit cher). Ma maîtresse envoie ce petit garçon au signor Federigo Rasponi; Je ne veux pas entrer dans l'auberge, alors j'ai pensé que je vous donnerais cet inconvénient, que vous êtes son serviteur.
Truffaldino - je le ferai avec plaisir; mais d'abord il savait que j'avais une hanche à faire.
Smeraldina - Pour qui?
Truffaldino - Partie d'un galantomo. Disime, conossive vu un certain Truffaldin Battocchio?
Smeraldina - Il me semble avoir entendu parler de lui une fois, mais je ne m'en souviens pas. (Il devrait être ceci).
Truffaldino - C'est un bel homme: teckel, têtu, plein d'esprit, qui parle bien. Maître des cérémonies ...
Smeraldina - Je ne le connais absolument pas.
Truffaldino - Et pourtant lu el ve cognosse, et en est amoureux.
Smeraldina - Oh! tu t'es moqué de moi.
Truffaldino - Et si el podesse espère beaucoup de correspondance, el se daria da cognosser.
Smeraldina - Je dirai, monsieur; si vous le voyiez et me donniez en génie, il me serait facile de correspondre avec lui.
Truffaldino - Voulez-vous le voir?
Smeraldina - Je le verrai avec plaisir.
Truffaldino - Maintenant immédiatement ( entrez dans l'auberge ).
Smeraldina - Il ne l'est donc pas. ( Truffaldino quitte l'auberge, fait révérence à Smeraldina, passe, puis soupire et entre dans l'auberge ). Je ne comprends pas cette histoire.
Truffaldino - L'aile vue? ( revenant pour sortir ).
Smeraldina - Qui?
Truffaldino - Celui qui est amoureux des beautés.
Smeraldina - Je n'ai vu personne d'autre que toi.
Truffaldino - Mah! ( soupirant ).
Smeraldina - Êtes-vous celui qui dit qu'il m'aime?
Truffaldino - Son mi ( soupirant ).
Smeraldina - Pourquoi ne m'as-tu pas dit le premier?
Truffaldino - Parce que je suis un peu honteux.
Smeraldina - (Cela ferait tomber les pierres amoureuses).
Truffaldino - Et cusì, cossa me unela?
Smeraldina - Je dis ça ...
Truffaldino - Via, le barrage.
Smeraldina - Oh, moi aussi j'ai honte.
Truffaldino - Si nous nous unissions, nous ferions du mariage des gens honteux.
Smeraldina - En vérité, tu me donnes en génie.
Truffaldino - Elle est putta elle?
Smeraldina - Oh, elle ne demande même pas.
Truffaldino - Que puis-je dire, certainement pas.
Smeraldina - En effet, cela signifie, oui, très certain.
Truffaldino - Hip Je suis un garçon.
Smeraldina - Je me serais mariée cinquante fois, mais je n'ai jamais trouvé de personne qui me donne du génie.
Truffaldino - Puis-je espérer urtarghe en toile de sympathie?
Smeraldina - En fait, je dois le dire, vous avez un je ne sais pas ... Assez, je ne dis rien d'autre.
Truffaldino - Quelqu'un qui le voulait pour Muier, comment puis-je l'obtenir?
Smeraldina - Je n'ai ni père ni mère. Il faut le dire à mon maître ou à ma maîtresse.
Truffaldino - Très bien, si je dis ghel, cossa dirali?
Smeraldina - Ils diront que si je suis heureux ...
Truffaldino - Et vous?
Smeraldina - Je dirai ... que s'ils sont heureux ...
Truffaldino - Rien d'autre. Nous serons tous heureux. Deme la lettre, et comme je vais apporter la réponse, nous allons parler.
Smeraldina - Voici la lettre.
Truffaldino - Saviu mo cossa que le barrage est une lettre?
Smeraldina - Je ne sais pas, et si tu savais quelle curiosité je saurais!
Truffaldino - No voria chicaner quelque lettre de dédain, et que je devais me casser le visage.
Smeraldina - Qui sait? L'amour ne devrait pas l'être.
Truffaldino - Je ne suis pas occupé. Sinon, je sais que le barrage, je ne le prends pas.
Smeraldina - Vous pouvez l'ouvrir ... mais je veux ensuite la verrouiller.
Truffaldino - Eh, lassè fare a mi; resserrer les lettres que je suis fait sur commande; pas si vous connaissez gnente du tout.
Smeraldina - Ouvrons-le alors.
Truffaldino - Saviu lezer vu?
Smeraldina - Un peu. Mais vous pourrez bien lire.
Truffaldino - Anca mi pochettin.
Smeraldina - Écoutons alors.
Truffaldino - Averzimola avec nettoyage (déchire une partie ).
Smeraldina - Oh! Qu'avez-vous fait?
Truffaldino - Rien. J'ai le secret de vous accueillir. Le voici, c'est l'avoir.
Smeraldina - Allez, lisez-le.
Truffaldino - Lezila vu. Le personnage de votre maîtresse sera compris comme meio de mi.
Smeraldina - Pour le dire, je ne comprends rien (en regardant la lettre ).
Truffaldino - Et je manque un mot ( fait de même ).
Smeraldina - Quelle était l'utilité de l'ouvrir?
Truffaldino - Attendez; inzegnemose; du capisso ( il garde la lettre ).
Smeraldina - Je veux dire aussi quelques lettres.
Truffaldino - Provemose pendant un certain temps. N'est-ce pas un emme?
Smeraldina - Oibò; c'est une erre .
Truffaldino - D' erre à emme, il y a peu de différence.
Smeraldina - Ri, ri, a, ria . Non, non, tais-toi , ce qui je pense est un emme, mi, mi, a, mia .
Truffaldino - Il ne dira pas le mien , il dira le mien .
Smeraldina - Non, il y a la codetta.
Truffaldino - Juste pour ça: le mien .
SCÈNE XVIII
Béatrice et Pantalone de l'auberge, et paroles .
Pantalon - Cossa feu qua? ( à Smeraldina ).
Smeraldina - Rien, monsieur, je vous suivais ( intimidé ).
Pantalon - Cossa voleu da mi? ( à Smeraldina ).
Smeraldina - La maîtresse vous cherche ( comme ci-dessus ).
Béatrice - Quelle feuille est-ce? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Rien, c'est une carte ... ( intimidé ).
Béatrice - Voyons voir ( à Truffaldino ).
Truffaldino - M. oui ( il lui donne le drap tremblant ).
Béatrice - Comment! Voici un petit garçon qui vient à moi. Indigne! Mes lettres sont-elles toujours ouvertes?
Truffaldino - Je ne sais rien, monsieur ...
Béatrice - Regardez, Signor Pantalone, une petite femme de Signora Clarice, dans laquelle elle m'avertit des jalousies folles de Silvio; et ce coquin me l'ouvre.
Pantalon - Et ti, ti ghe tien troisième? ( à Smeraldina ).
Smeraldina - Je ne sais rien, monsieur.
Béatrice - Qui a ouvert ce petit garçon?
Truffaldino - Pas moi.
Smeraldina - Pas moi.
Pantalon - Qui le portera?
Smeraldina - Truffaldino l'a emmené chez son maître.
Truffaldino - Et Smeraldina l'a apporté à Truffaldin.
Smeraldina - (Chatterbox, je ne t'aime plus).
Pantalone - Est-ce que vous, potins desgraziada, vous avez fait faire ça? Je ne sais pas qui se soucie que tu ne poignardes pas un homme en tel muo.
Smeraldina - Personne ne m'a donné les mains au visage; et je m'émerveille.
Pantalon - Cusì, tu vas me répondre? (ça se rapproche ).
Smeraldina - Eh, ne me prenez pas. Vous avez des obstacles que vous ne pouvez pas courir ( course partielle ).
Pantalone - Desgraziada, je vais vous montrer si je peux courir; Je vais te baiser (il commence à courir après Smeraldina ).
SCÈNE XIX
Béatrice, Truffaldino, puis Florindo à la fenêtre de l'auberge .
Truffaldino - (Si vous savez comment vous en tirer)
Béatrice - (Pauvre Clarice, elle est désespérée de la jalousie de Silvio; il vaudra mieux pour moi de la découvrir et de la consoler) (en observant le petit garçon ).
Truffaldino - (Il me semble qu'il ne me voit pas. Vous essayez de vous éloigner) ( lentement, il aimerait partir ).
Béatrice - Où vas-tu?
Truffaldino - Son qua ( s'arrête ).
Béatrice - Pourquoi avez-vous ouvert cette lettre?
Truffaldino - L'è stada Smeraldina. Monsieur, je ne sais pas.
Béatrice - Qu'est-ce que Smeraldina? Tu l'as été, coquin. Un et un deux. Vous m'avez ouvert deux lettres en une journée. Venez ici.
Truffaldino - Pour l'amour du ciel, monsieur ( s'approchant avec crainte ).
Béatrice - Viens ici, dis-je.
Truffaldino - Par pitié ( s'approche du tremblement ). Béatrice prend le bâton du côté de Truffaldino, et le colle bien, étant tourné le dos à l'auberge.
Florindo - ( à la fenêtre de l'auberge ) Comment! Mon serviteur est-il battu? ( commence par la fenêtre ).
Truffaldino - Pas plus, s'il vous plaît.
Béatrice - Tiens, coquin. Vous apprendrez à ouvrir les lettres ( jetez le bâton par terre et partez ).
SCÈNE XX
Truffaldino, puis Florindo de l'auberge .
Truffaldino - ( après le match Beatrice ) Sangue de mi! Body de mi! Et s'il s'agit des présages de mon destin? Tenez-vous un par le mien? Les serviteurs, sans serviteurs, s'il renvoie, pas s'il colle.
Florindo - Que dites-vous? ( laissé l'auberge invisible par Truffaldino ).
Truffaldino - (Oh!) ( Voir Florindo ). Pas s'il s'en tient aux serviteurs des autres de cette manière. C'est un affront qui a reçu el me padron ( vers la partie où Béatrice est allée ).
Florindo - Oui, c'est un affront que je reçois. Qui est celui qui t'a battu?
Truffaldino - Je ne sais pas, monsieur: je ne sais pas.
Florindo - Pourquoi t'a-t-il battu?
Truffaldino - Parce que ... parce que gh'ho spudà sur une chaussure.
Florindo - Et te laisseras-tu battre comme ça? Et tu ne bouges pas, et tu ne te défends même pas? Et vous exposez votre maître à un affront, à un précipice? Âne, fauteuil que tu es ( prend le bâton de terre ). Si vous aimez être battu, je vais vous donner un avant-goût, je vais encore vous battre (battez- le, puis entrez dans l'auberge ).
Truffaldino - Maintenant, je peux dire que je suis serviteur de do padroni. Ho tira el salario da tutti do ( entre dans l'auberge ).
ACTE TROIS
SCÈNE I
Salle de l'auberge avec diverses portes.
Truffaldino seul, puis deux serveurs.
Truffaldino - Avec une scorladina, j'ai renvoyé toute la douleur de la bastonade; mais j'ai magnà ben, j'ai disnà ben, et ce soir je vais dîner, et aussi longtemps que je le pourrai, je serai maître, à tel point qu'il pourra payer son salaire. Adess mo mo coss'òia à faire? Le premier patron est fora de casa, el segondo dort; poderia giust donne maintenant un peu d'air aux vêtements; jetez-les à travers les malles, et vardar si j'ai besoin de gnente. J'ai les clés. La chambre est juste au fait. Je vais tirer à travers les troncs et je vais nettoyer. J'ai besoin de m'aider. Serveurs ( appel ).
Serveur - ( vient en compagnie d'un garçon ) Que voulez-vous?
Truffaldino - Voria que tu m'as donné un coup de main pour faire des trous dans quelques malles de ces chambres, pour donner un peu d'air aux vestides.
Garçon - Allez: aidez-le ( au garçon ).
Truffaldino - Andemo, je vais vous donner à un homme bon une partie de ce cadeau que mes maîtres m'ont donné ( entrez dans une chambre avec le garçon ).
Serveur - Il semble être un bon serviteur. Il est rapide, prêt, très attentif; cependant, il aura aussi quelques défauts. J'ai aussi servi et je sais comment ça se passe. Rien ne se fait par amour. Tout est fait soit pour peler le propriétaire, soit pour lui faire confiance.
Truffaldino - ( de la chambre susmentionnée avec le garçon, portant une malle ) Par terre; mettons-le ici ( ils l'ont mis au milieu de la pièce ). Nous irons à tor staltra. Mais femo un pian, cet el padron est dans cette autre pièce, cet el endormi ( entre dans la chambre de Florindo avec le garçon ).
Serveur - C'est soit un grand homme de gentillesse, soit il est très intelligent: je n'ai pas vu servir deux personnes de cette façon. Je veux vraiment être un peu prudent; Je ne voudrais pas qu'un jour ou l'autre, sous prétexte de servir deux maîtres, les deux les déshabillent.
Truffaldino - ( de la chambre susmentionnée avec le garçon avec l'autre tronc ) Et mettons-le ici ( ils l'ont mis à une courte distance de l'autre ). Maintenant, s'il voulait y aller, eté, que je n'ai besoin de rien d'autre ( pour le garçon ).
Garçon - Allez, allez à la cuisine ( au garçon qui part ). As-tu besoin de quelque chose? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Gnente du tout. Je vais faire les faits pour moi.
Serveur - Oh allez, vous êtes un grand homme; si tu dures, je te respecte (en partie ).
Truffaldino - Maintenant, je vais nettoyer les bosses, en paix et sans me déranger ( prend une clé de sa poche ) Quelle est cette clé? Qu'est-ce que averzela de sti do bauli? Je vais essayer ( ouvre un coffre ). Je l'ai deviné tout de suite. Je suis le premier homme au monde. Et st'altra aura l'autre (il sort l'autre clé de sa poche et ouvre l'autre coffre ). Ici, ils vous donnent tous. Tiremo perce chaque cossa (il retire les vêtements des deux troncs et les place sur la table, avertissant que dans chaque tronc il y a un costume en tissu noir, des livres et des écrits, et d'autres choses comme vous le souhaitez ). Je veux voir un peu, s'il n'y a rien en toi la cicatrice. Parfois, le ghe met des buzzolai, des confettis (visiter les poches de la robe noire de Béatrice et y trouver un portrait ). Oh sympa! Quel beau portrait! Quel bel homme! Qui suis-je représenté? C'est une idée qui me semble de cognosser et je ne suis pas d'accord avec elle. El ghe someia un tantinin à l'autre moi padron; mais non, je n'ai pas de robe, ni de citrouille.
SCÈNE II
Florindo dans sa chambre, et dit .
Florindo - Truffaldino (l' appelle de la pièce ).
Truffaldino - Ou soyez maudit! El s'ha swabia. Si el diavol fait percer el vegna, et el voit st'alter baul, el voudra savoir ... Bientôt, bientôt, je le resserrerai, et je dirai que je ne sais pas qui c'est (c'est ranger le truc).
Florindo - Truffaldino ( comme ci-dessus ).
Truffaldino - Le serviteur ( répond fort ). Rangez le truc. Mais! Non, je me souviens bien, je suis où je vais. Et pas de carte, je me souviens où c'était.
Florindo - Tu viens ou je viens te chercher avec un bâton? ( comme ci-dessus ).
Truffaldino - Je viens immédiatement ( fort, comme ci-dessus ). Bientôt, devant ce vegna. Avec lui rentrant chez lui, je ferai tout (il met les trucs au hasard dans les deux malles, et les verrouille ).
Florindo - ( quitte sa chambre dans sa robe de chambre ) Qu'est-ce que tu fous? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Cher monsieur, ne me donnez-vous pas un doigt qui repousse les vêtements? C'était là que se trouvait mon obligation.
Florindo - Qui est cet autre tronc?
Truffaldino - je ne sais pas; el appartiendra à un autre forestier.
Florindo - Donnez-moi la robe noire.
Truffaldino - Le serviteur ( ouvre le coffre de Florindo et lui donne sa robe noire ). Florindo enlève sa robe de chambre et met sa robe; puis, mettant ses mains dans ses poches, il trouve le portrait.
Florindo - Qu'est-ce que c'est? ( s'émerveillant du portrait ).
Truffaldino - (Oh diable! Je vais échouer. Au lieu de le mettre sur la tel tel vestido, je l'ai foiré. La couleur m'a fait échouer).
Florindo - (Oh mon Dieu! Je ne me suis pas déjà trompé. C'est mon portrait; mon portrait que je me suis donné à ma chère Béatrice). Dites-moi, comment ce portrait est-il entré dans les poches de ma robe qui n'était pas là?
Truffaldino - (Maintenant, je ne sais pas comment l'inventer. Je vais commencer).
Florindo - Animo, je dis; parler, répondre. Ce portrait, comme dans mes poches?
Truffaldino - Chère sœur, je suis désolée pour vous, ma confiance. Ce portrait est mon truc; pour ne pas le perdre, il l'avait caché là. Pour l'amour du ciel, j'ai pitié de moi.
Florindo - Où avez-vous obtenu ce portrait?
Truffaldino - Je l'ai hérité de mon maître.
Florindo - hérité?
Truffaldino - Sior Oui, j'ai servi un maître, il est mort, et il m'a donné les boules que je leur ai vendues, et je suis laissé pour compte.
Florindo - Hélas! Depuis combien de temps votre maître est-il mort?
Truffaldino - Ce sera une semaine. (Digo ce qui me vient à la bouche).
Florindo - Comment s'appelait votre maître?
Truffaldino - Je ne sais pas, monsieur; el a vécu incognito.
Florindo - Incognito? Depuis combien de temps l'avez-vous servi?
Truffaldino - Poco: zorni diese ou dodese.
Florindo - (Oh mon Dieu! De plus en plus je tremble, ce n'était pas Béatrice! Tu fuis en costume d'homme ... elle vivait inconnue ... Oh moi malheureuse, si c'était vrai!).
Truffaldino - (Col croit tout, je vais vous en dire de bons).
Florindo - Dites-moi, votre maître était-il jeune? ( haletant ).
Truffaldino - Sior oui, zovene.
Florindo - Sans barbe?
Truffaldino - Sans barbe.
Florindo - (C'était certainement elle) ( soupirant ).
Truffaldino - (Bastonade spereria de no ghe n'aver).
Florindo - Connaissez-vous au moins la patrie de votre défunt maître?
Truffaldino - Le pays l'a sauvé et je ne suis pas d'accord.
Florindo - Turinois peut-être?
Truffaldino - Sior oui, Turinois.
Florindo - (Il est chaque accent est un coup sur mon cœur). Mais dis-moi: ce jeune Turinois est-il vraiment mort?
Truffaldino - Le Siguro est mort.
Florindo - À quel point est-il mort?
Truffaldino - Il y a un accident vegnù, et il est parti. (Cusì me destrigo).
Florindo - Où a-t-il été enterré?
Truffaldino - (Un autre tricheur). Non, il est enterré, monsieur; parce qu'un autre serviteur, je sais patriote, avait le permis de le mettre dans une boîte et de l'envoyer au pays.
Florindo - C'est ce domestique qui vous a fait retirer cette lettre de la Poste ce matin?
Truffaldino - Sior oui, à droite Pasqual.
Florindo - (Il n'y a plus d'espoir. Béatrice est morte. Misérable Béatrice! L'inconvénient du voyage, les tourments du cœur l'auront tuée. Hélas! Je ne supporte pas l'excès de ma douleur (elle entre dans sa chambre ).
SCÈNE III
Truffaldino, puis Béatrice et Pantalone .
Truffaldino - Coss'è st'imbroio? Il est en deuil, el pianze, el despera. No voria co me is fairytale averghe sveià ippochondria. Je l'ai fait pour éviter le compliment de la bastonade, et pour ne pas découvrir la tricherie des malles. Ce portrait a fait bouger les vers. Vous devez le savoir. Allez, le mei qui revient porter ces malles dans la chambre, et qui me libère d'un autre compagnon ennuyeux. Voici cet autre maître. Cette fois s'il partage la servitude, et s'il me rend bien servido ( pointant les bâtons ).
Béatrice - Croyez-moi, monsieur Pantalone, que le dernier lot de miroirs et de cires est dupliqué.
Pantalone - Poderia d'être que les zoveni avaient échoué. Nous compterons une fois de plus avec les Écritures; nous nous rencontrerons et verrons la vérité.
Béatrice - J'ai également fait un extrait de plusieurs jeux tirés de nos livres. Maintenant, nous allons le trouver. Il peut être dilué ou pour vous ou pour moi. Filou?
Truffaldino - M.
Béatrice - Tu as les clés de ma malle?
Truffaldino - Sior oui; Les voici.
Béatrice - Pourquoi as-tu amené ma malle dans la chambre?
Truffaldino - Pour donner un peu d'air aux vestides.
Béatrice - L'avez-vous fait?
Truffaldino - je l'ai fait.
Béatrice - Ouvre-moi et donne-moi ... Qui est l'autre tronc?
Truffaldino - Il appartient à un autre forestier qui est arrivé.
Béatrice - Donnez-moi un mémoire que vous trouverez dans le coffre.
Truffaldino - Sior oui. (El ciel me manda bona) ( ouvre et cherche le livre ).
Pantalone - Pol esser, comme ghe digo, que je vais échouer. Dans ce cas, l'erreur no effectue le paiement.
Béatrice - Et il se peut que ce soit bien; nous le trouverons.
Truffaldino - C'est ça? ( présente un livre d'Écritures à Béatrice ).
Béatrice - Ce sera ça ( elle le prend sans trop l'observer, et l'ouvre ). Non, ce n'est pas ça ... A qui est ce livre?
Truffaldino - ( je l'ai fait ).
Béatrice - (Ce sont deux lettres que j'ai écrites à Florindo. Hélas! Ces souvenirs, ces récits lui appartiennent. Je transpire, je tremble, je ne sais pas dans quel monde je suis).
Pantalon - Cossa gh'è, sior Federigo? Si vous vous sentez bien
Béatrice - Rien. (Truffaldino, comment voyez-vous ce livre dans mon coffre qui n'est pas le mien?) ( Lentement à Truffaldino ).
Truffaldino - Mi no saveria ..
Béatrice - Vite, ne t'embrouille pas, dis-moi la vérité.
Truffaldino - Ghe s'excuse pour l'ardeur que j'ai osé mettre ce livre dans tel so baul. Ce sont mes affaires, et pour ne pas les perdre, je les mets là. (Cela va bien avec cet alter, pol soit qu'il va bien avec ça).
Béatrice - Ce livre est le vôtre, et vous ne le savez pas, et me le donnerez-vous à la place du mien?
Truffaldino - (Oh, c'est encore plus fin). Ghe dira: cela fait un moment que ce n'est pas le mien, et je l'ai tout de suite su.
Béatrice - Et où avez-vous obtenu ce livre?
Truffaldino - J'ai servi un maître à Venise, qui en est mort, et j'ai hérité de ce livre.
Béatrice - Combien de temps est-ce?
Truffaldino - Qu'est-ce que le soja moi? Meurt ou zorni dodais.
Béatrice - Comment ça se fait que je te trouve à Vérone?
Truffaldino - Il quittait alors Venise pour la mort de mon maître.
Béatrice - (Misérable moi!). Votre maître avait-il le nom de Florindo?
Truffaldino - Sior oui, Florindo.
Beatrice - De la famille Aretusi?
Truffaldino - Giusto, Aretusi.
Béatrice - Et est-il définitivement mort?
Truffaldino - Certainement.
Béatrice - À quel point est-il mort? Où était-il enterré?
Truffaldino - C'est cascà dans le canal, el s'ha denà, et on ne le voit pas.
Beatrice- Oh malheureux moi! Florindo est mort, mon bien est mort, mon seul espoir est mort. A quelle heure ai-je besoin de cette vie inutile, s'il est mort pour lequel il n'a vécu que? Oh vaine flatterie! Oh cures jetées au vent! L'amour malheureux traite! Je quitte la patrie, abandonne mes proches, m'habille de butin viril, m'aventure au péril, je risque la vie elle-même, tout est pour Florindo et mon Florindo est mort. Malheureuse Béatrice! La perte de son frère était-elle un peu, sinon ajoutée à celle de l'époux? Après la mort de Federigo, le ciel a repris celui de Florindo. Mais si j'étais la cause de leur mort, si je suis le contrevenant, pourquoi le ciel ne se venge-t-il pas contre moi? Les pleurs sont inutiles, les procès sont vains, Florindo est mort. Hélas! La douleur me submerge. Je ne vois plus la lumière. Mon idole, cher mari,partie impatiente, et entre dans sa chambre ).
Pantalone - ( compris avec admiration tout le discours et le désespoir de Béatrice ) Truffaldino!
Truffaldino - Sior Pantalon!
Pantalon - Femme!
Truffaldino - Femmena!
Pantalon - Oh quel étui!
Truffaldino - Oh quelle maraveia!
Pantalon - je suis confus.
Truffaldino - Je suis enchanté.
Pantalon - Ghe vago à dire à ma fia (pièce).
Truffaldino - Je ne connais plus de serviteur de do padroni, mais de un padron et de padrona (en partie ).
SCÈNE IV
Rue avec l'auberge.
Docteur, puis Pantalone de l'auberge .
Docteur - Je ne peux pas être assuré de ce vieux geezer Pantalone. Plus j'y pense, plus ma bile saute.
Pantalone - Cher docteur, reverisso ve ( avec joie ).
Docteur - Je suis surpris que vous osiez même me saluer.
Pantalon - je dois vous donner une nova. Sappiè ...
Docteur - Voulez-vous me dire que vous avez eu un mariage? Je m'en fous d'une figue.
Pantalon - No x is true gnente. Lassème parlar, à vos risques et périls.
Docteur - Parlez, que le canchero y mangera.
Pantalon - (Maintenant, il me revient de le frapper avec un médecin). Mon fia, si tu veux, sera plus lourd de ton fio.
Docteur - Très obligé, ne vous embêtez pas. Mon fils n'est pas bon ventre. Donnez-le au Monsieur Turinois.
Pantalon - Qui sait qui est le Turinois, je ne sais pas quoi.
Docteur - Soyez qui vous voulez être. Votre fille a été vu avec lui, et hoc sufficit .
Pantalon - Mais non, c'est vrai que el ...
Docteur - Je ne veux rien entendre d'autre.
Pantalone - Si vous ne m'écoutez pas, ce sera pezo per vu.
Docteur - Nous le verrons pour ceux qui seront pires.
Pantalon - Mia fia la est un putta honoré; est-ce...
Docteur - Le diable qui vous amène.
Pantalon - Cela vous traîne.
Médecin - Vieil homme sans parole et sans réputation ( partie ).
SCENE V
Pantalon puis Silvio .
Pantalon - maudit Siestu. El x est une bête habillée en homme. Gh'oggio mai podesto pour dire que c'est une femme? Mo, sior no, nol vol lassar parlar. Mais voici cette petite éponge de so fio; J'attends une autre insolence.
Silvio - (Voici Pantalone. Je me sens tenté de jeter l'épée dans sa poitrine).
Pantalone - Sior Silvio, avec une si bonne grâce, avait un bon niova de darghe, s'il daignait parler, et que ce n'était pas comme ça masena de molin de so sior apparemment.
Silvio - Qu'est-ce que tu as à me dire? Parler.
Pantalone - sachez que le mariage de mon fia co sior Federigo xè va en amont.
Silvio - C'est vrai? Tu ne me trompes pas?
Pantalone - Ghe digo la vérité, et si le x est plus que cette humeur, mon fia x est prêt à darghe la man.
Silvio - Oh mon cher! Tu me rends de la mort à la vie.
Pantalone - (Via, via, nol xis tellement de bêtes, comme je le sais).
Silvio - Mais! oh mon Dieu! Comment vais-je pouvoir serrer celle qui a longtemps parlé à un autre mari?
Pantalon - Curte. Federigo Rasponi est dévotà Béatrice, je connais sœur.
Silvio - Comment! Je ne te comprends pas.
Pantalon - Il est très dur en bois. Et si Federigo croyait, c'était perdu pour Béatrice.
Silvio - Habillé en homme?
Pantalon - Vestia pour homme.
Silvio - Maintenant je le comprends.
Pantalons - Pour beaucoup.
Silvio - Comment ça s'est passé? Dis moi.
Pantalon - Rentrons à la maison. Ma fia ne sait pas. Avec une seule histoire je satisferai tout le monde.
Silvio - Je te suis, et je te demande humblement pardon, si porté par passion ...
Pantalon - Amont; dommage. Je connais cossa que xè amor. Allez, ma chère, est venu avec moi (en partie ).
Silvio - Qui est plus heureux que moi? Quel cœur peut être plus heureux que le mien? ( commence par Pantalone ).
SCÈNE VI
Salle de l'auberge avec diverses portes.
Béatrice et Florindo quittent tous les deux leur chambre avec un fer à repasser à la main, dans le but de vouloir se suicider: retenu celui de Brighella, et ceux du serveur de l'auberge; et ils avancent pour que les deux amants ne se voient pas .
Brighella - Si vous vous arrêtez ( saisissant la main de Béatrice ).
Béatrice - Laissez-moi pour la charité ( elle essaie de se libérer de Brighella ).
Serveur - C'est un désespoir ( pour Florindo, le retenant ).
Florindo - Allez en enfer ( ça fond du serveur ).
Béatrice - Vous ne pourrez pas m'empêcher ( s'éloigne de Brighella ).
Tous deux avancent, déterminés à vouloir se suicider, et se voyant et se reconnaissant, ils restent stupides.
Florindo - Que vois-je!
Béatrice - Florindo!
Florindo - Béatrice!
Béatrice - Tu es en vie?
Florindo - Vivez-vous toujours?
Béatrice - Oh destin!
Florindo - Oh mon âme!
Les fers tombent et s'embrassent.
Brighella - Tolè sur ce sang, qui n'ira pas de mal ( au serveur en plaisantant, et en partie ).
Serveur - (au moins je veux avancer ces couteaux. Je ne les lui donne plus) (il prend les couteaux au sol et s'en va ).
SCÈNE VII
Béatrice, Florindo, puis Brighella .
Florindo - Quelle raison vous avait réduit à un tel désespoir?
Béatrice - Une fausse nouvelle de votre mort.
Florindo - Qui vous a fait croire ma mort?
Béatrice - Mon serviteur.
Florindo - Et moi aussi m'a fait croire que tu étais éteint, et porté par une douleur égale, il a voulu me priver de vie.
Béatrice - Ce livre était la raison pour laquelle je lui faisais confiance.
Florindo - Ce livre était dans ma malle. Comment est-il passé entre vos mains? Ah oui, il vous sera venu, comme dans les poches de ma robe j'ai trouvé mon portrait; voici mon portrait, que je vous ai donné à Turin.
Béatrice - Ces imbéciles de nos serviteurs, le ciel sait ce qu'ils auront fait. Ils ont été la cause de notre douleur et de notre désespoir.
Florindo - Cent fables, mon histoire m'a parlé de vous.
Béatrice - Et j'ai autant de vous de mon serviteur que vous le tolérez.
Florindo - Et où sont-ils?
Béatrice - Ils ne sont plus vus.
Florindo - Cherchons-les et comparons la vérité. Qui est au-delà? Y a-t-il quelqu'un là-bas? ( appeler ).
Brighella - Les commandes.
Florindo - Où sont nos serviteurs Eglino?
Brighella - Je ne sais pas, monsieur. Je vois pol cercar.
Florindo - Essayez de les trouver et envoyez-les nous ici.
Brighella - je n'en connais qu'un; Je vais le dire aux serveurs; lori les connaîtra tous. Je me réjouis avec eux d'avoir fait une douce mort; si je voudrais le faire enterrer, laissez-le passer à un autre logo, ce qui est bien ici. Serviteur de lor signori ( pièce ).
SCÈNE VIII
Florindo et Béatrice .
Florindo - Êtes-vous également dans ce lodge?
Béatrice - Je suis arrivée ce matin.
Florindo - Et je suis toujours ce matin. Et ne nous sommes-nous pas rencontrés auparavant?
Béatrice - La chance a mis du temps à dormir.
Florindo - Dis-moi: ton frère Federigo est-il mort?
Béatrice - Vous en doutez? Il a expiré instantanément.
Florindo - Pourtant, on m'a fait croire qu'il était vivant, et à Venise.
Béatrice - C'est une tromperie de ceux qui m'ont jusqu'ici pris pour Federigo. J'ai quitté Turino avec ces vêtements et ce nom pour suivre ...
Florindo - Je sais, pour me suivre, ma chère; une lettre que vous a écrite votre serviteur de Turino m'a assuré d'un tel fait.
Béatrice - Comment est-elle arrivée entre vos mains?
Florindo - Un serviteur, qui je crois était le vôtre, a prié mon serviteur de les chercher au bureau de poste. Je l'ai vu, et le trouvant dirigé vers vous, je ne pouvais pas manquer de l'ouvrir.
Béatrice - Juste la curiosité d'un amoureux.
Florindo - Que dira Turino de votre départ?
Béatrice - Si je retourne là-bas avec ta fiancée, tout entretien sera terminé.
Florindo - Comment puis-je être flatté de revenir si tôt, si je suis accusé de la mort de votre frère?
Béatrice - Les capitales que j'apporterai à Venise vous libéreront de l'interdiction.
Florindo - Mais ces serviteurs ne sont toujours pas vus.
Béatrice - Qu'est-ce qui leur a causé une si grande douleur?
Florindo - Pour tout savoir, il n'est pas commode de faire preuve de rigueur avec eux. Il vaut mieux les prendre avec de bons.
Béatrice - je vais essayer de me couvrir.
Florindo - En voici un ( voir Truffaldino arriver ).
Béatrice - Il est devenu le plus coquin.
Florindo - Je ne pense pas que tu dises mal.
SCÈNE IX
Truffaldino, dirigé de force par Brighella et le serveur, et dit .
Florindo - Viens, viens, n'aie pas peur.
Béatrice - Nous ne voulons pas te faire de mal.
Truffaldino - (Eh! Je me souviens encore de bastonade) ( partie ).
Brighella - Nous l'avons trouvé; si nous trouvons l'autre, nous le ferons vegnir.
Florindo - Oui, nous devons tous les deux être là à la fois.
Brighella - (Lo conosseu vu cet autre?) (Lentement au serveur ).
Serveur - (je ne sais pas) ( à Brighella ).
Brighella - (Nous demanderons en cusina. Quelqu'un le connaîtra) ( au serveur, et en partie ).
Serveur - (S'il y en avait, il faudrait que je le sache) ( partie ).
Florindo - Allez, raconte-nous un peu comment s'est déroulé le changement de portrait et de livre, et pourquoi toi et cet autre coquin vous avez unis pour nous désespérer.
Truffaldino - (fait un geste du doigt à tous les deux qui sont silencieux ) Tais-toi ( à tous les deux ). La favorissa, un mot à part ( à Florindo, l'éloignant de Béatrice ). (Maintenant je vais tout vous dire) ( à Béatrice, dans l'acte qui s'écarte pour parler à Florindo ). (Sachez, monsieur ( parlez à Florindo ) que je ne suis pas en charge de tous les magasins, mais je ne suis pas à blâmer, mais celui qui est là est Pasqual, serviteur de cette dame qui est là ( avec une mention prudente de Béatrice)). Lu est celui qui a confondu les choses, et ce qui se passait dans t'un baul et il a tout gâché dans cet alter, sans que je le remarque. El poveromo s'ha m'a recommandé de le couvrir, pour que je sache que son maître ne le chasse pas, et que je suis de bon cor, qui m'a fait éventrer des amis, j'ai trouvé toutes ces belles inventions à voir pour la calmer . Non me saria mo mai estima, que ce portrait était voster, et qu'il y avait tellement de despiaser que ce qui était mort. Eccove compte l'histoire telle qu'elle est, de cet homme sincère, de ce fidèle serviteur qu'il y a).
Béatrice - (Il lui fait un long discours. Je suis curieux de connaître le mystère).
Florindo - (Alors celui qui vous a fait apporter la fameuse lettre à la Poste, était la servante de Madame Béatrice?) ( Lentement à Truffaldino ).
Truffaldino - (Sior Sì, el giera Pasqual) ( plan à Florindo ).
Florindo - (Pourquoi me cacher quelque chose dont il t'a tant cherché?) ( Lentement à Truffaldino ).
Truffaldino - (El m'aveva a prié pour qu'il ne le prenne pas) ( lentement à Florindo ).
Florindo - (Qui?) ( Comme ci-dessus ).
Truffaldino - (Pasqual) ( comme ci-dessus ).
Florindo - (Pourquoi ne pas obéir à votre maître?) ( Comme ci-dessus ).
Truffaldino - (Per amor de Pasqual) ( comme ci-dessus ).
Florindo - (Ce serait mieux si je battais Pasquale et toi en même temps) ( comme ci-dessus ).
Truffaldino - (Dans ce cas, cela dépendait de moi et du mien aussi de Pasqual).
Béatrice - Ce long examen est-il encore terminé?
Florindo - Il me dit ...
Truffaldino - (Pour l'amour du ciel, sior padron, pas la descoverza Pasqual. Plutôt, le barrage qui est moi, le moi est branché, si le vol, mais pas moi ruvina Pasqual) ( plan pour Florindo ).
Florindo - ( Aimez -vous tellement votre Pasquale?) ( Lentement à Truffaldino ).
Truffaldino - (Ghe ben ben, comme s el fuss me fradel Adess vous allez chez cette dame, vous me dites que je suis, que j'échouerai; allez que je crie, que je brouille, mais que si je sauve Pasqual) ( comme ci-dessus, et s'éloigne de Florindo ).
Florindo - (Il est d'une nature très aimante).
Truffaldino - Son qua da she ( s'approchant de Béatrice ).
Béatrice - (Quel long discours avez-vous eu avec Signor Florindo?) ( Lentement à Truffaldino ).
Truffaldino - ( Qu'on sache que ce monsieur a un servidor qui a le nom de Pasqual; c'est le plus grand mamalucco du monde; c'est lui qui a fait ces choses-là, et pourquoi le pauvre homme est le il avait peur qu'el patron cazzasse le chemin, je me trouve cette excuse dans le livre, le maître mort, nie, etecetera. Et hanche Adess au Signor Florindo gh'ho ditt que j'ai stà cause de tout) ( toujours plan à Béatrice ) .
Béatrice - (Pourquoi vous accuser d'une faute que vous prétendez ne pas avoir?) ( À Truffaldino, comme ci-dessus ).
Truffaldino - (Pour l'amour que j'apporte à Pasqual) ( comme ci-dessus ).
Florindo - (Cela va un peu long).
Truffaldino - (Cher vous, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas) ( lentement à Béatrice ).
Béatrice - (Qui?) ( Comme ci-dessus ).
Truffaldino - (Pasqual) ( comme ci-dessus ).
Béatrice - (Pasquale et vous êtes deux coquins) ( comme ci-dessus ).
Truffaldino - (Eh, je serai moi seul).
Florindo - Nous ne cherchons rien d'autre, Signora Beatrice, nos domestiques ne l'ont pas fait avec malveillance; ils méritent d'être corrigés, mais grâce à nos consolations, nous pouvons pardonner leur passé.
Béatrice - C'est vrai, mais ton serviteur ...
Truffaldino - (Pour l'amour du ciel, Pasqual n'est pas nominé) ( lentement à Béatrice ).
Béatrice - Allez, je devrais aller chez le signataire Pantalone de'Bisognosi; voudriez-vous venir avec moi? ( à Florindo ).
Florindo - J'aimerais bien y aller, mais je dois attendre un banquier à la maison. Je reviendrai plus tard, si vous êtes pressé.
Béatrice - Oui, je veux y aller immédiatement. Je t'attendrai du signor Pantalone; Je ne partirai pas de là, si tu ne viens pas.
Florindo - Je ne sais pas où il est chez lui.
Truffaldino - Je me connais, monsieur, je vais l'accompagner.
Béatrice - Eh bien, je vais dans ma chambre pour finir de m'habiller.
Truffaldino - (Allez, laissez-moi vous servir immédiatement) ( plan à Béatrice ).
Béatrice - Cher Florindo, une grande douleur que j'ai ressentie pour toi ( entre dans la chambre ).
SCÈNE X
Florindo et Truffaldino .
Florindo - Le mien n'était pas mineur ( derrière Béatrice ).
Truffaldino - Le barrage, patron supérieur, pas de Pasqual; siora Beatrice no gh'ha nissun qui l'aide à s'habiller; si vous êtes content que j'irai vous servir à la place de Pasqual?
Florindo - Oui, allez-y; servez-le avec soin, j'aurai du plaisir.
Truffaldino - (En invenzion, préparation, cabale, je défie le premier sollicitador de Palazzo) ( entre dans la chambre de Béatrice ).
SCÈNE XI
Florindo, puis Béatrice et Truffaldino .
Florindo - De gros accidents se sont produits ce jour-là! Plantes, plaintes, désespoirs, et dernière consolation et joie. Passer des larmes au riz est un doux saut qui vous fait oublier vos soucis, mais lorsque vous passez du plaisir au duol, la mutation est plus sensible.
Béatrice - Me voilà rapide.
Florindo - Quand allez-vous changer ces vêtements?
Béatrice - N'était-elle pas bien habillée comme ça?
Florindo - J'ai hâte de te voir avec ta jupe et ton buste. Votre beauté n'a pas besoin d'être trop couverte.
Béatrice - Allez, je t'attends au signor Pantalone; être accompagné de Truffaldino.
Florindo - J'attends encore un peu; et si le banquier ne vient pas, il reviendra.
Béatrice - Montrez-moi votre amour dans votre sollicitude ( commence à partir ).
Truffaldino - (Comandela qui reste à servir, je suis monsieur?) (Lentement à Béatrice, hochant la tête Florindo ).
Béatrice - (Oui, tu l'accompagneras au signor Pantalone) ( à Truffaldino ).
Truffaldino - (Et de cette route, je le servirai, car il n'y a pas de Pasqual) ( comme ci-dessus ).
Béatrice - Sers-le, tu vas me rendre reconnaissant. (Je l'aime plus que moi) (en partie ).
SCÈNE XII
Florindo et Truffaldino .
Truffaldino - Tolì, si vous ne le voyez pas. El padron s'il s'habille, el va fora de casa, et nol s'il voit.
Florindo - De qui parlez-vous?
Truffaldino - De Pasqual. Ghe voio ben, c'est moi amigo, mais c'est un fauteuil. Je suis un serviteur que je vaux.
Florindo - Venez m'habiller. Pendant ce temps, le banquier viendra.
Truffaldino - Sior padron, je pense que Vussioria doit se rendre chez Sior Pantalon.
Florindo - Eh bien, qu'aimeriez-vous dire?
Truffaldino - Je voudrais lui demander une grâce.
Florindo - Oui, vous le méritez vraiment pour votre bonne tenue.
Truffaldino - Si quelque chose est né, vous savez que Pasqual l'est.
Florindo - Où est ce maudit Pasquale? Tu ne le vois pas?
Truffaldino - El vegnerà sto baron. Et cusì, sior padron, voria domandarghe est grâce.
Florindo - Que veux-tu?
Truffaldino - Anca mi, pauvre, je suis amoureux.
Florindo - Êtes-vous amoureux?
Truffaldino - M. oui; et le me morosa est le serviteur de sior Pantalon; et voria mo che vussioria ...
Florindo - Comment puis-je entrer?
Truffaldino - Oh, pas de digo che ghe intra; mais comme je suis ma servante, je m'en dis un mot à sœur Pantalon.
Florindo - Tu dois voir si la fille te veut.
Truffaldino - La fille vol. Un mot suffit à Sœur Pantalon; s'il vous plaît de charité.
Florindo - Oui, je le ferai; mais comment garderez-vous votre femme?
Truffaldino - Je ferai ce que je ferai. Je me recommanderai à Pasqual.
Florindo - Recommandé à un peu plus de jugement ( entrez dans la salle ).
Truffaldino - Si je ne suis pas un jugement, cette fois, je ne le referai plus (il entre dans la pièce, derrière Florindo ).
SCÈNE XIII
Chambre dans la maison de Pantalone.
Pantalone, le docteur, Clarice, Silvio, Smeraldina .
Pantalone - Allez, Clarice, ne sois pas cusì ustinada. Vous voyez qu'il lui est repentant Silvio, qui vous demande pardon; s'il le donne dans une certaine faiblesse, il l'a fait par amour; hip gh'ho je vais pardonner les caprices, vous ghe les a pour vous pardonner hip.
Silvio - Mesurez la mienne, Mme Clarice, à partir de votre douleur, et plus vous vous assurez que je vous aime vraiment, plus la peur de vous perdre me rend furieuse. Le ciel veut que nous soyons heureux, ne vous rendez pas ingrats aux œuvres de charité du ciel. A l'image de la vengeance, vous ne souffrez pas du plus beau jour de notre vie.
Docteur - Aux prières de mon fils, j'ajoute les miennes. Mme Clarice, ma chère belle-fille, est désolée pour le pauvre garçon; il était là pour devenir fou.
Smeraldina - Allez , madame, que voulez-vous faire? Les hommes, un peu plus, un peu moins, sont tous cruels envers nous. Ils exigent une fidélité très exacte, et pour chaque soupçon léger ils nous brouillent, nous maltraitent, ils voudraient nous voir mourir. Déjà avec l'un ou l'autre, vous devez vous marier; Je dirai, comme les gens le disent aux malades, puisque vous devez prendre le médicament, prenez-le.
Pantalon - Via, sentistu? Smeraldina au mariage du médicament ghe dise. Ne laissez pas el te para tossego. (Vous devez voir devertirla) ( plan chez le docteur ).
Docteur - Ce n'est ni un poison, ni un médicament, non. Le mariage est un paquet, un julep, un bonbon.
Silvio - Mais, ma chère Clarice, est-il possible qu'un accent ne sorte pas de tes lèvres? Je sais que je mérite d'être puni, mais par pitié, punissez-moi avec vos mots, pas avec votre silence. Me voici à tes pieds; bouge avec pitié de moi ( s'agenouille ).
Clarice - Cruel! (soupirant vers Silvio).
Pantalone - (Aveu sentio qui soupire? Bon signe) ( lentement au Docteur ).
Docteur - (exhorte le sujet) ( lentement à Silvio ).
Smeraldina - (Le soupir est comme un éclair: signe avant-coureur de la pluie).
Silvio - Si je croyais que tu as exigé mon sang pour se venger de ma supposée cruauté, je te le montre de bon cœur. Mais oh mon dieu! à la place du sang de mes veines, prenez ce qui coule de mes yeux ( cris ).
Pantalon - (Bravo!).
Clarice - Cruel! ( comme ci-dessus, et avec plus de tendresse ).
Docteur - (Elle est cuite) ( lentement à Pantalone ).
Pantalon - Animo, leviers ( à Silvio, le soulevant ). Vous allez ici ( en même temps, en le prenant par la main ). Allez ici anca vu, siora ( prend la main de Clarice ). Animo, il toucha de nouveau sa main; fe pase, plus de pianzè, consoleve, fenila, tolè; Le ciel vous bénisse ( unit les mains des deux ).
Docteur - Allez, c'est fait.
Smeraldina - Fait, fait.
Silvio - Deh, Signora Clarice, pour l'amour de Dieu (lui tenant la main ).
Clarice - ingrat!
Silvio - Cara.
Clarice - Inhumain!
Silvio - Mon âme.
Clarice - Chien!
Silvio - Mine Viscere.
Clarice - Ah! ( soupire ).
Pantalon - (La va).
Silvio - Pardonnez-moi, pour l'amour du ciel.
Clarice - Ah! Je vous ai pardonné ( soupirant ).
Pantalon - (La xè andada).
Docteur - Allez, Silvio, il vous a pardonné.
Smeraldina - Le patient est prêt, donnez-lui le médicament.
SCÈNE XIV
Brighella et dictons .
Brighella - De bonne grâce, se pol vegnir? ( entrez ).
Pantalon - Venez ici, Sior Brighella apparaît. Vu sè ce qu'il me donne pour comprendre les beaux mensonges ste, ce qui m'a assuré que sior Federigo gera ça, ah?
Brighella - Cher Signor, qui n'a pas été trompé? J'étais fradelli qui ressemblait à un pommeau spartide. Avec ces robes, la tête qui el giera lu zogà.
Pantalon - Assez; la xè passada. Cossa gh'è da niovo?
Brighella - Signora Beatrice est ici, qui veut la révérer.
Pantalon - Que le vegna pur, que le xè parona.
Clarice - Pauvre Mme Beatrice, je me console qu'elle est en bon état.
Silvio - Avez-vous de la compassion pour elle?
Clarice - Oui, beaucoup.
Silvio - Et moi?
Clarice - Ah cruel!
Pantalone - Écoutez quels mots aimants? ( au docteur ).
Docteur - Mon fils a alors des manières ( à Pantalone ).
Pantalon - Mia fia, pauvre, la xè de bon cuor ( au docteur ).
Smeraldina - (Eh, les deux peuvent faire leur part).
SCÈNE XV
Béatrice et paroles .
Béatrice - Messieurs, ici je vous demande de vous excuser, de demander pardon, si pour ma raison vous avez eu des ennuis ...
Clarice - Rien, mon ami, viens ici ( embrasse-la ).
Silvio - Hé? (montrant des regrets pour ce câlin).
Béatrice - Comment! Pas même une femme? ( vers Silvio ).
Silvio - (Ces vêtements me rendent toujours gentil).
Pantalone - Andè là, siora Beatrice, qu'être une femme et être zovène, gh'avè un beau courage.
Docteur - Trop d'esprit, ma maîtresse ( à Béatrice ).
Béatrice - Amore vous fait faire de grandes choses.
Pantalon - je m'ha ai trouvé, ni vrai, avec le copain? C'est important pour moi.
Béatrice - Oui, le ciel m'a consolé.
Docteur - Belle réputation! ( à Béatrice ).
Béatrice - Seigneur, tu n'as rien à voir avec moi ( au docteur ).
Silvio - Cher Monsieur Père, laissez tout le monde faire son truc, ne vous inquiétez pas. Maintenant que je suis heureux, je souhaite que le monde entier puisse en profiter. Y a-t-il d'autres mariages à faire? Fais le.
Smeraldina - Hé, monsieur, il y aurait le mien ( à Silvio ).
Silvio - Avec qui?
Smeraldina - Avec le premier qui vient.
Silvio - Trouvez-le et je suis là.
Clarice - toi? Pour faire quoi? ( à Silvio ).
Silvio - Pour un peu de dot.
Clarice - Vous n'avez pas besoin de vous.
Smeraldina - (Il a peur qu'ils le mangent. Cela nous a donné du goût).
SCÈNE XVI
Truffaldino et dictons .
Truffaldino - Fazz révérence à ces messieurs.
Béatrice - Où est signor Florindo? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - C'est ici, qu'el voria vegnir avanti, si je suis content.
Béatrice - Êtes-vous convaincu, signor Pantalone, que le signor Florindo est décédé?
Pantalon - Xèlo l'amigo oui fait? (à Béatrice ).
Béatrice - Oui, mon mari.
Pantalon - Che el reste servido.
Béatrice - Laissez passer ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Zovenotta, ve reverisso ( dans Smeraldina, piano ).
Smeraldina - Farewell, morettino ( piano à Truffaldino ).
Truffaldino - Nous parlerons ( comme ci-dessus ).
Smeraldina - De quoi? ( comme ci-dessus ).
Truffaldino - Si vous voulez ( il fait signe de lui donner la bague, comme ci-dessus ).
Smeraldina - Pourquoi pas? ( comme ci-dessus ).
Truffaldino - Nous parlerons ( comme ci-dessus, et partie ).
Smeraldina - Dame maîtresse, avec la licence de ces messieurs, je voudrais vous demander une charité (à Clarice).
Clarice - Qu'est-ce que tu veux? ( s'écartant pour l'écouter ).
Smeraldina - (Moi aussi je suis une pauvre jeune femme, que j'essaie de me retrouver: il y a la servante de Signora Beatrice qui me voudrait; si elle disait un mot à sa maîtresse, qu'elle serait convaincue qu'il me prendrait, j'espère faire le ma chance) ( plan à Clarice ).
Clarice - (Oui, chère Smeraldina, je le ferai volontiers: immédiatement que je pourrai parler à Béatrice en toute liberté, je le ferai certainement) ( retournez chez elle ).
Pantalon - Cossa xè sti gran secreti ( à Clarice ).
Clarice - Rien, monsieur. Il m'a dit une chose.
Silvio - (Puis-je le savoir?) ( Lentement à Clarice ).
Clarice - (Grande curiosité! Et puis d'autres femmes parleront de nous).
DERNIÈRE SCÈNE
Florindo, Truffaldino et dictons .
Florindo - Très humble serviteur de leurs messieurs. ( Tout le monde le salue ). Est-elle le maître de la maison? ( à Pantalone ).
Pantalon - Pour le servir.
Florindo - Permettez-moi d'avoir l'honneur de vous dédier ma servitude, escortée à cet effet par Mme Beatrice dont les événements passés, comme moi, me seront connus.
Pantalon - Je me console pour connaître et reverirla, et je me console au coeur de tant de contentements.
Florindo - Signora Beatrice doit être ma fiancée, et si vous ne dédaignez pas de nous honorer, vous serez à la hauteur de notre mariage.
Pantalon - Ce que vous avez à faire, qu'el se baise immédiatement. Si vous poignardez l'homme.
Florindo - Je suis prêt, Signora Beatrice.
Beatrice - La voici, M. Florindo.
Smeraldina - (Eh, ne vous priez pas).
Pantalon - Nous ferons le solde de nos comptes. Je les connais juste, que nous justifierons les nôtres.
Clarice - Ami, je me console ( à Béatrice ).
Béatrice - Et j'ai chaleureusement avec toi ( à Clarice ).
Silvio - Seigneur, me reconnais-tu? ( à Florindo ).
Florindo - Oui, je vous reconnais; c'est toi qui voulais faire un duel.
Silvio - En effet, je l'ai fait pour mon mal. Voici qui m'a désarmé et un peu moins que tué ( hochant la tête Béatrice ).
Béatrice - Vous pouvez dire qui vous a donné la vie ( à Silvio ).
Silvio - Oui, c'est vrai.
Clarice - Dans ma grâce, cependant ( à Silvio ).
Silvio - C'est très vrai.
Pantalon - Tout x est vrai, tout x est fenio.
Truffaldino - El meggio manquant, messieurs.
Pantalon - Cossa manquant?
Truffaldino - Avec une si bonne grâce, un mot ( à Florindo, le tirant de côté ).
Florindo - (Que voulez-vous?) ( Lentement à Truffaldino ).
Truffaldino - (S'arrecordel cossa ch'el m'a promis?) (Lentement à Florindo ).
Florindo - (Quoi? Je ne me souviens pas) ( lentement à Truffaldino ).
Truffaldino - (De domandar a sior Pantalon Smeraldina per me muier?) ( Comme ci-dessus ).
Florindo - (Oui, maintenant ça me vient à l'esprit. Je le fais maintenant) ( comme ci-dessus ).
Truffaldino - (Anca mi, pauvre garçon, cela me met à l'honneur du monde).
Florindo - Signor Pantalone, bien que ce soit la première fois que j'ai l'honneur de vous rencontrer, j'ose vous demander une grâce.
Pantalon - Les commandes pur. Autant que je pourrai, je vous servirai.
Florindo - Mon serviteur aurait envie de votre femme de chambre pour femme; auriez-vous du mal à l'accorder?
Emerald - (Oh magnifique! Un autre que je veux. Qui diable est? Au moins je le savais).
Pantalon - Car je suis content. Cossa disela elle, patron? ( à Smeraldina ).
Smeraldina - Si je pouvais croire que j'allais bien ...
Pantalon - Xèlo homo de qualcossa I'm so servitor? ( à Florindo ).
Florindo - Pour le peu de temps que j'ai avec lui, il a certainement confiance et je pense qu'il est capable.
Clarice - M. Florindo, vous m'avez empêché dans quelque chose que je devais faire. Je devais proposer le mariage de ma femme de chambre au domestique de Mme Beatrice. Vous avez demandé le vôtre; rien d'autre.
Florindo - Non, non; lorsque vous avez cette préoccupation, je me retire du tout et vous laisse en toute liberté.
Clarice - Il ne sera jamais vrai que je veuille permettre que mes préoccupations soient préférées aux vôtres. Et puis je n'ai aucun engagement à vous dire. Allez-y dans la vôtre.
Florindo - Vous le faites par compliment. Monsieur Pantalone, ce que j'ai dit, que ce soit tacite. Pour ma servante, je ne te parle plus, en fait je ne veux pas que tu l'épouses du tout.
Clarice - Si la vôtre ne l'épouse pas, l'autre n'a pas non plus à l'épouser. Cela doit être au moins également.
Truffaldino - (Oh beau! Lori complimente, et je reste sans muier).
Smeraldina - (je vais voir que je n'en aurai pas deux).
Pantalone - Eh bien, c'est vrai; le pauvre putta est gh'ha voggia de maridarse, demola ou à l'un, ou à l'autre.
Florindo - Pour mon non. Je ne veux certainement pas faire de tort à Mme Clarice.
Clarice - Je ne permettrai jamais que cela soit fait au signor Florindo.
Truffaldino - Siori, cela va le réparer. Sior Florindo, ne demandez-vous pas à Smeraldina le serviteur el so?
Florindo - Oui, tu ne l'as pas entendu toi-même?
Truffaldino - Et vous, Siora Clarice, n'utiliserez-vous pas Smeraldina pour el servidor de siora Beatrice?
Clarice - j'ai vraiment dû en parler.
Truffaldino - Ben, avec le cusì, Smeraldina, deme la man.
Pantalon - Mo pour cossa voleu qu'un daga la ve daga la man? ( à Truffaldino ).
Truffaldino - Parce que je le suis, je suis un serviteur de Sior Florindo et de siora Beatrice.
Florindo - Comment?
Béatrice - Qu'est-ce que tu dis?
Truffaldino - Un peu de flegme. Sior Florindo, qui vous a demandé de demander Smeraldina à Sœur Pantalon?
Florindo - Tu me l'as demandé.
Truffaldino - Et vous, sœur Clarice, qui vouliez-vous que Smeraldina soit?
Clarice - À propos de vous.
Truffaldino - Ergo Smeraldina est à moi.
Florindo - Mme Beatrice, où est votre servante?
Béatrice - Le voici. N'est-ce pas Truffaldino?
Florindo - Truffaldino? Voici mon serviteur.
Béatrice - N'est-ce pas le vôtre Pasquale?
Florindo - Pasquale? Ce devait être le vôtre.
Beatrice - Comment ça va? ( vers Truffaldino ).
( Truffaldino avec des blagues silencieuses s'excuse ).
Florindo - Ah coquin!
Béatrice - Ah condamné!
Florindo - Avez-vous servi deux maîtres en même temps?
Truffaldino - Sior oui, je me suis bien fait. Je suis intrà dans cet engagement sans pensarghe; Je voulais essayer. J'ai une courte durée de vie, c'est vrai, mais en même temps j'ai la gloire que personne n'avait encore découverte pour moi, si désormais il me décrivait pour le bien de cette fille. J'ai fait un grand fadiga, j'ai fait quelques défauts, mais j'espère que, par souci d'extravagance, tout sii siori me pardonnera.
Fin de la comédie.
L'AUTEUR QUI LIT
Le Rusteghi en langue vénitienne n'est pas le même que le Rustici en langue toscane. À Venise, nous entendons l'homme Rustego , un homme dur et zoptique, ennemi de la civilisation, de la culture et de la conversation. On peut voir dans le titre de la comédie que non seulement le protagoniste, mais plusieurs ensemble, et en fait ils sont quatre, tous du même personnage, mais avec diverses teintes décrites, quoi dire la vérité, très difficile, semblant que plus de personnages sont égaux dans le même La comédie peut porter plus que du plaisir.
Cette fois, j'ai tout fait dans l'autre sens: le public s'est beaucoup amusé et je peux dire que c'est l'une de mes œuvres les plus chanceuses; car non seulement à Venise il était apprécié, mais de partout, où il était représenté jusqu'à présent par les Comédiens. Cela signifie que la coutume ridicule des gens est connue de tous, et la comédie n'est pas si mauvaise pour la langue en question. Bien que, pour d'autres choses, il ait été récité d'ici avec bonne fortune, je suis sûr que tous les termes et toutes nos phrases ne peuvent pas être compris, mais avec quelle étude j'ai pu, j'ai mis l'explication au bas de la page.
Beaucoup voudraient un dictionnaire vénitien pour comprendre cette langue, et j'ai moi-même pensé à le faire; mais je pense que les lecteurs servis sont meilleurs en leur donnant l'explication du fait, plutôt que de les distraire de la lecture, pour recourir au Dictionnaire, que vous ne pouvez pas toujours avoir à portée de main quand vous en avez besoin.
Je ne croyais pas vraiment qu'il me faudrait bientôt me noyer dans les premiers volumes de cette édition Comédie en favella vénitienne. Je l'ai fait pour la raison mentionnée dans l'épître dédicatoire précédente, et je ne regrette pas de l'avoir fait, car il me semble avoir pris les notes les plus difficiles à clarifier les plus difficiles à comprendre. J'ai donné l'explication de tous ces termes et de ces phrases que les étrangers ne trouvent pas dans les vocabulaires italiens; mais ces voix, qui ont en quelque sorte une analogie avec les dictons toscans, je les ai laissées telles quelles, pouvant à ceux qui ont un peu de talent connaître leur dérivation, et surmonter la petite différence. Par exemple, les conjugaisons de 'verbes sont quelque peu différentes, mais elles comprennent facilement: Farave for ferait l'affaire ;Je suis allé ; Si vous le souhaitiez plutôt que si vous le saviez, ce ne sont pas des façons si étranges qui nécessitent une explication, ni le dictionnaire ne suffirait à les expliquer, mais la grammaire vous aimerait toujours.
Même l'orthographe vénitienne modifie parfois le sens, mais celui qui l'abandonne le comprend et l'orthographe est réglée en fonction du son de la prononciation. Nous, par exemple, ne disons pas beau , mais beau , pas parfait , mais parfait ; et en règle générale, presque toutes les consonnes doubles sont prononcées simplement par nous. Mais dans certains articles, les lettres simples que nous double, comme à la place de ce que nous, disons cossa , mais ce sont très peu.
Les pronoms ont quelques différences avec les toscans: les plus observables sont moi , qui s'appelle Mi , You , qui s'appelle Ti , He , qui s'appelle Elo . Ainsi, il est observable dans l'expression des verbes, qui se dit de la même manière au singulier et au pluriel. Par exemple: je suis allé : je suis allé . Ça allait : Ça allait . Beaucoup aimeraient vous en parler. Pour l'instant, ça suffit. Il se peut qu'à une autre occasion, il dise quelque chose de plus.
PERSONNAGES
| Citoyen CANCIANO . | |
| FELICE épouse de Canciano . | |
| Le comte RICCARDO. | |
| Marchand LUNARDO . | |
| MARGARITA épouse de Lunardo en deuxième mariage . | |
| Lucietta fille de Lunardo du premier lit . | |
| Marchand SIMON . | |
| MARINA épouse de Simon . | |
| Beau-frère de Marina MAURIZIO . | |
| FELIPPETTO fils de Maurizio . | |
La scène est représentée à Venise.
SCENE I
Chambre dans la maison de Lunardo.
Margarita tourne, Lucietta fait des bas, toutes deux assises.
Lucietta - mère Siora.
Margarita - mine de Fia (1) .
Lucietta - Debotto (2) xè fenìo (3) carneval.
Margarita - Cossa diseu, quel bon plaisir, que nous avons abuo (4) ?
Lucietta - De diana! Gnanca une merde de comédie que nous n'avons pas vu.
Margarita - Ve feu maraveggia pour ça? Je l'aime vraiment beaucoup. Xè mois j'ai passé six mois, dont je suis maridada; m'àlo jamais menà en aucun liogo ton père sior?
Lucietta - Et oui, sàla? Il pouvait à peine attendre el s'il retournait à maridar. Co giera (5) seule dans la maison, elle a dit entre de mi: le compatisso sior padre; elo no me vol menar, nol gh'ha nissun da mandarme; si el se marida, j'irai avec siora maregna. El s'ha retournera à Maridar, mais pour autant que je vois, pas de ghe xè gnente ni pour moi, ni pour ela.
Margarita - El x est un ours, fia mia; pas si ça amuse elo, et pas si ça amuse gnanca nu. Et oui, savé? Co giera da maridar, je n'ai pas manqué de plaisir. Son stada arlevada ben. Ma mer (6) est déjà une femme sutila, et si elle est un peu piaseva, elle la sauvera et sauvera son homme. Mais autrefois, nos amusements le donnaient. Imaginez, l'autuno est allé au théâtre trois ou trois fois; el carneval cinque o sie (7) . Si quelqu'un donnait une clé de la scène, il l'apporterait à l'opéra, sinon à la comédie, et il l'achèterait la si bonne clé, et il dépenserait les bonnes sobres. Il l'a procuré pour aller là où il l'a sauvé, que si c'était le cas (8) comédies osseuses, de poderghe menar de le fie et vendu avec nu, et si nous nous amusions. Andevimo, encore moins, parfois à Reduto; un pochetin à Liston (9) , un pochetin à Piazzeta par le stròleghe, par buratini et un de va va à casoti. Comme nous restions à la maison, nous avons toujours eu notre conversation. Ses parents sont venus, ses amis sont venus, même du zovène; mais pas de danger déjà, encore moins.
Lucietta - ( Figurarse, figurarse ; il l'a touchée jusqu'à présent six fois).
Margarita - Pas de digo; que je ne suis pas de ceux qui gias piasa el zorno vont à torziando (10) . Mais, oui, oui. Parfois, il me piasera la hanche.
Lucietta - Et moi, pauvre, qui ne passe jamais par la porte? Et pas vol mo gnanca (11) qui erre une fià (12) sur le balcon? L'autre zorno me fils butada cusì, un petit scampar; que la pétazza (13) de la lasagnera (14) m'a vu , le ghe l'a pointé du doigt, et j'ai pensé, que el me bastona.
Margarita - Et combien de minutes ai-je eu à cause de toi?
Lucietta - De diana! cossa ghe fazzio?
Margarita - Vu almanco, fia mia, ve mariderè; mais je dois être aussi longtemps que je vis.
Lucietta - Le barrage, mère siora, moi marideroggio?
Margarita - Croyez-moi oui.
Lucietta - Le barrage, mère siora, et quand vais-je marideroggio?
Margarita - Ve mariderè, apparais, quand le ciel veut.
Lucietta - Dois-je l'épouser sans que je le sache?
Margarita - Quelle erreur! L'avè da saver anca vu.
Lucietta - Nissun a toujours le doigt génial sur moi.
Margarita - Sinon, je l'aurai, je vous le dirai.
Lucietta - Ghe xè gnente au chantier naval (15) ?
Margarita - Ghe xè, et pas de ghe xè. Mon mario no vol che ve damnente.
Lucietta - Cara ela, le barrage.
Margarita - Pas de dasseno, fia mia.
Lucietta - Cara ela, un peu.
Margarita - Se ve digo gnente, el me jump to the eyes co (16) fait un basilic.
Lucietta - Nol connaîtra miga sior père, si je ne le sais pas.
Margarita - Oh imaginez, sinon je le ferai!
Lucietta - Non dasseno, imaginez, que je ne digo pas.
Margarita - Cossa gh'intra'm figurarse ?
Lucietta - ( Ironiquement ) Je ne sais pas, je l'utilise et je ne vais pas creuser ça.
Margarita - (Gh'ho dans ma tête, que ma blague me frascona).
Lucietta - Le barrage, mère siora.
Margarita - Animo laorè (17) , l'aveu gnancora fenìa ce bas?
Lucietta - Deboto.
Margarita - Si el el a casa elo (18) , et que la chaussette n'est pas fenìa, el dira que si elle monte sur les balcons, et je no vòi, apparais ... (bon sang je suis vice!)
Lucietta - La varda co spessego (19) . Le barrage me qualcossa de sto novizzo (20) .
Margarita - De qual novizzo?
Lucietta - Non dis-tu que je vais me marier?
Margarita - Pol esser.
Lucietta - Cara ela, si vous savez quelque chose.
Margarita - ( Avec un peu de colère ) Je ne sais pas.
Lucietta - Gnanca mo gnente, mo, gnanca mo (21) .
Margarita - Son stuffa.
Lucietta - (En colère ) Les deux malignazo (22) .
Margarita - Coss'è sti sesti (23) ?
Lucietta - Pas de gh'ho nissun dans ce monde, qui me soutient bien.
Margarita - J'en vois trop, frascona.
Lucietta - ( à voix basse ) Ben de la mer (24) .
Margarita - Doigt Cossa aveu?
Lucietta - Gnente.
Margarita - ( Avec dédain ) Il a senti, savè, no me stè a seccar, that deboto, deboto ... Davantazo (25) ghe ne soporto assae in sta casa. Gh'ho a mario che rosega (26) all el zorno, no ghe mancarave other, encore moins, qui m'avait obligé à être une hanche inrabiar pour la fiastra (27) .
Lucietta - Mo chère maman siora, elle va très tôt au choléra.
Margarita - (Le gh'ha squasi rason. Pas de giera cusì une fois, je suis deventada une bête. Pas de gh'è remedio; qui est avec lovo (28) apprend à crier).
SCENE II
Lunardo et dit .
Lunardo entre et est magnifique, sans parler.
Margarita - (Vèlo qua, per diana). ( Augmente )
Lucietta - (El vien co fa cats). ( Se lève ) Père Sior, patron.
Margarita - ( à Lunardo ) Sioria. Non si nous disons au revoir à Gnanca?
Lunardo - Laorè, laorè. Pour me faire un compliment tralassè de laorar?
Lucietta - J'ai laora jusqu'à présent. Je déboto fenìo la chaussette.
Margarita - Stago a véder, figurarse, qui siemo pagae a zornada (29) .
Lunardo - Vu sempre, vegnimo dir el merito (30) , me donne toujours ces réponses.
Lucietta - Mo loin, chère soeur père; almanco in sti last zorni de carneval, qui nol staga à criar. Sinon, nous n'irons pas sans logo, folie; tige en pase (31) almanco.
Margarita - Oh, elo no pol star un zorno sans criar.
Lunardo - Il a entendu quelle blague! Cossa songio? Un tartare? Une bête? De cossa ve podeu lamentar? Honnêtement, j'ai aimé les chiennes.
Lucietta - Via donca, qui mène à un pocheto masqué.
Lunardo - En masque? Masqué?
Margarita - (Maintenant el va zoso (32) !)
Lunardo - Et avait-il tant de museau (33) de dirme qu'il porte un masque? M'avez-vous déjà vu, allons-nous dire le mérite, au mètre et au visage sur le museau (34) ? Coss'èla est-elle un masque? Si vous portez un masque? Non moi fè parle; le putti (35) n'a pas à entrer dans le masque.
Margarita - Et les maridae?
Lunardo - Gnanca le maridae, siora no, gnanca le maridae.
Margarita - Et pour cossa donca les autres, paraissent, ghe vàle?
Lunardo - ( Le canular de son saut ) Figurarse, figurarse . Je pense à moi à la maison et je ne pense pas aux autres.
Margarita - ( fait de même ) Pourquoi, disons le crédit , parce que c'est un ours.
Lunardo - Siora Margarita, le jugement gh'abbia.
Margarita - Sior Lunardo, ne me piquez pas.
Lucietta - Mo loin, sois malicieux! Toujours cusì. Je m'en fiche si je vais dans le masque. Je vais rester à la maison, mais je reste en bon état.
Lunardo - Non sentìu? Vegnimo ... non sentìu? Le x est ela qui toujours ...
Margarita - ( Rires )
Lunardo - ( à Margarita ) Ridè, patron?
Margarita - Ve n'aveu pour malade, pourquoi je ris?
Lunardo - Via, vegnì qua tutti (36) , a-t-il entendu. Parfois, je me mets un peu sur la tête, et cela semble ennuyeux, mais quand même (37) je suis de voggia. Semo de carneval, et je veux que vous emportiez notre zornada (38) .
Lucietta - Oh peut-être (39) !
Margarita - Allez, écoutons ça.
Lunardo - Il a entendu: voggio, qui encore une fois dénoncer en compagnie.
Lucietta - ( gaiement ) Où, où, sœur Père?
Lunardo - À la maison.
Lucietta - ( mélancolique ) À la maison?
Lunardo - Siora oui, à la maison. Où vouliez-vous que nous allions? À l'auberge?
Lucietta - Sior non à la taverne.
Lunardo - Dans la maison de nissun mi no vago (40) ; Je ne floue pas, on va dire le mérite, à magnar les côtes à nissun.
Margarita - Loin, loin, pas de ghe tendè. Vous m'avez parlé, figuremose, voleu enidar qualchedun?
Lunardo - Siora oui. J'ai envie de l'oncle, et je vais vendre ici, et si nous allons profiter et être bien.
Margarita - Qui as-tu envié?
Lunardo - Une compagnie de galantomeni, parmi lesquels ghe ne xè do de maridai, ei vegnerà co le so parone (41) , et nous serons heureux.
Lucietta - ( Allegra ) (Via, via, gh'ho a caro). ( A Lunardo ) Cher elo, qui xèli?
Lunardo - Siora curieuse!
Margarita - Allez , cher vieil homme (42 ans) , ne voulais-tu pas que nous sachions qui doit vegnir?
Lunardo - Pas de barrage voleu che vel? Si tu sais. Sœur Canzian Tartuffola, sœur Maurizio dalle Strope et sœur Simon Maroele viendront.
Margarita - Cospeto de diana! Trois cai à droite! J'avais bien trouvé le trou dans le pont.
Lunardo - Cossa diriez-vous? No i xè three omeni co se diè (43) ?
Margarita - Sior oui. Trois salvadeghi comme vu.
Lunardo - Eh, patronne, à l'époque d'Ancuo, on va dire le crédit, à un homme qui a un jugement, si un homme le sauve. Saveu pourquoi? Parce que les femmes vualtre trop trope desmesteghe. No ve contentè de l'honnête; ve piaserave les bruits, les paquets, les modes, la bouffonnerie, les putelezzi (44) . Pour rester chez soi, ve par de star à preson (45) . Sans vêtements ni costa assae, ni xè beli; Sans pratique, la mélancolie vient, et aucune pensée à la fin; et aucun gh'avè un fià de jugement, et il a écouté ceux qui les ont érigés, et aucune espèce ne vous fait entendre ce qu'il a dit (46) de tant de maisons, de tant de fameggie précipitae; qui vous donne drio (47) s'il fait du ménar pour la langue (48) , s'il fait mètre sur les fans (49) , et quiconque voulait vivre dans la maison soa avec respect, sérieux, réputation, se ghe dise, vegnimo pour dire le mérite, l'ennui, omo rustego, omo salvadego. Pàrlio ben? Pensez-vous que ce barrage la vérité?
Margarita - Je ne vais pas contester. Tout ce qu'il voulait. Donca viendra à déconner avec Nu Siora Felice et Siora Marina.
Lunardo - Siora oui. Cusì, vedu? J'ai aussi aimé pratiquer. Tout le monde avec je connais le mariage. Cusì no ghe xè dirty, (50) no ghe xè, vegnimo pour dire le crédit ... ( À Lucietta ) Quel steu écouter? Maintenant non s'il parle au vu.
Lucietta - ( à Lunardo ) Xèle sourit que je ne peux pas entendre?
Lunardo - ( lentement à Margarita ) (Non, j'ai hâte de le détruire).
Margarita - ( Plan in Lunardo ) (Comment ça se passe cette boutique?)
Lunardo - ( Piano a Margarita ) (je vais compter). ( À Lucietta ) Andè via de qua.
Lucietta - Cossa ghe fazzio?
Lunardo - Andè via de qua.
Lucietta - De diana! El xè impastà de velen.
Lunardo - Andè loin, que je te donne une claque au visage.
Lucietta - Séntela, mère siora?
Margarita - ( chaleureusement ) Va-t'en , avec ton doigt qui est parti, obéi.
Lucietta - (Oh, si c'était ma mer, tant mieux! Folie, si tu me donnes un scoazzer (51) , toria). ( Partie )
SCÈNE III
Lunardo et Margarita .
Margarita - Chère sœur Lunardo, sur mon visage pas de ghe dago rason, mais en vérité c'est trop rustego avec cette puta.
Lunardo - Vedeu? Vu no savè gnente. Ghe voggio bien, mais je crains de peur.
Margarita - Ne me donnez jamais de déviation.
Lunardo - Le pute les fait rester à la maison et elle ne les enlève pas.
Margarita - Almanco un soir à la comédie.
Lunardo - Siora no. Vòi poder dir, co la marido: tolè, sior, dago, vegnimo pour dire le crédit, qu'aucun masque n'a jamais été mis sur le visage; qu'aucun x ne va jamais au théâtre.
Margarita - Et cusì, allez-y je suis maridozzo (52) ?
Lunardo - Gh'aveu gnente doigt dans la puta?
Margarita - Mi? Noffink.
Lunardo - Vardè ben, vedè.
Margarita - Non vraiment, je digère.
Lunardo - Je me crois, tu vois, je pense que je l'ai maridada.
Margarita - Avec qui? Que ce soit pour le mettre moins cher?
Lunardo - Zito, qui ne sait rien de l'air. ( Regardez autour de vous ) Col fio de sior Maurizio.
Margarita - Co sior Filipeto?
Lunardo - Oui, zito, non il a parlé.
Margarita - Zito, zito, de diana! Xèlo de la contrebande?
Lunardo - Aucun voggio qui ne connaît de destin.
Margarita - Si tu le fais bientôt?
Lunardo - Bientôt.
Margarita - L'àlo fata demande?
Lunardo - Plus de réflexion. Je l'ai promis.
Margarita - ( avec admiration ) La promesse de la hanche que vous l'avez obtenue?
Lunardo - Siora oui, ve feu maraveggia?
Margarita - Sans rien dire?
Lunardo - Son paron mi.
Margarita - Cossa ghe deu de dota?
Lunardo - Ce pour quoi je vis.
Margarita - Je suis une statue, donca. Pour moi, encore moins, pas si je m'attire.
Lunardo - Figurarse, figurarse , non tu vas dighio maintenant?
Margarita - Sior oui, et le puta quand tu le sais?
Lunardo - Co l'épousera.
Margarita - Et non je m'ha pour voir en avant?
Lunardo - Siora no.
Margarita - Seu je sais que tu es un piaser?
Lunardo - Son paron mi.
Margarita - Ben ben, x est votre fia. Je n'en suis pas fou (53) ; c'est tout ce qu'il voulait.
Lunardo - Mon fia no vosi nissun peut dire qu'il l'a vue et que ce qui la voit doit se marier.
Margarita - Et si tu le vois, tu ne le veux pas?
Lunardo - Il semble donc qu'il me donne un mot.
Margarita - Oh quel beau mariage!
Lunardo - Aimeriez-vous Cossa? Qu'est-ce que l'amour a fait en premier?
Margarita - Les bates, les bates; vague pour voir qui il est.
Lunardo - Non ghe xè le serviteur?
Margarita - Le xè pour faire le repos, j'irai me voir.
Lunardo - Siora no. Non, tu es allé sur le balcon.
Margarita - Vardè quels cas!
Lunardo - Non allez, quel gh'andè, gh'anderò moi. Commandez-moi, vegnimo pour dire le crédit, commandez-moi. ( Partie )
SCÈNE IV
Margarita, puis Lunardo .
Margarita - Mo che man, qui m'a touché! Pas de compagnon gh'è el sous la tête du ciel (54) . Et po el me stuffa avec ça je sais dire le crédit ; deboto, encore moins, je ne peux plus soportar.
Lunardo - Saveu c'est qui?
Margarita - Qui?
Lunardo - Sior Maurizio.
Margarita - El pare del novizzo?
Lunardo - Tasè. Juste elo.
Margarita - Tu viens régler ça?
Lunardo - Andè de là.
Margarita - M'as-tu renvoyé?
Lunardo - Siora oui; parti.
Margarita - Vous ne vouliez pas que j'entende?
Lunardo - Siora no.
Margarita - Vardè, vedè! cossa songio mi (55) ?
Lunardo - Son paron mi.
Margarita - Non, je suis ton agresseur (56) ?
Lunardo - Andè via de qua, ve digo.
Margarita - Mo quel ours c'est!
Lunardo - Destrighève (57) .
Margarita - ( Montant lentement ) Mo quel satyre!
Lunardo - ( Avec dédain ) La fenimio (58) ?
Margarita - Mo quelle bête de omo! ( Partie ).
SCÈNE V
Lunardo, puis Maurizio .
Lunardo - Le xè andada. Co le bone non si ça me rend attrayant. Nous devons pleurer. Ghe voggio ben assae, ghe ne voggio assae; mais dans ma maison il n'y a pas d'autre paroni que moi.
Maurizio - Sior Lunardo, patron.
Lunardo - Bondì siorìa, sior Maurizio.
Maurizio - Je parle à mon fio.
Lunardo - Gh'aveu doigt qui voulait maridar?
Maurizio - Ghe doigt.
Lunardo - Cossa dìselo?
Maurizio - El dise que el x est heureux, mais el gh'averave gusto de véderla.
Lunardo - ( Avec dédain ) Sior non, ce ne sont pas nos patios.
Maurizio - Via, via, non, il est entré dans le choléra, ce que el puto fera tout ce que je soutiens.
Lunardo - Co volè, ??vegnimo pour dire le crédit, la dota xè parecchiada. Je vous ai promis sie mile ducati et sie mile ducati ve dago. Les voulez-vous dans autant de paillettes, dans autant de duchés d'argent, ou voulez-vous les écrire sur le comptoir? Comandè.
Maurizio - Eh bien, je ne les soutiens pas. Soit zirème une capitale de zecca ou investimoli mieux que si pol.
Lunardo - Oui bien; nous ferons tout ce qu'il voulait.
Maurizio - Pas de dépenses en vêtements, que je ne nourris pas.
Lunardo - Je te le donnerai en tant que xè.
Maurizio - Gh'àla roba de séa (59) ?
Lunardo - Le gh'ha a un chiffon.
Maurizio - Dans ma maison pas de mer voggio. Tant que je vis, je dois aller avec la robe en laine, et toi ni tabarini ni scuffie. Ni chercher (60) , ni toppè, ni cartes postales sur le devant (61) .
Lunardo - Bravo, sieu benedeto. Parce que moi aussi je m'aimais. Zoggie (62) ghe ne feu?
Maurizio - Ghe fera le so boni manini (63) d'or, et la fête ghe donnera un zoggielo qui giera de mia muggier, et un per de recchineti de perle.
Lunardo - Oui bien, oui bien, et pas moi-même pour faire la minchioneria de far ligar est un truc de mode.
Maurizio - Pensez-vous que c'est mato? Quelle est cette mode? Le zoggie le x est toujours tendance. Cossa si vous estimez? Diamants ou ligadura?
Lunardo - Et même le lendemain (64) , on va dire le mérite, s'il jette beaucoup de bezzi en ste ligadure.
Maurizio - Sior oui; fè ligar le zoggie tous les dies anni, en cao de cent anni (65) il l' a acheté deux fois.
Lunardo - Ghe xè peu, qui pense comme nous pensons nu.
Maurizio - Et ghe xè peu, ce gh'abbia de bezzi comme ce gh'avemo nu.
Lunardo - I dixe mo, che nu no savemo goder.
Maurizio - Pauvres gars! Ghe vèdeli drento de notre cœur? Croyez-vous qu'il n'y a pas d'autre monde que celui qui les aime? Oh comparer (66) , el x est un bon goût el poder dit: j'ai mon besoin, je ne manque pas de gnente, et en serment je peux doser l'homme sur une centaine de sequins!
Lunardo - Sior oui, et magnar ben, de boni caponi, d'os et de boni straculi de vedèlo (67) .
Maurizio - Tout est bon, et bon marcà, car s'il paie de temps en temps.
Lunardo - Et à la maison soa; pas de hochets, pas de chuchotements.
Maurizio - Et sans rien, ce qui vous intrigue (68) .
Lunardo - Et Nissun connaît notre destin.
Maurizio - Et semo paroni nu.
Lunardo - Et le muggier sans commandes.
Maurizio - Et le fioi est da fioi (69) .
Lunardo - Et ma fia xè arlevada cusì.
Maurizio - Mon arc est une perle. Il n'y a aucun danger qu'il jette une bagatine (70) .
Lunardo - Mon puta sait comment le faire. À la maison, je voulais que la fazza de tuto. Fina lave la vaisselle.
Maurizio - Et à mon avis, parce que je ne vous apprends pas ce dont vous avez besoin et que je deviens fou avec ça, je vous ai appris à utiliser les chaussettes et à mettre le fondèli sur la braghesse (71) .
Lunardo - ( Riant ) Bravo.
Maurizio - ( Riant ) Oui, c'est ça.
Lunardo - (se frottant les mains et riant ) Allez, fémolo je vais me marier; destrighemose.
Maurizio - ( Comme ci-dessus ) Co volè, ??apparaît.
Lunardo - Ancuo attend que tu me renies. Za savè que j'ai ton doigt. Gh'ho quatro latesini (72) , vegnimo pour dire le crédit, mais plein de destins.
Maurizio - Nous allons grossir.
Lunardo - Si nous voulons en profiter.
Maurizio - Nous serons aliegri.
Lunardo - Et puis je dirai que semo salvadeghi!
Maurizio - Schtroumpfs!
Lunardo - Martuffi! ( Ils partent )
SCÈNE VI
Chambre dans la maison de M. Simon
Marina et Filippetto .
Marina - Coss'è, Nevodo (73) ? Quel miracle, qu'il est venu me trouver?
Filippetto - Je suis vegnù via de mezà (74) , et avant de rentrer chez moi, je suis vegnù a pochetin pour la saluer.
Marina - Bravo. Filipeto; avait bien fait. Sentève (75) , voleu marendar (76) ?
Filippetto - Merci, sior'amia (77) . Vous devez rentrer chez vous; parce que s'il n'est pas père, il me trouve pauvre.
Marina - Diseghe qui se tient à côté de votre amie Marina; cossa le dire?
Filippetto - Si vous le pouvez! Nol tase mai, nol me ne perd jamais un moment de liberté.
Marina - El s'en sort bien, d'un gang. Mais de votre amour, vous devez l'avoir quitté.
Filippetto - Ghe l'a touché; pas vol que ghe vegna.
Marina - Mo el x est un satyre compagnon de mon compagnon.
Filippetto - Sior barbe (78) Simon ghe xèlo à la maison?
Marina - Nol ghe xè, mais pas de pol far che el vegna.
Filippetto - Anca elo co el me voit, co vegno qui, el me cria.
Marina - Lassè ce barrage el. La sarave bela. C'est ma neige. Moi de ma sœur; cette pauvre pauvre femme est morte, et je peux dire que je n'en ai pas d'autres dans ce monde, que vous voulez.
Filippetto - Pas de vorave qui, pour moi, el ghe criasse anca a ela.
Marina - Oh pour moi, ma chère, no vo tolè je suis travaggio. Si el me dise tantin, me ghe je réponds tanton. Pauvre moi, s'il n'en était pas ainsi! Sur tuto el cateria da criar. Non, je crois qu'un homo plus rustego que mon Mario est dans ce monde.
Filippetto - Plus que son père?
Marina - Je ne sais pas, tu vois, le bate là-bas.
Filippetto - Jamais, après que je sois au monde, ça ne me donne jamais un peu de plaisir. El dì da laorar (79) à mezà et à la maison. La fête pour faire ce qui doit être fait, et bientôt à la maison. El me fait accompagner le serviteur, et il a voulu le persuader ainsi que le serviteur de me faire attention ce matin. Jamais une fois dans la Zueca (80) , jamais à Castelo (81) , je ne pense pas que ce sera dans ma vie trois ou quatre fois sur la Piazza (82) : ce qui vous fait elo, el vol che fazza anca mi. En fin de soirée, s'il reste au milieu, s'il dîne, s'il va se coucher, et bondì siorìa.
Marina - Pauvre puto, dasseno me fè sin. X est vrai; le zoventù doit être tourné en échec, mais el trope x est trope.
Filippetto - Assez; Je ne sais pas si ça ira à partir de maintenant.
Marina - Si vous êtes discret, vous auriez dû donner un peu de liberté.
Filippetto - Sàla, gnente, sior'amia?
Marina - De cossa?
Filippetto - Nol gh'ha doigt gnente sior père?
Marina - Oh, c'est un morceau que je ne vois pas.
Filippetto - Aucun cadeau sachant.
Marina - je ne sais pas. Cossa ghe xè de niovo?
Filippetto - Si je le creuse, le dira-t-il à son père?
Marina - Non, cela ne fait aucun doute.
Filippetto - Au revoir, voyez-le.
Marina - Ve digo de no, ve digo.
Filippetto - Écoutez, el me veut maridar.
Marina - Dasseno?
Filippetto - El a le doigt et l'élo.
Marina - Al trouvera-t-il la nouveauté?
Filippetto - Siora oui.
Marina - Qui est Xèla?
Filippetto - Ghe je dirai, mais chère ela, la tasa.
Marina - Mo loin, je me sens en colère. Cossa credeu que c'est?
Filippetto - La xè fia de sior Lunardo Cròzzola.
Marina - Oui, oui, le cognosso. Autrement dit, pas le cognosso ela, mais les cognosso connaissent maregna, siora Margarita Salicola, qui a épousé sior Lunardo, et el xè amigo de mio mario, un salvadego co elo. Mo i s'ha ben catà (83) , il a vu, et le père du novice avec le père du novice. Avez-vous vu le puta?
Filippetto - Siora no.
Marina - Avanti de serar el contrato, je vais vous le montrer.
Filippetto - J'ai peur de non.
Marina - Oh bela! Et sinon, avez-vous aimé?
Filippetto - Sinon, je l'ai aimé, je ne le prends pas, par Diana.
Marina - Ça aurait été mieux si je la voyais devant.
Filippetto - Comment veux-tu baiser?
Marina - Disèghelo à votre sœur père.
Filippetto - Ghe l'a pointé du doigt, et il me l'a donné (84) .
Marina - S'il sauve comment le faire, il veut me le faire, je sers.
Filippetto - Oh peut-être!
Marina - Mais aussi cet ours de sior Lunardo pas lassa véder de nissun so fia.
Filippetto - En cas de succès, une fête ...,
Marina - Zito, zito qui est ici mon mario.
Filippetto - Vorla s'éloigne?
Port de plaisance - Fermève.
SCÈNE VII
Simon et dictons .
Simon - (Cossa fàlo qua sto frascon?)
Filippetto - Patron, sans barbe.
Simon - ( Brusquement ) Sioria.
Marina - Un bel acèto, qu'est-ce que je pense!
Simon - Je l'ai enlevé avec toi, que dans ma maison, je me fiche des parents.
Marina - Varè (85) ! Venez-vous flatter à la porte et me poser des questions sur mes proches? Aucun gh'ha n'a besoin de vu, sior; A cao de tanto (86) , ma neige vient-elle me trouver et me gronde encore (87) ? Gnanca si nous étions taggialegni (88) . Gnanca si nous étions hors de la valade. Vu sè un omo civil? Sois un tangaro, compact.
Simon - Aveu gnancora fenìo? Pas de gh'ho voggia de criar ce matin.
Marina - Tu ne vois pas ma neige? Le destin de Cossa v'àlo?
Simon - Nol m'a fait du bien; ghe voggio bien; mais savé que dans ma maison je n'ai pas le goût du ghe vegna nissun.
Filippetto - Et si cela ne fait aucun doute, je n'abandonnerai plus.
Simon - Je serai de garde.
Marina - Et je veux cet el ghe vegna.
Simon - Et je ne veux pas de ce ghe vegna.
Marina - Sta sorte de cosse Je ne les avais pas à empêcher.
Simon - Tout ça, que je n'ai pas aimé, je peux, et je vais vous aider à l'empêcher.
Filippetto - ( En train de partir ) Patron.
Marina - ( à Filippetto ) Attendez. Cossa gh'aveu co sto puto?
Simon - Je ne le soutiens pas.
Marina - Mo pour cossa?
Simon - Per cossa ou per gamba (89) , no vòi nissun.
Filippetto - Sior'àmia, mon temps s'en ira.
Marina - Andè, andè, nevodo. Je vais retourner chez ton père.
Filippetto - Patronne. Patron, sior barbe.
Simon - Sioria.
Filippetto - (Oh, el ghe pol à mon père, el x est plus rustego que six fois). ( Partie )
SCÈNE VIII
Marina et Simon .
Marina - Vardè quels sixièmes! Cossa voleu ce barrage el qui putto!
Simon - Lo savè malgré mon tempérament. Dans ma maison, je vis ma liberté.
Marina - Quelle intrigue vous fait mon signe de tête?
Simon - Gnente. Mais pas de voggio nissun.
Marina - Pourquoi ne pas avoir ta chambre en toi?
Simon - Parce que je veux rester ici.
Marina - En vérité, ce qui est cher. Aveu enverra le shopping (90) ?
Simon - Siora no.
Marina - Non, si vous avez un ancêtre (91) ?
Simon - ( Plus fort ) Siora pas.
Marina - Non si tu disna?
Simon - Siora no.
Marina - Ghe mancarave hip this, que je suis entré dans la colère hip avec disnar.
Simon - Za, celui qui t'entend vu, je suis un cinglé, un alocco.
Marina - Mais pourquoi pas si je disna?
Simon - ( Avec Malagrazia ) Parce que nous devons aller à disnar fora de casa.
Marina - Et mel disè co bona grace?
Simon - Me fè vegnir suso el mio mal.
Marina - Cher Mario, compatime, gh'avè a natural, who de fè va va anger.
Simon - No lo cognosseu el mio natural? Co lo cognossè, scène cossa feu ste?
Marina - (Ghe était très patient). Où dois-je aller pour déconner?
Simon - Vegnirè avec moi.
Marina - Mais où?
Simon - Où je vais te donner moi.
Marina - Pour cossa no voleu qui sait?
Simon - Cossa est-ce important, qui sait? Comme pour votre Mario, je ne cherche rien d'autre.
Marina - En fait, j'avais l'air fou. Il faut que je sache où aller, comment je dois m'habiller, quel zhe ghe xè. Si ghe xè suggestion, aucun voggio miga ne va me faire smattar.
Simon - Où j'erre, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de suggestion.
Marina - Avec qui vas-tu?
Simon - Vegnirè avec moi.
Marina - Mo la xè mo curieux lu (92) !
Simon - Mo la xè curieux seguro.
Marina - Je dois vegnir sans économiseur où?
Simon - Patronne oui.
Marina - Muème el nome (93) se ghe vegno.
Simon - Et vu restera à la maison sans se soucier.
Marina - J'irai à mon cugnà (94) Maurizio.
Simon - Sior Maurizio votre cugnà ira à disnar où nous irons nu.
Marina - Mais où?
Simon - Il est parti avec moi, qui saura. ( Partie )
SCÈNE IX
Marina, puis Felice, Canciano et le comte Riccardo .
Marina - Mo cher! Mo siestu benedetto! Quelle bonne grâce qu'el gh'ha! Je bat (95) . ( Sur les lieux ) Oe, vardè qui les bat. Le x est un moyen de faire rire les chapons. Je dois aller à disnar fora de casa sans économiseur où? Gh'averave anca voggia de andarme à dévier un peu, mais sans savoir où, pas de vague. S'il savait comment le savoir. Oh qui est là? Siora Felice! Qui est avec Ela? Un x est ce massacre (96) de so mario. Et qui d'autre qui a jamais xèlo? Eh, ela gh'ha en a toujours, ce qui lui sert. Je connais mario xè de la taggia del mio (97) ; mais Felice ne se laisse pas suggérer; Je voulais le savoir, et ce pauvre ghe va drio (98) , comme une canette de canette. Despiase de mio mario. Cossa dis-le, si tu vois que le costume est calme? Oe! Ce barrage el quoi el vol; Je n'ai pas de phares vegnir. Malegrazie no ghe vòi far.
Felice - Patronne, siora Marina.
Marina - Patrona, siora Felice. Patrons vénérés.
Canciano - ( Mélancolique ) Patronne.
Riccardo - ( à Marina ) Très humble servante de la dame.
Marina - Votre servante. ( À Felice ) Qui suis-je monsieur?
Felice - Un comte, un cavalier forestier, un amigo de mio mario; Est-ce vrai (99) , sœur Cancian?
Canciano - Je ne sais pas.
Riccardo - Bon ami et bon serviteur de tous.
Marina - Avec xè amigo de sior Cancian, n'étant pas une personne de mérite.
Canciano - Je digère que je ne connais pas.
Marina - Comment puis-je vous sauver si vous venez avec du vu chez moi?
Canciano - Avec moi?
Felice - Mo avec qui vous faites un don? Chère soeur Conte, la compatissa. Semo de carneval, sàla; mon mario si tu dévertes un peu. Marina El vol tararo siora; Est-ce vrai, Sior Cancian?
Canciano - (Nous devons l'injustice).
Marina - (Oh, co smart, quelle garde!) Vorle sentarse? Si vous êtes à l'aise.
Felice - Oui, écoutons un pochetin. ( S'assoit ) Si vous êtes à l'aise ici, sœur Conte.
Riccardo - La fortune n'aurait pas pu mieux me placer.
Canciano - D'où je me sens?
Felice - ( à Canciano ) Andè là, arente (100) siora Marina.
Marina - ( Piano a Felice ) Non, chère fia (101) , que si mon mario vient, pauvre moi.
Felice - ( à Canciano ) Vardè là; pas de ghe xè de le careghe (102) ?
Canciano - ( s'assoit à côté ) Oui, oui, merci.
Riccardo - ( à Canciano ) Ami, si tu veux t'asseoir ici, tu es maître; nous ne faisons pas de cérémonies. J'irai de l'autre côté, à Signora Marina.
Marina - ( à Riccardo ) Sior non, sior non, non tu es mal à l'aise.
Felice - Pour les rhumes cossa dìsela ste? Croyez-vous que mon Mario est zélé? Oe, Sior Cancian, Defendève (103) . Il vous a entendu, il vous croit zélé. Me maraveggio de ela, sior Conte. Mon mario x est un galantomo, il sait que le plus lourd que el gh'ha, n'a pas souffert de tels maux, et s'il les souffrait, il les laisserait passer. La saria bela qu'une femme civilisée pourrait honnêtement traturer un gentleman, une personne propre, qui vient à Venise pour le sti quatro zorni de carneval, qui me est recommandé par un de mes amis, qui est à Milan! Cossa diseu, Marina, ne serait-ce pas une incivilité? N'était-ce pas une asenaria? Mon mario no xè de sto cuor, el gh'ha ambition de farse merit, de farse honor, el gh'ha gusto that I know how to die if it dvertts, that the fool is a good figure, that staga in a good conversation. Est-ce vrai, sœur Cancian?
Canciano - ( Mâcher ) Siora oui.
Riccardo - Pour dire la vérité, j'avais quelques doutes; mais puisque vous me trompez, et M. Canciano le confirme, je vivrai très tranquillement et profiterai de l'honneur de vous servir.
Canciano - (Son est une bête pour moi, pour le recevoir à la maison la première fois).
Marina - Rester une pièce, Sior Conte, à Venise?
Riccardo - Il avait l'intention d'y rester un peu; mais je suis tellement contente de cette belle ville que je prolongerai mon séjour.
Canciano - (Peut-être que le diable ne l'enlève pas?)
Felice - Et cusì, Siora Marina, nous allons Disney ensemble.
Marina - Où?
Felice - Où? Non le savè où?
Marina - Mon Mario a un doigt sur moi, mais le logo n'a pas de doigt sur moi.
Felice - De siora Margarita.
Marina - De Sior Lunardo?
Felice - Oui bien (104) .
Marina - Maintenant je comprends. Mariage (105) ?
Felice - Quel mariage?
Marina - No savè gnente?
Felice - Pas moi. Contème (106) .
Marina - Oh, bonne nouvelle.
Felice - De qui? De Lucietta?
Marina - Oui bien; mais, zito.
Felice - ( tire à Marina ) Cara vu, contème.
Marina - ( Notant Riccardo et Canciano ) Sénteli (107) ?
Felice - Sior Riccardo, le barrage de ghe un peu à mon mario, le ghe erre arente; un peu de conversation avec elo, el gh'ha gusto avec qui je parle si fort, mais il n'y a pas de vol mnanca elo dans le canton de t'un. Est-ce vrai, sœur Cancian?
Canciano - ( à Riccardo ) Eh, pas mal à l'aise, je m'en fiche.
Riccardo - En fait, j'aurai le plaisir de parler avec M. Canciano. Je vais lui demander de s'enquérir de certaines choses. ( Approches Canciano )
Canciano - (El est cool).
Felice - ( à Marina ) Et qu'en est-il?
Marina - ( à Felice ) Andè là, qui est un grand diable.
Felice - Si ce n'était pas le cas, tu mourrais d'éthique avec ce Mario.
Marina - Et moi? ...
Felice - Diseme, diseme. Cossa gh'è de Lucieta?
Marina - je vais tout vous dire; mais appian, que personne n'entend. ( Ils parlent doucement )
Riccardo - ( à Canciano ) Monsieur, vous semblez faire très peu attention à moi.
Canciano - La compatissa, j'ai tellement d'intrigues pour moi, que je ne peux pas me détourner des autres.
Riccardo - Eh bien, je ne vous rabaisserai jamais. Mais ces dames se parlent secrètement; disons quelque chose; nous avons des conversations entre nous.
Canciano - Cossa vorla ce barrage? Je suis homo de quelques mots; pas de nouvelles sur les nouvelles, et pas trop aimer la conversation.
Riccardo - (C'est un gentil satyre).
Felice - ( à Marina ) Nol l'a-t-elle vue?
Marina - Non, et pas de vols qui le voient.
Felice - Mo cet el x est un grand must (108) .
Marina - Si tu l'as fait! Pagheria qualcossa de belo qui l'a vu, avant le contrat (109) .
Felice - À la maison, tu n'es pas obligé de partir?
Marina - Oh, gnanca pour l'insomnie (110) .
Felice - Pas si une poderia à l'occasion des masques? ...
Marina - Disè appian, qui l'entend.
Felice - ( à Riccardo ) Via, que j'ai tendance (111) au soi fati. Qu'est-ce que je n'espère pas espionner; que je parle, que nous parlons anca nu. ( À Marina, et ils parlent lentement ) Elle a senti du cossa qui me vient à la tête.
Riccardo - ( à Canciano ) Où allez-vous ce soir?
Canciano - À la maison.
Riccardo - Et la dame?
Canciano - À la maison.
Riccardo - Vous avez une conversation?
Canciano - Sior oui. Au lit.
Riccardo - Au lit? À quelle heure?
Canciano - A do ore ore (112) .
Riccardo - Eh, tu te moques de moi.
Canciano - Oui la hanche en tant que serviteur.
Riccardo - (je suis mal pris dans ce que je vois).
Felice - ( dans la marina ) Cossa diseu? Ve piàsela?
Marina - Oui bien; il est allé propre. Mais je ne sais pas comment parler à mon nevodo. Si je l'envoie, mon Mario se met en colère.
Felice - Mandèghe pour dire que el vegna da mi.
Marina - Et je le sais?
Felice - Non, allez à la hanche et dégagez de sior Lunardo? Avec xè fora de casa, qui el vegna; lassème el travaggio a mi (113) .
Marina - Et po (114) ? ...
Felice - Et po, et po? Après el Po vient les Adese (115) . Lassème loin a mi, ve digo.
Marina - Maintenant, je l'envoie à Avisar.
Felice - ( à Riccardo et Canciano ) Qu'est-ce que c'est, muti?
Riccardo - Le signataire Canciano n'a pas la volonté de parler.
Heureux - Gramazzo! El gh'avà aura quelque chose en tête. El x regorge d'intérêts: el x est un homo de garbo, sàla, my mario.
Riccardo - Je doute qu'il ne va pas bien.
Felice - Dasseno? Oh, pauvre moi; moi despiaserave assae. Cossa gh'aveu, sior Cancian?
Canciano - Rien.
Felice - ( à Riccardo ) Pour cossa dìselo, qu'est-ce que el gh'ha mal?
Riccardo - Parce qu'il a dit qu'il voulait aller dormir deux heures la nuit.
Felice - ( à Canciano ) Dasseno? Il est bien gouverné, ma chère.
Canciano - Ma ghe vegnirè anca vu.
Felice - Oh, aponto, pas de v'arecordè que nous devons aller à l'opéra?
Canciano - À l'opéra mi no ghe vago.
Felice - ( à Canciano ) Comment? C'est la clé de la scène; Je l'ai même comprada vu.
Canciano - J'ai sympathisé ... J'ai sympathisé, parce qu'il m'a trompé; mais à l'opéra, je n'ai ni ghe vago, ni gh'avè d'andar gnanca vu.
Heureux - Oh mon cher! El burla, sàla? El burla, savè, Marina? Mon cher Mario m'aimait tellement, il m'a acheté la scène et il vendra l'opéra avec moi: est-ce vrai? ( Piano a Canciano ) (Écoute tu sais, non moi loin el mato, quel pauvre homme tu)
Marina - (Oh, quelle joie (116) !)
Felice - ( à Riccardo ) Voulez-vous rester serviteur avec moi? Ghe x est le logo sur scène: est-ce vrai, sœur Cancian?
Canciano - (Siestu maudit! Le moi me fait faire ce que je veux).
SCÈNE X
Simon et dictons .
Simon - ( brusquement ) Marina.
Marina - Sior.
Simon - (Cossa xè'm Baccan? Cossa vorli ici? ( Il fait référence à Riccardo ) À propos de XELO Colu?).
Felice - Oh, sior Simon, le reverisso.
Simon - ( à Felice ) Patronne. ( À Marina ) Ah?
Felice - Semo vient rendre visite.
Simon - À qui?
Felice - Un vu. Est-ce vrai, sœur Cancian?
Canciano - ( Demi-bouche ) Siora oui.
Simon - ( à Marina ) Andè via de qua, vu.
Marina - Utiliserez-vous une mauvaise création?
Simon - Lassème el pensier a mi, andè via de qua.
Felice - Via, Marina, obéissez à votre mario: hip moi, il a vu, avec sœur Cancian il m'a donné un chariot, le fils immédiatement.
Marina - Bien, bien, je comprends. Patrons.
Riccardo - ( à Marina ) Très humble révérence.
Simon - ( ironique au comte ) Patron.
Marina - ( Rend hommage au Comte ) Serviteur.
Simon - ( Contrafà la révérence ) Patronne.
Marina - (Thassos, pourquoi, pourquoi: mais la vie n'est pas loin de Voggio). ( Partie )
Simon - ( à Felice ) Qui est-ce que je suis sior?
Felice - Demandez-le à mon Mario.
Riccardo - Si vous voulez savoir qui je suis, je vous le dirai, sans que vous ayez du mal à le demander. Je suis le comte Riccardo degli Arcolai, cavalière d'Abruzzo; Je suis un ami de Signor Canciano et un bon serviteur de Signora Felice.
Simon - ( à Canciano ) E vu lassè practicar tua muggier co sta sorte de cai (117) ?
Canciano - Cossa voleu che fazza?
Simon - Puffeta (118) ! ( Partie )
Felice - Vedeu, quelle belle création, quel el gh'ha? Il l'a imploré ici sans dire bête. Védela, sior Conte, la différence? Mon mario x est un omo civil; il n'est pas capable d'une action du destin. Je despiase que pour dénouer avec nu ancuo pas le menar podemo. Mais je vais vous en dire un peu, je ne sais pas pour plus tard, et ce soir nous irons à l'opéra ensemble. Est-ce vrai, sœur Cancian?
Canciano - Mais je digère ...
Felice - Eh, viens ici, sior pampalugo (119) . ( Il prend Canciano par un bras, Riccardo par l'autre, et ils partent )
ACTE DEUX
SCÈNE I
Chambre dans la maison de Lunardo.
Margarita habillée avec biens et Lucietta.
Lucietta - Brava, mère siora. Clean co, qui l'a habillé.
Margarita - Cossa voleu, chère fia? S'il y a encore un ancêtre, voleu che staga, et encore moins, que fait une massera?
Lucietta - Et quel genre de figure veux-tu?
Margarita - Vu da puta va bien.
Lucietta - Oh oui oui, bien stago! Co no son amalada, bien stago.
Margarita - Mi no so cossa dir, chère fia. S'il en était capable, il me demanderait aussi si j'avais votre besoin; mais savè qui semble être le vôtre. Avec elo no se pol parlar. Si ghe digo de farve qualcossa, el me saute aux yeux. El dise que le pute doit aller desmesse (1) ; el me sa dir che ve meto su (2) ; et moi, pour ne pas avoir pitié, je ne deviens pas fou; caduc que el fazza elo. Enfin non si ma fia, non je peux tor certains boniman (3) .
Lucietta - ( mortifiée ) Eh bien, je sais, je sais, que je ne sais pas.
Margarita - Cossa, tu veux dire? No ve voggio ben fursi (4) ?
Lucietta - Siora oui, je l'ai pris; mais non si ça me réchauffe. S'il en était ainsi, co (5) vien zente de suggizion, pas de lasserave miga qui se tenait avec la barre transversale (6) devant.
Margarita - Via, cavèvela la barre transversale.
Lucietta - Eh bien, comment vais-je l'obtenir?
Margarita - Qu'est-ce que la cavada, et encore moins, pas de gh'averè plus.
Lucietta - Eh za! Pensez-vous que je ne sais pas que mon canular?
Margarita - Moi, c'est un cavalier. Qu'est-ce que tu veux?
Lucietta - Vorave anca je vais apparaître cofà (7) les autres.
Margarita - Disèghelo à votre père. Voleu qui envoie chercher un sartor à scondon (8) , et qui te fait un costume? Et po? Xèlo orbo sior Lunardo? Credeu, imaginez, que je ne l'ai pas vu?
Lucietta - Je ne creuse pas de robe; mais un almanco. Le varda; no gh'ho gnanca un fià de cascate (9) . Gh'ho je suis strazzo de goliè da colo, que j'ai honte. Et xè antigo cofà mon neuvième. Pour la maison avec cette robe je n'ai pas de mauvais vêtements; mais ghe voria, cusì, qualcossa, cela semblait bon. Ils sont zovènes, et non il me manque une petite touche; il me semble que certains bagatela no la me desdiga (10) .
Margarita - Attends. S'il voulait un pèr de cascate, je vous le donnerai. Voulez-vous un colana de perle?
Lucietta - Peut-être.
Margarita - Maintenant je me promène. (Pauvre! Le maquereau. D'autres femmes, apparaissant, semo tute cusì). ( Partie )
SCÈNE II
Lucietta est dite .
Lucietta - Vardè? Je lui ai dit que mon père n'était pas vol. Je pense que c'est ela mi, qui ne supporte pas. Il est vrai que Sœur Père est un homo rustego, et que dans la maison il ne voulait pas avoir de bons vêtements, mais il fallait néanmoins les habiller, et avec la volonté il portait une habitude, s'il le faisait, et en même temps qu'il la damait. Mais pour moi, pauvre chose, pas si vous pensez. Maregna (11) , juste cussì. Et petit cognosso, les gh'ha en colère contre moi, car ils sont plus zovènes et plus bela de ela. Dans la maison ghe fous. Me dise fia co boca streta; avec cette mère digo siora, les gh'a ont peur que le ghe fazza grandisse ani.
Margarita - Via, cavève cette croix.
Lucietta - ( Elle enlève son tablier ) Oui, oui, immédiatement.
Margarita - Viens ici, je vais mesurer les chutes.
Lucietta - Cara ela, le lassa voir.
Margarita - Vardè; le x est neuf.
Lucietta - Cossa aimeriez-vous une fazza de sti scovoli (12) pour faire la vaisselle?
Margarita - Scovoli ghe disè? Un per de cascate de cambrada, que je n'ai pas fait quatre fois?
Lucietta - Non tu vois avec fiappe (13) que le xè?
Margarita - Vardè quelle honte! Bien sûr, je viendrai vardar les cascades, si le xè de lissìa. (14)
Lucietta - Le soe mais le xè nete.
Margarita - Quelle chère siora! Voulez-vous mètre co mi? Ce sont les cascades: si vous les vouliez, metèvele: si vous en vouliez plus, catèvene.
Lucietta - Allez , non, il l'erre dans le choléra, que je mesurerai.
Margarita - Viens ici. ( Mettre les chutes ) Za co ste spuzzete (15) , plus que s'il le fait, s'il fait pezo.
Lucietta - ( prenant les cascades ) Bien sûr! Il le fait pour moi.
Margarita - ( Comme ci-dessus ) J'emmerde plus que ce que j'ai à faire.
Lucietta - ( Comme ci-dessus ) Cara ela, qui ne la combat pas.
Margarita - ( comme ci-dessus, la tirant ) Si elle est très insolente, elle est le matin.
Lucietta - Allez, non, je suis fatigué de traîner, je ne suis pas une bête.
Margarita - Non, non, pas d'indubité, que je ne vegnirai plus autour. Moi trop délicat, siora. Fève servir da la serva, qui veut en devenir fou.
Lucietta - Des perles Gh'àla?
Margarita - Je ne sais pas: pas de voggio plus mustazzae (16) .
Lucietta - Via mo, chère Ela.
Margarita - Mata inspiritada che son, deventar mata co est frascona.
Lucietta - (Il pleure et se sèche avec son mouchoir ).
Margarita - Qu'est-ce que c'est? Cossa gh'aveu?
Lucietta - ( pleurer )
Margarita - Pianzè? Le destin de Cossa v'òggio?
Lucietta - ( pleurant ) Il a mon doigt ... de darme ... un colana de perle ... et non, il m'a voulu ... plus dar.
Margarita - Mo se me fè va au choléra.
Lucietta - Tu me le donnes?
Margarita - Allez, viens ici. ( Veut mettre le collier sur elle )
Lucietta - La lassa voir.
Margarita - Trovereu à dire aussi? Lassè, lassè, che la zola (17) .
Lucietta - ( lentement, grommelant ) Il y aura de l'anti-déesse (18) .
Margarita - ( Laçage du collier ) Cossa diseu?
Lucietta - Gnente.
Margarita - ( Comme ci-dessus ) Toujours brontolè.
Lucietta - ( Il y a une perle cassée dans son sein ) La varda: une perle rota.
Margarita - Et qu'en est-il? Est-ce que ça importe? Slarghèle un pochetin (19) .
Lucietta - Xote rote costumes?
Margarita - Je devrais me laisser dire ...
Lucietta - Combien d'ani gh'àla est colana?
Margarita - Voleu zogar (20) , qui vous emmènera et l'emmènera?
Lucietta - De diana! Toujours la cria.
Margarita - Mo sinon jamais content.
Lucietta - Staghio bien?
Margarita - Elle se porte très bien.
Lucietta - Me fais-je bien au visage?
Margarita - Propre, je digère, propre. (Le gh'ha a une damnée ambition) (21) .
Lucietta - (No ghe credo gnente, me vòi vardar) (22) . (Il sort un miroir de sa poche .)
Margarita - Le miroir gh'avè en rare (23) ?
Lucietta - Oh, el x est un chiffon (24) .
Margarita - Si ton père te voit!
Lucietta - Allez, pas de ghe pour le moins.
Margarita - Vèlo qui, vedè, che el vien.
Lucietta - Soyez malignazo! Non m'ho gnanca podesto véder ben. ( Il range le miroir ).
SCENE III
Lunardo et dit .
Lunardo - ( à Margarita ) Qu'est-ce que c'est, siora? Andeu al festin?
Margarita - Tolè. Vèlo ici. Je m'habille une fois par an et je grogne. Avez-vous eu peur, et encore moins, qui vous envoie en enfer?
Lunardo - Je m'en fous que j'ai apprécié (25) , on va dire le crédit, même une robe dans la semaine. Dieu merci, aucun de ces hommes ne souffre de spienza (26) . Je peux dépenser cent ducats. Mais pas dans les buffles de ste; cossa voleu che dam ces galantomeni qui me viennent? Et Piavola de Franza (27) ? Non, je vais smatar.
Lucietta - (Gh'ho gusto in verità, ce truc du barrage el ghe) (28) .
Margarita - Comment pensez-vous qu'il vendra les autres? Avec une chaussure et un sabot?
Lunardo - Lassè qui les vend sous le vol. Dans ma maison il n'y a jamais eu de pratique de ste cargadure, et non tu veux l'oublier, et non tu veux faire un mètre sur les ventilateurs. Ai-je compris?
Lucietta - Dasseno, mon père, j'ai le doigt sur ma hanche.
Lunardo - ( à Lucietta ) Écoute, tu sais, pas d'exemple de tor d'Ela ... C'est quoi ce truc? Cossa xis ces démons que vous avez au colo?
Lucietta - Eh bien, oui, père. Une bizarrerie, une anti-guerre.
Lunardo - Càvete ces perles.
Margarita - Dasseno, sœur Lunardo, que j'ai un doigt sur ma hanche.
Lucietta - Allez , cher elo, semo de carneval.
Lunardo - tu veux dire Cossa? Qu'y a-t-il dans le masque? Pas de voggio sti putelezzi. Toujours à venir; s'il vous voit, je ne vois que le barrage que la fia xè mata, et qu'il ne semble pas y avoir de jugement gh'ha. Donnez ici ces perles. (Il va les enlever, elle se défend ) Cossa xè ces lambeaux (29) ? Chutes d'eau, patronne? Cascades? Qui vous donne ces sales (30) ?
Lucietta - Je l'ai obtenue de ma mère.
Lunardo - ( à Margarita ) Faites un don de mata! Cusì soignée arlevè mia fia?
Margarita - Sinon, je suis heureuse, je lui dis que je la déteste, que je ne suis pas heureuse.
Lunardo - ( à Lucietta ) Depuis quand y a-t-il vegnù dans la tête sti grili?
Lucietta - Je l'ai vue et sa robe, elle est vegnù hip pour moi.
Lunardo - ( à Margarita ) Sentìu? Ce x est le rason de l'exemple catif.
Margarita - Ela xè puta, et je suis maridada.
Lunardo - Le maridae doit donner l'exemple au pute.
Margarita - Mi mar'à no maridà, sans parler de vous vendre pour devenir mata avec vos amis.
Lunardo - Je ne vous ai pas emmené non plus, nous sommes allés dire le mérite, afin qu'il se vende pour discréditer ma maison.
Margarita - Je vous honore plus que vous ne méritez.
Lunardo - ( A Margarita ) Anemo, il est immédiatement allé à despoggiar.
Margarita - No ve dago, je suis gnanca goût si vous me faites face.
Lunardo - Et vu no vegnirè to tola.
Margarita - Non ghe je pense ni bezzo ni bagatin.
Lucietta - Et moi, mon père, vegniroggio a tola?
Lunardo - Càvete ces déversoirs.
Lucietta - Sior oui, sans autre raison, cette toge el. Je suis obéissant. La varda ce truc: gnanca dommage que la méta. ( Vous obtenez des perles et des cascades ).
Lunardo - Vedeu? Si vous savez que le x est bien arlevada. Eh, mon premier muggier, pauvre! C'était déjà une femme du sixième (31) . Non s'il a posé un galan (22) sans me le dire, et avec moi il n'a pas voulu, giera fenìo, no ghe giera autres réponses. Siestu benedeta dove che xè (23) . Inspiration Mato que je retourne à Maridar.
Margarita - Mi, j'ai fait une bonne boutique chez un satyre pour Mario.
Lunardo - Pauvre mamie! Vous manquez votre besoin? Pas de gh'avè à magnar?
Margarita - Bien sûr! Une femme, avec le gh'ha da magnar, aucun ghe n'en manque plus!
Lunardo - Cossa vous manque?
Margarita - Cher vu, no me fè parlar.
Lucietta - père Sior.
Lunardo - Cossa gh'è?
Lucietta - Non, je me mesurerai plus sans te le dire, sàlo?
Lunardo - Cela vous fera du bien.
Lucietta - Gnanca si tu me dis siora mère.
Margarita - ( A Lucietta ) Eh, mozzina! Si on sait. Sur son visage, il apparut, tegnò par elo, et un peu drio les piques zélés à double cloches.
Lucietta - ( à Margarita ) Mi, siora?
Lunardo - ( A Lucietta ) Tasè là-bas.
Lucietta - ( In Lunardo ) La dise delle busie (24) .
Margarita - ( à Lunardo ) Avez-vous entendu comment il le parle?
Lunardo - Tasè là, ve digo. Avec la maregna non si ça parle comme ça. Gh'avè à respecter; il l'a fait tegnir in conto de mare.
Lucietta - ( à Lunardo ) De mi no la se pol lamentar.
Margarita - ( à Lunardo ) Et je ...
Lunardo - ( à Margarita ) E vu, vegnimo pour dire le mérite, despoggieve, qui fera mieux.
Margarita - Diseu dasseno?
Lunardo - Digo dasseno.
Lucietta - (Oh peut-être!)
Margarita - Je suis capable de le déchirer, je vis en cent touches.
Lunardo - Soul, stupide, que je vais ajuster à vous.
Lucietta - Père Sior, à venir.
Lunardo - Aseni! Je fais la moyenne sans diriger? ( À Lucietta ) Andè via de qua.
Lucietta - Mo pour cossa?
Lunardo - ( à Margarita ) Andève à despoggiar.
Margarita - Cossa voleu che i dam?
Lunardo - Cospeto et encoche (25) !
SCÈNE IV
Simon, Marina et dictons .
Marina - Patrona, siora Margarita.
Margarita - Patronne, siora Marina (26) .
Lucietta - Patronne.
Marina - Patronne, fia, patronne.
Margarita - Sior Simon, patron.
Simon - ( Rude ) Patronne.
Marina - Sior Lunardo, gnanca? Pazenzia.
Lunardo - Le reverisso. ( A Lucietta ) (Cavève) (27) .
Lucietta - (Gnanca si je me coupe, je ne m'éloigne pas).
Simon - Semo qua, sior Lunardo, pour recevoir vos grâces.
Lunardo - (Quela mata de mia muggier ancuo la me vol magnar tanto velen).
Simon - ( à Lunardo ) Mon cugnà Maurizio nol x est toujours vegnù?
Lunardo - (Figurève cossa que dira el si si Simon dans tel so cuor, un véder est cargadura (28) de mia muggier).
Marina - ( à Simon ) (Vardè che bel sixième! Nol ve bada gnanca).
Simon - ( à Marina ) Tasè là, vu; cossa gh'intreu?
Marina - ( à Simon ) Chère cette grâce!
Margarita - Allez, siora Marina, pars avec ça.
Marina - Volontiers. ( Il veut faire germer le zendale ).
Lunardo - (En colère contre Margarita ) Andè de là, siora, pour habiller la robe et el zendà.
Margarita - Loin, loin, apparais, no me magnè. Allez, siora Marina.
Lunardo - ( à Margarita ) Et despoggieve anca vu.
Margarita - ( Riant ) Est-ce que je me méprise la hanche? Que dit-elle, Siora Marina? El vol qui me despoggia. Xèlo belo my mario?
Marina - ( à Margarita ) De mi no the gh'ha à avoir suggéré.
Lunardo - ( à Margarita ) Sentìu? de quoi ghe giera, vegnimo pour dire le crédit, que tu as habillé en andriè?
Margarita - Quelle chère sœur Lunardo! Et ela, apparaissent, comment xèla vestìa?
Lunardo - Éla xè fora de casa, et vu sè in casa.
Simon - ( à Lunardo ) Anca Je me suis battu après des heures avec ce mata. Vous vouliez l'habiller d'une manière subtile. ( À Marina ) Il a renvoyé chez lui à tor el tuo cotuss (29) .
Marina - Figurève si j'envoie!
Margarita - Allons, allons-y, Siora Marina.
Marina - Vardè! gnanca si nous étions vestìe de ganzo (30) !
Margarita - I xè cusì. S'il a l'étoffe, et je ne veux pas que ça marche.
Marina - Je verrai siora Felice, alors que ce xè est habillé.
Margarita - L'avez-vous vue?
Marina - La xè stada da mi.
Margarita - Comment ça va, cara vu?
Marina - ( Avec exclamation ) Oe, en tabarin.
Margarita - En tabarin?
Marina - Et propre!
Margarita - Sentìu, sior Lunardo? Siora Felice, figurarse, le x est en tabarin.
Lunardo - Je n'entre pas dans d'autres personnes. Ve digo a vu, vegnimo pour dire le crédit, que x est une honte.
Margarita - ( à Marina ) Quelle robe gh'avévela?
Marina - Arzento à l'état sauvage (31) .
Margarita - ( à Lunardo ) Sentìu? Robe Siora Felice gh'ha en argent et vu criè, pourquoi gh'ho sto strazzeto de sea (64) ?
Lunardo - Cavèvelo, ve digo.
Margarita - Oui, eh bien, si vous y croyez. ( À Marina ) Allons, allons-y, siora Marina. Si on avait tendance à lori (65) , je metérave les petites boules (66) . Si nous pouvions entrer dans canèo (67) . J'ai des trucs, et tant que je serai zovene, j'en profiterai. ( À Lunardo ) Mais il n'y a rien d'autre; cusì le xè. ( Partie ).
Lunardo - Custìa la me vol tirar a cimento
Marina - Chère sœur Lunardo, vous devez vous sentir désolée pour elle. Le x est ambitieux; Bien sûr, il n'est pas nécessaire de le montrer à la maison, mais de l'affection, mais xè zovene: pas de gh'ha gnancora el so bon intendacchio (68) .
Simon - Tasè là-bas. Vardève vu, siora petegola.
Marina - Sinon, emmène-moi où je suis ...
Simon - Réalisé Cossa?
Marina - Voyez qui vous a amené là-bas (67) . (Ours du diable). ( Partie )
SCÈNE V
Lunardo et Simon .
Simon - Marideve, ce que goûte gh'avre de sti.
Lunardo - Ve recordeu de la prima muggier? C'était déjà une bonne créature; mais c'est une mousse!
Simon - Mais moi, compagnon bête, que je n'ai jamais pu souffrir les femmes, et dès que je vais m'enchanter avec ce diable Descaenà.
Lunardo - Le lendemain, non si se pol plus maridar.
Simon - Si tu veux mourir, si tu veux mourir, si tu es un sauveur; s'il est content de le faire, s'il est un œil.
Lunardo - Sinon, optez pour cette puta que j'ai, je vous proteste comme un galantom, nous allons dire le crédit, ce qui ne m'a pas intriguée avec les autres femmes.
Simon - Me xè est le doigt que le maridè: xè true?
Lunardo - ( Avec dédain ) Qui a ton doigt?
Simon - Mia muggier.
Lunardo - ( Avec dédain ) Comme l'aile sauvage?
Simon - Je crois que je l'ai touché.
Lunardo - Felipeto?
Simon - Oui, Felipeto.
Lunardo - Frascon, petegolo, babuin! Je sais qu'il semble qu'il le confie, et lu immédiatement et le xè va au squaquarar? Je sais que ce n'est pas le puto qui a cru à el fusse. J'étais désolée de lui avoir promis, et ça ne manquait pas, on est allé dire le mérite, ça n'a pas déchiré le contrat.
Simon - Ve n'aveu pour malade, pourquoi el ghe avait-il un doigt sur so amia?
Lunardo - Sior oui: celui qui ne connaît pas le taser, non il a la prudence, et celui qui n'a pas la prudence, aucun homme n'est maridar.
Simon - Gh'avè rason, cher vieil homme; mais d'autre part pas plus que celle de notre époque. V'arecordeu? Non s'il ne faisait ni plus ni manque de ce qu'il souhaitait.
Lunardo - Mi gh'aveva do sorele maridae: non, je pense que je les ai vus mourir (68) fois dans ma vie.
Simon - Non, il ne m'a jamais parlé avec ma jument siora.
Lunardo - Je ne sais pas cossa que c'est un opéra, une comédie.
Simon - Il m'a forcé une nuit au travail et je dors toujours.
Lunardo - Il me semble, co zera zovene, et il a dit: Vustu see el Mondo niovo (69) ? Ou est-ce que je veux que vous donniez de l'argent? Je ne parlais pas de donner de l'argent.
Simon - Et moi? les bonemans (70) , et un peu d'argent qui mâchait (71) au soleil , et j'ai fait cent ducats, et j'ai investi quatre pour cent, et j'ai quatre duchés de plus que la rue; et co scuodo (72) , gh'ho un goût cusì grando, que je ne peux pas fenir de dir. Pas de miga pour l'avarice des quatre duchés, mais gh'ho gusto de poder dir: tolè; ceux-ci, je suis parti de putelo.
Lunardo - Trovèghene un ancêtre qui a trompé cusì. Je les ai jetés, vegnimo pour dire le mérite, dans les palae (73) .
Simon - Et il fait chier les farces qu'il jette. Xè que s'il tombe d'une centaine de façons.
Lunardo - Et tout xè provoque la liberté.
Simon - Sior oui, s'il connaît la braghesse (72) par lui-même, j'ai tout de suite l'incompétence à pratiquer.
Lunardo - Et qui sauve qui enseigne? Je connais la mer.
Simon - Non, je n'ai pas dit plus: je me sentais cosse, ce qui me fait piquer les grottes.
Lunardo - Sior oui; cusì le dise: Pauvre putelo! cet el se deverta, pauvre! Voleu che el mora de mélancolie? En venant, il les appelle: Viens ici, ma chère; la varda, siora Lugrezia, ste care raìse (73) , no fàlo vogia (74) ? Si vous étiez sage avec cet esprit xè! Cànteghe cette chanson: barrages cette belle scène de Trufaldin. Pas de digo pour le dire, mais il sait tout faire: el bala, el zoga à la carte, el fait du son: el gh'ha la morosa, sàla? El dise che el se vol maridar. El x est un peu insolent, mais la pazenzie, el x est toujours putelo, el va juger. Cher colù; viens ici, ma vie; donner une base à siora Lugrezia ... Via; sporchezzi; la honte; femmes sans jugement.
Simon - Cossa che pagherave, che ghe était là pour ressentir la soif ou oto de quele femmes qui me connaissaient.
Lunardo - Cospeto de diana! Vous vous êtes gratté les yeux.
Simon - j'ai bien peur oui; et cussì, diseme: aveu serà el contrato avec Sior Maurizio?
Lunardo - Vegnì in mezà (75) de moi, que je compterai avec vous.
Simon - Mia muggier sera là avec le vôtre.
Lunardo - Pas de voleu?
Simon - Aucun ghe ne sera nissun, j'imagine.
Lunardo - Dans ma maison? Pas de vien nissun sans que je le sache.
Simon - Si tu l'as fait! De moi ce matin ... assez, pas de digo d'autre.
Lunardo - Contème ... cossa xè sta?
Simon - Andémo, andémo; Je vais compter. Des femmes, des femmes et des petites femmes.
Lunardo - Quiconque désire une femme, nous allons dire le mérite, dise mal.
Simon - ( rire et étreindre Lunardo ) Bravo de galantomo.
Lunardo - Et pourtant, si je dois dire la vérité, je ne la méprise pas.
Simon - Gnanca a mi vraiment.
Lunardo - Mais à la maison.
Simon - Et seul.
Lunardo - Et avec les portes du soir.
Simon - Et avec les balcons que j'ai cloués.
Lunardo - Et baissez -les.
Simon - Et faites-les faire à notre façon.
Lunardo - Et celui qui est omeni, doit faire cusì. ( Partie ).
Simon - Et qui ne cusì, pas de xè omeni. ( Partie ).
SCÈNE VI
Une autre pièce.
Margarita et Marina .
Marina - Fème à mon service. Il a appelé Lucieta et disémoghe qualcossa de sto so novizzo. Consolemola, et sentez-vous cossa qui sait le dire.
Margarita - Credème, Siora Marina, qui ne le mérite pas.
Marina - Pourquoi?
Margarita - Parce que x est une frascona. Je me procure pour tous les versets de contenu, et le xè avec moi, apparaît, ingrat, hautain et sophistiqué au signe du mazor.
Marina - Chère fia, tu dois sympathiser avec zoventù.
Margarita - Cossa credeu? est-ce un putela?
Marina - Quel âge avez-vous?
Margarita - Mo le gh'avà je sais disdotani fenii lu.
Marina - Eh loin (76) !
Margarita - Oui! de ce que je suis.
Marina - C'est ma neige qui ne l'a surmontée de rien.
Margarita - J'ai besoin d'être nettoyée selon l'âge.
Marina - Disè mo hip, dont el x est un bon puto.
Margarita - Si je dois dire la vérité, gnanca Lucieta no xè cativa: mais cusì; ça va aux lunes. De le volta la me strucola de caresses (77) , et de le vaire me met en colère.
Marina - Je suis les premières années de ma vie. Croyez-moi, je m'en souviens comme si c'était maintenant: hip fava cusì avec ma mère siora.
Margarita - Mais il y a une différence, vedu? Un mer pol soportar, mais pour moi non me xè gnente.
Marina - La xè fia de tuo mario.
Margarita - Giusto elo me fait passer la vogia de torme quelques pensées; parce que, si vous êtes heureux, el cria; sinon, heureux et grogne. En vérité, je ne sais plus quoi faire.
Marina - Fè de tuto qui la détruit.
Margarita - Peut-être demain.
Marina - Pas de xèli à contrato?
Margarita - Pas de fondation gh'è miga à sti omeni; je regretterai tout moment.
Marina - Et pourtant j'ai un peu de scométrie, que je peux encore arranger si je suis mariée.
Margarita - Ancuo? Par cossa?
Marina - Je sais que Sior Lunardo enviait mon cugnà Maurizio de dénouer la hanche. Pas le xis utilisé pour vous faire envie; voir ce que je me digère.
Margarita - Pol esser; mais il me semble impussible, que je ne suis pas foutu à la puta.
Marina - No saveu che zente che i xè? Je suis capable de parler du doigt au destin: tocchève la man, et bondì sioria.
Margarita - Et si la puta disesse de no?
Marina - C'est pourquoi c'est mieux que nous.
Margarita - Qui veut t'appeler?
Marina - Si vous pensez que c'est bien, appelez-le.
Margarita - Cara fia, moi reporto a vu.
Marina - Eh, chère Siora Margarita; en matière de prudence, aucun ghe x n'est le vôtre.
Margarita - Vago et vegno. ( Partie ).
Marina - Pauvre puta! Lassarghe vegnir eau sur lui cusì! Le gh'ha un fià (78) du jugement est donc maregna .
SCÈNE VII
Margarita, Lucietta et Marina .
Margarita - Viens ici, fia, que siora Marina veut te parler.
Lucietta - La compatissa, sàla, sinon je suis vegnua devant, parce que, si tu le fais, j'ai toujours peur de falar. Dans cette maison, je cata pour tout dire.
Marina - C'est vrai; votre père père x est un peu trop sutile; mais d'autre part, qu'il y avait une mer de mer qui vous aimait.
Lucietta - Siora oui. ( Il lui fait un signe de la tête avec son coude, ce qui n'est pas vrai .)
Marina - (Figurarse. Si vous aviez une assiette, vous m'auriez fait la même chose).
Margarita - (Ghe voggio bien, mais je ne peux pas attendre mes trous vagabonds dans mes yeux).
Lucietta - Et cusì, Siora Marina, cossa gh'àla da dirme?
Marina - Siora Margarita.
Margarita - Fia mia.
Marina - Diseghe vu qualcossa.
Margarita - Je vous laisse me parler.
Lucietta - Pauvre moi! De ben ou de mal?
Marina - Oh de ben, de ben.
Lucietta - Mo via donca, qui n'est pas mon idiot le plus ruiné (79) .
Marina - Je me console avec vu, Lucieta.
Lucietta - De cossa?
Marina - ( à Margarita ) Qu'est-ce que le barrage?
Margarita - ( à Marina ) Partez , il y a longtemps (80) , désengagez-vous.
Marina - ( À Lucietta ) Je me console en tant que novice.
Lucietta - ( mortifiant ) Oh oui!
Marina - Vardè! Non, tu l'as cru?
Lucietta - ( Comme ci-dessus ) Non, voyez-la.
Marina - ( Nodding Margarita ) Domandèghelo.
Lucietta - Xèla la vérité, mère siora?
Margarita - En ce qui me concerne.
Lucietta - Oh! Non ghe xè gnente de seguro (81) ?
Marina - je crois que c'est très sûr.
Lucietta - Oh, le canular, Siora Marina.
Marina - Burlo? Je sais aussi qui est ton novice.
Lucietta - Dasseno? Qui xèlo?
Marina - No savè gnente vu?
Lucietta - Non, vois-la. El me par un somio (82) .
Marina - Voulez-vous expliquer que j'ai sommeil (83) ?
Lucietta - Pas de vorla (84) ?
Margarita - Pol ess qui vous touche grâce.
Lucietta - Peut-être. ( À Marina ) Xèlo zovene?
Marina - Figureve, environ votre âge.
Lucietta - Xèlo belo?
Marina - plus difficile.
Lucietta - (Siestu benedetto!)
Margarita - Il l'a mis, encore moins, dans t'un boccon de gringola (85) .
Lucietta - ( à Margarita ) Mo loin, non, elle me mortifie. Il semble qu'elle despiasa.
Margarita - Oh, je suis trompé. Pour moi plutôt ce soir que demain.
Lucietta - Eh, je sais pourquoi.
Margarita - Disè mo.
Lucietta - Je sais, je sais que je ne peux plus le voir.
Margarita - ( à Marina ) Avez-vous entendu quelle belle façon de parler?
Marina - Via, via, chères créatures, butè en amont (86) .
Lucietta - ( In Marina ) Le barrage; nom de cossa gh'àlo?
Marina - Filipetto.
Lucietta - Oh, quel beau nom! Xèlo civil?
Marina - El x est ma neige.
Lucietta - ( embrasse gaiement Marina ) Oh sior'amia (87) ! Gh'ho si cher, sior'amia, béni soit, sior'amia.
Margarita - Vardè che stomeghezzi (88) .
Lucietta - Chère siora, la tasa, qui l'aura fait pezo de mi.
Margarita - Bien sûr, pour cette belle houe qui m'a touché (89) .
Marina - ( A Lucietta ) Dixè, fia mia. L'avez-vous déjà vu?
Lucietta - Oh, pauvre moi! Quand? Où est-ce? S'il n'y a jamais de canette ici, sinon je ne me promène jamais nulle part.
Marina - Si vous le voyez, il vous verra.
Lucietta - Dasseno? Quand vais-je le voir?
Marina - je ne sais pas; siora Margarita saura quelque chose.
Lucietta - Mère Siora, quand le verrai-je?
Margarita - Oui, oui: mère Siora, quand je le reverrai ! Quoi qu'il appuie, il le recommande. Et po, gnente gnente, le ranzigna le dessine (90) .
Lucietta - Tu sais que tu vas si bien.
Margarita - Allez-y, allez-y, mozzina.
Marina - (Wow! Le gh'ha de la malizia est tellement effrayant).
Lucietta - Le barrage, siora Marina. Xèlo fio de sior Maurizio?
Marina - Oui, fia mia et el xè est seul.
Lucietta - J'ai tellement cher. Le barrage: saralo rustego co fa so sior padre?
Marina - Oh, cet el x est si bon!
Lucietta - Mo quand le verrai-je?
Marina - Pour dire la vérité, tu as eu le goût de te voir, parce que si tu le donnes, cette elo no ve piasa a vu, ou cette vu no ghe piasè a elo?
Lucietta - Se peut-il que ce ghe piasa?
Margarita - Cossa credeu de essere, figurarse, la déesse Vénus?
Lucietta - Je ne pense pas que je suis la déesse Vénus, mais je ne crois pas que je suis l'ogre.
Margarita - (Eh, les gh'ha que je connais les cathares).
Marina - Il a entendu, Siora Margarita, je dois vous faire confiance.
Lucietta - Je peux t'entendre ?
Marina - Oui, il se sentait déjà vu. En parlant de cette boutique avec Siora Felice, vous avez fait de maraveggia que, à l'avance et la contraction, vous ne pouvez pas être vu. Il a été supprimé et l'engagement de le faire. Encore une fois, comme savè, venez ici pour dénouer, et nous nous sentirons cossa, qui le dira.
Lucietta - Propre, propre depuis le début.
Margarita - S'il est tôt pour dire propre et propre ! Et si mon Mario s'en sort? Qui a décollé, encore moins d'autres que moi?
Lucietta - Oh, au fait, tu veux qu'elle soit renforcée?
Margarita - Àlo à vendre chez elle pour el luminal (91) ?
Lucietta - Je ne sais pas. Cossa dìxela, siora Marina?
Marina - Il a entendu, je parle franchement. Mi no ghe peut blâmer Siora Margarita. Nous entendrons ce dixe siora Felice. S'il y a un danger, ça ne me dérange pas.
Lucietta - Vardè; le me in saor (92) , et po, tolè suso.
Margarita - Zito, il me semble ...
Marina - À venir.
Lucietta - Euh, si vous êtes père, je m'éloigne.
Marina - Cossa gh'aveu a peur? Omeni no ghe ne xè.
Margarita - Oh, saveu c'est qui?
Marina - Qui?
Margarita - Siora Felice dans un masque: dans un air très en colère (93) .
Lucietta - Xèla seule?
Margarita - ( A Lucietta ) Seul. Qui aimeriez-vous être patronne?
Lucietta - ( Allegra ) Allez, mère Siora, que c'est bien, que tu vas si bien.
Marina - Nous allons entendre quelque chose.
Lucietta - ( Allegra ) Nous allons entendre quelque chose.
SCÈNE VIII
Heureux en masque à bavuta, et dit .
Felice - Patron. ( Tous répondent patronne, comme d'habitude ).
Margarita - Très tard, siora Felice; il y avait un désir.
Lucietta - De diana (94) , si nous le voulions.
Heureux - Si tu l'as fait! Je vais compter.
Marina - Seul? Non gh'è gnanca votre mario?
Felice - Oh, el ghe xè ce torse de verza (95) .
Margarita - Où xèlo?
Felice - Je l'ai envoyé de ton Mario. Non, je voulais cet el vegna de qua, parce que j'ai quelque chose à te dire.
Lucietta - (Oh, si un bon Niova da Darme avait le gha!)
Felice - Saveu chi ghe xè en mezzà avec lori?
Marina - Mon mario?
Felice - Oh oui bien, mais ghe x en est un autre.
Marina - Qui?
Felice - Sior Maurizio.
Lucietta - ( Joyeusement ) (El padre del puto!)
Marina - Comment l'as-tu eu?
Felice - Mon mario, qui est aussi un tangaro, avant d'aller au milieu, voulait qu'il sache qui est déjà là, et le serviteur qui a son doigt qui est déjà Simon et Maurizio.
Marina - Cossa mai fàli?
Felice - Je me crois, voyez-vous, je crois que j'ai établi cette certaine boutique ...
Marina - Oui, oui, je comprends.
Margarita - Gh'arivo me hanche.
Lucietta - (Anca I g'arivo).
Marina - Et de cet autre intérêt gh'avemio gnente da novo?
Felice - De cet amigo?
Marina - Oui, de cet amigo.
Lucietta - (Il parle en jargon (96) , il croit qu'elle ne comprend pas).
Heureux - Podemio parle librement?
Margarita - Oui, cossa est nécessaire? Za Lucieta sait tout.
Lucietta - Oh, chère Siora Felice, si vous étiez aussi avisé que je suis obligé.
Felice - ( A Lucietta ) Mo y est allé, fia mia, que si fortunada.
Lucietta - Pour cossa?
Felice - Je n'avais jamais vu ce puto. Je vous assure qu'el x est une houe.
Lucietta - ( Il se pavane ).
Margarita - ( A Lucietta ) Tegnìve in bon, patronne (97) .
Marina - Pas idiot de dire que el est ma neige; mais el x est un puto de sesto (98) .
Lucietta - ( Comme ci-dessus ).
Margarita - ( à Lucietta ) Mais ghe vol jugement, apparais, et tu dois être aimé.
Lucietta - Co nous serons à quela (99) , je ferai ma dette.
Marina - ( à Felice ) Et qu'en est-il? Si vous les voyez sti puti?
Felice - J'espère que oui.
Lucietta - Comment? Quand, bonne siora? Quand Comment?
Felice - Puta benedeta, gh'avè plus de presse de mi.
Lucietta - Pas de vorla?
Heureux - Il a entendu. ( Planifiez les trois ) Maintenant, elle va vendre ici.
Margarita - ( Avec émerveillement ) Ici!
Felice - Siora oui, ici.
Lucietta - ( à Margarita ) Pourquoi ne pas la mettre ici?
Margarita - Tasè là, vu siora, qui ne savè ce que vous vouliez. Chère siora Felice, mon Mario le sait, c'est bien qu'aucune femo pezo (100) .
Felice - No indubité gnente. El vegnerà en masque, habillé en femme; votre mario nol cognosserà.
Marina - Oui bien, oui bien: il trouvait ça propre.
Margarita - Eh, cher siora, mon mario xè sutilo (101) ; si el encourt, apparais, pauvre moi.
Lucietta - ( Allegra a Margarita ) Pas de séntela? El viendra dans un masque.
Margarita - ( à Lucietta ) Oh allez, frasconazza.
Lucietta - ( mortifiée , à Margarita ) El vendra une robe de femme.
Felice - Credème, Siora Margarita, qui avait tort pour moi. Stè sora de mi, pas de peur. No pol far che el vegna (102) . Si el vien, ce sémo ici seul, comme ce sémo maintenant, nous allons pod pochetin ciaccolar; si el vien che semo a tola (103) , ou que ghe est votre mario, lassème do a mi. Je sais ce que j'ai à dire. Je vais voir comment je vais pod. Un œil sbrisson ne vous suffit pas?
Lucietta - ( à Felice, pathétiquement ) À sbrisson (104) ?
Margarita - Allez-vous le vendre seul?
Felice - Non, chère fia; seulement nol pol vegnir. Il a bien vu, dans un masque, habillé en femme ...
Margarita - ( à Felice ) Avec qui le donnerez-vous donca (104) ?
Felice - ( à Margarita ) Avec un forestier. ( à Marina ) Oe, avec quelo de stamatina.
Marina - je comprends.
Margarita - Imaginez, si mon mario veut être à la maison, quel manque de toux!
Felice - El viendra avec un masque de hanche.
Margarita - Pezo: non, absolument pas.
Lucietta - Mo loin, chère mère Siora, a du mal à tout. (Le x n'est qu'un caga dubi).
Margarita - Je sais ce que je creuse; et mon mario, encore moins, personne ne le connaît mieux que moi.
Felice - Il a entendu, fia mia, du tien à mon sémo là-bas. I xè tuti do taggiai in t'una moon. Mi mo, vedu? Non, je vais avoir si peur.
Margarita - Brava, sarè plus spirituelle que moi.
Lucietta - Je déteste.
Margarita - Eh, pas de retard, non.
Marina - Pauvre chose, le gh'ha el bataor dans tel cuor.
Felice - Vedè, chère Siora Margarita, qui est dans ma boutique, je n'ai ni intrar ni insir (105) . Je l'ai fait pour siora Marina et hip pour sta puta, que je soutiens bien. Mais si vous en voulez vraiment ...
Lucietta - Eh bien! Cossa dìsela?
Marina - ( à Margarita ) Oh allez, za che ghe semo.
Margarita - ( A Lucietta ) Très bien; s'il laisse quelque chose, ce sera pezo per vu.
Lucietta - ( à Margarita ) Tu l'entends? Je plaisante, ghe digo.
Margarita - Maintenant que j'ai batu.
Lucietta - Il faut dormir la culìa. J'irai.
Margarita - Siora non, siora non, j'irai. ( Partie ).
SCÈNE IX
Felice, Marina et Lucietta .
Lucietta - ( à Felice ) Cara ela, je recommande.
Felice - Pas de vorave desgustar siora Margarita.
Marina - Pas de ghe badè. Si c'était dans ela, c'est puta no if mariderave jamais.
Lucietta - Si tu pouvais!
Felice - ( à Marina ) Cossa vol dire? cossa gh'àla co est une créature?
Marina - Pas de saveu? Envie. Gh'ha touche un vieux mario, la colère gh'avà qui touche un zovène dans sa lumière.
Lucietta - J'ai bien peur que cette merde soit la vérité.
Felice - Maintenant un cossa dise, maintenant ghe dise un autre.
Marina - Se ve digo: ni gh'è ni sixième, ni modelo (106) .
Lucietta - Il ne peut rien dire de plus qu'apparaître, apparaître .
SCENE X
Margarita et dit .
Margarita - A vu, siora heureuse.
Felice - Un mi? Cossa?
Margarita - Masques qui vous demandent.
Lucietta - ( Allegra a Felice ) Des masques qui demandent!
Marina - ( à Felice ) Saralo amigo?
Felice - (à Marina ) Pol darse. ( A Margarita ) Fèlo vegnir devant.
Margarita - Et si mon Mario vient?
Felice - Si votre Mario vient, ne saurai-je pas donner un sens à Panchiana? Non, je peux dire que ma soeur est maridada à Milan? Je l'ai juste attendu de cette façon, et le pol capitar de moment en moment.
Margarita - Et le masque d'homo?
Heureux - Oh bela! Non je peux dire que el xè mon cugnà (107) ?
Margarita - Et qu'en est-il de votre Mario Cossa?
Felice - My mario, co voggio that el dam de yes, assez que varda; d'un coup d'œil, il veut dire moi.
Lucietta - Mère Siora, ghe n'àla plus?
Margarita - Cossa?
Lucietta - Quelques difficultés?
Margarita - ( à Lucietta ) Permettez-moi de dire, deboto ... allez, à tel point que la staga de la quele masque, comme la vegna de qua. Au dernier des derniers, gh'avre à penser plus que moi. ( Vers la scène ) Masques de Siore, le favorissa, vegna devant.
Lucietta - (Oh, comme moi bate el cuor!)
SCÈNE XI
Filippetto dans un masque de femme, dit le comte Riccardo .
Riccardo - Très humble serviteur de leur seigneur.
Felice - Patron, masques siore.
Margarita - ( Supporté ) Serviteur.
Marina - ( À Filippetto ) Masque de femme Siora, le reverisso.
Filippetto - ( Il fait du respect en tant que femme ).
Lucietta - (Vardè che bon sesto (108) !)
Felice - Masques, andeu in spasseti?
Riccardo - Le carnovale s'éveille en s'amusant.
Marina - Siora Lucieta, masques cossa diseu de ste?
Lucietta - ( Montrant la honte ) Cossa vorla che dama?
Filippetto - (Oh, mon cher! Oh, quel pometo da riosa) (109) .
Margarita - Masques Siore, la mauvaise création lui pardonne; àle disnà ele?
Riccardo - Non.
Margarita - En fait, nous voulions aller à Disnar.
Riccardo - Nous supprimerons les inconvénients.
Filippetto - (De diana! Non, je n'ai pas (110) vardada!)
Riccardo - ( à Filippetto ) Allez, masque de dame.
Filippetto - (Soyez malignazo!)
Marina - ( à Riccardo et Filippetto ) Eh, attendez un pochetin.
Margarita - (je sens que le satyre de mon mario recchie en toi).
Felice - ( À Filippetto ) Masque, il a entendu un mot.
Filippetto - ( s'approche de Felice ).
Felice - ( Piano a Filippetto ) Ve piàsela?
Filippetto - ( Piano a Felice ) Siora oui.
Felice - ( Comme ci-dessus ) Xèla bela?
Filippetto - ( Comme ci-dessus ) De diana!
Lucietta - (mère Siora).
Margarita - (Cossa gh'è?)
Lucietta - ( lentement à Margarita ) (Almanco qui pouvait le voir pochetin).
Margarita - (Maintenant, je vais vous appeler pour une oie, et moins loin).
Lucietta - (Pazenzia).
Marina - ( A Filippetto ) Mask.
Filippetto - ( Approches Marina )
Marina - Ve piàsela?
Filippetto - Assae.
Marina - ( à Filippetto ) Tabac Toleu, masque?
Filippetto - Siora oui.
Marina - S'il a commandé, il a servi.
Filippetto - ( Prend du tabac avec ses doigts, et veut le prendre avec le masque sur son visage )
Felice - Co se tol tabac, s'il obtient le visage. ( Il enlève son masque .)
Lucietta - (le regardant furtivement ) (Oh, co belo!)
Marina - ( Vers Filippetto ) Mo che bela puta!
Felice - Le x est ma sœur.
Lucietta - ( Riant ) (je suis un cavalier).
Filippetto - (Oh, co rit bien!)
Felice - Viens ici, garde ta bauta sous la gorge. ( Le bauta tombe .)
Lucietta - (El consola el cuor).
Marina - Qui est plus beau que ste do pute? ( Par Filippetto et Lucietta ).
Filippetto - ( Il a honte et regarde subrepticement Lucietta ).
Lucietta - ( fait de même ).
Riccardo - (je suis obligé envers Signora Felice, qui m'a aujourd'hui fait profiter de la plus belle comédie de ce monde).
Margarita - ( A Lucietta et Filippetto ) Oh allez, fenìmola, imagine, que xè maintenant. Nous ne parlons plus équivoque. Il a remercié mon seigneur, qui l'a fait en faisant de la contrebande, et a recommandé au ciel, si sarè destinai, ve torè (111) .
Felice - Via andè, masques; heureux qu'il l'ait fait pour l'instant.
Filippetto - (Mi no me so destaccar).
Lucietta - (El me enlève le cœur).
Margarita - Je regrette que le x se passe bien.
Marina - ( à Filippetto ) Tireve sur la bauta.
Filippetto - Comment ça marche? Je n'ai aucune pratique.
Felice - Viens ici pour moi. ( Accueille le bauta ).
Lucietta - ( Riant fort ) (Pauvre gars! Non s'il peut justifier la bauta).
Filippetto - ( A Lucietta ) Me bùrlela?
Lucietta - ( riant ) Pas moi.
Filippetto - intelligent!
Lucietta - (Cher colù) (112) .
Margarita - Oh, pauvre fille! Oh, pauvre moi!
Felice - Coss'è sta.
Margarita - Ve mario ici.
Marina - Oui pour Diana: la hanche et la mienne.
Felice - Non, ma sœur?
Margarita - Eh, chère Ela, si tu me trouves dans le busia, pauvre moi. ( À Filippetto, le poussant ) Bientôt, bientôt, il scondève, est allé dans cette chambre. ( À Riccardo ) Cher sior, il erre là-bas.
Riccardo - Quelle est cette tricherie?
Felice - Errant, errant, sœur Ricardo. Le fazza est la grâce.
Riccardo - Je ferai aussi cela pour vous plaire. ( Entrez dans une pièce )
Filippetto - (j'espionnerai en attendant). ( Entrez dans une pièce )
Lucietta - (Mes jambes tremblent, ce que je ne peux plus faire).
Margarita - ( à Felice et Marina ) Avez-vous un doigt?
Marina - ( à Margarita ) Petit à petit, pas de xè gnente.
Felice - Co nous irons à disnar, je vais le battre (113) .
Margarita - Son stada tropo minchiona.
SCÈNE XII
Lunardo, Simon, Canciano et dit .
Lunardo - Oh, patron, xèle stuffe d'aspetar? Nous allons maintenant aller à Disnar. Nous attendrons sœur Maurizio, et aussitôt cet el vien, nous irons à dénouer.
Margarita - Pas de ghe gierelo sior Maurizio?
Lunardo - El ghe giera. El xè ira à un service, et el reviendra maintenant. ( À Lucietta ) Cossa gh'àstu ti, che ti par me sbattueta (114) ?
Lucietta - Gnente. Voulez-vous qu'il s'éloigne?
Lunardo - Non non, reste ici, sois à moi, cette hanche pour toi est vegnù la to zornada: est-ce vrai, Sior Simon?
Simon - Pauvre! Gh'ho a caro.
Lunardo - ( à Canciano ) Ah! Cossa diseu?
Canciano - Oui, en vérité, il le mérite.
Lucietta - (No vol volar via I'm shaking) (115) .
Felice - Y a-t-il quelque chose de nouveau, sœur Lunardo?
Lunardo - Siora oui.
Marina - Via, que nous connaissions également nu.
Margarita - ( à Lunardo ) Za je serai le dernier à savoir.
Lunardo - Il a entendu, fia, ancuo disè ce qu'il voulait, qu'aucun gh'ho voggia de criar. Je suis heureux et je le soutiens si nous apprécions. Lucieta, viens ici.
Lucietta - ( s'approche en tremblant ).
Lunardo - Cossa gh'àstu?
Lucietta - ( tremblante ) Je ne sais pas me gnanca.
Lunardo - Gh'astu la freve (116) ? Écoutez, elle s'en remettra. En présence de mon muggier, qui agit comme votre mer, en présence de ce galantomeni, et je vous connais, je vous donne la niova qui est nouvelle pour vous.
Lucietta - (Elle tremble, pleure et tombe presque ).
Lunardo - Olà, olà, cossa fastu? Vous at-il méprisé, qu'est-ce qui vous a rendu novice?
Lucietta - Sior no.
Lunardo - Sastu qui xè el à novizzo?
Lucietta - Sior oui.
Lunardo - (avec dédain ) Le savez-vous? Comment le sastu? Qui vous a touché?
Lucietta - Sior non, je ne sais pas. La compatissa, que je ne connais pas cossa ce barrage.
Lunardo - ( A Simon et Canciano ) Ah! Pauvre inocente! Alors le xè arlevada, vedu?
Felice - ( Piano a Margarita ) (Se el savesse tuto).
Margarita - ( à Felice ) (je suis inspiré (117) qui le sait).
Marina - ( à Margarita ) (Non, il y a un danger).
Lunardo - Allez, tu sais que el so novizzo xè el fio de sior Maurizio, nevodo de siora Marina.
Marina - Dasseno? Ma neige?
Felice - Oh, cossa that contè!
Marina - Mo gh'ho ben a caro, dasseno.
Felice - De meggio no podevi trovar.
Marina - Quand l'épouserez-vous?
Lunardo - Ancuo.
Margarita - Ancuo?
Lunardo - Sior oui, ancuo, maintenant. Sior Maurizio xè rentre chez lui; el xè montera (118) donc fio, el mena qui; disnemo ensemble, et peu immédiatement s'il donne la main (119) .
Margarita - (Oh, pauvre fille!)
Felice - Cusì à l'invite?
Lunardo - Mi no voggio brui longhi (120) .
Lucietta - (Maintenant je tremble mes salopes) (121) .
Lunardo - ( A Lucietta ) Cossa gh'astu?
Lucietta - Gnente.
SCÈNE XIII
Maurizio et dictons .
Lunardo - ( à Maurizio ) Oh loin; seu qua?
Maurizio - ( Troublé ) Je suis là.
Lunardo - Cossa gh'aveu?
Maurizio - Son fora de mi.
Lunardo - Qu'est-ce qu'il y a?
Maurizio - Fils rentre à la maison, je cherche el puto. Non, je l'ai trouvé dans Nissun Liogo. J'ai demandé, je suis informé, c'est mon doigt qu'on le voit en compagnie d'une certaine sœur Riccardo, qui pratique Siora Felice. ( À Felice ) Qui suis-je forestier? Cossa gh'ìntrelo avec mon fio?
Felice - Je ne connais pas ta foi. Mais à propos du forestier, el x est un Cavalier honoré. Est-ce vrai, sœur Cancian?
Canciano - Je ne sais pas qui il est et je ne sais pas qui l'a envoyé. Jusqu'à présent, j'ai envoyé des bouches amères, pour me contenter, pas pour pleurer; mais maintenant je digère que je ne vis plus pour ma maison. Siora oui, el sera un fa pele (122) .
SCÈNE XIV
Riccardo et dictons; puis Filippetto .
Riccardo - ( à Canciano ) Parlez mieux que les chevaliers d'honneur.
Lunardo - ( à Riccardo ) Dans ma maison?
Maurizio - ( à Riccardo ) Où est mon bourgeon?
Riccardo - ( à Maurizio ) Votre fils est là-dedans.
Lunardo - Réduction dans la chambre?
Maurizio - Où est-ce, desgrazià?
Filippetto - ( s'agenouille ) Ah, mon père, s'il te plaît.
Lucietta - ( s'agenouille ) Ah, mon père, par pitié.
Margarita - (se recommandant ) Mario, je ne sais pas, mario.
Lunardo - Je te paierai, desgraziada. (Il veut donner Margarita ).
Margarita - Agiuto.
Marina - Tegnìlo.
Filippetto - Fermèlo.
Simon - Reste stable.
Canciano - Pas de fè. ( Simon et Canciano traînent à Lunardo et partent en trois )
Maurizio - ( prend le bras Filippetto ) Viens ici, viens ici, malin.
Margarita - ( prend un bras Lucietta ) Il est allé ici, frasconazza.
Maurizio - (le tire ) Allez.
Margarita - (la tire ) Il est parti avec moi.
Maurizio - ( à Filippetto ) Chez nous, nous le justifierons.
Margarita - ( A Lucietta ) À cause de toi.
Filippetto - ( Partant, salue Lucietta ).
Lucietta - ( Partant, il se frappe ).
Filippetto - Pauvre chose!
Lucietta - Son desperada.
Maurizio - Partez d'ici. ( Il le chasse et ils partent ).
Margarita - Soyez maudit car je suis vegnua dans cette maison. (Il commence à pousser Lucietta .)
Marina - Oh quel murmure, oh quel diable! Pauvre puta, pauvre ma neige! ( Partie ).
Riccardo - Dans quel problème m'avez-vous mis, madame?
Felice - Xèlo Cavalier?
Riccardo - Pourquoi me posez-vous cette question?
Felice - Xèlo Cavalier?
Riccardo - Je me vante d'un tel être.
Felice - Donca, qui le vend avec moi.
Riccardo - Dans quel but?
Felice - Je suis une femme honorée. J'ai des feux de joie et ghe vòi remediar.
Riccardo - Mais comment?
Felice - Comment, comment! Si ghe digo el come, xè comédie. Andemo. ( Ils partent ).
ACTE TROIS
SCÈNE I
Camera di Lunardo.
Lunardo, Canciano et Simon.
Lunardo - Se trata de onor, se trata, vegnimo de dire, de reputazion de casa mia. Un homme de mon destin. Cossa direz-vous de mi? Cossa direz-vous de Lunardo Cròzzola?
Simon - Quietève, cher ami. Vu no ghe n'avè culpabilité. Xis cause les femmes; castighèle (1) , et tout le monde vous louera.
Canciano - Oui bien, il faut donner un exemple. Nous devons humilier l'arrogance de ste muggier cusì altiere et apprendre aux homènes à les châtier.
Simon - Et que le barrage cependant, que je rouille toujours.
Canciano - Et que le barrage que je garde toujours.
Lunardo - Mia muggier xè causa de tuto.
Simon - Castighèla.
Lunardo - Et quela frasconazza, la ghe tien drio.
Canciano - Mortifichèla.
Lunardo - ( à Canciano ) Et ton troisième le plus lourd.
Canciano - Je vous châtierai.
Lunardo - ( à Simon ) Et le vôtre sera d'accord.
Simon - Ma hanche me paiera.
Lunardo - Chers amis, parlons-en, consegiemose. Avec custìe (2) , vegnimo pour dire le crédit, cossa avemio da fare? C'est facile pour puta x, et je pense, et j'ai une écurie. Prima de tuto, en amont du mariage (3) . Plus jamais, qui ne le parle pas de maridarse. Je t'enverrai au sérar à t'un liogo (4) , loin du monde, entre quatre murs, et le xè fenìa. Mais vais-je les mourir en tant qu'avigmi de Castigar? Disè votre opinion.
Canciano - En fait, j'avoue la vérité: je suis un pochetin intrigà.
Simon - Si vous pouviez les coller (5) hanche dans un retrait entre quatre murs, et droitier vous le pourriez.
Lunardo - Pour le moins, cela aurait été une punition plus pour nu que pour ele. Vous devez dépenser, payer les frais, leur envoyer des vêtements avec un peu de nettoyage, et pour retirer cette staga, vous les aurez toujours là-bas drasso plus de plaisir et plus de liberté, que de ne pas les avoir dans notre maison. ( A Simon ) Pàrlio ben (6) ?
Simon - C'était bien. Surtout de vu et mi, que nous ne laisserons pas la brena (7) sur le colo comme le mien apparaît Cancian.
Canciano - Cossa voleu ce barrage? Gh'avè rason. Nous pourrions tegnirle à la maison, serae dans la salle de thon; conduisez-les un peu à la fête avec nu, puis revenez au sérar, et que personne ne les verrait, et que personne ne leur parlerait.
Simon - Femmes Serae? Sans parler à Nissun? Ce x est une punition qui les fait craquer en trois jours.
Canciano - Tant pis.
Lunardo - Mais qui est cet homme qui veut faire l'aguzin? et si les parents le savent, ils le font et le diable, les destinations dans la moitié du monde, ils vous font le retirer, et ils vous disent toujours que c'est un ours, que c'est un tangaro, que c'est une canette.
Simon - Et co avè molà (8) , ou par amour ou pour engagement, ve ve la man, et non plus paron de criarghe.
Canciano - Giusto cusì a fait avec mi mia muggier.
Lunardo - La vraie saria, disons le mérite, d'utiliser un morceau de bois.
Simon - Oui, galantomo et lassar ce barrage zente (9) .
Canciano - Et s'il se révolte contre lui?
Simon - Se poderave dar, savè (10) .
Canciano - Je sais ce que je digère.
Lunardo - Dans ce cas, si nous trouvons dans un procès brutal.
Simon - Et alors? Pas de saveu? Ghe ne xè de l'omeni qui colle je sais muggier, mais croyez-vous que gnanca pour cela je peux domar? Oibò (11) ! Il les rend pezo (12) plus que jamais; il le fait par despeto; sinon je les copa, pas de remède gh'è.
Lunardo - Coparle peu no.
Canciano - Mo non, bien sûr. Parce que po, vòltela, ménela (13) , sans femmes non si pol star.
Simon - Mo non sera un contentement, avoir un bon agresseur calme, obéissant? Ne serait-ce pas une consolation?
Lunardo - J'ai essayé une fois. Ma première, pauvre chose, est déjà un agneau. Cette? Le x est un basilic.
Canciano - Et le mien? Tuto a so vol.
Simon - Et je pleure, rugis, et pas de fou du tout.
Lunardo - Tuto est mauvais, mais une douleur qui si pol soportar; mais au cas où je le serais maintenant, nous allons dire le mérite, si trata de assae. Voria ressolver, et je ne sais pas quoi faire.
Simon - Mandèla de parents.
Lunardo - Bien sûr! Alors que le smatar me fazza (14) .
Forums de Canciano - Mandèla (15) . Fèla soit à la campagne.
Lunardo - Pezo! Le moi consomme l'intrae (16) en quatre zorni.
Simon - Feghe parlar; il en trouva, que le but était d'avoir.
Lunardo - Eh! Je ne l'écoute pas.
Canciano - Il a essayé d'habiller les vêtements, de serarghe la zoggie, de la baisser; mortifichèla.
Lunardo - j'essaie; s'il fait pezo que jamais.
Simon - je comprends; fè cusì, apparaît.
Lunardo - Comment?
Simon - Godèvela, comme ce xè.
Canciano - J'ai également pensé qu'il n'y a pas d'autre remède que celui-ci.
Lunardo - Oui, j'ai compris que x est une pièce. Je vois aussi qu'avec la fée, plus de remède. J'avais du réconfort et mon estomac pour dormir sur elle; mais celui-ci me l'a fait, le x est trop grand. Ruvinarme una puta de quela sorte? Farghe vegnir el moroso à la maison? Il est vrai qu'il m'avait destiné à Mario, mais cossa savévela, dirons-nous mon intention? Gh'ho donne une raison (17) de le faire mariner. Mais pas moi podevio pentir? Non s'il pouvait donner ce non si nous avions raison? N'était-il pas possible de continuer pendant des mois et des années? Et m'a introduit dans la maison? Masqué? De Scondon (18) ? Cela me fait-il voir? Cela vous fait-il parler? Mon puta? Une colombe inocente? Non, ça ne me dérange pas; vòi castigar, voi mortificar, s'il croyait, allons dire le crédit, précipité.
Simon - Parce que la siora est heureuse.
Lunardo - ( à Canciano ) Oui, cause ce mata de tua muggier.
Canciano - Gh'avè rason. Mia muggier me paiera.
SCÈNE II
Felice et dictons .
Felice - Patrons vénérés, merci pour la gentillesse.
Canciano - Cossa feu qua?
Lunardo - Voulez-vous Cossa dans ma maison?
Simon - Xèla ici, pour faire apparaître une autre belle scène?
Felice - Si tu étais surpris parce que je suis là? Vouliez-vous qu'il s'en aille? Croyez-moi, sœur Cancian, que se passait-il avec le forestier?
Canciano - Si je vais plus avec lui, je vous ferai voir qui je suis.
Felice - Diseme, cher vieil homme, ghe songio ne va jamais sans vu?
Canciano - La sarave bela!
Felice - Sans être vu, l'oggio (19) rentrerait-il jamais chez lui?
Canciano - Ghe aussi ça manque!
Felice - Et pourquoi pensais-tu quea allait avec elo?
Canciano - Parce que c'est un mata.
Felice - (El fa el bravo, car el xè en compagnie).
Simon - ( Piano a Lunardo ) (Oe, le gh'ha filo) (20) .
Lunardo - ( Piano a Simon ) (El fait bien de montrer le visage).
Canciano - Andémo, siora, est rentré chez moi avec moi.
Felice - Abiè un pocheto de flema.
Canciano - Me maraveggio that gh'abiè so museau de vegnir qua.
Felice - Pour cossa? Le destin de Cossa òggio?
Canciano - No me fè parlar.
Felice - Il a parlé.
Canciano - Nous partirons.
Felice - Sior no.
Canciano - (la menaçant ) Andemo, che cospeto de diana ...
Felice - Cospeto, cospeto ... Je sais que cospetizar me hanche. Qu'est-ce, sior? M'aveu trouvera-t-il en vous un chat (21) ? Songio votre massera? Et si elle parle à une femme civilisée? Je suis ton plus lourd; me podè comandar, mais non me vòi (22) lassar scramble. Je ne te perds pas et je te rejette, et tu ne veux pas me perdre. Et après mon mario, aucun m'avè ne parle plus jamais de cette façon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cossa xè je lève la main? Pour me manipuler? À une femme de mon destin? Disè, sior Cancian, vous êtes-vous installé comme mécène? V'àli m'a conseillé de vous traiter de cette façon? Ste asenarie the aveu imparade de lori? Si c'est un galantomo, tratè de ce que c'est, si j'ai falà, corezème (23) ; mais pas s'il se bouscule, et non s'il souffle, et non s'il le regarde, et non s'il traite Cusì. Ai-je bien compris, Sior Cancian? Abiè jugement vu, s'il voulait que je l'ait aussi.
Canciano - ( reste stupéfait )
Simon - ( à Lunardo ) (Aveu sentio che collola (24) ?)
Lunardo - ( A Simon ) (Maintenant je viens voggia de chiaparla moi pour el colo. Et ce marteau (25) est zito).
Simon - (Cossa voleu che el fazza? Voleu che el précipita?)
Felice - Allez, sœur Cancian, n'est-ce pas la créatrice?
Canciano - Qui a plus de jugement et de travail (26) .
Heureux - Jugement de Ciceron! Cossa dìsele ele, patroni?
Lunardo - Cher siora, non moi fè parle.
Felice - Pourquoi? Je suis vegnua exprès, de sorte qu'il a parlé; Je sais que vous vous êtes plaint auprès de moi et j'ai le goût d'entendre vos plaintes. Il a venté avec moi, sœur Lunardo, mais il n'est pas à un mètre de mon Mario. Parce que, si vous me dites vos rasons, je suis une belle femme, et si je me trompe, je serai prêt à vous donner satisfaction; mais arecordeve ben, cette désunion el mètre entre mario et muggier el x est l'un de ces maux, qui s'il était juste, il a facilement causé, et ce que je ne voulais pas que les autres fassent avec vu Je m'entretiens également avec sœur Simon, qui avec costume je connais la prudence et sait jouer le rôle du diable co (27) . Je parle avec tout le monde que je donne (28) , et je vous parle sincèrement, parce que vous m'avez compris. Je suis une femme d'honneur, et si gh'avè qualcossa, parlait.
Lunardo - Diseme, cher siora, qui est là, qui a fait ce puto vegnir dans ma maison?
Felice - Son stada mi. Je suis stada, qui l'a fait vegnir.
Lunardo - Brava, siora!
Simon - Propre!
Canciano - Lodève, qui a fait du bon boulot!
Felice - je ne me loue pas; Je sais que c'était encore pire qu'il ne l'ait pas fait; mais non le x est une mauvaise action.
Lunardo - Qui vous donne la licence, qui le fait vegnir?
Felice - Votre muggier.
Lunardo - Mia muggier? V'àla parle-t-il? V'àla prie? Xèla vegnua ela pour vous dire que le menu (29) ?
Felice - Sior non; Marina l'a pointé du doigt.
Simon - Mia muggier?
Felice - Votre muggier.
Simon - Àla prega ela el forestier, qui est devenu troisième (30) à quela puta?
Felice - Sior non, el forestier je te prie.
Canciano - ( Avec dédain ) Vu avè pregà?
Felice - ( à Canciano, avec dédain ) Sior oui, moi.
Canciano - (Oh quelle bête! Pas de par pol!)
Lunardo - Mo pourquoi faire cossa? Mo pourquoi le conduire? Mo pourquoi siora Marina intrigà n'àla? Pourquoi mon muggier s'àla contentà?
Felice - Mo parce que ça, mo parce que d'autres choses! Ascoltème; senti l'histoire comme ce xè. Lassème dir; non, il m'a arrêté. Si je me trompe, je me tromperai; et si j'ai rason, donnez-moi rason. Prima de tuto, là-haut, patrons, qui endiguent un cossa. Non, il est entré dans le choléra, et il n'y en a pas besoin. Soi trop trope; si trop économiseur. De la manière qui a tourné avec les femmes, avec le muggier, avec la fia, le x est cusì des forums extravagants de l'ordinaire, que vous ne voudrez plus jamais aimer; par la force, il leur obéissait, s'il les mortifiait avec du rason, et ne les considérait ni mers, ni pères, mais tartares, ours et aguzini. Nous allons au destin. (Non vegnimo pour dire le crédit, nous arrivons au destin). Sior Lunardo vol maridar Je le connais pur, sans le savoir, sans le savoir; non il l'a vu; piasa, ou pas piasa, l'a de tor. Je suis également d'accord, que le pute ne va pas bien que l'amour fazza, qu'el mario ghe doit trouver son père si sior, et qu'il doit obéir, mais pas xè mo gnanca juste de mètre à la fie a lazzo al colo, et dites: vous l'avez de tior. ( A Lunardo ) Gh'avè a fia seul, et gh'avè cuor de sacrificarlo? Mo el puto x est un puto de sesto, el xè bon, el xè zovene, nol xè bruto, el ghe piaserà. Seu seguro, vegnimo pour dire le crédit , ce piaser el gh'abia? Et si tu ne sais pas? Une puta arlevada à la casalina avec un mario fio d'un semble salvadego, sur votre chemin (31) , quelle vie devra-t-il faire? Oui, oui, nous avons bien fait de le laisser voir. Votre agresseur le voulait, mais non, elle avait le courage. Siora Marina m'est recommandée. Je me suis retrouvé l'invention du masque, j'ai prié le forestier. Je m'ha visto, je m'ha piasso (32) , je suis heureux. Si je devais être plus silencieux, plus consolé. Xyour muggier est compatible, Marina mérite des éloges. J'ai travaillé pour bon cœur. Si seni omeni, persuader, se sè tangheri, sodisfeve. Puta x est honnête, el puto no a falà; à d'autres égards, les femmes d'honneur. Je fenìo le tiens; il loua le mariage et eut pitié de l'avocat (33) .
Lunardo, Simon et Cancian se regardent sans parler.
Felice - (j'ai mis le sac, mais avec rason).
Lunardo - Cossa diseu, sior Simon?
Simon - Mi, si ça ne tenait qu'à moi, lauderave (34) .
Canciano - Gnanca mi no ghe vago à tel verde (35) .
Lunardo - Et pourtant je crains que nous devions taguer (36) .
Felice - Pour cossa?
Lunardo - Parce que el père del puto, nous allons dire le crédit ...
Felice - Disons au crédit , au père du puto xè va lui parler, Comte, el xè dans un engagement que si fazza je suis mariage, car el dise que inocemment el xè est dû à elo de sti chuchotement, et el s'il appelle il fera face, et el vol est satisfaction; el x est un homme de garbo, el x est un homme qui parle bien, et je suis sûr que Sior Maurizio ne pourra pas dire de non.
Lunardo - Cossa devais-je faire?
Simon - Cher amigo, de tout ce que nous y avons pensé, aucun ghe x n'est le meilleur. Tor coosse comme il vient.
Lunardo - Et l'affront?
Felice - Quel affront? Co el xè mario (37) , xè fenìo l'affront.
Canciano - Il a entendu, Sior Lunardo; siora Felice gh'ha hip et connaître ses faiblesses, mais à vrai dire, parfois le x est une dame de grâce.
Felice - C'est vrai, sœur Cancian?
Lunardo - Mo via, cossa avemio da fare?
Simon - Prima de tuto, dis-moi d'aller dénouer.
Canciano - Pour le dire, il semblait que el disnar s'avesse desmentegà (38) .
Felice - Eh, qui l'a commandé, no xè alocco (39) . El l'a suspendu, mais il ne partira pas en fumée. Fè cusì, Sior Lunardo, s'il voulait le magnemo in pase: il a envoyé chercher votre muggier, votre fia, pour déguiser du cossa, grommeler comme d'habitude un peu de pochetin, mais un peu de phényme; nous attendrons que sœur Riccardo vienne, et s'il vient el puto, il flirtera.
Lunardo - Si mon muggier et ma fia viennent ici, j'ai peur de no poderme tegnir.
Felice - Loin, sfogheve, gh'avè rason. Seu contento cusì?
Canciano - Appelons-les.
Simon - Anca mia muggier.
Felice - Mi, mi: m'attendait. (Il commence à courir )
SCÈNE III
Lunardo, Canciano et Simon .
Lunardo - ( à Canciano ) Un grand bavardage a votre esprit.
Canciano - Vedeu! non disè donca que je suis un marteau, si parfois je me lèche par le nez. Si je creuse un peu, le moi fait un renga , et je me vante (40) .
Simon - Grandes femmes! De toute façon, je voulais qu'elle connaisse son chemin.
Lunardo - Dès que je vous parle, vous ne vous êtes jamais trompé.
SCÈNE IV
Felice, Marina, Margarita, Lucietta et dictons .
Felice - ( à Lunardo ) Vèle ici, velè ici. Pitié, contrit et demande pardon.
Lunardo - ( à Margarita ) Si tu me rends branché?
Felice - ( à Lunardo ) Non, ce n'est pas de ma faute, je suis la cause.
Lunardo - ( A Lucietta ) Cossa meriteressistu, frasconcela!
Felice - ( à Lunardo ) Il m'a parlé, je vais te répondre.
Lunardo - ( à Margarita et Lucietta ) Les omeni dans la maison? Les remises d'arriérés?
Felice - ( à Lunardo ) Criè co mi, qui me sont dus.
Lunardo - ( à Felice ) Andève pour faire un quart de hanche.
Felice - ( à Lunardo, se moquant de lui ) Vegnimo pour dire le mérite ...
Canciano - ( à Lunardo ) Comment parler à mon agresseur?
Lunardo - ( A Cancian ) Cher vu, compatime. Son fora de mi.
Margarita - ( mortifiée )
Lucietta - ( pleurer )
Margarita - Siora Felice. Cossa n'aveu doigt? Le x est-il correct?
Simon - ( à Marina ) Anca vu, siora, tu méritais ta part.
Marina - Je parle de (41) et je m'éloigne.
Felice - Non, non, fermève. Le pauvre Sior Lunardo ghe giera aura un peu de choléra dans son corps: il voulait des fora butala (42) . Du reste el ve excuses, el vous pardonne, et si cela vient el puto, el se contentera que je me marie; Est-ce vrai, Sior Lunardo?
Lunardo - ( Rough ) Siora oui, siora oui.
Margarita - Cher Mario, si tu savais combien de passion je ressens! Croyez-moi, pas de saveva gnente. Co xè vegnù ces masques, personne ne voulait les laisser vegnir. Xè sta ... xè sta ...
Felice - Allez, je suis stada mi, cossa ocore?
Marina - ( Piano a Lucietta ) (Diseghe anca vu qualcossa).
Lucietta - Chère soeur Père, je demande pardon. Je n'en suis pas coupable ...
Felice - Son stada mi, ve digo, son stada mi.
Marina - Pour dire la vérité, j'ai ma part de crédit.
Simon - ( à Marina, avec ironie ) Eh, savemo qui est une dame d'esprit.
Marina - Plus de vu bien sûr.
Felice - ( Observant entre les scènes ) Qui est-ce?
Margarita - ( à Felice ) Oe, i xè lori (43) .
Lucietta - ( En soi, heureuse ) (El mio novizzo).
Lunardo - ( Aux femmes ) Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Qui arrive? Omeni? Andè via de qua.
Felice - Vardè! Cossa femio? Aviez-vous peur que l'omeni ne magna? Pas de quart de graine? Non ghe seu vu? Lassè i vegna.
Lunardo - Comandeu vu, patronne?
Felice - Commandez-moi.
Lunardo - Je ne soutiens pas ce forestier. Si el vegnò elo, je m'en irai.
Felice - Mo pourquoi nol voleu? El x est un gentleman honoré.
Lunardo - Que el ce qui est vol, je ne le soutiens pas. Mia muggier et mia fia no le xè utilisent pour voir nissun.
Felice - Eh, pour le moment tu seras pazenzia, c'est vrai, fie?
Margarita - Oh oui je le fais.
Lucietta - Oh, branle-moi.
Lunardo - ( Burlandole ) Oui, la hanche, oui. ( À Felice ) Je digère que je ne le supporte pas.
Felice - (Mo quel ours, mo quel satyre!) Il a attendu et attendu, que je le fasse rester à drio (44) . ( S'approche de la scène )
Lucietta - (Eh, je m'en fiche. Celui qui paie suffit).
DERNIÈRE SCÈNE
Maurizio, Filippetto et dictons .
Maurizio - ( Supporté ) Patrons.
Lunardo - ( Brusco ) Sioria.
Filippetto - ( salue furtivement Lucietta. Maurizio le regarde. Filippetto prétend que ce n'est rien ).
Felice - Sior Maurizio, aveu savesto comment le xè stada?
Maurizio - Je ne pense pas à ce qui est maintenant, je pense à ce que cela doit être pour l'avoir. Cossa dise sior Lunardo?
Lunardo - Je digo cusì, vegnimo pour dire le mérite, que le fioi, avec le xè bien élevé, non je rentre dans le masque, et non je rentre dans la maison, vegnimo pour dire el mérite, du pute civil.
Maurizio - Gh'avè rason! ( À Filippetto ) Nous partirons d'ici.
Lucietta - ( pleurant fort )
Lunardo - Desgraziada! quel xè suis fifar (45) ?
Felice - Mo ve digo la vérité, sœur Lunardo, disons le mérite , que x est une honte. Seu omo ou seu putelo? Disè, desdisè, ve muè (46) co zirandole (47) .
Marina - ( à Lunardo ) Vardè quels sixièmes! Non ghe l'a promis? No aveu serà el contrato? Cossa xè stà? cossa x est arrivé? Ve alà menada loin? V'àlo sort le déshonneur à la casa? Coss'è sti putelezzi? Cossa xè ste grimaces? Curmudgeons Cossa xè sti?
Margarita - (à Lunardo ) Ghe voggio mo intrar hip Je suis dans la boutique. Oui, oui, il m'a méprisé qu'il élit; il a mal fait vegnir; mais avec le gh'ha il donne la main, pas de xè fenìo tuto? Jusqu'à un certain point, je l'ai laissé me dépasser, mais maintenant je suis digo, oui, oui, il l'a à tor, et il doit se marier.
Lunardo - Che el la toga, che el la sposa, che el se destriga: son stuffo; Je ne peux plus.
Lucietta et Filippetto - ( Ils sautent de joie )
Maurizio - ( à Lunardo ) Comment est-il en colère de se marier?
Felice - Si el xèrarara, je connais le mal. Nol l'a pour l'épouser.
Margarita - Allez, Sior Lunardo, tu veux que je poignarde l'homme?
Lunardo - Attendez un pochetin. Lassè, qui me dose le choléra.
Margarita - ( à Lunardo ) Allez , cher Mario, je suis désolé. Je connais votre tempérament: si vous êtes un gentleman, si vous aimez, si vous avez bon cœur; mais, encore moins, il est un peu sutile (48) . Cette fois gh'avè anca rason: mais finalement autant votre fia que moi, nous avons demandé pardon. Credème, que redur une femme au pas, ghe vol assae. Mais je le baise, parce que je vis bien, parce que je vis bien dans le puta, même si je ne suis pas d'accord avec lui ou pas. Pour ela, pour vu, tu me grottes tout ce que j'ai; sparzerave el blood pour le pase de sta fameggia; contentè est puta, quieteve vu, salvè la réputation de la maison, et si je ne mérite pas ton amour, pazenzia, ce sera de mi ce que fera mon mario, mon destin ou ma mauvaise desgrazia.
Lucietta - ( Pleurs ) Chère mère Siora, oui, bénis, je vous demande de pardonner même ce que j'ai doigter, et ce que je l' ai fait.
Filippetto - (Le moi est un pianzer hip me).
Lunardo - ( s'essuie les yeux )
Canciano - ( à Lunardo ) Vedeu, sior Lunardo? Co cusì, pas si se pol tegnir.
Simon - Dans suma (49) , avec des os ou des cations, il fait tout ça vol.
Felice - Et toi, soeur Lunardo? ...
Lunardo - ( Avec dédain ) Attendez.
Felice - (Mo che zoggia!)
Lunardo - ( Amoureusement ) Lucieta.
Lucietta - Sior.
Lunardo - Viens ici.
Lucietta - ( s'approche beau ) Vegno.
Lunardo - Te vustu maridar?
Lucietta - ( Elle a honte et ne répond pas )
Lunardo - ( Avec dédain ) Allez , réponds, te vustu maridar?
Lucietta - ( Forte, tremblante ) Sior oui, sior oui.
Lunardo - Vous a-t-il vu ah, el novizzo?
Lucietta - Sior oui.
Lunardo - Sior Maurizio.
Maurizio - ( Rugueux ) Cossa gh'è?
Lunardo - Allez, cher vieil homme, no me respondè, vegnimo pour dire le crédit, cusì rustego.
Maurizio - Disè malgré ce que tu voulais dire.
Lunardo - Sinon gh'avè gnente contraire, ma fia xè pour ton fio. ( Les deux époux se réjouissent ).
Maurizio - Je n'en vaut pas la peine.
Filippetto - ( Dans l'air à recommander ) Père Sior ...
Maurizio - ( Sans regarder Filippetto ) Faire une action du destin?
Filippetto - ( Comme ci-dessus ) Père Sior ...
Maurizio - Non, je veux le marier.
Filippetto - ( La moitié vacillante s'est évanouie) Oh, pauvre moi!
Lucietta - Tegnìlo, tegnìlo (50) .
Felice - ( à Maurizio ) Mo via, che cuor gh'aveu (51) ?
Lunardo - El fait bien de le mortifier.
Maurizio - ( à Filippetto ) Viens ici.
Filippetto - Je suis ici.
Maurizio - Xèstu se repent de ce qu'il vous a fait?
Filippetto - Oui, oui, eh bien, oui, père.
Maurizio - Varda ben, que même si vous vous mariez, je vois que vous m'utilisez la même obéissance, et que vous dépendez de moi.
Filippetto - Sior, oui, je lui promets.
Maurizio - Viens ici, siora Lucieta, je t'accepte par la fia; et vous, et le ciel vous a bénis; daghe la man.
Filippetto - ( à Simon ) Comment ça marche?
Felice - Allez, deghe la man; Cusi.
Margarita - (Pauvre gars!)
Lunardo - ( s'essuie les yeux )
Margarita - Sior Simon, sior Cancian, sarè vu i compari (52) .
Canciano - Siora oui semo qua, témoins semo.
Simon - Et avec le gh 'aura un putelo?
Filippetto - ( rires et sauts )
Lucietta - ( Elle a honte )
Lunardo - O via, puti, stè aliegri. C'est maintenant que nous sommes allés dénouer.
Felice - Disè, chère sœur Lunardo, ce forestier qui pour moi vous attend, vous semble-t-il opportun de le renvoyer? El xè parle à sœur Maurizio, et il l'a fait vegnir qui elo. La civilisation n'enseigne pas le tratar cusì.
Lunardo - Maintenant, nous allons aller à Disnar.
Felice - Invidèlo hip elo.
Lunardo - Siora no.
Felice - Vedeu? C'est la justice, je suis un épargnant qui est autour, car c'est la cause de tous les desordens qui sont nés de nouveau (53) , et vous fera être ... Tous les trois, saveu? Je parle avec les trois: cela vous mettra en colère, haineux, mécontent et se moquera de tous. C'est un peu plus civilisé, négociable, humain. Il a examiné les actes de votre muggier, et avec l'honnête x, donè qualcossa, soportè qualcossa. Que le comte forestier x est une personne honnête, civilisée; pour ne le traiter aucun fou gnente de mal; mon mario sait, el vien con elo; x est une conversation pure et simple. Quant aux vêtements, pas s'ils vont directement à tous les modes, pas s'ils ternissent la maison, la propreté est bonne, le par bon. En somme, s'il voulait vivre tranquillement, s'il voulait être en bonne santé avec l'agresseur, c'était des homeni, mais pas des salvadeghi; commandé, pas de tiraneggiè, et amè, s'il voulait être amai.
Canciano - Il faut dire: gran mia muggier!
Simon - Seu persuadé, sœur Lunardo?
Lunardo - E vu?
Simon - Oui je le sais.
Lunardo - ( à Margarita ) Diseghe à ce sior forestier, qui reste à déconner avec nu.
Margarita - Je m'ennuie de mal. Vit dans le ciel qui est liction abia profità.
Marina - ( à Filippetto ) Et vu, nevodo, comme la tratereu votre novice?
Filippetto - Cusì; sur l'ordre qui a le doigt siora Felice.
Lucietta - Oh, je suis content de tuto.
Margarita - Ghe despiase seulement avec les chutes est fiape.
Lucietta - Allez, non, tu me pardonnes toujours?
Felice - En amont tout. Nous irons à disnar, qui est maintenant. Et si el cuogo de sior Lunardo n'a pas économisé d'argent, à tola (54) aucun ghe n'ha ne sera, et aucun ghe ne le sera. Semo tuti desmesteghi (55) , amis tuti boni, avec beaucoup de cœur. Stemo aliegri, magnemo, buvait et femo, un prindese pour la santé de tous ceux qui, avec tant de gentillesse et de courtoisie, sont montés, ont souffert et ont eu pitié.
________________
ACTE UN
(1) Fia : fille.
(2) Debotto : Maintenant.
(3) xè phenìo : C'est fini; sert toujours, que le Xè dans les moyens vénitiens est , is .
(4) abuo : J'ai compris .
(5) Co giera : Quand j'étais.
(6) mer : Mère.
(7) sie : Six.
(8) si fava : Cela a été fait.
(9) sur Liston : situation établie par l'usage dans la grande Piazza di San Marco, où les masques sont portés pour une promenade.
(10) Allez faire un tour: Allez en groupe.
(11) gnanca : Même pas.
(12) un fià : Un peu.
(13) pétazza : Sguaiata.
(14) lasagnera : qui vend des pâtes.
(15) Ghe xè gnente au chantier naval? : Y a-t-il quelque chose dans l'air?
(16) co fa : Comment.
(17) Animo laorè : Éloignez-vous.
(18) elo : Il signifie le maître de la maison.
(19) co spessego : Comme je le sollicite.
(20) novice : marié.
(21) gnanca mo : Ce moréappliqué est une certaine manière chargée de se plaindre, adaptée à l'âge de Lucietta.
(22) Les deux malignazo : la même chose que maladetto, mais avec plus de modestie.
(23) Coss'è sti sixièmes : de quel mal s'agit-il?
(24) maregna : belle-mère.
(25) Davantazo : D'avantage.
(26) me rosega : Ça me ronge, ça me tourmente.
(27) fiastra : belle - fille .
(28) lovo : Loup.
(29) pagae a zornada : paiement par jour.
(30) vegnimo pour dire le crédit : un intercalaire vicieux.
(31) par étapes: En paix.
(32) el va zoso : Descends , abandonne.
(33) Et il avait tant de museau : Et as-tu tant de visage?
(34) el face sur le museau : Le masque sur le visage?
(35) Les putti : les jeunes filles.
(36) tous le font : les deux.
(37) ancuo : Aujourd'hui.
(38) que si nous enlevons notre zornada : Que nous prenons notre journée. Les chefs de ménage à l'ancienne ont permis à la famille une journée de caravane. Maintenant, tous les jours sont des compagnons.
(39) Oh peut - être : le paradis voulait.
(40) pas de vague : je n'y vais pas.
(41) parone : Maître, c'est-à-dire les épouses.
(42) cher vieil homme : Parole dite par amour.
(43) co se diè : C'est un dicton de bas vulgaire, qui explique que ces hommes sont exprès, c'est ainsi qu'ils devraient être.
(44) putelezzi: Filles.
(45) Preson : Prison.
(46) et si dise : ce qui est dit.
(47) qui vous donne drio : qui vous second.
(48) s'il mène par la langue : il murmure.
(49) s'il fait mètre sur les fans : Être mis sur les fans, c'est la même chose que d'être ridicule.
(50) crasse: Porcherie.
(51) un scoazzer : Un de ceux qui ramassent les ordures.
(52) maridozzo : Traité de mariage, pour ainsi dire très bas.
(53) non je suis fou : je m'en fous .
(54) sous la tête du ciel: façon de dire, qui est la même, comme si elle se disait sous le ciel, simplement.
(55) Cossa songio mi: Que suis-je?
(56) muggier : Épouse.
(57) Destrighève : Dépêchez-vous .
(58) Phénimium? : Voulons-nous le terminer?
(59) de mer? : En soie?
(60) vous cherchez: Guardinfanti.
(61) cartes postales au recto : Papigliotti.
(62) Zoggie : Joys.
(63) manini : Smanigli.
(64) le lendemain : De nos jours.
(65) en cao cent ans : Au bout de cent ans.
(66) apparaît : Terme d'amitié.
(67) straculi de vedèlo : La jambe du veau.
(68) qui vous intrigue : venez vous déranger.
(69) Et le fioi est da fioi : et les fils sont comme des fils.
(70) une bagatine : la douzième partie d'un sou.
(71) fondèli a le braghesse : Les patchs avec un pantalon.
(72) Latesini : Ris.
(73) nevodo : Petit-fils.
(74) mezà : bureau, bureau.
(75) Sentève : Asseyez-vous.
(76) marendar : Petit déjeuner.
(77) Amia : Tante.
(78) barbe : mon oncle.
(79) El dì da laorar : Les jours de travail.
(80) La Zuecca : La Giudecca, une charmante île en face de Venise, et pas loin.
(81) Castelo : l'un des sestieri de Venise, qui offre d'agréables promenades.
(82) Piazza : C'est à dire à Venise, quand on dit la Piazza, celle de San Marco; les autres carrés sont appelés champs .
(83) Mo i s'ha ben catà : On les trouve précisément.
(84) el m'ha abandonne l'ose : Il m'a donné la voix.
(85) Varè : Regardez.
(86) In cao de tanto : Après une longue période.
(87) grommelant? : Marmonnez-vous?
(88) si nous étions des taggialegni : si nous étions des taglialegni, des villana, nés dans les vallées les plus incultes.
(89) Per cossa ou per gamba : en vénitien ce qu'on appelle cossa , ela cuisse est censée être cossa , de sorte que le malentendu ludique de cossa et de la jambe se produit .
(90) la dépense : Cela signifie les nécessiteux pour le déjeuner.
(91) Non s'il désavoue ancuo? : Avez-vous déjeuné aujourd'hui?
(92) lu : Ce lu donne une certaine force à l'expression qui ne se traduit pas.
(93) Muème el nome : Changez mon nom.
(94) cugnà : Beau- frère.
(95) Je bat : Ils battent.
(96) destruction : Stolid.
(97) Je connais Mario Xé de la Taggia: Votre mari est en train de faire le mien.
(98) ghe va drio : Il la poursuit.
(99) C'est vrai : n'est-il pas vrai?
(100) arente : Appresso
(101) cara fia : Chère fille, c'est pour l'amitié.
(102) careghe : chaises hautes.
(103) defendève : Défendez-vous.
(104) Oui bien : la même chose que oui .
(105) Vous vous mariez? : Ont-ils un mariage à la maison?
(106) Contème : Parlez-moi de ça.
(107) Sénteli ?: Entendent -ils?
(108) beaucoup: Codogno signifie melcotogno, mais ici, il s'agit d'une erreur, d'une mauvaise chose.
(109) serar el contrato : Cela signifie signer l'écriture.
(110) gnanca pour l'insomnie : Nemen pour le rêve.
(111) que la tente : Laissez-les prendre soin.
(112) A do ore : deux heures la nuit, c'est-à-dire deux heures après le coucher du soleil.
(113) lassème el travaggio a mi : Laisse-moi le remède.
(114) Et alors? : Et alors?
(115) Après el Po vient Adese : plaisanterie de mots entre le fleuve Po et proposition po , ce qui signifie alors .Après le Pô, l'Adese signifie qu'après le Pô il y a le fleuve Adige, d'où vient ce qui vient.
(116) gaìna : Faux , perspicace , espiègle.
(117) co sta sorte de cai : Avec ce sort des gens?
(118) Puffeta : Une exclamation qui explique l'émerveillement et le mépris très médiatisés.
(119) pampalugo : Babbeo, fou.
DEUXIÈME ACTE
(1) desmesse : sans ornements .
(2) che ve meto su : Que dois-je vous donner des conseils?
(3) boniman : Arbitrî.
(4) fursi : Peut-être?
(5) co : Quand.
(6) barre transversale : Tablier.
(7) co fa : Come
(8) à scondon : Secrètement
(9) chutes d'eau : Manicotti.
(10) no la me desdiga : Ne me le fais pas savoir.
(11) Maregna : belle-mère.
(12) brosses : brosse à poilsen vénitien, c'est une brosse à dents de minuscule badigeon, avec laquelle les tondi sont nettoyés dans la cuisine.
(13) fiappe : flétrie .
(14) de lissìa : Blanchisserie.
(15) Spuzzete : De jolis petits humeurs.
(16) mustazzae : Rimbrotti.
(17) che zola zola : Ch'io l'attache.
(18) anti-âge : Anti-âge .
(19) Slarghèle un pochetin : Répartissez-les un peu.
(20) Voleu zocar : Vous voulez jouer.
(21) damnés damnés : damnés damnés .
(22) Vardar : Regardez.
(23) rare : Saccoccia.
(24) chiffon : chiffon.
(25) que vous avez apprécié : que vous avez épuisé.
(26) spienza : Cela signifie la rate, mais dans un proverbe souffrant de spienza, on entend un homme avare.
(27) piavola de Franza : Bamboccia exposée à Venise par les professeurs de mode.
(28) Choses du barrage de Che el Ghe : Puissiez-vous crier.
(29) sbrindoli : Pendentifs.
(30) qui vous donne ces saletés? : Qui vous a donné ces drogués?
(31) una donna de sesto : Une femme de grâce.
(32) un galan: Un ruban.
(33) Siestu benedeta dove che xè : Puissiez- vous être béni où que vous soyez.
(34) occupé : Lies.
(35) Plein et cran loin : bas, en colère, exclamation, pour ne pas blasphémer.
(36) Patron : Cette salutation: patron, patron est l'ordinaire, et presque indispensable de cet ordre de personnes.
(37) Cavève : Va-t'en.
(38) cargadura : Caricature.
(39) cotuss : Robe très succincte, qui était utilisée de nombreuses années auparavant.
(40) de ganzo : De brocart.
(41) Arzento et se vautrer: Argent en quantité.
(42) de sèa : De soie.
(43) Si nous avons tendance à lori : Si nous nous occupons d'eux.
(44) Je metérave le drio morveux : Mettre le morveux derrière quelqu'un signifie lui faire honte, se moquer de lui.
(45) coincé dans un chien : Va se cacher.
(46) intendacchio : Jugement, dit moqueur.
(47) Ve dirìa de chi ha nanìo : Je voudrais vous parler des méchants.
(48) diese : Dix
(49) Mondo niovo : Ces machines qui se montrent sur la place aux curieux pour peu de prix.
(50) Sunava le boneman : Recueilli les pourboires.
(51) che ghe bruscava : Ch'io est sorti de sa main.
(52) e co i scuodo : Et quand je les collectionne.
(53) Je les jette ... un palae : Ils les jettent avec une pelle.
(54) la braghesse : le pantalon.
(55) raìse : Expression tendre, aimante, comme les entrailles .
(56) no fàlo vogia : Ne bougez-vous pas pour l'embrasser, le caresser? etc.
(57) mezà : À Venise, vous dites à cette salle, où se font les plus grandes tâches: mezzàc'est le cabinet d'avocats, de six ministres, d'avocats, de mercadants; on l'appelle également une demi-chambre avec une ou plusieurs chambres, qui sont au premier étage en dessous du rez-de-chaussée, et certaines d'entre elles sont également au rez-de-chaussée.
(58) Eh! : Expression d'émerveillement.
(59) me strucola de caresses : Ça me charge de caresses.
(60) un fià : Rien.
(61) sgangolir : Souffrir .
(62) Il y a longtemps : c'est un.
(63) No ghe xè gnente de seguro : Il n'y a rien de certain.
(64) El me par un somio : Cela me semble un rêve.
(65) Je serais heureux d'expliquer que je suis sans sommeil : vous expliqueriez volontiers le rêve , vous avez l'intention de le vérifier.
(66) Pas de vorla? : Y a-t-il un doute?
(67) boccon de gringola : Joie avec désir.
(68) butè en amont : ne parlez plus.
(69) amia : Il est répété que amia signifie tante.
(70) che stomeghezzi : Che sguaiataggini .
(71) m'a touché : Cela signifie ironiquement à propos de son mauvais mari.
(72) l'araignée la mange : Elle resserre le nez.
(73) luminal: Fenêtre de toit pour éclairer le plafond.
(74) le me mete in saor : Ils me mettent en saveur, c'est-à-dire en flatterie.
(75) malignazonazza : Très grand.
(76) De Diana : Comme si c'était dit: Pour Bacchus!
(77) torse de verza : tronc de chou.
(78) Il les parle en argot : ils parlent en argot.
(79) Tegnive bon : Insuperbite.
(80) un punto de sesto : Un jeune homme de gentillesse.
(81) Co nous serons à quela : Quand je serai dans le cas.
(82) pezo : Pire.
(83) sutilo : Délicat.
(84) No pol : ce n'est peut-être pas grand-chose à venir
(75) a tola : À table.
(86) Un petit oeil en sbrisson : Un coup d'œil sur la fugace.
(87) donca : Eh bien.
(88) ni intrar, ni insir : ni entrée ni sortie, c'est-à-dire que je n'ai aucun intérêt pour chacun.
(89) aucun gh'è ni sixième, ni modèle : la même chose que dire ni droit ni inversé
(90) cugnà : Beau- frère.
(91) quel bon sixième! : Comme c'est gentil!
(92) pometo da riosa : pomme rose.
(93) de mauvaise humeur : à peine.
(94) if sarè destinai, ve torè : Si vous êtes destiné, vous vous marierez.
(95) colù : Lui.
(96) Je vais me battre : Ils partiront
(97) en claquant : à contrecœur.
(98) tremblements : tremblements.
(99) freve : fièvre.
(100) M'inspire : je tremble, j'ai peur.
(101) se lever : prendre.
(102) i se la man : Ils se marient.
(103) brui longhi : Bouillons longs.
(104) Le buele : les tripes.
(105) un fa pele: Un recruteur de soldats.
TROISIÈME ACTE
(1) castighèle : Castigatele
(2) custìe : Costoro .
(3) en amont du mariage : Plus besoin de parler du mariage.
(4) liogo : Loco.
(5) les coller : les mettre de force.
(6) Pàrlio bien? : Je parle bien?
(7) brena : La bride.
(8) Et co avè molà : Et quand tu as cédé.
(9) barrage de lassar la zente : Laissez les gens dire ce qu'ils peuvent dire.
(10) savè : Tu sais.
(11) Oibò : Messer no.
(12) pezo: Pire.
(13) vòltela, mènela : Caveau, révolte.
(14) smatar : honte , rire.
(15) forums : bien sûr dans la villa.
(16) entre en eux : Les entrées.
(17) une raison : Certains mentionnent.
(18) De scondon : secrètement .
(19) l'oggio : je l'ai
(20) le fil gh'ha : il a peur.
(21) gatolo : Presque toutes les rues de Venise ont de petits ruisseaux sur le côté, où les ordures se rejoignent, et où l'eau de pluie coule et se perd, et elles sont appelées gattoli .
(22) mais je pars : je ne veux pas de moi.
(23) corezème : Corrigez-moi
(24) que collectionnez-vous? : Quelle bagatella?
(25) marteau : insensé.
(26) el dopera : Vous l'utilisez.
(27) co : Quand
(28) je donne : Deux
(29) que le menu : Que vous le conduisiez.
(30) qu'il est devenu troisième : qu'il s'est tenu la main.
(31) sur votre chemin : Made in your way.
(32) i s'ha piasso : Ils s'aimaient
(33) Je fenìo le tiens; il loua le mariage et eut pitié de l'avocat : je finis le hareng, approuvai le mariage et pitié de l'avocat. Il plaisante sur la façon dont le hareng finissait habituellement par les avocats de Venise.
(34) lauderave : J'approuverais .
(35) vert : l'urne verte est celle des votes contraires
(36) Je crains que nous devions étiqueter : j'ai peur qu'elle doive être révoquée.
(37) mario : Mari.
(38) s'avesse desmentegà : avait oublié.
(39) alocco : Ici, l'auteur parle de lui-même, qui n'oublie pas ce dont il a parlé.
(40) le moi fait un renga, et je me vante : ça fait de moi un hareng, et j'approuve.
(41) Je parle de : Chiapo signifie que je prends: ici nous voulons dire que je résous sur le moment, et je m'en vais.
(42) Butarla Fora : jetez-le.
(43) Oe, i xè lori : Hé, ils le sont.
(44) dans drio : Retour.
(45) fifar : Pianger , dit humblement .
(46) ve muè : Vous changez.
(47) zirandole : roues de feux d'artifice, mais aussi jouets pour enfants, qui tournent avec l'agitation de l'air.
(48) sutilo : Mince, délicat.
(49) In suma : Eh bien.
(50) tegnìlo : Tenez-le , soutenez-le.
(51) quel cœur gh'aveu? : Quel noyau avez-vous?
(52) copains : à Venise, ceux qui servent de témoins dans les mariages sont appelés copains du ring .
(53) ancuo : Aujourd'hui.
(54) a tola : À table.
(55) desmesteghi : Domestique, c'est-à-dire humain, gérable.
?
---------------------------
Goldoni vu par lui-même
CHAPITRE I
Ma naissance et mes Parens.
Je suis né à Venise, l'an 1707, dans une grande et belle maison, située entre le pont de Nomboli et celui de Donna-Onesta, au coin de la rue de Cà cent'anni, sur la paroisse de S. Thomas.
Jules Goldoni, mon pere, étoit né dans la même ville; mais toute sa famille étoit de Modene.
Charles Goldoni, mon grand pere, fit ses études au fameux College de Parme. Il y connut deux nobles Vénitiens et se lia avec eux de la plus intime amitié. Ceux-ci l'engagerent à les suivre à Venise. Son pere étoit mort; son oncle, qui étoit Colonel et Gouverneur du Final, lui en accorda la permission; il suivit ses camarades dans leur patrie; il s'y établit, il fut pourvu d'une Commission très-honorable et très-lucrative à la Chambre des Cinq Sages du Commerce, et il épousa en premieres noces Mademoiselle Barili, née à Modene, fille et sœur de deux Conseillers d'Etat du Duc de Parme. C'étoit ma grande-mere paternelle.
Celle-ci vint à mourir: mon grand-pere fit la connoissance d'une veuve respectable qui n'avoit que deux filles; il épousa la mere, et fit épouser la fille aînée à son fils. Elles étoient de la famille Salvioni; et sans être riches, elles jouissoient d'une honnête aisance. Ma mere étoit une jolie brune: elle boitoit un peu, mais elle étoit fort piquante; tout leur bien passa entre les mains de mon grand-pere.
C'étoit un brave homme, mais point économe. Il aimoit les plaisirs, et s'accommodoit très-bien de la gaîté Vénitienne. Il avoit loué une belle maison de campagne appartenante au Duc de Massa-Carrara, sur le Sil, dans la Marque-Trevisanne, à six lieues de Venise; il y faisoit bombance; les Terriens de l'endroit ne pouvoient pas souffrir que Goldoni attirât les Villageois et les Etrangers chez lui; un de ses voisins fit des démarches pour lui ôter la maison; mon grand-pere alla à Carrare, il prit à ferme tous les biens que le Duc possédoit dans l'Etat de Venise. Il revint glorieux de sa victoire; il renchérit sur sa dépense. Il donnoit la Comédie, il donnoit l'Opéra chez lui; tous les meilleurs Acteurs, tous les Musiciens les plus célebres étoient à ses ordres; le monde arrivoit de tous les côtés. Je suis né dans ce fracas, dans cette abondance; pouvois-je mépriser les Spectacles? Pouvois-je ne pas aimer la gaîté?
Ma mere me mit au monde presque sans souffrir: elle m'en aima davantage; je ne m'annonçai point par des cris, en voyant le jour pour la premiere fois; cette douceur sembloit, dès-lors, manifester mon caractere pacifique, qui ne s'est jamais démenti depuis.
J'étois le bijou de la maison: ma bonne disoit que j'avois de l'esprit, ma mere prit le soin de mon éducation, mon pere celui de m'amuser. Il fit bâtir un Théâtre de Marionnettes: il les faisoit mouvoir lui-même, avec trois ou quatre de ses amis; et je trouvois, à l'âge de quatre ans, que c'étoit un amusement délicieux.
En 1712, mon grand-pere vint à mourir; une partie de plaisir lui causa une fluxion de poitrine, qui, en six jours, le conduisit au tombeau. Ma grande-mere le suivit de près. Voilà l'époque d'un changement terrible dans notre famille, qui tomba tout d'un coup de l'aisance la plus heureuse dans la médiocrité la plus embarrassante.
Mon pere n'avoit pas eu l'éducation qu'il auroit dû avoir; il ne manquoit pas d'esprit, mais on avoit manqué de soin pour lui. Il ne put conserver l'emploi de son pere: un Grec adroit sut le lui enlever.
Les biens libres de Modene étoient vendus, les biens substitués étoient hypothéqués.
Il ne restoit que les biens de Venise, qui étoient la dot de ma mere et l'apanage de ma tante.
Pour surcroît de malheur, ma mere mit au monde un second enfant, Jean Goldoni, mon frere. Mon pere se trouva très- embarrassé; mais comme il n'aimoit pas trop à s'appesantir sous le poids de réflexions tristes, il prit le parti de faire un voyage à Rome pour se distraire. Je dirai dans le Chapitre suivant ce qu'il y fit, et ce qu'il est devenu. Revenons à moi, car je suis le héros de la piece.
Ma mere resta seule à la tête de la maison, avec sa sœur et ses deux enfans. Elle envoya son cadet en pension; et s'occupant uniquement de moi, elle voulut m'élever sous ses yeux. J'étois doux, tranquille, obéissant; à l'âge de quatre ans je lisois, j'écrivois, je savois mon catéchisme par cœur, et on me donna un Précepteur.
J'aimois beaucoup les livres: j'apprenois avec facilité ma Grammaire, les principes de la Géographie et ceux de l'Arithmétique; mais ma lecture favorite étoit celle des Auteurs comiques. Il n'y en avoit pas mal dans la petite Bibliotheque de mon pere; j'en lisois toujours dans les momens que j'avois à moi, et j'en copiois même les morceaux qui me faisoient le plus de plaisir. Ma mere, pourvu que je ne m'occupasse pas à des joujous d'enfant, ne prenoit pas garde au choix de mes lectures.
Parmi les Auteurs comiques que je lisois et que je relisois très-souvent, Cicognini étoit celui que je préférois. Cet Auteur Florentin, très-peu connu dans la République des Lettres, avoit fait plusieurs Comédies d'intrigue, mêlées de pathétique larmoyant et de comique trivial; on y trouvoit cependant beaucoup d'intérêt, et il avoit l'art de ménager la suspension, et de plaire par le dénouement. Je m'y attachai infiniment: je l'étudiai beaucoup; et à l'âge de huit ans, j'eus la témérité de crayonner une Comédie.
J'en fis la premiere confidence à ma bonne, qui la trouva charmante; ma tante se moqua de moi; ma mere me gronda et m'embrassa en même tems; mon Précepteur soutint qu'il y avoit plus d'esprit et plus de sens commun que mon âge ne comportoit; mais ce qu'il y eut de plus singulier, ce fut mon parrain, homme de robe, plus riche d'argent que de connoissances, qui ne voulut jamais croire que ce fût mon Ouvrage. Il soutenoit que mon Précepteur l'avoit revue et corrigée: celui-ci trouva le jugement indécent. La dispute alloit s'échauffer: heureusement une troisieme personne arriva dans l'instant, et les appaisa.
C'étoit M. Vallé, depuis l'Abbé Vallé, de Bergame. Cet ami de la maison m'avoit vu travailler à cette piece: il avoit été témoin de mes enfantillages et de mes saillies. Je l'avois prié de n'en parler à personne: il m'avoit gardé le secret; et dans cette occasion faisant taire l'incrédule il rendit justice à mes bonnes dispositions.
Dans le premier volume de mon édition de Pasquali, j'avois cité, pour preuve de cette vérité, l'Abbé Vallé, qui vivoit encore en 1770, me doutant bien qu'il y auroit d'autres parrains qui ne me croiroient pas.
Si le Lecteur me demandoit quel étoit le titre de ma piece, je ne pourrois pas le satisfaire; car c'est une bagatelle à laquelle je n'avois pas pensé en la faisant. Il ne tiendroit qu'à moi de lui en donner un aujourd'hui; mais j'aime à dire les choses comme elles sont, plutôt que de les embellir.
Enfin cette Comédie, ou pour mieux dire cette folie enfantine, a couru dans toutes les sociétés de ma mere. On en envoya une copie à mon pere; voici l'instant de revenir à lui.
Mon premier voyage. - Mes Humanités.
Mon pere ne devoit rester à Rome que quelques mois, il y resta quatre ans; il avoit dans cette grande capitale du monde chrétien, un ami intime, M. Alexandre Bonicelli, Vénitien, qui venoit d'épouser une Romaine très-riche et qui jouissoit d'un état très-brillant.
M. Bonicelli reçut avec sensibilité son ami Goldoni: il le logea chez lui, il le présenta à toutes ses sociétés, à toutes ses connoissances, et il le recommanda vivement à M. Lancisi, premier Médecin et Camérier secret de Clément XI. Ce célebre Docteur qui a enrichi la République des Lettres et la Faculté d'éxcellens Ouvrages, s'attacha singulierement à mon pere, qui avoit de l'esprit et qui cherchoit de l'occupation.
Lancisi lui conseilla de s'appliquer à la Médecine: il lui promit sa faveur, son assistance, sa protection. Mon pere y consentit; il fit ses études au College de la Sapience, et fit son apprentissage dans l'hôpital du Saint-Esprit. Au bout de quatre ans il fut reçu Docteur, et son Mécene l'envoya à Perouse faire ses premieres expériences.
Le début de mon pere fut très-heureux: il avoit l'adresse d'éviter les maladies qu'il ne connoissoit pas; il guérissoit ses malades, et le Docteur Vénitien étoit fort à la mode dans ce pays-là.
Mon pere qui étoit peut-être bon Médecin, étoit aussi très-agréable dans la société; il réunissoit à l'aménité naturelle de son pays, l'usage de la bonne compagnie, où il avoit vécu. Il gagna l'estime et l'amitié des Bailloni et des Antinori, deux des plus nobles et des plus riches familles de la ville de Perouse.
C'est dans ce pays et dans cette heureuse position qu'il reçut le premier essai des bonnes dispositions de son fils aîné. Cette Comédie, toute informe qu'elle devoit être, le flatta infiniment; car, calculant d'après les principes de l'arithmétique, si neuf ans donnoient quatre carats d'esprit, dix-huit pouvoient en donner douze; et par progression successive, on pouvoit arriver jusqu'au degré de la perfection.
Mon pere se décida à me vouloir auprès de lui: ce fut un coup de poignard pour ma mere; elle résista d'abord, elle hésita ensuite, et finit par céder. Il se présenta une occasion la plus favorable du monde; notre maison étoit très-liée avec celle du Comte Rinalducci de Rimini, qui, avec sa femme et sa fille, étoit alors à Venise. Le Pere Abbé Rinalducci, Bénédictin, et frere du Comte, devoit aller à Rome; il s'engagea de passer par Perouse, et de m'y conduire.
Les paquets sont faits, l'instant arrive, il faut partir. Je ne vous parlerai pas des pleurs de ma tendre mere; tous ceux qui ont eu des enfans connoissent ces cruels momens. J'étois très-attaché aussi à celle qui m'avoit porté dans son sein, qui m'avoit élevé, qui m'avoit caressé; mais l'idée d'un voyage est pour un jeune homme unedistraction charmante.
Nous nous embarquâmes, le Pere Rinalducci et moi, au port de Venise, dans une espece de félouque, appellée Peota- Zuecchina, et nous fîmes voile pour Rimini. La mer ne me fit aucun mal; au contraire, j'avois un appétit excellent, nous mîmes pied à terre à l'embouchure de la Marecchia, où il y avoit des chevaux qui nous attendoient.
Quand on me proposa de monter à cheval, je me vis dans le plus grand embarras. A Venise, on ne voit point de chevaux dans les rues; il y a deux académies, mais j'étois trop jeune pour en profiter. J'avois vu, dans mon enfance, des chevaux à la campagne, je les craignois et je n'osois pas m'en approcher.
Les chemins de l'Ombrie que nous devions traverser, étoient montagneux; le cheval étoit la voiture la plus commode pour les passagers: il fallut s'y soumettre. On me prend à travers le corps, on me flanque sur la selle... Miséricorde! des bottes, des étriers, une bride, un fouet! Que faire de tout cela? J'étois balloté comme un sac; le Révérend Pere rioit de tout son cœur, les domestiques se moquoient de moi, j'en ris moi-même. Peu-à-peu je fis connoissance avec mon bidet: je le régalois de pain et de fruits; il devint mon ami, et en six jours de tems nous arrivâmes à Perouse.
Mon pere fut content de me voir, encore plus de me voir bien portant, je lui dis d'un air d'importance que j'avois fait ma route à cheval: il m'applaudit en riant, et m'embrassa tendrement.
Je trouvai notre logement fort triste dans une rue escarpée et très-vilaine: je priai mon pere de déménager; il ne le pouvoit pas, la maison étoit attenante à l'hôtel d'Antinori; il ne payoit point de loyer, et il étoit tout près des Religieuses de Sainte-Catherine, dont il étoit le Médecin.
Je vis la ville de Perouse: mon pere me conduisit lui-même par-tout; il commença par la superbe église de Saints Laurent, qui est la Cathédrale du pays, où l'on conserve et l'on expose l'Anneau avec lequel Saint Joseph épousa la Vierge Marie. C'est une pierre d'un transparent bleuâtre et d'un contour très-épais: voilà comme je l'ai vu; mais on dit que cet anneau change miraculeusement de couleur et de forme aux différens yeux qui l'approchent.
Mon pere me fit remarquer la citadelle que Paul III fit bâtir, du tems que Perouse jouissoit de la liberté républicaine, sous prétexte de régaler les Perousins d'un hôpital pour les malades et les pélerins: il y fit introduire des canons dans des charrettes chargées de paille; ensuite on cria: qui vive? Il fallut bien répondre: Paul III.
Je vis de beaux hôtels, de belles églises, de jolies promenades: je demandai s'il y avoit une salle de Spectacle, on me dit que non; tant pis, répondis-je, je n'y resterois pas pour tout l'or du monde.
Au bout de quelques jours, mon pere se détermina à me faire continuer mes études; c'étoit juste, je le voulois bien; les Jésuites étoient en vogue, il m y proposa: j'y fus reçu sans difficulté.
Les classes des humanités en Italie ne sont pas partagées comme en France; il n'y en a que trois: Grammaire inférieure, Grammaire supérieure, ou humanité proprement dite, et Rhètorique. Ceux qui profitent et emploient bien leur tems dans l'espace de trois ans, peuvent terminer leur cours.
J'avois fait à Venise ma premiere année de Grammaire inférieure: j'aurois pu entrer dans la supérieure; mais le tems que j'avois perdu, la distraction du voyage, les nouveaux maîtres que j'allois avoir, tout engagea mon pere à me faire recommencer mes études, et il fit très-bien; car vous allez voir, mon cher Lecteur, comme ce Grammairien Vénitien, qui ne manquoit pas de se vanter d'avoir composé une Piece, se trouva rapetissé en un instant.
L'année littéraire étoit avancée, on me reçut dans la classe inférieure comme un Ecolier très-fait, très-instruit pour la supérieure. On m'interrogea, je répondis mal, on me fit traduire, je bégayois; on me fit faire du latin, beaucoup de barbarismes et de sollécismes. On se moqua de moi: j'étois devenu le jouet de mes camarades, ils se plaisoient à me défier; tous mes combats étoient des chûtes; mon pere étoit au désespoir; j'étois étonné, mortifié; je me crus ensorcelé.
Le tems des vacances s'approchoit: on devoit donner le devoir qu'on appelle en Italie le Latin du passage; car ce petit travail doit décider du mérite des Ecoliers pour les faire monter à une autre classe, ou pour les faire rester dans la même; c'étoit le sort auquel, tout au plus, je devois m'attendre. Le jour arrive: le Régent dicte; les Ecoliers écrivent; chacun fait de son mieux. Je rassemble toutes mes forces, je me représente mon honneur, mon ambition, mon pere, ma mere; je vois mes voisins qui me regardent du coin de l'œil, et qui rient; facit indignatio versum. La rage, la honte m'enflamment; je lis mon theme, je sens ma tête fraîche, ma main légere, ma mémoire féconde; je finis avant les autres, je cachete mon papier, je l'apporte au Régent, et je m'en vais content de moi.
Huit jours après, on appelle et on rassemble les Ecoliers: on publie la décision du College. Premiere nomination, Goldoni en supérieure; voilà un brouhaha général dans la classe; on tient des propos indécens. On lit ma traduction à haute voix, pas une faute d'ortographe; le Régent m'appelle à la chaire: je me leve pour y aller, je vois mon pere à la porte, je cours l'embrasser.
Suite du Chapitre précédent. - Nouvel amusement comique. - Arrivée de ma Mere à Perouse.
Le Pere Régent voulut me parler en particulier: il me fit un compliment; il me dit que, malgré les fautes grossieres que je faisois de tems en tems dans mes leçons ordinaires, il avoit deviné que je devois avoir de l'esprit par des traits de justesse qu'il rencontroit par-ci, par-là, dans mes themes et dans mes versions. Il ajouta que ce dernier essai l'avoit convaincu que je m'étois caché par malice, et il badina sur la ruse des Vénitiens.
Vous me faites trop d'honneur, mon Révérend Pere, lui dis-je, j'ai trop souffert pendant trois mois pour m'amuser à mes dépens; je ne faisois pas l'ignorant, je l'étois; c'est un phénomene que je ne saurois expliquer.
Le Régent m'exhorta de continuer à m'appliquer; et comme il devoit passer lui-même à la classe supérieure où j'allois entrer, il m'assura de sa bienveillance.
Mon pere, content de moi, tâcha de me récompenser et de m'amuser pendant le tems des vacances. Il savoit que j'aimois les Spectacles, il les aimoit aussi: il rassembla une société de jeunes gens; on lui prêta une salle dans l'hôtel d'Antinori, il y fit bâtir un petit Théâtre; il dressa lui-même les Acteurs, et nous y jouâmes la Comédie.
Dans les Etats du Pape (excepté les trois Légations), les femmes ne sont pas tolérées sur la scene. J'étois jeune, je n'étois pas laid, on me destina un rôle de femme, on me donna même le premier rôle, et on me chargea du Prologue.
Ce Prologue étoit une piece si singuliere, qu'il m'est resté toujours dans la tête, et il faut que j'en régale mon Lecteur. Dans le siecle dernier, la Littérature Italienne étoit sí gâtée, que prose et poésie, tout étoit ampoulé; les métaphores, les hyperboles et les antitheses tenoient la place du sens commun. Ce goût dépravé n'étoit pas encore tout-à-fait extirpé en 1720: mon pere y étoit accoutumé; voici le commencement du beau morceau qu'on me fit débiter.
Benignissimo Cielo! (je parlois à mes Auditeurs) ai rai del vostro splendilissimo sole eccoci quai farfalle, che spiegando le deboli ali de' nostri concetti, portiamo al bel lume il volo, etc. Cela voudroit dire bêtement en françois: Ciel très-benin, aux rayons le votre soleil très-éclatant, nous voilà comme des papillons qui, sur les foibles ailes de nos expressions, prenons notre vol vers votre lumiere, etc.
Ce charmant Prologue me valut un boisseau de dragées, dont le Théâtre fut inondé et moi presqu'aveuglé. C'est l'applaudissement ordinaire dans les Etats du Pape.
La Piece dans laquelle j'avois joué étoit la Sorellina di don Pilone: je fus beaucoup applaudi; car dans un pays où les Spectacles sont rares, les spectateurs ne sont pas difficiles.
Mon pere trouva que j'avois de l'intelligence, mais que je ne serois jamais bon Acteur; il ne se trompa point.
Nos représentations durerent jusqu'à la fin des vacances. A l'ouverture des classes, je pris ma place; à la fin de l'année je passai en Rhétorique, et j'achevai mes humanités, ayant gagné l'amitié et l'estime des Jésuites, qui me firent l'honneur de m'offrir une place dans leur société, que je n'acceptai pas.
Pendant ce tems-là il arriva beaucoup de changemens dans notre famille; ma mere ne pouvoit pas soutenir l'éloignement de son fils aîné, elle pria son époux de revenir à Venise, ou qu'il lui permît d'aller le rejoindre où il étoit.
Après beaucoup de lettres et beaucoup de débats, il fut décidé que Madame Goldoni viendroit avec sa sœur, et avec son cadet, se réunir au reste de sa famille; tout cela fut exécuté.
Ma mere, dans Perouse, ne put jouir d'un seul jour de bonne santé, l'air du pays lui étoit fatal; née et habituée dans le climat tempéré de Venise, elle ne pouvoit soutenir les frimats d'un pays montagneux.
Elle souffrit beaucoup; elle fut réduite presque à la mort, et elle sut surmonter les peines et les dangers tant qu'elle crut ma demeure nécessaire dans cette ville, pour ne pas m'exposer à interrompre mes études qui étoient si bien avancées.
Mes humanités finies et ma Rhétorique achevée, elle engagea mon pere à la satisfaire, et il s'y prêta de bon cœur. La mort de son protecteur Antinori lui avoit causé des désagrémens, les Médecins de Perouse ne le regardoient pas de bon œil; il prit le parti de quitter le Perousin, et de se rapprocher des marais de la mer Adriatique.
Mon voyage à Rimini. Ma Philosophie. - Ma premiereconnoissance avec les Comédiens.
Le projet fut exécuté en peu de jours; on acheta un carrosse à quatre places, mon frere y étoit par-dessus le marché, nous prîmes la route de Spoleti, qui étoit plus commode, et nous arrivâmes à Rimini, où toute la famille du Comte Rinalducci se trouvoit rassemblée, et où nous fûmes reçus avec des transports de joie.
Il étoit nécessaire pour moi que je ne misse pas une seconde fois des lacunes dans mes applications littéraires, mon pere me destinoit à la Médecine, et je devois étudier la Philosophie.
Les Dominicains de Rimini étoient en grande réputation pour la Logique, qui ouvre la carriere de toutes les sciences physiques et spéculatives, le Comte Rinalducci nous fit faire la connoissance du Professeur Candini, et je fus confié à ses soins.
M. le Comte ne pouvant pas me garder chez lui, on me mit en pension chez M. Battaglini, Négociant et Banquier, ami et compatriote de mon pere. Malgré les remontrances et les regrets de ma mere, qui n'auroit jamais voulu se détacher de moi, toute ma famille prit la route de Venise, où je ne devois la rejoindre que lorsqu'ils auroient jugé à propos de me rappeller.
Ils s'embarquerent pour Chiozza, dans une barque de ce pays-là; le vent étoit favorable, ils arriverent en très-peu de tems; mais ma mere étoit fatiguée, et ils s'y arrêterent pour se reposer.
Chiozza est une ville à huit lieues de Venise, bâtie sur des pilotis comme la capitale; on y compte quarante mille ames, tout peuple; des pêcheurs et des matelots, des femmes qui travaillent en grosse dentelle, dont on fait un commerce considérable, et il n'y a qu'un petit nombre de gens qui s'élevent au-dessus du vulgaire. On range dans ce pays-là tout le monde en deux classes, riches et pauvres; ceux qui portent une perruque et un manteau sont les riches, ceux qui n'ont qu'un bonnet et une capotte sont les pauvres; et souvent ces derniers ont quatre fois plus d'argent que les autres.
Ma mere se trouvoit très-bien dans ce pays-là, l'air de Chiozza étoit analogue à son air natal, son logement étoit beau, elle jouissoit d'une vue agréable et d'une liberté charmante; sa sœur étoit complaisante, mon frere étoit encore un enfant qui ne disoit rien, et mon pere, qui avoit des projets, fit part de ses réflexions à sa femme, qui les approuva.
Il falloit, disoit-il, ne retourner à Venise que dans une position à n'être à charge à personne; il falloit, pour cet effet, qu'auparavant il allât lui-même à Modene pour y arranger les affaires de la famille; cela fut exécuté: voilà mon pere à Modene, ma mere à Chiozza et moi à Rimini.
Je tombai malade, la petite vérole se déclara: elle étoit bénigne; M. Battaglini n'en fit part à mes parens que quand il me vit hors de danger; il n'est pas possible d'être mieux soigné, mieux servi que je le fus dans cette occasion.
A peine étois-je en état de sortir, mon hôte, très-attentif et très-zélé pour mon bien, me pressa d'aller revoir le Pere Candini.
J'y allois malgré moi: ce Professeur, cet homme célebre m'ennuyoit à périr; il étoit doux, sage, savant: il avoit beaucoup de mérite, mais il étoit Thomiste dans l'ame, il ne pouvoit pas s'écarter de sa méthode ordinaire; ses détours scholastiques me paroissoient inutiles, ses barbara, ses baraliptons me paroissoient ridicules. J'allois écrire sous sa dictée, mais au lieu de repasser mes cahiers chez moi, je nourrissois mon esprit d'une philosophie bien plus utile et plus agréable; je lisois Plaute, Térence, Aristophane, et les fragmens de Ménandre. Je ne brillois pas, il est vrai, dans les cercles qui se tenoient journellement: j'avois l'adresse cependant de faire comprendre à mes camarades que ce n'étoit ni la lourde paresse, ni la crasse ignorance qui me rendoient indifferent aux leçons du maître, dont la longueur me fatiguoit et me révoltoit; il y en avoit plusieurs qui pensoient comme moi.
La Philosophie moderne n'avoit pas encore fait les progrès considérables qu'elle a fait depuis, et il falloit se tenir (les Ecclésiastiques sur-tout) à celle de Saint Thomas ou à celle de Scot, ou à la péripatéticienne, ou à la mixte, qui toutes ensemble ne font que s'écarter de la Philosophie du bon sens.
J'avois bon besoin, pour soulager l'ennui qui m'accabloit, de me procurer quelque distraction agréable: j'en trouvai l'occasion j'en profitai; et l'on ne sera pas fâché, peut-être, de passer avec moi des cercles de la Philosophie à ceux d'une Troupe de Comédiens.
Il y en avoit une à Rimini qui me parut délicieuse; c'étoit pour la premiere fois que je voyois des femmes sur le Théâtre, et je trouvai que cela décoroit la scene d'une maniere plus piquante. Rimini est dans la légation de Ravenne, les femmes sont admises sur le Théâtre, et on n'y voit point, comme on voit à Rome, des hommes sans barbe ou des barbes naissantes.
J'allois les premiers jours à la Comédie fort modestement au parterre, je voyois de jeunes gens comme moi dans les coulisses: je tentai d'y parvenir, je n'y trouvai point de difficulté; je regardois du coin de l'œil ces demoiseiles, elles me fixoient hardiment. Peu à peu je m'apprivoisai; de propos en propos, de question en question, elles apprirent que j'étois Vénitien. Elles étoient toutes mes compatriotes, elles me firent des caresses et des politesses sans fin; le Directeur lui-même me combla d'honnêtetés: il me pria à dîner chez lui, j'y allai; je ne vis plus le Révérend Pere Candini.
Les Comédiens alloient finir leur engagement, et devoient partir; leur départ me faisoit vraiment de la peine. Un vendredi, jour de relâche pour toute l'Italie, hors l'Etat de Venise, nous fîmes une partie de campagne; toute la compagnie y étoit, le Directeur annonça le départ pour la huitaine; il avoit arrêté la barque qui devoit les conduire à Chiozza... A Chiozza! dis-je, avec un cri de surprise! -Oui, Monsieur; nous devons aller à Venise, mais nous nous arrêterons quinze ou vingt jours à Chiozza pour y donner quelques représentations en passant. - Ah, mon Dieu! ma mere est à Chiozza, et je la verrois avec bien du plaisir. - Venez avec nous; - oui, oui (tout le monde crie l'un après l'autre), avec nous, avec nous, dans notre barque; vous y serez bien, il ne vous en coûtera rien; on joue, on rit, on chante, on s'amuse, etc. Comment résister à tant d'agrément? pourquoi perdre une si belle occasion? J'accepte, je m'engage et je fais mes préparatifs.
Je commence par en parler à mon hôte, il s'y oppose très-vivement: j'insiste, il en fait part au Comte Rinalducci; tout le monde étoit contre moi. Je fais semblant de céder, je me tiens tranquille; le jour fixé pour partir, je mets deux chemises et un bonnet de nuit dans mes poches; je me rends au port, j'entre dans la barque le premier, je me cache bien sous la proue; j'avois mon écritoire de poche, j'écris à M. Battaglini, je lui fais mes excuses; c'est l'envie de revoir ma mere qui m'entrame, je le prie de faire présent de mes hardes à la bonne qui m'avoit soigné dans ma maladie, et je lui déclare que je vais partir. C'est une faute que j'ai faite, je l'avoue; j'en ai fait d'autres, je les avouerai de même.
Les Comédiens arrivent. - Où est M. Goldoni? - Voilà Goldoni qui sort de sa cave; tout le monde se met à rire; on me fête, on me caresse, on fait voile; adieu Rimini.
La Barque des Comédiens. - Surprise le ma Mere. Lettre intéressante de mon Pere.
Mes Comédiens n'étoient pas ceux de Scaron; cependant l'ensemble de cette Troupe embarquée présentoit un coup d'œil plaisant.
Douze personnes, tant Acteurs qu'Actrices, un Souffleur, un Machiniste, un Garde du magasin, huit domestiqués, quatre femmes-de-chambre, deux nourrices, des enfans de tout âge, des chiens, des chats, des singes, des perroquets, des oiseaux, des pigeons, un agneau; c'étoit l'arche de Noé.
La barque étoit très-vaste, il y avoit beaucoup de compartimens, chaque femme avoit sa niche avec des rideaux; on avoit arrangé un bon lit pour moi à côté du Directeur, tout le monde étoit bien.
L'Intendant général du voyage, qui étoit en même tems Cuisinier et Sommelier, sonna une petite cloche qui étoit le signal du déjeûner; tout le monde se rassembla dans une espece de sallon qu'on avoit ménagé au milieu du navire par-dessus les caisses, les malles et les ballots; il y avoit sur une table ovale du café, du thé, du lait, des rôties, de l'eau et du vin.
La premiere Amoureuse demanda un bouillon, il n'y en avoit point, elle étoit en fureur; on eut toute la peine du monde à l'appaiser avec une tasse de chocolat; c'étoit la plus laide et la plus difficile.
Après le déjeûner, on proposa la partie, en attendant le dîner. Je jouois assez bien le tresset; c'étoit le jeu favori de ma mere, qui me l'avoit appris.
On alloit commencer un tresset et un piquet, mais une table de pharaon qu'on avoit établi sur le tillac, attira tout le monde, la banque annonçoit plutôt l'amusement que l'intérêt, le Directeur ne l'auroit pas souffert autrement. On jouoit, on rioit, on badinoit, on se faisoit des niches: la cloche annonce le dîner, on s'y rend.
Des macaroni! tout le monde se jette dessus, on en dévore trois soupieres; du bœuf à la mode, de la volaille froide, une longe de veau, du dessert et du vin excellent; ah, le bon dîner! il n'est chere que d'appétit.
Nous restâmes quatre heures à table; on joua de différens instrumens, on chanta beaucoup; la Soubrette chantoit à ravir, je la regardois attentivement, elle me faisoit une sensation singuliere; hélas! il arriva une aventure qui interrompit l'agrément de la société; un chat se sauva de sa cage, c'étoit le minet de la premiere Amoureuse, elle appella tout le monde au secours, on courut après lui: le chat qui étoit farouche comme sa maîtresse, glissoit, sautoit, se cachoit par-tout; se voyant poursuivi, il grimpa sur le mât. Madame Clarice se trouva mal; un matelot monte pour le ravoir, le chat s'élance dans la mer et il y reste; voilà sa maîtresse au désespoir, elle veut tuer tous les animaux qu'elle apperçoit, elle veut jetter sa femme-de-chambre dans le tombeau de son cher minet; tout le monde prend le parti de la femme-de-chambre; la querelle devient générale: le Directeur arrive, il en rit, il badine, il fait des caresses à la dame affligée: elle finit par rire elle-même, et voilà le chat oublié.
Mais c'est assez, je crois, et c'est peut-être trop abuser de mon Lecteur en l'entretenant de ces miseres, qui n'en méritent pas la peine.
Le vent n'étoit pas favorable, nous restâmes trois jours sur mer; toujours les mêmes amusemens, les mêmes plaisirs, le même appétit; nous arrivâmes à Chiozza le quatrieme jour.
Je n'avois pas l'adresse du logement de ma mere, mais je n'ai pas cherché long-tems. Madame Goldoni et sa sœur portoient une coëffe: elles étoient dans la classe des riches, et tout le monde les connoissoit.
Je priai le Directeur de m'y accompagner; il s'y prêta de bonne grace, il y vint: il s'y fit annoncer, je restai dans l'antichambre. - Madame, dit-il à ma mere, je viens de Rimini, j'ai des nouvelles à vous donner de M. votre fils. - Comment se porte mon fils? - Très-bien, Madame. - Est-il content de sa position? - Pas trop, Madame; il souffre beaucoup. - De quoi? - D'être éloigné de sa tendre mere. - Le pauvre enfant! je voudrois bien l'avoir auprès de moi. (J'entendois tout cela, et le cœur me battoit). - Madame, continua le Comédien, je lui avois offert de le conduire avec moi. - Pourquoi, Monsieur, ne l'avez-vous pas fait? - L'auriez-vous trouvé bon? - Sans doute. - Mais ses études? - Ses études! ne pouvoit-il pas y retourner? D'ailleurs, il y a des maîtres partout. - Vous le verriez donc avec plaisir? - Avec la plus grande joie. - Madame, le voilà. - Il ouvre la porte, j'entre: je me jette aux genoux de ma mere; elle m'embrasse, les larmes nous empêchent de parler. Le Comédien, accoutumé à de pareilles scenes, nous dit des choses agréables, prit congé de ma mere et s'en alla. Je reste avec elle, j'avoue avec sincerité la sottise que j'avois faite; elle me gronde et m'embrasse; nous voilà contens l'un de l'autre. Ma tante étoit sortie: quand elle rentre, autre surprise, autres embrassemens; mon frere étoit en pension.
Le lendemain de mon arrivée, ma mere reçut une lettre de M. Battaglini, de Rimini; il lui faisoit part de mon étourderie, il s'en plaignoit amerement, et lui annonçoit qu'elle recevroit incessamment un porte-manteau chargé de livres, de linge et de hardes, dont sa Gouvernante ne savoit que faire.
Ma mere en fût très-fâchée, elle pensa me gronder; mais à propos de lettre, elle se souvint qu'elle en avoit une de mon pere, très-intéressante: elle alla la chercher, me la remit, et en voici le précis:
"Ma chere femme
Pavie, 27 Mars 1721.
"J'ai une bonne nouvelle à te donner, elle regarde notre cher fils: elle te fera beaucoup de plaisir. J'ai quitté Modene, comme tu sais, pour aller à Plaisance, et pour y arranger les affaires avec M. Barilli, mon cousin, qui me doit encore un reste de dot de ma mere; et si je peux réunir cette somme aux arrérages que je viens de toucher à Modene, nous pourrons nous rétablir à nostre aise.
"Mon cousin n'étoit pas à Plaisance, il étoit parti pour Pavie, pour assister au mariage d'un neveu de sa femme. Je me trouvois en route, le voyage n'étoit pas long, je pris le parti de venir le rejoindre à Pavie. Je le trouve, je lui parle, il avoue la dette, et nous nous sommes arrangés. Il me payera en six années; mais voici ce qui vient de m'arriver en cette ville.
"Je vais descendre en arrivant à l'hôtel de la Croix rouge; on me demande mon nom, pour en faire la consigne à la Police; le lendemain, l'Aubergiste me présente un Valet-de-pied du Gouverneur, qui me prie très-poliment de me rendre à mon aise à l'hôtel du Gouvernement. Malgré le mot à votre aise, je n'étois pas à mon aise dans ce moment-là, et je ne pouvois pas deviner ce qu'on vouloit de moi.
"J'allai d'abord en sortant chez mon cousin; et après l'arrangement de nos affaires, je lui fis part de cette espece d'invitation, qui ne laissoit pas de m'inquiéter, et je lui demandai s'il connoissoit le Gouverneur de Pavie personnellement; il me dit que oui, qu'il le connoissoit depuis long-tems, que c'étoit le Marquis de Goldoni-Vidoni, une des bonnes familles de Crémone, et Sénateur de Milan.
"A ce nom de Goldoni, je bannis toute crainte, je conçus des idées flatteuses, et je ne me trompois pas.
"J'allai voir, dans l'après-midi, le Gouverneur; il me fit l'accueil le plus honnête et le plus gracieux: c'étoit ma consigne qui lui avoit donné l'envie de me connoître; nous causâmes beaucoup, je lui dis que j'étois originaire de Modene; il me fit l'honneur de m'observer que la ville de Crémone n'étoit pas bien éloignée de celle de Modene; il arriva du monde, il me pria à dîner pour le jour suivant.
"Je ne manquai pas de m'y rendre, comme tu peux croire; nous n'étions que quatre personnes à table, on dîna fort bien; les deux autres convives partirent après le café, nous restâmes seuls M. le Sénateur et moi.
"Nous parlâmes de bien des choses, principalement de ma famille, de mon état et de ma position actuelle; enfin, pour abréger ma lettre, il me promit qu'il tâcheroit de faire quelque chose pour mon fils aîné.
"Il y a à Pavie une Université aussi fameuse que celle de Padoue, et il y a plusieurs Colleges où on ne reçoit que des Boursiers. M. le Marquis s'engagea de m'obtenir une de ces places dans le College du Pape; et si Charles se conduit bien, il aura soin de lui.
"N'écris rien de tout cela à ton fils; à mon retour je le ferai revenir, et je veux me ménager le plaisir de l'en instruire moi-même.
"Je ne tarderai pas, j'espere, etc."
Tout ce que contenoit cette lettre étoit fait pour me fiatter, et pour me faire concevoir les espérances les plus étendues.
Je sentis alors l'imprudence de mon équipée; je craignois l'indignation de mon pere, et qu'il ne se méfiât de ma conduite dans une ville encore plus éloignée, et où j'aurois beaucoup plus de liberté.
Ma mere m'assura qu'elle tâcheroit de me garantir des reproches de mon pere, qu'elle prendroit tout sur elle, d'autant plus que mon repentir lui paroissoit sincere.
J'avois vraiment assez de raison pour mon âge; mais j'étois sujet à des escapades inconsidérées: elles m'ont fait beaucoup de tort, vous le verrez, et vous me plaindrez peut-être quelquefois.
Retour le mon Pere.-Dialogue entre mon Pere et moi. Mes nouvelles occupations. - Trait de jeunesse.
Ma mere vouloit me produire et me présenter à ses connoissances; mais je n'avois pour tout habillement qu'un vieux surtout qui m'avoit servi sur mer d'habit, de robe-de-chambre et de couvre-pieds.
Elle fit venir un Tailleur, je fus bientôt en état de paroître. J'employai mes premiers pas à aller voir mes compagnons de voyage, ils me virent avec plaisir: ils étoient retenus pour vingt représentations; j'avois mes entrées, je m'étois proposé d'en profiter, sous le bon plaisir de ma tendre mere.
Elle étoit fort liée avec l'Abbé Gennari, Chanoine de la Cathédrale. Ce bon Ecclésiastique étoit un peu rigoriste. Les Spectacles en Italie ne sont pas proscrits par l'Eglise Romaine, les Comédiens ne sont point excommuniés; mais l'Abbé Gennari soutenoit que les Comédies qu'on donnoit alors, étoient dangereuses pour les jeunes gens; il n'avoit peut-être pas tort, et ma mere me défendit le Spectacle.
Il falloit bien obéir; je n'allois pas à la Comédie, mais j'allois voir les Comédiens, et la Soubrette plus fréquemment que les autres. J'ai toujours eu par la suite un goût de préférence pour les Soubrettes.
Au bout de six jours, mon pere arrive; je tremble, ma mere me cache dans le cabinet de toilette, et se charge du reste. Il monte, ma mere va au devant de lui, ma tante aussi, voilà les embrassemens de coutume. Mon pere paroît fâché, sourcilleux: il n'a pas sa gaîté ordinaire, on le croit fatigué, ils entrent dans la chambre; voici les premiers mots de mon pere: Où est mon fils? Ma mere répond de bonne foi: Notre cadet est à sa pension. Non, non, répliqua mon pere en colere, je demande l'aîné, il doit être ici; vous me le cachez, vous avez tort, c'est un impertinent qu'il faut corriger. Ma mere interdite ne savoit que dire: elle prononça des mots vagues: mais... comment?... Mon pere l'interrompt en frappant des pieds: Oui, M. Battaglini m'a instruit de tout, il m'a écrit à Modene, j'ai retrouvé la lettre en y repassant. Ma mere le prie, d'un air affligé, de m'écouter avant que de me condamner. Mon pere, toujours en colere, redemande où j'étois. Je ne puis plus y tenir, j'ouvre la porte vitrée, mais je n'ose pas avancer. Sortez, dit mon pere à sa femme et à sa sœur, laissez-moi seul avec ce bon sujet. Elles sortent, je m'approche en tremblant: ah, mon pere!-Comment, Monsieur! par quel hazard êtes-vous ici? - Mon pere... on vous aura dit. - Oui on m'a dit que, malgré les remontrances, les bons conseils, et en dépit de tout le monde, vous avez eu l'insolence de quitter Rimini brusquement. - Qu'aurois-je fait à Rimini, mon pere? c'étoit du tems perdu pour moi. - Comment, du tems perdu! l'étude de la Philosophie, c'est du tems perdu? - Ah! la Philosophie scholastique, les syllogismes, les enthymêmes, les sophismes, les nego, probo, concedo; vous en souvenez-vous, mon pere? (il ne peut s'empêcher de faire un petit mouvement de levres qui annonçoit l'envie qu'il avoit de rire: j'étois assez fin pour m'en appercevoir, et je pris courage). Ah, mon pere! ajoutai-je, faites-moi apprendre la Philosophie de l'homme, la bonne morale, la physique expérimentale. - Allons, allons, comment es-tu venu jusqu'ici? - Par mer. - Avec qui? - Avec une Troupe de Comédiens. - Des Comédiens? - Ce sont d'honnêtes gens, mon pere. - Comment s'appelle le Directeur? - Il est Florinde sur la scene, et on l'appelle Florinde des Maccaroni. - Ah, ah! je le connois; c'est un brave homme: il jouoit le rôle de Don Juan dans le Festin de Pierre; il s'avisa de manger les maccaroni qui appartenoient à Arlequin, voilà l'origine de ce surnom. - Je vous assure, mon pere, que cette Troupe...- Où est-elle allée cette Troupe? - Elle est ici. - Elle est ici?-Oui, mon pere. - Joue-t-elle la Comédie ici? - Oui, mon pere.-J'irai la voir. - Et moi, mon pere? - Toi, coquin! Comment s'appelle la premiere Amoureuse? - Clarice.-Ah, ah, Clarice!... excellente, laide, mais beaucoup d'esprit. - Mon pere...- Il faudra donc que j'aille les remercier? - Et moi, mon pere? - Malheureux! - Je vous demande pardon. - Allons, allons; pour cette fois-ci...
Ma mere entre, elle avoit tout entendu; elle est très-contente de me voir raccommodé avec mon pere.
Elle lui parle de l'Abbé Gennari, non pas pour m'empêcher d'aller à la Comédie, car mon pere l'aimoit autant que moi, mais pour lui annoncer que ce Chanoine, attaqué de différentes maladies, l'attendoit avec impatience; qu'il avoit parlé à toute la ville de ce fameux Médecin Vénitien, éleve du célebre Lancisi, qu'on attendoit incessamment, et qu'il n'avoit qu'à se montrer pour avoir plus de malades qu'il n'en sauroit désirer.
Cela arriva en eflet; tout le monde vouloit du Docteur Goldoni; il avoit les riches et les pauvres, et les pauvres payoient mieux que les riches.
Il loua donc un appartement plus commode, et il s'établit à Chiozza pour y rester tant que la fortune lui seroit favorable, et jusqu'à ce que quelqu'autre Médecin à la mode vînt le supplanter.
Me voyant oisif, et manquant dans la ville de bons maîtres pour m'occuper, mon pere voulut faire lui-même quelque chose de moi.
Il me destinoit à la Médecine, et en attendant les lettres d'appel pour le College de Pavie, il m'ordonna de le suivre dans les visites qu'il faisoit journellement; il pensoit qu'un peu de pratique avant l'étude de la théorie, me donneroit une connoissance superficielle de la Médecine qui me seroit très-utile pour l'intelligence des mots techniques et des premiers principes de l'art.
Je n'aimois pas trop la Médecine: mais il ne falloit pas être récalcitrant; car on auroit dit que je ne voulois rien faire.
Je suivis donc mon pere: je voyois la plus grande partie de ses malades avec lui; je tâtois le pouls, je regardois les urines, j'examinois les crachats, et bien d'autres choses qui me révoltoient. Patience: tant que la Troupe continua ses représentations, qu'elle porta même jusqu'à trente-six, je me croyois dédommagé.
Mon pere étoit assez content de moi, et ma mere encore davantage. Mais un des trois ennemis le l'homme, et peut-être deux, ou tous les trois, vinrent m'attaquer et troubler ma tranquillité.
Mon pere fut appellé chez une malade fort jeune et fort jolie; il m'emmena avec lui, ne se doutant pas de quelle maladie il s'agissoit. Quand il vit qu'il falloit faire des recherches et des observations locales, il me fit sortir; et depuis ce jour-là, toutes les fois qu'il entroit dans la chambre de Mademoiselle, j'étois condamné à l'attendre dans un sallon fort petit et fort sombre.
La mere de la jeune malade, très-polie et bien honnête créature, ne souffroit pas que je restasse tout seul: elle venoit me tenir compagnie, et me parloit toujours de sa fille.
Grace au talent et aux soins de mon pere, son enfant étoit hors d'affaire; elle se portoit bien, et la visite de ce jour-là devoit être la derniere.
Je lui fis compliment: je la remerciai de sa complaisance pour moi, et je finis par dire: si je n'ai plus l'honneur de vous voir... - Comment, me dit-elle, nous ne vous verrons plus? - Si mon pere n'y vient pas. - Vous y pourrez bien venir. - Pour quoi faire? - Pour quoi faire! Ecoutez, ma fille se porte bien, elle n'a plus besoin de M. le Docteur; mais je ne serois pas fâchée qu'elle eût de tems à autre une visite d'amitié, pour voir... si les choses vont bien... si elle n'auroit pas besoin... de se purger...; si vous n'avez rien de mieux à faire, venez-y quelquefois, je vous en prie. - Mais, Mademoiselle voudroit-elle de moi? - Ah! mon cher ami, ne parlons pas de cela; ma fille vous a vu, elle ne demanderoit pas mieux que de lier connoissance avec vous. - Madame, c'est beaucoup d'honneur pour moi; mais si mon pere venoit à le savoir? - Il ne le saura pas; d'ailleurs ma fille est sa malade, il ne peut pas trouver mauvais que son fils vienne la voir. - Mais, pourquoi ne m'a-t-il pas laissé entrer dans la chambre? - C'est que... la chambre est petite; il fait chaud. - J'entens remuer; mon pere sort, je crois.- Allons, allons; venez nous voir. - Quand? - Ce soir, si vous voulez. - Si je le peux. - Ma fille en sera enchantée. - Et moi aussi.
Mon pere sort: nous nous en allons; je rêve toute la journée, je fais des réfiexions, je change d'avis à chaque instant. Le soir arrive, mon pere alloit à une consultation; et moi, à la nuit tombante, je vais regagner la porte de la malade qui se porte bien.
J'entre: beaucoup de politesses, beaucoup de gentillesses; on m'offre de me rafraîchir, je ne refuse rien; on cherche dans le garde-manger, il n'y a plus de vin; il faudrait en aller chercher, je mets la main à la poche. On frappe, on ouvre; c'est le domestique de ma mere, il m'avoit vu entrer, il connoissoit ces canailles-là; c'est un Ange qui l'a envoyé. Il me dit un mot à l'oreille; je reviens en moi-même, et je sorts dans l'instant.
Mon départ pour Venise.-Coup-d'œil le cette ville. Mon installation chez le Procureur.
Revenu de cet aveuglement où m'avoit plongé l'effervescence de la jeunesse, je regardois avec horreur le danger que j'avois couru.
J'étois naturellement gai, mais sujet, depuis mon enfance, à des vapeurs hypocondriaques ou mélancoliques, qui répandoient du noir dans mon esprit.
Attaqué d'un accès violent de cette maladie léthargique, je cherchois à me distraire, et je n'en trouvois pas les moyens; mes Comédiens étoient partis, Chiozza ne m'offroit plus d'amusement de mon goût, la Médecine me déplaisoit; j'étois devenu triste, rêveur: je maigrissois à vue d œil.
Mes parens ne tarderent pas à s'en appercevoir: ma mere me questionna la premiere: je lui confiai mes chagrins.
Un jour que nous étions à table en famille, sans convives étrangers et sans valets, ma mere fit tomber la conversation sur mon compte, et il y eut un débat de deux heures; mon pere vouloit absolument que je m'appliquasse à la Médecine: j'avois beau me remuer, faire des mines, bouder, il n'en démordoit pas; ma mere enfin prouva à mon pere qu'il avoit tort, et voici comment.
Le Marquis de Goldoni, dit-elle, veut bien prendre soin de notre enfant. Si Charles est un bon Médecin, son Protecteur pourra le favoriser, il est vrai, mais pourra-t-il lui donner des malades? Pourra-t-il engager le monde à le préférer à tant d'autres? Il pourroit lui procurer une place de Professeur dans l'Université de Pavie; mais, combien de tems et combien de travail pour y parvenir! Au contraire, si mon fils étudioit le Droit, s'il étoit Avocat, un Sénateur de Milan pourroit faire sa fortune sans la moindre peine et sans la moindre difficulté.
Mon pere ne répondit rien: il garda le silence pendant quelques minutes; il se tourna ensuite de mon côté, et me dit en plaisantant: Aimerois-tu le Code et le Digeste de Justinien? Oui, mon pere, répondis-je, beaucoup plus que les Aphorismes d'Hippocrate. Ta mere, reprit-il, est une femme: elle m'a dit de bonnes raisons et je pourrois bien m'y rendre; mais en attendant il ne faut pas rester sans rien faire, tu me suivras toujours. Me voilà encore dans le chagrin. Ma mere alors prend vivement mon parti; elle conseille mon pere de m'envoyer à Venise, de me placer chez mon oncle Indric, un des meilleurs Procureurs du Barreau de la capitale, et se propose de m'y accompagner elle-même et d'y rester avec moi jusqu'à mon départ pour Pavie. Ma tante appuie le projet de sa sœur; je leve les mains et je pleure de joie; mon pere y consent; j'irai donc incessamment à Venise.
Me voilà content: mes vapeurs se dissipent dans l'instant. Quatre jours après nous partons, ma mere et moi: il n'y a que huit lieues de traversée; nous arrivons à Venise à l'heure de dîner; nous allons nous loger chez M. Bertani, oncle maternel de ma mere, et le lendemain nous nous rendons chez M. Indric.
Nous fûmes reçus très-honnêtement. M. Paul Indric avoit épousé ma tante paternelle. Bon mari et bon pere, bonne mere et bonne femme, des enfans très-bien élevés: c'étoit un ménage charmant. Je fus installé dans l'étude; j'étois le quatrieme Clerc, mais je jouissois des privileges que la consanguinité ne pouvoit pas manquer de me procurer.
Mon occupation me paroissoit plus agréable que celle que mon pere me donnoit à Chiozza; mais l'une devoit être pour moi aussi inutile que l'autre.
En supposant que je dusse exercer la profession d'Avocat à Milan, je n'aurois pas pu profiter de la pratique du Barreau de Venise, inconnue à tout le reste de l'Italie; on n'auroit jamais pu deviner que, par des aventures singulieres et forcées, j'aurois plaidé un jour dans ce même Palais, où je me regardois alors comme un étranger.
Faisant exactement mon devoir et méritant les éloges de mon oncle, je ne laissois pas de profiter de l'agréable séjour de Venise, et de m'y amuser. C'étoit mon pays natal; mais j'étois trop jeune quand je l'avois quitté, et je ne le connoissois pas.
Venise est une ville si extraordinaire, qu'il n'est pas possible de s'en former une juste idée sans l'avoir vue. Les cartes, les plans, les modeles, les descriptions ne suffisent pas, il faut la voir. Toutes les villes du monde se ressemblent plus ou moins: celle-ci ne ressemble à aucune; chaque fois que je l'ai revue, après de longues absences, c'étoit une nouvelle surprise pour moi; à mesure que mon âge avançoit, que mes connoissances augmentoient, et que j'avois des comparaisons à faire, j'y découvrois des singularités nouvelles et de nouvelles beautés.
Pour cette fois-ci, je l'ai vue comme un jeune homme de quinze ans qui ne pouvoit pas approfondir ce qu'il y avoit de plus remarquable et qui ne pouvoit la comparer qu'a des petites villes qu'il avoit habitées. Voici ce qui m'a frappé davantage. Une perspective surprenante au premier abord, une étendue très-considérable de petites îles si bien rapprochées et si bien réunies par des ponts, que vous croyez voir un continent élevé sur une plaine, et baigné de tous les côtés d'une mer immense qui l'environne.
Ce n'est pas la mer, c'est un marais très-vaste plus ou moins couvert d'eau, à l'embouchure de plusieurs ports, avec des canaux profonds qui conduisent les grands et les petits navires dans la ville et aux environs.
Si vous entrez du côté de Saint-Marc, à travers une quantité prodigieuse de bâtimens de toute espece, vaisseaux de guerre, vaisseaux marchands, frégates, galeres, barques, bateaux, gondoles, vous mettez pied à terre sur un rivage appellé la Piazzetta (la petite Place), où vous voyez d'un côté le Palais et l'Eglise Ducales, qui annoncent la magnificence de la République; et de l'autre, la Place Saint-Marc, environnée de portiques élevés sur les dessins de Palladio et de Sansovin.
Vous allez par les rues de la Mercerie jusqu'au pont de Rialto, vous marchez sur des pierres quarrées de marbre d'Istrie, et piquetées à coup de ciseau pour empêcher qu'elles ne soient glissantes; vous parcourez un local qui représente une foire perpétuelle, et vous arrivez à ce Pont qui, d'une seule arche de quatre-vingt-dix pieds de largeur, traverse le grand canal, qui assure par son élévation le passage aux barques et aux bateaux dans la plus grande crue du flux de la mer, qui offre trois différentes voies aux passagers, et qui soutient sur sa courbe vingt-quatre boutiques avec logemens et leurs toits couverts en plomb.
J'avoue que ce coup-d'œil m'a paru surprenant; je ne l'ai pas trouvé rendu tel qu'il est par les Voyageurs que j'ai lus. Je demande pardon à mon Lecteur, si je me suis un peu délecté.
Je n'en dirai pas davantage pour le présent: je me réserve de donner quelqu'idée des mœurs et des usages de Venise, de ses loix et de sa constitution, à mesure que les circonstances m'y rameneront, et que mes lumieres auront acquis plus de consistance et de précision. Je finirai ce Chapitre par une relation succinte de ses Spectacles.
Les salles de Spectacles en Italie s'appellent Théatres. Il y en a sept à Venise, portant chacun le nom du Saint titulaire de sa paroisse.
Le Théâtre de Saint Jean-Chrisostôme étoit alors le premier de la ville, où l'on donnoit les grands Opéras, où débuta Métastase par ses Drames, et Farinello, Faustine et la Cozzoni, dans le chant.
Aujourd'hui c'est celui de Saint Benoît qui a pris le premier rang.
Les six autres s'appellent Saint Samuel, Saint Luc, Saint Ange, Saint Cassian et Saint Moïse.
De ces sept Théâtres, il y en a ordinairement deux de grands Opéras, deux d'Opéra-comique et trois de Comédies.
Je parlerai de tous en particulier, quand je deviendrai l'Auteur à la mode de ce pays-là; car il n'y en a pas un seul qui n'ait eu de mes Ouvrages, et qui n'ait contribué à mon profit et à mon honneur.
Mon départ pour Pavie. - Mon arrivée à Milan. - Premiere entrevue avec le Marquis de Goldoni. Difficultés surmontées.
Je m'acquittois assez bien dans mon emploi chez le Procureur à Venise: j'avois beaucoup de facilité pour faire le sommaire et le résumé d'un procès; mon oncle auroit bien voulu me garder, mais une lettre de mon pere vint me rappeller à lui.
La place dans le College du Pape étoit devenue vacante: elle avoit été arrêtée pour moi; le Marquis de Goldoni nous en faisoit part, et nous conseilloit de partir.
Nous quittâmes Venise, ma mere et moi, et nous nous rendîmes à Chiozza. Les paquets furent faits, les coffres cordés, ma mere en pleurs, ma tante aussi; mon frere, qu'on avoit fait sortir de sa pension, auroit bien voulu partir avec moi; la séparation fut d'un pathétique touchant, mais la chaise arrive, il faut se quitter.
Nous prîmes la route de Rovigo et Ferrare; et de-là nous arrivâmes à Modene, où nous restâmes, pendant trois jours, logés chez M. Zavarisi, Notaire très-accrédité dans cette ville, et notre proche parent du côté des femmes.
Ce brave et digne garçon avoit entre ses mains toutes les affaires de mon pere: c'étoit lui qui touchoit nos rentes à l'Hôtel-de-ville et le loyer des maisons, il nous fournit de l'argent, et nous allâmes à Plaisance.
Là, mon pere ne manqua pas d'aller visiter son cousin Barilli, qui n'avoit pas rempli tout-à-fait ses engagemens, et le conduisit doucement à s'acquitter des arrérages des deux années révolues qu'il nous devoit; de maniere que nous étions assez bien munis d'argent comptant; il nous a été très-utile dans les circonstances imprévues où nous nous sommes trouvés depuis.
En arrivant à Milan, nous prîmes notre logement à l'auberge des Trois-Rois, et le jour suivant nous allâmes faire notre visite au Marquis et Sénateur Goldoni.
Nous fûmes reçus on ne peut pas plus agréablement; mon Protecteur parut content de moi: je l'étois parfaitement de lui. On parla de College, on destina même le jour que nous devions nous rendre à Pavie; mais M. le Marquis me regardant plus attentivement, demanda à mon pere et à moi pourquoi j'étois en habit séculier, pourquoi je n'avois pas le petit collet.
Nous ne savions pas ce que cela vouloit dire; bref, nous fûmes instruits pour la premiere fois que, pour entrer dans le College Ghislieri, dit le College du Pape, il falloit de toute nécessité, 1° que les Boursiers fussent tonsurés; 2° qu'ils eussent un certificat de leur état civil et de leur conduite morale; 3° autre certificat de n'avoir pas contracté de mariage; 4° leur extrait de baptême.
Nous restâmes interdits, mon pere et moi, personne ne nous en avoit prévenus; M. le Sénateur étoit persuadé que nous devions en être instruits, il en avoit chargé son Secrétaire; il lui avoit donné une note pour nous l'envoyer. Le Secrétaire l'avoit oublié: cette note étoit restée dans son bureau. Bien des excuses, bien des pardons; son maître étoit bon: nous n'aurions rien gagné à faire les méchans.
Il falloit y remédier: mon pere prit le parti d'écrire à sa femme. Elle se transporta à Venise, sollicita de tous les côtés; les certificats d'état libre et de bonnes mœurs n'offroient aucune difficulté, l'extrait de baptême encore moins; le grand embarras étoit celui de la tonsure, le Patriarche de Venise ne vouloit pas accorder des lettres dimissoriales sans la constitution du patrimoine ordonné par les canons de l'Eglise. Comment faire? Les biens de mon pere n'existoient pas dans les Etats de Venise, ceux de ma mere étoient des biens substitués; il falloit recourir au Sénat pour en avoir la dispense. Que de longueurs! que de contradictions! combien de tems perdu! M. le Secrétaire sénatorial, avec ses excuses et sa gaucherie, nous a coûté bien cher. Patience: ma mere se donna des soins qui lui réussirent enfin; mais pendant qu'elle travaille pour son fils à Venise, que ferons-nous à Milan? Voici ce que nous avons fait.
Nous restâmes pendant quinze jours à Milan, dînant et soupant tous les jours chez mon Protecteur, qui nous faisoit voir ce qu'il y avoit de plus beau dans cette ville magnifique, qui est la capitale de la Lombardie Autrichienne. Je ne dirai rien de Milan pour l'instant: je dois le revoir, et j'en parlerai à mon aise quand je serai plus digne d'en parler. Pendant ce tems-là, on me fit changer de costume: je pris le petit collet; nous partîmes ensuite pour Pavie, bien munis de lettres de recommandation. Nous nous logeâmes et nous mîmes en pension dans une bonne maison bourgeoise, et je fus présenté au Supérieur du College où je devois être reçu.
Nous avions une lettre du Sénateur Goldoni pour M. Lauzio, Professeur en Droit: il me conduisit lui-même à l'Université, je le suivis dans la classe qu'il occupoit, et je ne perdois pas mon tems en attendant le titre de Collégien.
M. Lauzio étoit un Jurisconsulte du plus grand mérite. Il avoit une Bibliotheque très-riche; j'en étois le maître comme je l'étois de sa table, et Madame son épouse avoit beaucoup de bontés pour moi. Elle étoit encore assez jeune, et elle auroit dû être jolie, mais elle étoit furieusement défigurée par un goître monstrueux qui lui pendoit du menton à la gorge. Ces bijoux ne sont pas rares à Milan et à Bergame; mais celui de Madame Lauzio étoit d'une espece particuliere, car il avoit une petite famille de petits goîtres autour de lui. La petite vérole est un grand fléau pour les femmes; mais je ne crois pas qu'une jeune personne qui en seroit picotée, troquât ses piqûres contre un goître milanois.
Je profitai beaucoup de la Bibliotheque du Professeur; je parcourus les Instituts du Droit Romain, et je meublai ma tête des matieres pour lesquelles j'étois destiné.
Je ne m'arrêtois pas toujours sur les textes de la Jurisprudence; il y avoit des tablettes garnies d'une collection de Comédies anciennes et modernes, c'étoit ma lecture favorite; je me proposois bien de partager mes occupations entre l'étude légale et l'étude comique, pendant tout le tems de ma demeure à Pavie; mais mon entrée au College me causa plus de dissipation que d'application, et j'ai bien fait de profiter de ces trois mois que je dus attendre les lettres dimissoriales et les certificats de Venise.
J'ai relu avec plus de connoissances et avec plus de plaisir les Poëtes Grecs et Latins, et je me disois à moi-même: Je voudrois bien pouvoir les imiter dans leurs plans, dans leurs styles, pour leur précision; mais je ne serois pas content si je ne parvenois pas à mettre plus d'intérêt dans mes Ouvrages, plus de caracteres marqués, plus de comique et des denouemens plus heureux.
Facile inventis addere.
Nous devons respecter les grands maîtres qui nous ont frayé le chemin des sciences et des arts; mais chaque siecle a son génie dominant, et chaque climat a son goût nátional. Les Auteurs Grecs et Romains ont connu la Nature, et l'ont suivie de près; mais ils l'ont exposée sans gaze et sans ménagement.
C'est pourquoi les Peres de l'Eglise ont écrit contre les Spectacles, et les Papes les ont excommuniés; la décence les a corrigés, et l'anathême a été révoqué en Italie; il devroit l'être bien plus en France, c'est un phénomene que je ne puis concevoir.
Fouillant toujours dans cette Bibliotheque, je vis des Théâtres Anglois, des Théâtres Espagnols et des Théâtres. François; je ne trouvai point de Théâtres Italiens.
Il y avoit par-ci, par-là, des Pieces Italiennes de l'ancien tems, mais aucun Recueil, aucune Collection qui pussent faire honneur à l'Italie.
Je vis avec peine qu'il manquoit quelque chose d'essentiel à cette Nation, qui avoit connu l'Art dramatique avant toute autre Nation moderne, je ne pouvois pas concevoir comment l'Italie l'avoit négligé, l'avoit avili et abâtardi: je desirois avec passion voir ma patrie se relever au niveau des autres, et je me promettois d'y contribuer.
Mais voici une lettre de Venise qui nous apporte les dimissoriales, les certificats et mon extrait de baptême. Cette derniere piece manqua nous mettre dans un nouvel embarras.
Il falloit attendre deux ans pour que je parvinsse à l'âge requis pour ma réception au College; je ne sais pas quel a été le Saint qui a fait le miracle, mais je sais bien que je me suis couché un jour n'ayant que seize ans, et que le lendemain à mon réveil j'en avois dix-huit.
Mon installation au College. - Mes dissipations.
Ma mere avoit remédié avec adresse au défaut de patrimoine pour obtenir les lettres dimissoriales du Patriarche de Venise; un Secrétaire du Sénat (M. Cavanis) les fit expédier, à condition que, si j'étois dans le cas d'embrasser l'état Ecclésiastique, il y auroit une rente constituée en ma faveur.
Je reçus donc la tonsure des mains du Cardinal Cusani, Archevêque de Pavie, et j'allai avec mon pere, en sortant de la Chapelle de Son Eminence, me présenter au College.
Le Supérieur, qu'on appelle le Préfet, étoit l'Abbé Bernerio, Professeur en Droit Canon à l'Université, Protonotaire Apostolique; et en vertu d'une Bulle de Pie V, jouissant du titre de Prélat sujet immédiat du Saint Siege.
Je fus reçu par le Préfet, le Vice-Préfet et l'Aumonier. On me fit un petit sermon; on me présenta aux plus anciens des Eleves. Me voilà installé: mon pere m'embrasse il me quitte, et le lendemain il prend la route de Milan pour s'en retourner chez lui.
J'abuse un peu trop, peut-être, mon cher Lecteur, de votre complaisance; je vous entretiens de miseres qui ne doivent pas vous intéresser, et qui ne vous amusent pas davantage; mais je voudrois bien vous parler de ce College où j'aurois dû faire ma fortune, et où j'ai fait mon malheur. Je voudrois vous avouer mes torts, et en même tems vous prouver qu'à mon âge, et dans la position où j'étois, il falloit une vertu supérieure pour les éviter. Ecoutez-moi avec patience.
Nous étions bien nourris dans ce College, et très-bien logés; nous avions la liberté de sortir pour aller à l'Université, et nous allions par-tout: l'ordonnance étoit de sortir deux à deux et de rentrer de même; nous nous quittions à la premiere rue qui tournoit, en nous donnant rendez-vous pour rentrer, et si nous rentrions seuls, le Portier prenoit la piece et ne disoit mot. Cette place lui valoit celle d'un Suisse de Ministre d'Etat.
Nous étions bien mis aussi élégamment que les Abbés qui courent les sociétés: drap d'Angleterre, soie de France, broderies, dentelles, avec une espece de robe-de-chambre sans manches par-dessus l'habit, et une étole de velours attachée à l'épaule gauche, avec les armes Ghislieri brodées en or et argent, surmontées par la thiare pontificale et les clefs de Saint Pierre. Cette robe appellée sovrana, qui est la devise du College, donne un air d'importance qui releve la coquetterie du jeune homme. Ce College n'étoit pas, comme vous voyez, une communauté d'enfans: on faisoit précisément tout ce que l'on vouloit; beaucoup de dissipations dans l'intérieur, beaucoup de liberté au dehors. C'est là où j'ai appris à faire des armes, la danse, la musique et le dessin; c'est là aussi où j'ai appris tous les jeux possibles de commerce et de hasard. Ces derniers étoient défendus, mais on ne les jouoit pas moins, et celui de la Prime me coûta cher.
Quand nous étions sortis, nous regardions l'Université de loin, et nous allions nous fourrer dans les maisons les plus agréables; aussi les Collégiens à Pavie sont regardés par les gens de la ville comme les Officiers dans les garnisons; les hommes les détestent, et les femmes les reçoivent.
Mon jargon Vénitien plaisoit aux Dames, et me donnoit quelqu'avantage sur mes camarades; mon âge et ma figure ne déplaisoient pas; mes couplets et mes chansonnettes n'étoient pas mal goûtées.
Est-ce ma faute si j'ai mal employé mon tems? Oui; car parmi les quarante que nous étions, il y en avoit quelquesuns de sages et morigenés que j'aurois dû imiter; mais je n'avois que seize ans: j'étois gai, j'étois foible: j'aimois le plaisir, et je me laissois séduire et entramer.
En voilà assez pour cette premiere année de College; les vacances vont s'approcher: elles commencent vers la fin de Juin, et on ne revient qu'à la fin d'Octobre.
Mes premieres vacances. - Lecture intéressante. - Mon départ pour Modene. - Aventure comique.
Quatre mois de vacances! soixante lieues pour aller chez moi, et autant pour revenir! On ne payoit pas de pension dans ce College; mais cette dépense n'étoit pas indifférente.
J'aurois pu rester en pension à Pavie, mais aucun Collégien étranger n'y restoit. On ne porte pas la sovrana dans ce tems-là; et n'ayant pas les armes du Pape sur nos épaules, il y avoit à craindre que les bourgeois de Pavie ne voulussent nous contester certains droits de préférence dont nous étions accoutumés de jouir.
J'étois sûr d'ailleurs que je ferois le plus grand plaisir à ma mere, si j'allois la rejoindre. Je pris donc ce parti-là; et étant court d'argent, je fis la route par eau, ayant pour mon domestique et mon guide un frere du Sommelier du College. Ce voyage n'eut rien de remarquable. J'avois quitté Chiozza en habit séculier, j'y revins en habit ecclésiastique: mon petit collet n'inspiroit pas trop la dévotion; mais ma mere qui étoit pieuse, crut recevoir chez elle un Apôtre. Elle m'embrassa avec une certaine considération, et me pria de corriger mon frere qui lui donnoit du chagrin.
C'étoit un garcon très-vif, très-emporté, qui fuyoit l'école pour aller à la pêche, qui à onze ans se battoit comme un diable et se moquoit de tout le monde. Mon pere, qui le connoissoit bien, le destinoit à la guerre; ma mere vouloit en faire un Moine, c'étoit entr'eux un sujet continuel de disputes.
Je m'embarrassois fort peu de mon frere: je cherchois à me distraire, et je n'en trouvois pas les moyens; Chiozza me parut maussade plus que jamais. J'avois autrefois une petite Bibliotheque: je cherchai mon ancien Cicognini, et je n'en ai trouvé qu'une partie; mon frere avoit employé le reste à faire des papillotes.
Le Chanoine Gennari étoit toujours l'ami de la maison: mon pere l'avoit guéri de tous les maux qu'il avoit et qu'il n'avoit pas; il étoit plus chez nous que chez lui. Je le priai de me procurer quelques livres, mais dans le genre dramatique, si c'étoit possible. M. le Chanoine n'étoit pas familiarisé avec la littérature; il me promit cependant qu'il feroit son possible pour m'en trouver, et il me tint parole.
Il m'apporta, quelques jours après, une vieille Comédie reliée en parchemin, et sans se donner la peine de la lire, me la confia, et me fit bien promettre de la lui rendre incessamment; car il l'avoit prise sans rien dire dans le cabinet d'un de ses confreres.
C'étoit la Mandragore de Machiavelli. Je ne la connoissois pas; mais j'en avois entendu parler, et je savois bien que ce n'étoit pas une piece très-chaste.
Je la dévorai à la premiere lecture, et je l'ai relue dix fois. Ma mere ne faisoit pas attention au livre que je lisois, car c'étoit un Ecclésiastique qui me l'avoit donné; mais mon pere me surprit un jour dans ma chambre, pendant que je faisois des notes et des remarques sur la Mandragore. Il la connoissoit: il savoit combien cette piece étoit dangereuse pour un jeune homme de dix-sept ans; il voulut savoir de qui je la tenois, je le lui dis; il me gronda amerement, et se brouilla avec ce pauvre Chanoine qui n'avoit péché que par nonchalance.
J'avois des raisons très-justes et très-solides pour m'excuser vis-à-vis de mon pere; mais il ne voulut pas m'écouter.
Ce n'étoit pas le style libre ni l'intrigue scandaleuse de la piece qui me la faisoient trouver bonne; au contraire, sa lubricité me révoltoit, et je voyois par moi-même que l'abus de confession étoit un crime affreux devant Dieu et devant les hommes; mais c'étoit la premiere piece de caractere qui m'étoit tombée sous les yeux, et j'en étois enchanté. J'aurois desiré que les Auteurs Italiens eussent continué, d'après cette Comédie, à en donner d'honnêtes et décentes, et que les caracteres puisés dans la Nature eussent remplacé les intrigues romanesques.
Mais il étoit réservé à Moliere l'honneur d'ennoblir et de rendre utile la scene comique, en exposant les vices et les ridicules à la dérision et à la correction.
Je ne connoissois pas encore ce grand homme, car je n'entendois pas le François; je me proposois de l'apprendre, et en attendant je pris l'habitude de regarder les hommes de près, et de ne pas échapper les originaux.
Déjà les vacances tiroient à leur fin: il falloit partir; un Abbé de notre connoissance devoit aller à Modene, mon pere profita de l'occasion, et me fit prendre cette route, d'autant plus volontiers, que dans cette ville on devoit me fournir de l'argent.
Nous nous embarquâmes, mon compagnon de voyage et moi, avec le Courier de Modene, nous y arrivâmes en deux jours de tems, et nous allâmes loger chez un Locataire de mon pere qui louoit en chambres garnies.
Il y avoit dans cette maison une Servante qui n'étoit ni vieille ni jeune, ni laide ni jolie: elle me regardoitd'un œil d'amitié, et prenoit soin de moi avec des attentions singulieres; je badinois avec elle, elle s'y prêtoit de bonne grace, et de tems en tems elle laissoit tomber quelques larmes. Le jour de mon départ, je me leve de bonne heure pour achever mes paquets; voilà Toinette (c'étoit le nom de la fille) qui vient dans ma chambre, et qui m'embrasse sans autres préliminaires; je n'étois pas assez libertin pour en tirer parti: je l'évite; elle insiste, et veut partir avec moi. - Avec moi! - Oui, mon cher ami, ou je me jette par la fenêtre. - Mais, je vais en chaise de poste. - Eh bien, nous ne serons que nous deux. - Mon Domestique. - Il est fait pour monter derriere. Le maître et la maîtresse cherchent Toinette par-tout. Ils entrent: ils la trouvent fondant en larmes. -Qu'est-ce que c'est? - Ce n'est rien. Je me dépêche: il faut partir. J'avois destiné un sequin pour Toinette: elle pleure je ne sais comment faire; j'allonge le bras, je lui offre la piéce: elle la prend, la baise; et tout en pleurant, la met dans sa poche.
Route pour Pavie. - Bonne fortune à Plaisance. - Entrevue avec le Marquis de Goldoni. - Seconde année de College.
J'avois bien de quoi payer la poste jusqu'à Pavie; mais n'ayant pas trouvé à Modene mon cousin Zavarisi, qui avoit ordre de me donner quelqu'argent, je serois resté au dépourvu dans mon College, où MM. les Boursiers ont besoin d'une bourse pour leurs menus plaisirs.
J'arrive le même jour sur le soir à Plaisance, j'avois une lettre de recommandation de mon pere pour le Conseiller Barilli; je vais le voir, il me reçoit poliment, il m'offre de me loger chez lui: j'accepte, comme de raison. Il étoit malade, il avoit envie de se reposer, et moi aussi; nous soupâmes à la hâte, et nous nous couchâmes de bonne heure.
Je rêvois toujours sur ma position, j'étois tenté d'emprunter cent écus à mon cher parent, qui me paroissoit si bon et si honnête; mais il ne devoit plus rien à mon pere, il s'étoit acquitté énvers lui avant même l'échéance des deux derniers payemens, et je craignois que mon âge et ma qualité d'Ecolier ne fussent pas des garans biens sûrs pour lui inspirer de la confiance.
Je me couchai avec mes irrésolutions et mes craintes; mais, graces au Ciel, ni les embarras, ni les chagrins, ni les réflexions, n'ont jamais pris sur mon appétit, non plus que sur mon sommeil, et je dormis tranquilleínent.
Le lendemain M. le Conseiller me fait proposer si je veux venir déjeûner avec lui. J'étois coëffé et habillé; je descends, tout étoït prêt. Un bouillon pour mon hôte, une tasse de chocolat pour moi; et tout en déjeûnant, et tout en causant, voici comment la conversation devint intéressante.
Mon cher enfant, me dit-il, je suis vieux, j'ai eu une attaque dangereuse, et j'attends tous les jours les ordres de la Providence pour déloger de ce monde. Je voulois lui dire les choses honnêtes que l'on dit en pareil cas, il m'interrompit, en disant: Point de flatterie, mon ami; nous sommes nés pour mourir, et ma carriere est très-avancée. J'ai satisfait, continua-t-il, M. votre pere, pour un reste de dot que ma famille devoit à la sienne; mais en feuilletant dans les papiers et dans les registres de mes affaires domestiques j'ai trouvé un compte ouvert entre M. Goldoni votre grand- pere et moi. (Oh, ciel! me disois-je à moi-même est-ce que nous lui devrions quelque chose?) J'ai bien examiné, ajouta M. le Conseiller; j'ai bien collationné les lettres et les livres, et je suis sûr que je dois encore une somme à sa succession. Je respire; je veux parler: il m'interrompit toujours, et continue son discours.
Je ne voudrois pas mourir, dit-il, sans m'en acquitter; j'ai des héritiers qui n'attendent que mon trépas pour dissiper les biens que je leur ai ménagés, et M. votre pere auroit bien de la peine à se faire payer. Ah! continua-t-il, s'il étoit ici, avec quel plaisir je lui donnerois cet argent!
Monsieur, lui dis-je, d'un air d'importance, je suis son fils: Pater et filius censentur una et eadem persona. C'est Justinien qui le dit; vous le savez mieux que moi. Ah, ah! dit-il, vous étudiez donc le Droit! Oui, Monsieur, répondis-je, et je serai licencié dans peu; j'irai à Milan, et je compte y exercer la profession d'Avocat. Il me regarde en souriant, et me demande: Quel âge avez-vous? J'étois un peu embarrassé, car mon extrait de baptême et ma réception au College n'alloient pas d'accord; je répondis cependant avec assurance, et sans mentir: Monsieur, j'ai dans ma poche les lettres-patentes de mon College, voulez-vous les voir? Vous verrez que j'ai été reçu à dix-huit ans passés; voici ma seconde année; dix-huit et deux font vingt, je touche au vingt-unieme: Annus inceptus habetur pro completo; et selon le code Vénitien, on acquiert la majorité à vingt-un ans. (Je cherchois à embrouíller la chose mais je n'en avois que dix- neuf.)
M. Barilli n'en fut pas la dupe; il voyoit bien que j'étois encore dans la minorité, et qu'il auroit hasardé son argent. Il avoit cependant, en ma faveur, une recommandation de mon pere, pourquoi m'auroit-il cru capable de le tromper? Mais il changea de discours; il me demanda pourquoi je n'avois pas suivi l'état de mon pere, et ne parloit plus d'argent. Je répondis que mon goût n'étoit pas pour la Médecine; et revenant tout de suite au propos qui m'intéressoit: - Oserois-je, Monsieur, vous demander, lui dis-je, quelle est la somme que vous croyez devoir à mon pere? - Deux mille livres, dit-il; deux mille livres de ce pays-ci (environ six cents livres tournois); l'argent est là dans ce tiroir; mais il n'y touchoit pas. - Monsieur, ajoutai-je avec une curiosité un peu vive, est-ce en or ou en argent? - C'est en or, dit-il, en sequins de Florence, qui, après ceux de Venise, sont les plus recherchés. - C'est bien commode, dis-je, pour les transporter. - Voudriez-vous, me dit-il, d'un air goguenard, vous en charger? - Avec plaisir, Monsieur, répondis-je: je vais vous faire ma reconnoissance; j'en donnerai avis à mon pere, et je lui en tiendrai compte. - Le dissiperez-vous, dit-il, le dissiperez- vous cet argent? - Hélas, Monsieur! repris-je avec vivacité, vous ne me connoissez pas; je ne suis pas capable d'une mauvaise action: l'Aumônier du College est le Caissier que mon pere m'a destiné pour mon petit revenu; sur mon honneur, Monsieur, en arrivant à Pavie, je mettrai les sequins entre les mains de ce digne Abbé.
Enfin, dit-il, je veux bien m'en rapporter à votre bonne foi: écrivez, faites-moi la reconnoissance, dont voici le modele que j'avois déjà préparé. - Je prends la plume; M. Barilli ouvre le tiroir, met les sequins sur le secrétaire; je les regarde avec attendrissement. - Mais, arrêtez, arrêtez, me dit-il, vous êtes en voyage, il y a des voleurs. - Je lui fais remarquer que je vais en poste, qu'il n'y a rien à craindre; il me croit seul, il y voit toujours du danger; je fais entrer mon guide, le frere du Sommelier; M. Barilli en paroît content; il lui fait un sermon aussi bien qu'à moi: je tremble toujours; enfin il me donne l'argent, et me voilà consolé.
Nous dînons, M. le Conseiller et moi; après le dîner les chevaux arrivent: je fais mes adieux, je pars et je prends la route de Pavie.
A peine arrivé dans cette ville, je vais remettre entre les mains de mon Caissier les sequins: j'en demande six pour moi, il me les donne; et je sus si bien ménager le reste de cette somme, que j'en eus suffisamment pour toute mon année au College et pour mon retour.
J'étois cette année-là un peu moins dissipé que l'autre; je suivois mes leçons à l'Université, et j'acceptois rarement les parties de plaisir qu'on me proposoit.
Il y eut dans le mois d'Octobre et dans celui de Novembre, quatre de mes camarades licenciés. Il semble qu'en Italie on ne puisse faire aucune cérémonie qu'elle ne soit décorée d'un sonnet. Je passois pour avoir de la facilité pour les vers, et j'étois devenu le panégyriste des bons et des mauvais sujets.
Dans les vacances de Noël, M. le Marquis de Goldoni vint à Pavie, à la tête d'une Commission du Sénat de Milan, pour visiter un canal dans le Pavois, qui avoit donné lieu à plusieurs procès; il me fit l'honneur de me demander et de m'emmener avec lui. Au bout de six jours, je revins au College glorieux de la partie honorable que je venois de faire. Cette ostentation me fit un tort infini, elle excita l'envie de mes camarades, qui, peut-être, dès-lors méditerent contre moi la vengeance qu'ils firent éclater l'année suivante.
Deux d'entr'eux me tendirent un piege qui manqua de me perdre. Ils m'emmenerent dans un mauvais lieu que je ne connoissois pas; j'en voulois sortir, les portes étoient fermées; je sautai par la fenêtre, cela fit du bruit, le Préfet du College le sut. Je devois me justifier, et je ne pouvois le faire qu'en chargeant les coupables; dans pareil cas, sauve qui peut. Il y en eut un d'expulsé, l'autre fut aux arrêts; mais voila bien du monde contre moi!
Les vacances arrivent, j'avois bien envie d'aller les passer à Milan, et prévenir mon Protecteur du désagrément qui m'étoit arrivé; mais deux personnes de mon pays que je rencontrai par hasard au jeu de paume, me firent changer d'avis. C'étoient le Secrétaire et le Maître-d'hôtel du Résident de la République de Venise à Milan. Ce Ministre (M. Salvioni) venoit de mourir, il falloit que sa suite et ses équipages fussent transportés à Venise; ces deux Messieurs étoient à Pavie pour louer un bateau couvert, ils m'offrirent de m'emmener avec eux; ils m'assurerent que la société étoit charmante, que je ne manquerois ni de bonne chere, ni de parties de jeu, ni de bonne musique, et tout cela gratis; pouvois-je me refuser à une si belle occasion?
J'acceptai sans hésiter un instant; mais comme ils ne partoient pas de sitôt, je devois attendre, et le College alloit se fermer. Le Préfet, très-honnêtement, et pour plaire, peut-être, à mon Protecteur, voulut me garder auprès de lui; voilà un nouveau crime envers mes confreres: cette partialité du Supérieur pour moi les irrita davantage; les méchans! J'en ai été bien puni.
Charmant voyage. - Sermon de ma façon. - Retour à Pavie par la Lombardie. - Agréable rencontre. - Danger d'assassinat. - Station à Milan chez le Marquis de Goldoni.
Aussi-tôt que la compagnie fut prête à partir, on m'envoya chercher. Je me rendis au bord du Tesino, et j'entrai dans le bateau couvert, où tout le monde s'étoit rendu.
Rien de plus commode, rien de plus élégant que ce petit bâtiment appellé Burchiello, et que l'on avoit fait venir exprès de Venise. C'étoit une salle et une anti-salle couvertes en bois, surmontées d'une balustrade, éclairées des deux côtés, et ornées de glaces, de peintures, de sculptures, d'armoires, de bancs et de chaises de la plus grande commodité. C'étoit bien autre chose que la barque des Comédiens de Rimini.
Nous étions dix maîtres et plusieurs domestiques. Il y avoit des lits sous la proue et sous la poupe; mais on ne devoit voyager que de jour; on avoit de plus décidé qu'on coucheroit dans de bonnes auberges, et qu'où il n'y en auroit pas, on iroit demander l'hospitalité aux riches Bénédictins qui possedent des biens immenses sur les deux rives du Po. Tous ces Messieurs jouoient de quelqu'instrument. Il y avoit trois violons, un violoncelle, deux hauts-bois, un cor-de- chasse et une guitarre. Il n'y avoit que moi qui n'étoit bon à rien, j'en étois honteux, et pour tâcher de réparer le défaut d'utilité, je m'occupois pendant deux heures tous les jours, à mettre en vers, tant bons que mauvais, les anecdotes et les agrémens de la veille. Cette galanterie faisoit grand plaisir à mes compagnons de voyage, et c'étoit leur amusement et le mien après le café.
La musique étoit leur occupation favorite. A la chute du jour ils se rangeoient sur une espece de tillac qui faisoit le toit de l'habitation flottante, et là faisant retentir les airs de leurs accords harmonieux, ils attiroient de tous côtés les Nymphes et les Bergers de ce fleuve qui fut le tombeau de Phaéton.
Diriez-vous, mon cher Lecteur, que je donne un peu dans l'emphase? Cela peut être; mais voilà comme je peignois dans mes vers notre sérénade. Le fait est, que les rives du Po (appellé par les Poëtes Italiens le Roi des fleuves) étoient bordées de tous les habitans des environs qui venoient en foule nous entendre; les chapeaux en l'áir et les mouchoirs déployés, nous faisoient comprendre leur plaisir et leurs applaudissemens.
Nous arrivâmes à Cremone sur les six heures du soir. On étoit prévenu que nous devions y passer, les bords de la riviere étoient remplis de monde qui nous attendoit.
Nous mîmes pied-à-terre. Nous fûmes reçus avec des transports de joie; on nous fit entrer dans une superbe maison qui tenoit à la campagne et à la ville, on y donna un concert, des musiciens de la ville en augmenterent l'agrément; il y eut un grand souper, on dansa toute la nuit, et nous rentrâmes avec le soleil dans notre niche, où nous trouvâmes nos matelas délicieux.
La même scene à-peu-près fut répétée à Plaisance, à la Stellada et à les Bottrigues, chez le Marquis de Tassoni; et ainsi parmi les ris, les jeux et les amusemens, nous arrivâmes à Chiozza, où je devois me séparer de la société la plus aimable et la plus intéressante du monde.
Mes compagnons de voyage voulurent bien me faire l'amitié de descendre avec moi. Je les présentai à mon pere qui les remercia de bon cœur; il les pria même à souper chez lui, mais ils devoient se rendre le soir à Venise. Ils me prierent de leur donner les vers que j'avois fait sur notre voyage, je demandai du tems pour les mettre au net; je leur promis de les envoyer, et je n'y manquai pas.
Me voilà donc à Chiozza, où je m'ennuyois comme à l'ordinaire; je me dépêcherai de dire le peu que j'y fis, comme j'aurois voulu me dépêcher d'en partir.
Ma mere avoit fait la connoissance d'une Religieuse du Couvent de Saint François. C'étoit Donna Maria-Elisabetta Bonaldi, sœur de M. Bonaldi, Avocat et Notaire de Venise. On avoit reçu de Rome dans ce couvent une relique de leur Séraphique Fondateur; on devoit l'exposer avec pompe et avec édification, il y falloit un sermon, la dame Bonaldi, s'en rapportant à mon petit collet, me croyoit déjà Moraliste, Théologien et Orateur. Elle protégeoit un jeune Abbé qui avoit de la grace et de la mémoire, et elle me pria de composer un sermon, et de le confier à son protégé, sûre qu'il le débiteroit à merveille.
Mon premier mot fut de m'excuser et de refuser; mais faisant réflexion depuis, que tous les ans on faisoit dans mon College le panégyrique de Pie V, et que c'étoit un Boursier pour l'ordinaire qui s'en chargeoit, j'acceptai l'occasion de m'exercer dans un art, qui d'ailleurs ne me paroissoit pas extrêmement difficile.
Je fis mon sermon dans l'espace de quinze jours. Le petit Abbé l'apprit par cœur, et le débita comme auroit pu faire un Prédicateur très-habitué. Le sermon fit le plus grand effet; on pleuroit, on crachoit à tort et à travers, on se remuoit sur les chaises. L'Orateur s'impatientoit, il frappoit des mains et des pieds; les applaudissemens augmentoient, ce pauvre petit diable n'en pouvoit plus; il cria de la chaire: Silence et silence fut fait.
On savoit que c'étoit moi qui l'avois composé; que de complimens! que d'heureux présages! J'avois bien flatté les Religieuses, je les avois apostrophées d'une maniere délicate, en leur donnant toutes les vertus, sans le défaut de la bigotterie (je les connoissois, et je savois bien qu'elles n'étoient pas bigottes), et cela me valut un présent magnifique en broderie, en dentelles et en bombons.
Le travail de mon sermon, et le pour et le contre qui s'en suivirent, m'occuperent pendant si long- tems, que mes vacances touchoient à leur fin. Mon pere écrivit à Venise pour qu'on me procurât une voiture qui me conduisît à Milan; l'occasion se présenta à point nommé, nous allâmes, mon pere et moi, à Padoue; c'étoit un voiturier de Milan qui étoit sur le point de s'en retourner: l'homme étoit très-connu, on pouvoit s'y fier, je partis seul dans une chaise avec lui.
Quand nous fûmes hors de la ville, mon conducteur trouva un de ses camarades qui devoit faire la même route que nous, et qui n'avoit aussi qu'une seule personne dans la chaise. Cette personne étoit une femme qui me parut jeune et jolie; j'étois curieux de la voir de près, et à la premiere dînée ma curiosité fut satisfaite.
C'étoit une Vénitienne que j'ai jugée de trente ans, très-polie et très-aimable; nous fîmes connoissance ensemble et nous nous arrangeâmes d'accord avec nos voituriers que pour ne pas être ballotés dans les mauvais chemins, nous occuperions la même chaise, et deux chevaux iroient à vuide alternativement.
Nos conversations étoient très-agréables, mais très-décentes: je voyois bien que ma compagne de voyage n'étoit pas une Vestale; mais elle avoit le ton de la bonne compagnie, et nous passions les nuits dans des chambres séparées avec la plus grande régularité.
En arrivant à Desenzano, au bord du Lac de Garda, entre la ville de Brescia et celle de Verona, on nous fit descendre dans une auberge qui donnoit sur le Lac.
Il y avoit beaucoup de passagers ce jour-là, et il n'y eut qu'une chambre à deux lits pour Madame et pour moi. Que faire? Il falloit bien s'y arranger, la chambre étoit fort grande, les lits ne se touchoient pas; nous soupons, nous nous souhaitons le bon soir, et nous nous mettons chacun dans nos draps.
Je m'endors très-promptement comme à mon ordinaire, mais un bruit violent interrompt mon sommeil, et je me réveille en sursaut; il n'y avoit point de lumiere, mais au clair de lune à travers des croisées sans volets et sans rideaux, je vis une femme en chemise et un homme à ses pieds; je demande ce que c'est; ma belle héroïne, tenant un pistolet à la main, me dit d'un ton fier et moqueur: ouvrez la porte, Monsieur l'Abbé, criez au voleur, et puis allez vous coucher. Je n'y manquai pas, j'ouvre, je crie, il arrive du monde, le voleur est pris; je fais des questions à ma camarade, elle ne daigne pas me rendre compte de sa bravoure. Patience! je me recouche, et je dors jusq'au lendemain.
Le matin nous partons, je remercie bien ma compagne; elle badine toujours; nous continuons notre route par Brescia, et nous arrivons à Milan. Là nous nous quittâmes très-poliment, moi très-content de sa retenue, elle mécontente, peut-être, de ma continence.
J'allai descendre chez M. le Marquis de Goldoni, et je restai six jours chez lui en attendant la fin des vacances. Mon protecteur me tint des propos très-flatteurs, qui étoient faits pour me donner beaucoup d'espérance et beaucoup d'ardeur; je me croyois au comble du bonheur, et je touchois à ma perte.
Troisieme année de College. - Ma premiere et ma derniere satyre. - Mon expulsion du College.
J'avois appris à Milan la mort du Supérieur de mon College, et je connoissois M. l'Abbé Scarabelli, son successeur.J'allai, dès mon arrivée à Pavie, me présenter au nouveau Préfet, qui étant très-lié avec le Sénateur de Goldoni, m'assura de sa bienveillance.
J'allai aussi rendre visite au nouveau Doyen des Eleves, qui, après les cérémonies de convenance, me demanda si je voulois soutenir ma these de droit civil cette année; il ajouta que c'étoit mon tour, mais que si je n'étois pas pressé, il seroit bien aise de faire passer un autre à ma place. Je lui dis très-franchement, que puisque mon tour étoit arrivé, j'avois de bonnes raisons pour ne pas le céder; il me tardoit de finir mon tems et d'aller m'établir à Milan. Je priai le même jour notre Préfet de vouloir bien faire tirer au sort les points que je devois défendre; le jour fut pris, les articles me furent destinés, et je devois soutenir ma these pendant les vacances de Noël.
Tout alloit à merveille: voilà un brave garçon qui a envie de se faire honneur, mais en même tems il falloit bien s'amuser. Je sors deux jours après pour faire des visites; je commence par la maison qui m'intéressoit le plus (il n'y a point de portiers en Italie), je tire la sonnette, on ouvre, on vient au-devant de moi. - Madame est malade, et Mademoiselle ne reçoit personne. - J'en suis fâché, bien de complimens.
Je vais à une autre porte; je vois le domestique. - Peut-on avoir l'honneur de voir ces Dames? - Monsieur, tout le monde est à la campagne (et j'avois vu deux bonnets à fenêtre); je n'y comprends rien; je vais à un troisieme endroit, il n'y a personne.
J'avoue que j'étois très-piqué, que je me crus insulté, et je ne pouvois pas en deviner la cause; je cessai de m'exposer à de nouveaux désagrémens, et, le trouble dans l'esprit et la rage dans l'ame, je rentrai chez moi.
Le soir au foyer où les éleves se rendent ordinairement, je contai d'un air plus indifíérent que je ne l'étois, l'aventure qui m'étoit arrivée. Les uns me plaignirent, les autres se moquerent de moi; l'heure du souper arrive, nous allons au réfectoire, et ensuite nous montons dans nos chambres.
Pendant que je rêvois aux désagrémens que je venois d'éprouver, j'entends frapper à ma porte, j'ouvre, et quatre de mes camarades entrent et m'annoncent qu'ils avoient des affaires sérieuses à me communiquer; je n'avois pas assez de chaises à leur offrir, le lit tint lieu de canapé; j'étois prêt à les écouter, tous les quatre vouloient parler à la fois, chacun avoit son aventure à conter, chacun son avis à proposer. Voici ce que je pus comprendre.
Les bourgeois de Pavie étoient les ennemis jurés des écoliers, et pendant les dernieres vacances ils avoient fait une conspiration contre nous; ils avoient arrêté dans leurs assemblées, que toute fille qui en recevroit chez elle, ne seroit jamais demandée en mariage par un citoyen de la ville, et il y en avoit quarante qui avoient signé. On avoit fait courir cet arrêté dans chaque maison; les meres et les filles s'étoient allarmées, et tout d'un coup l'écolier devint pour elles un objet dangereux.
L'avis général de mes quatre confreres étoit de se venger. Je n'avois pas grande envie de m'en mêler; mais ils me traiterent de lâche et de poltron, et j'eus la bêtise de me piquer d'honneur, et de promettre que je ne quitterois pas la partie.
Je croyois avoir parlé à quatre amis, et c'étoit des traîtres qui ne desiroient que ma perte; ils m'en vouloient de l'année précédente, ils avoient nourri leur haine dans le cœur pendant une année, et ils cherchoient à profiter de ma foiblesse pour la faire éclater; j'en fus la dupe, mais je touchois à peine à ma dix-huitieme année, et j'avois à faire à de vieux renards de vingt-huit à trente ans.
Ces bonnes gens étoient dans l'usage de porter des pistolets dans leurs poches je n'en avois jamais touché; ils m'en fournirent très généreusement; je les trouvois jolis, je les maniois avec plaisir, j'étois devenu fou.
J'avois des armes à feu sur moi, et je ne savois qu'en faire. Aurois-je osé forcer une porte? Indépendamment du danger qu'il y avoit à courir, l'honnêteté, la bienséance s'y opposoient. Je voulois me défaire de ce poids inutile: mes bons amis venoient souvent me visiter, et rafraîchir la poudre du bassinet, ils me racontoient les exploits inouis de leur courage, les obstacles qu'ils venoient de surmonter, les rivaux qu'ils avoient terrassés: et moi à mon tour j'avois franchi des barrieres, j'avois soumis des meres et des filles, et j'avois tenu tête aux braves de la ville, nous étions tous également vrais, et tous peut-être de la même bravoure.
Enfin les perfides voyant que malgré mes pistolets je ne faisois pas parler de moi, ils s'y prirent d'une autre façon. Je fus accusé auprès des Supérieurs d'avoir des armes à feu dans mes poches: on me fit visiter un jour lorsque j'entrois par les domestiques du College, et mes pistolets furent trouvés.
Le Préfet du College n'étoit pas à Pavie, le Vice-Préfet me mit aux arrêts dans ma chambre, j'avois envie de profiter de ce tems pour travailler à ma these, mais les faux freres vinrent me tenter, et me séduire d'une façon encore plus dangereuse pour moi, puisqu'elle tendoit à chatouiller mon amour-propre.
Vous êtes Poëte, me dirent-ils, vous avez des armes pour vous venger bien plus fortes et plus sûres que les pistolets et les canons. Un trait de plume lâché à propos est une bombe, qui écrase l'objet principal, et dont les éclats blessent de droite et de gauche les adhérens. Courage, courage, s'écrient-ils tous à la fois, nous vous fournirons des anecdotes singulieres, vous serez vengé et nous aussi.
Je vis bien à quel danger et à quels inconvéniens on vouloit m'exposer, et je leur représentai les suites fâcheuses qui en devoient résulter. Point du tout, reprirent-ils, personne ne le saura; nous voilà quatre bons amis, quatre hommes d'honneur, nous vous promettons la discrétion la plus exacte, nous vous faisons le serment solemnel et sacré que personne ne le saura.
J'étois foible par tempérament, j'étois fou par occasion; je cédai, j'entrepris de satisfaire mes ennemis, je leur mis les armes à la main contre moi.
J'avois imaginé de composer une Comédie dans le goût d'Aristophane; mais je ne me connossois pas assez de force pour y réussir, d'ailleurs le tems ne m'auroit pas servi, et je composai une Atellane, genre de Comédies informes (chez les Romains) qui ne contenoient que des plaisanteries et des satyres.
Le titre de mon Atellane étoit le Colosse. Pour donner la perfection à la Statue colossale de la Beauté dans toutes ses proportions, je prenois les yeux de Mademoiselle une telle, la bouche de Mademoiselle celle-ci, la gorge de Mademoiselle cette autre, etc., aucune partie du corps n'étoit oubliée, mais les Artistes et les Amateurs avoient des avis différens, ils trouvoient des défauts par-tout.
C'étoit une satyre qui devoit blesser la délicatesse de plusieurs familles honnetes et respectables, et j'eus le malheur de la rendre intéressante par des saillies piquantes, et par des traits de cette vis comica qui avoit chez moi beaucoup de naturel, et pas assez de prudence.
Mes quatre ennemis trouverent mon ouvrage charmant; ils firent venir un jeune homme qui en fit deux copies en un jour, les fourbes s'en emparerent, et les firent courir dans les cercles et dans les cafés; je ne devois pas être nommé; les sermens me furent réitérés, ils tinrent parole; mon nom ne fut pas prononcé, mais j'avois fait dans un autre tems un Quatrain dans lequel il y avoit mon nom, mon surnom et ma patrie. Ils placerent ce Quatrain à la queue du Colosse, comme si j'eusse eu l'audace de m'en vanter.
L'Atellane faisoit la nouvelle du jour; les indifférens s'amusoient de l'ouvrage, et condamnoient l'Auteur; douze familles crioient vengeance, on en vouloit à ma vie; heureusement j'étois encore aux arrets; plusieurs de mes camarades furent insultés; le College du Pape étoit assiégé: on écrivit au Préfet, il revint précipitamment; il auroit desiré pouvoir me sauver: il écrivit au Sénateur de Goldoni; celui-ci envoya des lettres pour le Sénateur Erba Odescalchi, Gouverneur de Pavie. On intéressa en ma faveur l'Archeveque qui m'avoit tonsuré, le Marquis de Ghislieri qui m'avoit nommé, toutes mes protections et toutes leurs démarches furent inutiles; je devois étre sacrifié; sans le privilege de l'endroit où j'étois, la justice se seroit emparée de moi: on m'annonça l'exclusion du College, et on attendit que l'orage fut calmé pour me faire partir sans danger.
Quelle horreur! que de remords! que de regrets! mes espérances éclipsées, mon état sacrifié, mon tems perdu! Mes parens, mes protections, mes amis, mes connoissances tout devoit être contre moi; j'étois affligé, désolé, je restoi dans ma chambre, je ne voyois personne, personne ne venoit me voir; quel état douloureux, quelle situation malheureuse!
Triste voyage. - Mes desseins manqués. Rencontre singuliere.
J'étois dans ma solitude, accablé de tristesse, rempli d'objets qui me tourmentoient sans cesse, et de projets qui se succedoient les uns aux autres; j'avois toujours devant les yeux le tort que je m'étois fait à moi-même, et l'injustice que j'avois commise envers les autres, j'étais encore plus sensible à cette derniere réflexion, qu'au désastre que j'avois mérité.
Si depuis soixante ans il reste encore à Pavie quelque souvenir de ma personne et de mon imprudence, j'en demande pardon à ceux que j'ai offensés, en les assurant que j'en ai été bien puni, et que je crois ma faute expiée.
Pendant que j'étois concentré dans mes remords et dans mes réflexions, on m'apporte une lettre de mon pere. Terrible augmentation de chagrin et de désespoir. La voici:
"Je voudrois bien, mon cher fils, que tu pusses passer cette année-ci tes vacances à Milan; je me suis engagé d'aller à Udine, dans le Frioul Vénitien, pour entreprendre une cure qui pourroit être longue, et je ne sais si en meme tems ou après, je ne serai pas obligé d'aller dans le Frioul Autrichien, pour une autre personne qui a le meme genre de maladie. J'écrirai à M. le Marquis, en lui rappellant les offres généreuses qu'ils nous a faites, mais tache de ton coté de mériter ses bontés. Tu me mandes que tu dois incessamment soutenir une these, tache de t'en tirer avec honneur; c'est le moyen de plaire à ton protecteur, et de faire le plus grand plaisir à ton pere et à ta mere qui t'aiment bien, etc."
Cette lettre mit le comble à mon avilissement: comment, disois-je à moi-meme, comment oseras-tu te présenter à tes parens, couvert de honte et du mépris universel? Je redoutois si fort ce moment terrible, qu'en sortant d'une faute j'en méditois une autre qui pouvoit achever ma perte.
Non, je ne m'exposerai pas aux reproches les plus mérités et les plus accablans; non, je n'irai pas me présenter à ma famille irritée; Chiozza ne me reverra plus; j'irai par-tout ailleurs; je veux courir, je veux tenter la fortune, je veux réparer ma faute ou périr. Oui, j'irai à Rome, je trouverai peut-étre cet ami de mon pere qui lui a fait tant de bien, et qui ne m'abandonnera pas. Ah! si je pouvois devenir l'Ecolier de Gravina, l'homme le plus instruit en belles-lettres, et le plus savant dans l'Art Dramatique... Dieu! s'il me prenoit en affection comme il avoit pris Métastase! n'ai-je pas aussi des dispositions, du talent, du génie? oui à Rome, à Rome. Mais comment ferai-je pour y aller? Aurai-je assez d'argent?... J'irai à pied... A pied?... Oui, à pied. Et mon coffre et mes hardes? Au diable le coffre, et les hardes aussi. Quatre chemises, des bas, des cols et des bonnets de nuit. Voilà tout ce qu'il me faut; ainsi tout en révant et en extravaguant de la sorte, je remplis une valise de linge, je la mets au fond de mon coffre, et je la destine à m'accompagner jusqu'à Rome.
Comme je devois m'en aller incessamment, j'écrivis à l'Aumonier du College pour avoir de l'argent; il me répondit qu'il n'avoit pas de fonds de mon pere, cependant que mon voyage par eau et ma nourriture seroíent payés jusqu'à Chiozza, et que le Pourvoyeur de la maison me remettroit un petit paquet dont mon pere lui tiendroit compte.
Le lendemain au point du jour on vient me chercher avec un carrosse; on charge mon coffre, le Pourvoyeur y monte avec moi, nous arrivons au Tesino, nous entrons dans un petit bateau, et nous allons au confluent de cette riviere et du Po rejoindre une vaste et vilaine barque qui venoit d'apporter du sel; mon guide me consigne au Patron, et lui parle à l'oreille; ensuite il me donne un petit paquet de la part de l'Aumonier du College; il me salue, me souhaite un bon voyage, et s'en va.
Je n'ai rien de plus pressé que d'examiner mon trésor. J'ouvre le paquet. Oh ciel! quelle surprise agréable pour moi! j'y trouve quarante-deux sequins de Florence (vingt louis à-peu-près). Bon pour aller à Rome, je ferai le voyage en poste, et avec mon coffre... Mais comment l'Aumonier qui n'avoit pas de fonds de mon pere, a-t-il pu me confier cet argent? Pendant que je faisois des réflexions et des charmans projets, voilà le Pourvoyeur qui revient dans son bateau; il s'étoit trompé, c'étoit un argent du College qu'il devoit payer à un Marchand de bois; il reprit son paquet, et il me remit trente paules, qui forment la valeur de quínze francs.
Me voilà bien riche, je n'avois pas besoin d'argent pour aller à Chiozza, mais pour aller à Rome? Les sequins que j'avois eu entre mes mains, me faisoient tourner la téte encore davantage; il falloit s'en consoler et revenir au désagrément du pélerinage.
J'avois mon lit sous la proue, et mon coffre à cóté de moi; je dinois et soupois avec mon hote, qui étoit le conducteur de la barque, et qui me faisoit des contes à dormir debout.
Deux jours après nous arrivames à Plaisance, le Patron avoit là des affaires, il s'y arréta et mit pied à terre, je crus le moment favorable pour m'en aller; je pris ma valise, je dís à mon homme que j'avois la commission de la faire remettre au Conseiller Barilli, et que j'allois profiter de l'occasion favorable; le bourreau m'empécha de sortir; il avoit eu des ordres positifs de me le défendre, et comme j'insistois dans ma volonté, il me menaça de demander main-forte pour me retenir. Il faut céder à la force, il faut mourir de chagrin, il faut aller à Chiozza ou se jetter dans le Po. Je vais dans ma niche, mes malheurs ne m'avoient point encore fait répandre de larmes, cette fois-ci je pleurai.
Le soir on m'envoye chercher pour souper, je refuse d'y aller; quelques minutes après j'entends uné voix inconnue, qui d'un ton pathétique prononce ces mots, Deo gratias; il faisoit encore assez clair, je regarde par une fente à travers de la porte, et je vois un Religieux qui s'adressoit a moí; j'ouvre la coulisse, il entre.
C'étoit un Dominicain de Palerme, frere d'un fameux Jésuite, très-célebre Prédicateur; il s'étoit embarqué ce jour- là à Plaisance, il alloit à Chiozza comme moi: il savoit mes aventures, le Patron lui avoit tout révélé, il venoit m'offrir des consolations temporelles et spirituelles que son état le mettoit en droit de me proposer, et dont ma position paraissoit avoir besoin.
Il mettoit dans son discours beaucoup de sensibilité et beaucoup d'onction; je lui voyois tomber quelques larmes, du moins je lui vis porter son mouchoir aux yeux; je me sentis touché, je m'abandonnai à sa merci.
Le Patron nous fit dire qu'on nous attendoit; le Révérend Pere n'auroit pas voulu perdre sa collation, mais il me voyoit pénétré de componction; il fit prier le Patron de vouloir bien attendre un instant; ensuite il se tourne vers moi, il m'embrasse, il pleure, il me fait voir que j'étois dans un état dangereux, que l'ennemi infernal pouvoit s'emparer de moi, et m'entraîner dans un abyme éternel. J'étois sujet, comme je l'ai déjà annoncé, à des accès de vapeurs hypocondriaques, j'étois dans un état pitoyable; mon exorciste s'en apperçut, il me proposa de me confessser, je me jette à ses pieds. Dieu soit béni, dit-il; oui, mon cher enfant, faites votre préparation, je vais revenir, et il va souper sans moi.
Je reste à genoux, je fais mon examen de conscience; au bout d'une demi-heure le Pere revient avec un bougeoir à la main; il s'assied sur mon coffre: je dis mon Confiteor, et je fais ma confession générale avec l'attrition requise, et une contrition suffisante; il s'agissoit de la pénitence; le premier point, c'étoit de réparer le tort que j'avois pu faire à des familles, contre lesquelles j'avois lancé des traits satyriques. Comment faire pour le présent? En attendant, dit le Révérend Pere, que vous soyez en état de vous rétrécter, il n'y a que l'aumône qui puisse fléchir la colere de Dieu, car l'aumône est la premiere œuvre méritoire qui efface le péché. - Oui, mon Pere, lui dis-je, je la ferai. - Point du tout, répliqua-t-il, il faut faire le sacrifice sur-le-champ. - Je n'ai que trente paules. - Eh bien, mon enfant, en se dépouillant de l'argent qu'on possède, on a autant de mérite que si on donnoit davantage. Je tirai mes trente poules, je priai mon Confesseur de s'en charger pour les pauvres; il le voulut bien, et me donna l'absolution.
Je voulois continuer encore, j'avois des choses à dire que je croyois avoir oubliées; le Révérend Pere tomboit de sommeil, ses yeux se fermoient à tout moment; il me dit de me tenir tranquille, il me prit par la main, il me donna sa bénédiction, et alla bien vite se coucher.
Nous restâmes encore huit jours en chemin, je voulois me confesser tous les jours, mais je n'avois plus d'argent pour la penitence.
Mon arrivée à Chiozza. - Suite des anecdotes du Révérend Pere. - Mon voyage à Udine. - Essai sur cette ville et sur la province du Frioul.
J'arrivai à Chiozza en tremblant, avec mon Confesseur qui s'engagea à me raccomoder avec mes parens. Mon pere etoit à Venise pour affaire, ma mère me vit venir, et vint me recevoir en pleurant, car l'Aumônier du College n'avoit pas manqué de prévenir ma famille du détail de ma conduite. Le Révérend Pere n'eut pas beaucoup de peine à toucher le cœur d'une tendre mère; elle avoit de l'esprit et de la fermeté, et en se tournant vers le Dominicain qui la fatiguoit: mon Révérend Pere, lui dit-elle, si mon fils avoit fait une friponnerie, je ne le reverrois plus, il a fait une étourderie, et je lui pardonne.
Mon compagnon de voyage auroit bien voulu que mon pere fût à Chiozza, et qu'il le présentât au Prieur de Saint, Dominique; il y avoit là un dessous de cartes que je ne comprenois pas: ma mere lui dit, qu'elle attendoit son mari dans le courant de la journée; le Révérend Pere en parut content, et sans façon il se pria à dîner de lui-même.
Pendant que nous étions à table, mon pere arrive, je me leve et je vais m'enfermer dans la chambre voisine: mon pere entre, il voit un grand capuchon; c'est un étranger, dit ma mère, qui a demandé l'hospitalité. - Mais cet autre couvert? cette chaise? - Il fallut bien parler de moi; ma mere pleure, le Religieux sermonne, il n'oublie pas la parabole de l'Enfant Prodigue; mon pere étoit bon, il m'aimoit beaucoup. Bref, on me fait venir, et me voilà rebéni.
Dans l'après-midi, mon pere accompagna le Dominicain à son Couvent; on ne vouloit pas le recevoir; tous les Moines qui voyagent doivent avoir une permission par écrit de leurs Supérieurs qu'ils appellent l'obédience, et qui leur sert de passe-port et de certificat; celui-ci en avoit une, mais vieille, déchirée, qu'on ne pouvoit pas lire, et son nom n'étoit pas connu; mon pere, qui avoit du crédit, le fit recevoir, à condition qu'il n'y resteroit pas longtems.
Finissons l'histoire de ce bon Religieux; il parla à mon pere et à ma mere d'une Relique qu'il avoit encaissée dans une montre d'argent, il les fit mettre à genoux, et leur fit voir une espece de cordonnet entortillé sur du fil-de-fer; c'étoit un morceau du lacet de la Vierge Marie, qui avoit même servi à son divin Enfant; la preuve en étoit constatée, disoit-il, par un miracle qui ne manquoit jamais; on jettoit ce lacet dans un brasier, le feu respectoit la Relique, on retiroit le cordonnet sans dommage, et on le plongeoit dans l'huile, qui devenoit une huile miraculeuse qui faisoit des guérisons surprenantes.
Mon pere et ma mere auroient bien voulu voir ce miracle, mai cela ne se faisoit pas sans des préparatifs et des cérémonies pieuses, et en présence d'un certain nombre de personnes dévotes, pour la plus grande édification, et pour la gloire de Dieu. On parla beaucoup là-dessus, et comme mon pere étoit le Médecin des Religieuses de Saint-François, il sut si bien faire auprès d'elles, qu'elles se déterminèrent, d'après les instructions du Dominicain, à permettre qu'on fît le miracle, et l'on fixa le jour et le lieu où se feroit la cérémonie. Le Révérend Pere se fit donner une bonne provision d'huile et quelqu'argent pour des Messes dont il avoit besoin dans sa route.
Tout fut exécuté, mais le lendemain l'Evêque et le Podestà, instruits d'une cérémonie religieuse qui avoit été faite sans permission, et dans laquelle un Moine étranger avoit osé endosser l'étole, rassembler du monde, et vanter des miracles, procéderent chacun de leur côté à la vérification des faits. Le lacet miraculeux qui résistoit au feu, n'étoit que du fil-de-fer artistement arrangé, et qui trompoit les yeux. Les Religieuses furent réprimandées, et le Moine disparut.
Nous partîmes quelques jours après, mon pere et moi, pour le Frioul, et nous passâmes par Porto-Gruero , où ma mere avoit quelques rentes à l'Hôtel de la Communauté. Cette petite ville, qui est sur la lisiere du Frioul , est la residence de l'Evêque de Concordia, ville très-ancienne, mais presqu'abandonnée à cause du mauvais air.
En continuant notre route, nous passâmes le Taillamento, qui est tantôt riviere, et tantôt torrent, et qu'il faut passer à gué, n'y ayant ni ponts, ni bacs pour le traverser, et enfin nous arrivâmes à Udine, qui est la Capitale du Frioul Vénitien.
Les Voyageurs ne font aucune mention de cette Province, qui cependant mériteroit une place honorable dans leurs narrations.
Cet oubli d'un canton si considérable de l'Italie m'a toujours déplu, et j'en dirai quelques mots en passant.
Le Frioul, que l'on appelle aussi en Italie la Patria del Friul, est une très-vaste Province qui s'étend depuis la Marche Trévisanne jusqu'à la Carinthie. Elle est partagée entre la République de Venise et les Etats Autrichiens, le Lisonce en fait le partage, et Gorizia est la Capitale de la partie Autrichienne.
Il n'y a pas de Province en Italie où il y ait autant de Noblesse, que dans celle-ci. Presque toutes les terres sont érigées en fiefs, qui relevent de leurs Souverains respectifs, et il y a dans le Château d'Udine une salle de Parlement, où les Etats se rassemblent, privilege unique, qui n'existe dans aucune autre Province de l'Italie.
Le Frioul a toujours fourni de grands hommes aux deux Nations; il y en a beaucoup à la Cour de Vienne, et il y en a dans le Sénat de Venise. Il existoit autrefois un Patriarche d'Aquilée, qui faisoit sa résidence à Udine, car Aquilée ne put jamais se relever depuis qu'Attila, Roi des Huns, la saccagea, et la rendit inhabitable: ce Patriarchat a été supprimé depuis peu, et le seul Diocese qui embrassoit la Province entiere, a été partagé en deux Archevêchés, l'un à Udine et l'autre à Gorizia.
La culture est très-soignée dans le Frioul, et les produits de la terre, soit en bled, soit en vin, sont très- abondans et de la meilleure qualité: c'est-là où l'on fait le Picolit qui imite si bien le Tokay, et c'est des vignobles d'Udine que Venise tire une forte partie des vins nécessaires pour la consommation du Public.
Le langage Fourlan est particulier; il est aussi difficile à comprendre que le Genois, même pour les Italiens. Il semble que ce patois tienne beaucoup à la Langue Françoise. Tous les mots féminins qui en Italien finissent par un a, se terminent en Frioul par un e, et tous les pluriels des deux genres sont terminés par un s.
Je ne sais pas comment ces terminaisons Françoises et une quantité prodigieuse de mots François ont pu pénétrer dans un pays si éloigné.
Il est vrai que Jules César traversa les montagnes du Frioul, aussi les appelle-t-on les Alpes Jules; mais les Romains ne terminoient leurs mots féminins ni à la Françoise, ni à la Fourlane.
Ce qu'il y a de plus singulier dans le patois Fourlan, c'est qu'ils appellent la nuit, soir, et le soir, nuit. On seroit tenté de croire que le Petrarque parloit des Fourlans, lorsqu'il dit dans ses chansons lyriques:
Gente cui si fa notte innanzi sera.
En François,
O gens! à qui la nuit paroit avant le soir.
Mais on auroit tort si on partoit de-là pour croire que cette Nation ne fût pas aussi spirituelle et aussi laborieuse que le reste de l'Italie.
Il y a à Udine entr'autres choses une Académie de Belles Lettres, sous le titre Degli Sventati (des Evantés), dont l'emblême est un moulin à vent dans le creux d'un vallon avec cette Epigraphe:
Non è quaggiuso ogni vapore spento.
En François,
Toute vapeur n'est pas dans ces bas lieux éteinte.
Les Lettres y sont très-bien cultivées. Il y a des Artistes du premier mérite, et la société y est très-aisée et très-aimable.
Udine qui est à 22 lieues de Venise, est gouvernée par un noble Vénitien qui a le titre de Lieutenant, et il y a un Conseil des Nobles du pays, qui siegent à l'Hôtel-de-ville, et remplissent les Charges de la Magistrature en sous ordre.
La Ville est très-jolie, les Eglises très-richement décorées; les Tableaux de Jean d'Udine, Ecolier de Raphael, en font le principal ornement; il y a une promenade au milieu de la ville, des fauxbourgs charmans, et des environs délicieux. Le Palais immense et les superbes Jardins de Passarean des Comtes Manini, Nobles Vénitiens, sont un séjour digne d'un Roi.
Je demande pardon au Lecteur, si la digression lui paroît un peu longue; j'étois bien aise de rendre quelque justice à un pays qui le méritoit à tous égards.
Mes occupations sérieuses. - Thérese, anecdote plaisante.
Mon pere à Udine exerçoit sa profession, et moi je repris le cours de mes études. M. Movelli, célebre Jurisconsulte, tenoit chez lui un cours de droit civil et canonique, pour l'instruction d'un de ses neveux; il admettoit à ses leçons quelques personnes du pays, et j'eus le bonheur d'en être aussi; j'avoue que je profitai plus en six mois de tems dans cette occasion, que je n'avois fait pendant trois ans à Pavie.
J'avois bonne envie d'étudier; mais j'étois jeune, il me falloit quelques distractions agréables: je cherchai des amusemens, et j'en trouvai de différentes especes. Je vais rendre compte de ceux qui m'ont fait beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur, et je finirai par d'autres qui ne m'ont fait ni honneur ni plaisir.
Nous avions passé un carnaval bien triste et bien maussade; il étoit arrivé un accident affreux qui avoit mis la ville dans la consternation; un Gentilhomme d'une ancienne et riche maison avoit été tué d'un coup de fusil en sortant de la Comédie: on ne connoissoit pas l'auteur de l'assassinat; on le soupçonnoit, mais personne n'osoit en parler.
Le Carême arrive; je vais le jour des cendres à la Cathédrale pour entendre le Pere Cataneo, Augustin Réformé, et je trouve son Sermon admirable; je sors, je retiens mot pour mot les trois points de sa division; je tâche de rassembler en quatorze vers son argument, sa marche et sa morale, et je crois avoir fait un Sonnet assez passable.
Je vais le même jour le communiquer à M. Treo, Gentilhomme d'Udine, très-instruit en Belles-Lettres, ayant beaucoup de goût pour la Poésie; il trouva lui-même mon Sonnet assez passable.
Il me fit l'amitié de me corriger quelques mots, et m'encouragea à en faire d'autres. Je suivis exactement mon Prédicateur, je fis tous les jours le même travail, et je me trouvai à la troisieme fête de Pâques, ayant compilé trente- six Sermons excellens, en trente-six Sonnets tant bons que mauvais.
J'avois pris la précaution d'envoyer à la presse, aussitôt que j'avois des matériaux suffisans pour une feuille in- quarto, et pendant l'octave de Pâques, je publiai ma Brochure que j'avois dédiée aux Députés de la ville.
Beaucoup de remerciemens de la part de l'Orateur, beaucoup de reconnoissance de la part des premiers Magistrats, beaucoup d'applaudissemens. La nouveauté fit plaisir, et la rapidité du travail surprit encore davantage.
Bravo, Goldoni; mais doucement, ne lui prodiguez pas vos louanges. Il y avoit une jeune personne à quatre pas de ma porte, qui me plaisoit infiniment, et à qui j'aurois bien voulu faire ma cour. Faut-il, mon cher Lecteur, que je vous fasse le portrait de ma belle? que je lui donne un teint de roses et de lys, les traits de Vénus, et les talens de Minerve? Non, ces beaux récits ne vous intéresseroient pas; je cause avec vous dans mon cabinet comme je causerois dans la Société. La matiere de mes mémoires ne mérite, je crois, ni plus d'élégance, ni plus de soins. Il y a des gens qui disent: il faut s'élever, il faut respecter le Public; je crois le respecter en lui présentant la vérité nue et sans fard.
Je ne connoissois que de nom les parens de la Demoiselle; je la voyois à la fenêtre; je la suivois à l'Eglise ou à la promenade très-modestement, mais ne manquant pas de lui donner quelque marque de mon inclination.
Je ne sais pas si elle s'en apperçut; mais sa femme-de-chambre ne tarda pas à me deviner. Cette sorciere vint me voir un jour; j'étois seul chez moi, elle me parla beaucoup d'elle-même et de sa maîtresse, et m'assura que je pouvois compter sur l'une et sur l'autre. Je lui demandai si je pouvois me hasarder à écrire... Oui, me dit-elle, sans me laisser finir, écrivez à ma maîtresse, je me charge de lui donner votre lettre et de vous apporter la réponse.
Je voulois écrire sur-le-champ, et je la priai d'attendre. Non, me dit-elle, je vais à la Sainte Messe; je n'y manque jamais; j'y vais tous les jours, mais je reviendrai en sortant de l'Eglise: elle part, et j'écris ma lettre, dans laquelle, après les cérémonies d'étiquettes, et les tendres mots d'usage, je lui demande un rendez-vous dans les regles. Thérese revient (c'étoit le nom de la femme-de-chambre) elle prend ma lettre, elle veut partir, et me présente la joue; on n'embrasse pas les femmes en Italie aussi innocemment qu'en France; d'ailleurs elle étoit laide à faire peur; je refusai tant que je pus, mais elle me sauta au col, et il fallut bien l'embrasser.
Deux jours après, Thérese en me rencontrant dans la rue, me glissa adroitement un papier dans la main que je mis dans ma poche. C'étoit une lettre de Mademoiselle ***: c'étoit la réponse à la mienne; elle étoit si mal écrite que j'eus beaucoup de peine à y démêler quelque chose.
Je compris à-peu-près qu'elle ne pouvoit pas me recevoir chez elle sans l'aveu de ses parens, et que si je voulois lui parler dans la rue, de nuit, elle passeroit quelques quarts-d'heure à m'entendre de sa fenêtre. C'étoit l'ancien usage en Italie de faire l'amour à la belle étoile, il falloit s'y conformer.
Je m'y rendis le même jour à une heure du matin; je vis la croisée s'ouvrir, et je vis paroître une tête en bonnet de nuit; je parlois à cette tête, cette tête me répondoit, et de propos en propos, je prononçai quelques douceurs, et on me répondit sur le même ton; encouragé par la facilité que je croyois appercevoir, j'allai un peu plus en avant. Tout d'un coup j'entends un éclat de rire, et je vois la fenêtre se fermer; je ne savois pas ce que cela vouloit dire. Je rentre chez moi satisfait d'un côté, mécontent de l'autre; il faut attendre Thérese.
Je la vois le lendemain, mon pere étoit au logis; je descends, et je rejoins la dévote au parvis de la Cathédrale je l'interroge sur la risée de la nuit derniere. Vous avez dit, me répondit-elle, des plaisanteries; ma maîtresse en a ri car elle n'est pas bigotte; mais elle s'est souvenue de sa pudeur, et elle a fermé sa fenêtre. Continuez, poursuivit-elle, continuez et ne craignez rien; j'allois lui parler encore; allez, me dit-elle, il est tard, je ne veux pas perdre la Messe.
Je voyois bien que la Messe s'accordoit mal avec le métier d'entremetteuse; elle ne pouvoit être qu'une coquine, et elle l'étoit dans toute l'étendue du terme; mais j'étois amoureux, et je crus devoir la ménager; je continuai pendant quelque tems mes conversations nocturnes; ce n'étoit plus à la même fenêtre, que la tête en bonnet de nuit paroissoit; c'étoit à une autre, mais fort éloignée.
J'en demandai la raison; Mademoiselle craignoit la proximité de sa mere; j'étois plus réservé dans mes entretiens, mais on me lâchoit quelques mots un peu libres, et je ripostois à mon aise; les éclats de rire partoient, et la fenêtre ne se fermoit plus.
Un jour que je pressois Thérese pour qu'elle me procurât une entrevue diurne avec sa maîtresse, et que je la menaçois de tout rompre, si je ne l'obtenois pas: soyez tranquille, me dit-elle, j'y pense autant que vous; je parlerai à la Blanchisseuse de la maison qui demeure à Chiavris, à un demi-mille de distance, et c'est-là où je me flatte de pouvoir vous rendre content; mais écoutez, poursuivit-elle, écoutez, mon ami, vous devez connoître les Demoiselles, elles sont capricieuses, il y en a peu qui soient capables d'un désintéressement parfait, et ma maîtresse n'est pas des plus généreuses. Si vous vouliez lui faire un petit cadeau, je crois que cette attention avanceroit beaucoup vos affaires. - Comment, dis-je, elle accepteroit un présent?... - Pas de vous, reprit la sorciere, mais si c'étoit moi qui le lui présentât, elle ne le refuseroit pas... - Et que pourrois-je lui donner?...- Hier. .. tenez, pas plus loin qu'hier, Mademoiselle me marqua la plus grande envie d'avoir une garniture de ces pierreries de Vienne colorées qui sont à la mode aujourd'hui, et que toutes les femmes veulent avoir... - Où est-ce qu'on les vend? - Oh! il n'y en a pas d'assez belles dans ce pays-ci, il faudroit les faire venir de Venise: une garniture complette: croix, boucles d'oreilles, collier et épingles. - Ma chere Thérese, avez-vous été à la Messe? - Pas encore. - Allez-y. - Comment? Est-ce que vous vous refuseriez à obliger une jeune personne, aimable, charmante, que vous aimez, que vous estimez, que vous pourriez posséder un jour? - Paix, paix, je vous entends; j'aurai la garniture; je la mettrai entre vos mains. - Je la présenterai à ma maîtresse, et vous la verrez parée des bijoux de son cher Goldoni. - De son cher Goldoni? Croyez-vous que je sois le cher ami de Mademoiselle? - Vous l'êtes un peu, et vous le serez davantage. - Quand j'aurai donné les bijoux? - Oui, sans doute. - Allons, votre maîtresse les aura. - Tant mieux. - Bon jour, Thérese. - Adieu, Monsieur... embrassez-moi. - (Que le diable t'emporte).
Je vais chez un Bijoutier de ma connoissance; je lui donne la commission; il s'en charge, et au bout de quatre jours la boîte arrive. Superbe garniture; mais elle coûtoit aussi dix sequins sans le port et la commission. Je vois Thérese, je lui fais signe; elle vient, prend la boîte et l'emporte, et le jour après, qui étoit un Dimanche, je vois à l'Eglise Mademoiselle ***, parée de mes pierreries, qui imitoient les rubis et les émeraudes.
J'étois content comme un Roi; cependant la Demoiselle ne m'avoit pas fixé comme je l'aurois desiré; elle ne m'avoit donné aucune marque de satisfaction, et les rendez-vous nocturnes depuis quelques jours avoient été suspendus à cause de quelques propos des voisins.
Thérese ne manqua pas de venir me voir, et de me dire les plus jolies choses du monde de la part de sa maîtresse; et comme je lui fis comprendre, que je devois exiger quelque chose de plus, elle m'invita à me rendre le jeudi suivant à Chiavris chez la Blanchisseuse indiquée; c'étoit-là que Mademoiselle *** s'étoit reservée de me donner des preuves de son attachement et de sa reconnoissance. Bon! c'est bien, à jeudi.
Je trouvois le tems fort long; j'y rêvois jour et nuit: à quelle espece d'épreuve devois-je m'attendre? A vingt ans on est téméraire. Le jour arrive; je vais chez la Blanchisseuse, et je m'y rends le premier; au bout d'une demi-heure je vois Thérese, et je l'apperçois toute seule; je commence à frémir, et je la reçois fort mal; elle me prie de me tranquilliser, et me fait monter dans un galetas, où il n'y avoit qu'un lit fort sale et une chaise de paille déchirée; je la presse de me parler... de me dire... Elle me prie encore de me calmer, et de l'écouter.
Hélas! mon cher ami, (me dit-elle) je suis très-mécontente de ma maîtresse; après les attentions que vous avez eues pour elle, après la parole qu'elle m'avoit donnée, elle me manque et trouve des prétextes pour ne pas me suivre... - Comment, dis-je, en l'interrompant, elle trouve des prétextes! Elle ne viendra pas? Est-ce qu'elle se moque de moi? - Ecoutez-moi jusqu'au bout, reprit la fourbe, j'en suis piquée autant que vous, et plus que vous, car le tour qu'elle me joue, est pour moi d'une conséquence qui me désole. Elle mettoit dans son discours une chaleur, une véhémence si extraordinaire, que je la croyois vraiment pénétrée de zele pour moi; je tâchois moi-même de la calmer: effectivement elle changea de ton en prenant un air tendre et pathétique; elle continua en me disant: écoutez, je vais vous étaler tous les traits de perfidie de ce petit monstre qui nous a trompés. Elle savoit, l'ingrate, oui, elle le savoit, que j'avois de l'inclination pour vous; elle me reprocha d'abord une passion que j'avois nourrie dans mon cœur, et m'obligea à lui sacrifier mes vœux et mes espérances: elle me chargea de m'intéresser auprès de vous en sa faveur; mon état, ma douceur, mon caractere m'y engagerent; je fis des efforts qui m'ont coûté des soupirs et es larmes, et prête, comme j'étois, de vous voir heureux à mes dépens, elle me trompe, me déclare son indifference pour vous, et m'ordonne de ne plus lui en parler. - Je criai alors transporté de colere, et mes bijoux? Thérese crie encore plus fort que moi, elle les garde. J'avoue tout bonnement que les dix sequins que j'avois dépensés entroient pour quelque chose dans mon ressentiment, ainsi que les nuits que j'avois passées, les espérances que j'avois conçues, et la honte de me voir trompé. J'allois devenir furieux; mais la sage, la prudente Thérese me prit par la main, et tournant vers moi ses regards languissans: - Mon cher ami, me dit-elle, nous avons été trompés l'un et l'autre, et il faut nous venger; il faut rendre à l'ingrate le mépris qu'elle s'est attiré: je suis prête à la quitter sur-le-champ, et pour peu que vous vouliez faire pour moi, je n'aurai jamais d'autre ambition que celle de vous être attachée.
Ce propos m'interdit; je ne m'y attendois pas, et je commençai à ouvrir les yeux. - Vous m'aimez donc, Mademoiselle? (lui dis-je avec tranquillité). - Oui, me répondit-elle, en m'embrassant, je vous aime de toute mon ame, et je suis prête à vous en donner les preuves les plus convaincantes. -J'en suis bien reconnoissant, répondis-je, donnez-moi le tems de la réflexion, vous saurez incessamment ma façon de penser. - Après une seconde embrassade, nous nous quittâmes, prenant chacun un sentier différent.
Aussi-tôt arrivé à la ville, je vais chez une monteuse de bonnets que je connoissois, et qui étoit celle de Mademoiselle C***. J'avois fait quelques parties de plaisir avec cette fille, j'avois badiné avec elle sur le compte de sa pratique, et elle me paroissoit propre à l'usage que j'en voulois faire: je lui contai toute mon histoire d'un bout à l'autre; je la priai d'en démêler le nœud, et je lui promis un sequin, si elle parvenoit à pouvoir m'instruire de la vérité. Elle s'en chargea avec plaisir; elle y réussit à merveille, et trois jours après, elle me mit au fait de tout aussi clairement, aussi nettement que je pouvois le desirer.
Cette opération faite, je vis Thérese, je lui donnai rendez-vous chez la Blanchisseuse, et j'y allai de bonne heure pour arriver le premier; j'emmenai dans une espece de cabriolet trois personnes avec moi, et je les cachai dans un coin du hangard où l'on faisoit la lessive; j'avois arrangé mes affaires avec la maîtresse du logis, et j'étois sûr de mon fait.
Voilà Thérese qui arrive, et la voilà contente de moi; elle veut monter: - Non, non, lui dis-je, allons sous le berceau, nous respirerons un meilleur air. Là assis sur des sieges de gazon, elle veut commencer à me parler de sa maîtresse, et l'invectiver de nouveau. Je lui coupai la parole, et d'un ton sérieux et imposant, il ne s'agit plus, lui dis-je, de Mademoiselle C***; il ne s'agit que de Thérese qui est une fripponne, et qui m'a trompé. - A ces mots elle paroit interdite, et s'efforce de pleurer: je lui rappelle quelquesuns de ses traits de fripponnerie; elle nie tout, et vante sa probité. Alors je fais sortir les trois personnes que j'avois cachées; Thérese voit la monteuse de bonnets; elle cesse de grimacer, elle prend l'air de 1'effronterie, en disant tout haut: - Ah! coquine, tu m'as vendue; et en s'adressant à moi: - Oui, Monsieur, me dit-elle hardiment, je vous ai trompé, je ne m'en cache pas. - Tout le monde se mit à rire, et je frémissois de colere. - Attends, scélérate, lui dis-je, je vais dresser ton procès-verbal. Qui est-ce qui a écrit la premiere lettre que tu m'as remise? - Elle répond en riant: c'est moi. - A qui ai-je parlé pendant plusieurs nuits dans la rue? - A moi. - Et l'éclat de rire? Il partoit de moi. - Est-ce toi qui fermas la fenêtre? Non, ce fut ma maîtresse qui se moquoit de vous. - Ta maîtresse d'accord avec toi? Oui, car elle vous croyoit mon amant. Moi, ton amant! N'étoit-ce pas assez pour vous? L'impudente! Et mes bijoux? - Ma maîtresse en jouit. - Comment? - Elle les a payés. - A qui? - A moi. - Voleuse! l'envie me prenoit de la dévisager, mais la prudence vint à mon secours. Satisfait de l'avoir démasquée, je dis en me retournant vers les témoins de son indignité: je vous l'abandonne; qu'elle soit comblée de honte et de mépris; sa maîtresse sera instruite de sa conduite. Voilà ma vengeance complette, et je pars satisfait.
Mon voyage à Gorice et à Vipack. - Partie de campagne charmante. - Course en Allemagne.
Je ne vis plus la sorciere; je sus par la monteuse de bonnets qu'elle avoit été renvoyée de la maison où elle étoit, et qu'on la croyoit sortie de la ville.
Pour me dédommager du tems perdu, je fis la connoissance de la fille d'un Limonadier, où je rencontrai moins de difficultés, mais beaucoup plus de danger. Je motivai cette seconde anecdote Fourlane dans mon Edition de Pasquali; c'est pourquoi j'ai cru devoir en parler, afin qu'on n'imaginât pas que je fais des contes à plaisir; mais comme l'aventure ne mérite pas d'occuper mes Lecteurs, je passerai sous silence tous les détails étrangers, et je dirai seulement que je courus les plus grands risques; qu'on vouloit me tromper d'une maniere bien plus sérieuse, et que revenant à moi-même, je me sauvai bien vite pour aller rejoindre mon pere.
Il étoit à Gorice logé chez son illustre malade, le Comte Lantieri, Lieutenant-Général des Armées de l'Empereur Charles VI, et Inspecteur des Troupes Autrichiennes dans la Carniole et dans le Frioul Allemand.
Je fus très-bien reçu de cet aimable Seigneur, qui faisoit les délices de son pays. Nous ne restâmes pas long-tems à Gorice; mais nous passâmes bientôt a Vipack, Bourg très-considérable dans la Carniole, à la source d'une riviere qui lui donne le nom, et fief de la maison de Lantieri.
Nous y passâmes quatre mois le plus agréablement du monde; les Seigneurs dans ce pays-là vont se visiter en famille; les peres, les enfans, les maîtres, les domestiques, les chevaux, tout part à la fois, et tout le monde est reçu et logé: on voit souvent trente maîtres dans le même Château, tantôt chez les uns, tantôt chez les autres; mais le Comte Lantieri étoit censé malade, il n'alloit nulle part, et il recevoit tout le monde.
Sa table n'étoit pas délicate, mai très-abondante. Je me souviens encore du plat de rôt qui étoit d'étiquette: un quarré de mouton ou de chevreuil, ou une poitrine de veau, en faisoit la base; il y avoit par-dessus des lievres ou des faisans, surmontés par des perdrix rouges et des perdrix grises; ensuite des bécasses ou des bécassines, ou des grives, et la piramide finissoit par des mauviettes et des becquefigues.
Cet assemblage bizarre étoit bientôt partagé et distribué; on servoit les petits oiseaux à leur arrivée; les uns et les autres s'emparoient du gibier pour le découper, et les amateurs de viande voyoient à découvert les grosses pieces qui les flattoient davantage.
Il étoit d'étiquette aussi de servir trois potages à chaque repas; la soupe au pain avec les hors-d'œuvres; une soupe aux herbes au premier service, et de l'orge mondé aux entremets: on arrosoit cet orge avec le jus du rôt, et on me disoit que c'étoit bon pour la digestion.
Les vins étoient excellens; il y avoit un certain vin rouge, qu'on appelloit faiseur d'enfans, et qui donnoit lieu à de bonnes plaisanteries.
Ce qui me gênoit un peu, c'étoit les santés qu'il falloit porter à-tout-coup. Le jour de la Saint Charles on commença par Sa Majesté Impériale, on présenta à chacun des convives des vases à boire d'une espece tout à fait singuliere: c'étoit une machine de verre de la hauteur d'un pied, composée de différentes boules qui alloient en diminuant, et qui étoient séparées par de petits tuyaux, et finissoient par une ouverture allongée qu'on présentoit très-commodément à la bouche, et par où on faisoit sortir la liqueur; on remplissoit le fond de cette machine qu'on appelloit le glo-glo; en en approchant la sommité à la bouche, et en élevant le coude, le vin qui passoit par les tuyaux et par les boules, rendoit un son harmonieux; et tous les convives agissant en même-tems, cela formoit un concert tout nouveau et très- plaisant. Je ne sais pas si les mêmes usages durent encore dans ces pays-là; tout change, et tout pourroit y être changé, mais s'il y a dans ces cantons des gens du vieux tems, comme moi, ils seront bien aises, peut-être, que je leur en rappelle le souvenir.
Le Comte Lantieri étoit très-content de mon pere, car il alloit beaucoup mieux, et il n'étoit pas loin de sa guérison; il avoit aussi des bontés pour moi, et pour me procurer de l'amusement, il fit monter un Théâtre de Marionnettes qui étoit presque abandonné, et qui étoit très-riche en figures et en décorations.
J'en ai profité, et je fis l'amusement de la compagnie, en donnant une Piece d'un grand homme, faite exprès pour les Comédiens de bois: c'étoit l'Eternument d'Hercule, de Pierre-Jacques Martelli, Bolonois.
Cet homme célebre étoit le seul qui auroit pu nous laisser un Théâtre complet, s'il n'eut pas eu la folie d'imaginer des vers nouveaux pour les Italiens; c'étoit des vers de quatorze syllabes et rimés par couplets, à-peu-près comme les vers François.
Je parlerai des vers Martelliani dans la seconde Partie de ces Mémoires; car en dépit de leur proscription, je me suis amusé à les faire trouver bons cinquante ans après la mort de leur Auteur.
Martelli avoit donné en six volumes des Compositions dramatiques dans tous les genres possibles, depuis la Tragédie la plus sévere, jusqu'à la farce de Marionnettes qu'il avoit nommé Bambocciata (Bambochade), dont le titre étoit l' Eternument d'Hercule.
L'imagination de l'Auteur envoyoit Hercule dans le pays des Pigmées. Ces pauvres petits, effrayés à la vue d'une montagne animée, qui avoit des jambes et des bras, se cachoient dans des trous. Un jour qu'Hercule s'étoit couché en pleine campagne, et dormoit tranquillement, les habitans craintifs sortirent de leurs retraites, et armés d'épines et de joncs, monterent sur l'homme monstrueux, et le couvrirent de la tête aux pieds, comme les mouches s'emparent d'un morceau de viande pourrie. Hercule se réveille; il sent quelque chose dans son nez, il éternue; ses ennemis tombent de tout côté, et voilà la Piece finie.
Il y a un plan, une marche, une intrigue, une catastrophe, une péripétie; le style est bon et bien suivi; les pensées, les sentimens, tout est proportionné à la taille des personnages; les vers même sont courts, tout annonce les Pigmées.
Il fallut faire faire une Marionnette gigantesque pour le personnage d'Hercule; tout fut bien exécuté. Le divertissement fit beaucoup de plaisir, et je parirois que je fus le seul qui imagina d'exécuter la Bambochade de M. Martelli.
Nos représentations finies, et la cure du Comte de Lantieri allant toujours de mieux en mieux, mon pere commençoit à parler de s'en retourner chez lui. On me proposa en même-tems d'aller faire un tour avec le Secrétaire du Comte, qui étoit chargé de commissions pour son maître; mon pere m'accorda quinze jours d'absence, et nous partîmes en poste dans un petit charriot à quatre roues.
Nous arrivâmes d'abord à Laubeck, Capitale de la Carniole, sur la riviere du même nom. Je n'y ai vu d'extraordinaire que des écrevisses d'une beauté surprenante, et aussi grandes que les houmards, puisqu'il y en avoit de la longueur d'un pied.
De-là nous passâmes à Gratz, Capitale de la Styrie, où il y a une très-ancienne et très-célebre Université, bien plus fréquentée que celle de Pavie; les Allemands étant beaucoup plus studieux, et moins dissipés que les Italiens.
J'aurois bien voulu pouvoir pousser ma route jusqu'à Prague, mais nous étions pressés, mon compagnon de voyage et moi, lui, pour les ordres de son maître, moi, pour ceux de mon pere. Tout ce que nous fîmes, fut de ne pas revenir par le même chemin; nous traversâmes la Carinthie, nous vîmes Trieste, Port de mer considérable sur la mer Adriatique, de- là nous passâmes par Aquilea et par Gradisca, et nous nous rendîmes à Vipack, deux jours plus tard qu'on ne nous l'avoit prescrit.
Aussi-tôt que je fus de retour, mon pere prit congé du Comte Lantieri, qui lui fit présent, pour récompenser ses soins, d'une somme d'argent très-honnête, et y joignit une très-belle boîte avec son portrait, et une montre d'argent pour moi. Un jeune homme dans ce tems-là étoit bien content quand il pouvoit avoir une montre d'argent! A présent les laquais ne daignent pas en porter.
En prenant la poste à Gorice, je priai mon pere de préférer la route de Palma-Nova que je n'avois pas vue; mais dans le fond, c'étoit pour éviter de passer par Udine où la derniere aventure me faisoit craindre quelque rencontre désagréable. Mon pere y consentit de bonne foi et nous y arrivâmes à la premiere dînée.
Palma, ou Palma-Nova, est une des plus fortes et de plus considérables forteresses de l'Europe. Elle appartient aux Vénitiens, et c'est le rempart de leurs Etats du côté de l'Allemagne.
Les fortifications sont si bien ordonnées et si bien exécutées, que les Etrangers vont les voir par curiosité, comme un chef-d'œuvre d'architecture militaire.
La République de Venise envoyé à Palma un Provéditeur-Général pour la gouverner. Il préside au civil, au criminel et au militaire, et il rend compte au Sénat journellement de tout ce qui peut intéresser le Gouvernement.
Nous allâmes faire une visite au Provéditeur-Général, que mon pere avoit connu à Venise. Ce digne Sénateur nous reçut avec beaucoup de bonté; il avoit vu mon Carême Poëtique, et il m'en fit compliment; mais en me regardant avec un souris malin, il me dit que les Sermons du Pere Cataneo ne paroissoient pas m'avoir beaucoup sanctifié, me faisant comprendre qu'il étoit instruit de mes étourderies postérieures; et cela n'étoit pas bien difficile à cause de la proximité des lieux. Je rougis un peu; mon pere s'en apperçut, et me demanda depuis, ce que cela vouloit dire; je dis que je n'y comprenois rien, et il ne m'en parla pas davantage: nous soupâmes chez son Excellence, et nous partîmes le lendemain.
En nous approchant du Taillamento, que nous devions repasser, on nous dit que ce torrent avoit furieusement débordé, et qu'il n'étoit pas possible de le traverser. Comme nous n'étions pas bien éloignés d'Udine, mon pere proposa d'aller attendre tranquillement dans cette ville que les eaux revinssent dans leur état naturel. Udine me faisoit peur, j'y trouvois des difficultés. Mon pere insistoit, et moi toujours de nouvelles raisons. Mon pere s'impatientoit; nous descendîmes dans un cabaret; on nous servit un déjeûné dînatoire, et là mon pere, rapprochant les propos du Général de Palma de ceux que je tenois pour ne pas repasser par Udine, me pressa si fort que je fus obligé de lui dire, le plus modestement que je pus, tout ce qui m'étoit arrivé. Il s'amusa de l'aventure de Thérese, et me conseilla d'en tirer parti en me défiant des femmes suspectes, mais sur l'article de la Limonadiere, en me parlant plus en ami qu'en pere, il me fit voir mes torts, et il me fit pleurer. Heureusement on vint nous dire que le Taillamento étoit devenu guéable, et nous reprîmes la route que nous avions suspendue.
Mon retour à Chiozza. - Mon départ pour Modene. - Spectacle affreux. - Mes vapeurs. - Ma guérison à Venise.
Nous arrivâmes à Chiozza, et nous fûmes reçus comme une mere reçoit son cher fils, comme une femme reçoit son cher époux après une longue absence; j'étois très-content de revoir cette vertueuse mere qui m'étoit tendrement attachée; après avoir été séduit et trompé, j'avois besoin d'être aimé: c'étoit une autre espece d'amour celui-ci, mais en attendant que je pusse goûter les délices d'une passion honnête et agréable, l'amour maternel faisoit ma consolation; nous nous aimions tous deux, ma mere et moi; mais quelle différence de l'amour d'une mere pour son fils, à celui d'un fils pour sa mere! Les enfans aiment par reconnoissance; les meres aiment par impulsion naturelle, et l'amour propre n'a pas moins de part dans leur tendre amitié; elles aiment les fruits de leur union conjugale, qu'elles ont conçus avec satisfaction, qu'elles ont portés avec peine dans leur sein, qu'elles ont mis au monde avec tant de souffrances; elles les ont vus croître de jour en jour; elles ont joui des premiers traits de leur innocence; elles se sont habituées à les voir, à les aimer, à les soigner... Je crois même que cette derniere raison l'emporte sur les autres, et qu'une mere n'aimeroit pas moins un enfant qu'on lui auroit changé en nourrice, si elle l'avoit reçu de bonne foi pour le sien, si elle avoit pris soin de sa premiere éducation, et s'étoit habituée à le caresser et à le chérir.
Voilà une digression étrangere à ces Mémoires, mais j'aime à bavarder quelquefois; et sans courir après l'esprit, rien ne m'intéresse davantage que l'analyse du cœur humain. Reprenons le fil de notre discours.
Mon pere reçut une lettre de son cousin Zavarisi, Notaire à Modene, et en voici le contenu.
Le Duc venoit de renouveller un ancien Edit, par lequel il étoit défendu à tout possesseur de rentes et de biens fonds, de s'absenter de ses états sans permission, et ces permissions coûtoient cher.
M. Zavarisi ajoutoit dans sa lettre, que nos vues sur Milan, à mon égard, étant manquées, il conseilloit mon pere de m'envoyer à Modene, où il y avoit une Université comme à Pavie, où j'aurois pu achever mon droit, et être Licencié, et ensuite me faire recevoir Avocat. Ce bon parent, qui nous étoit vraiment attaché, rappelloit à mon pere que nos ayeux avoient toujours occupé des places distinguées dans le Duché de Modene, que je pourrois faire revivre l'ancien crédit de notre famille, et éviter en même-tems la dépense d'une permission qu'il faudroit renouveller tous les deux ans; il finissoit par dire qu'il se chargeroit du soin de ma personne, qu'il me chercheroit une bonne et honnête pension. Il y avoit dans un PostScriptum, qu'il avoit jetté les yeux sur moi pour un bon mariage.
Cette lettre occasionna beaucoup de raisonnemens, et des pour et des contre sans fins, entre mon pere et ma mere. Le maître l'emporta, et il fut décidé que je partirois incessamment avec le courier de Modene.
Il y a à Venise des couriers qui courent, et des couriers qui ne courent pas. Les premiers on les appelle les couriers de Rome, qui ne vont d'ordinaire qu'à Rome et à Milan, et par extraordinaire par-tout où la République les envoye. Ce sont des charges fixées au nombre de trente-deux, et ils jouissent d'une certaine considération dans la bourgeoisie.
Mais pour les autres couriers, c'est bien différent; ce ne sont que des conducteurs de coches d'eau, payés par leurs fermiers respectifs, ils sont cependant dans le cas d'avancer leur fortune, en tirant parti des recoins de leurs barques, pour y receler leurs paquets.
On est très-commodément dans ces coches d'eau, qui sont au nombre de cinq. Celui de Ferrare, celui de Bologne, celui de Modene, celui de Mantoue et celui de Florence: on y est nourri, si l'on veut, et de toute façon; le prix en est très- modique.
Il n'y a qu'un seul inconvénient; c'est que dans un seul et même voyage, il faut changer de barque trois fois. Chaque Etat par où ces couriers doivent passer, prétend avoir droit d'employer ses coches et ses matelots, et les différens Etats limitrophes n'ont jamais imaginé un arrangement qui pourroit tourner au profit commun, sans gêner les passagers. Je souhaite que les maîtres du Po lisent mes Mémoires, et profitent de mon avis.
Me voilà donc dans la barque couriere de Modene; nous étions quatorze passagers: notre conducteur, appellé Bastia, étoit un homme fort âgé, fort maigre, d'une phisionomie sévere; cependant très-honnête homme, et même dévot.
Nous fûmes servis à la premiere dînée tous ensemble, à l'auberge où notre Patron fit la provision nécessaire pour le souper, qui se fait en marchant.
A la nuit tombante, on allume les deux lampes qui éclairent par-tout, et voilà le courier qui paroît au milieu de nous, un chapelet à la main, et nous prie et nous exhorte très-poliment de réciter avec lui à haute voix une tierce-partie du Rosaire, et les Litanies de la Vierge.
Nous nous prêtâmes presque tous à la pieuse insinuation du bon-homme Bastia, et nous nous rangeâmes des deux côtés pour partager les Pater et les Ave, Maria, que nous récitions assez dévotement. Il y avoit dans un coin du coche trois de nos voyageurs, qui, le chapeau sur la tête, ricanoient entr'eux, nous contrefaisoient, et se moquoient de nous. Bastia s'en apperçut; il pria ces Messieurs d'être au moins honnêtes, s'ils ne vouloient pas être dévots. Les trois inconnus lui rirent au nez; le courier souffre, et n'en dit pas davantage, ne sachant pas à qui il avoit à faire; mais un matelot qui les avoit reconnus, dit au courier que c'étoit trois Juifs. Bastia monte en fureur, et crie comme un possédé: Comment! vous êtes des Juifs, et à la dînée vous avez mangé du jambon!
A cette escapade inattendue, tout le monde se mit à rire, et les Juifs aussi. Le courier va son train; je plains, dit-il, les malheureux qui ne connoissent pas notre Religion; mais je méprise ceux qui n'en observent aucune. Vous avez mangé du jambon, vous êtes des coquins; les Juifs en fureur se jettent sur le conducteur: nous prîmes le parti raisonnable de le garantir, et nous forçâmes les Israëlites à faire bande à part.
Notre Rosaire interrompu fut remis au lendemain; nous soupâmes assez gaîment, nous nous couchâmes sur nos petits matelas, et il n'y eut rien d'extraordinaire pendant le reste du voyage.
En approchant de Modene, Bastia me demanda où j'allois me loger; je ne le savois pas moi-même; M. Zavarisi devoit me chercher une pension: Bastia me pria d'aller en pension chez lui; il connoissoit M. Zavarisi, il se flattoit qu'il le trouveroit bon: effectivement mon cousin donna son approbation, et j'allai demeurer chez le courier qui ne couroit pas.
C'étoit une maison de dévots; le pere, le fils, les filles, la bru, les enfans étoient tous dans la plus grande dévotion; je ne m'y amusois pas: mais comme c'étoient d'honnêtes gens qui vivoient sagement et tranquillement, j'étois très-content de leurs attentions, et on est toujours estimable quand on remplit les devoirs de la société.
Mon cousin Zavarisi, très-content de me voir auprès de lui, me présenta d'abord au Recteur de l'Université, et m'emmena ensuite chez un célebre Avocat du pays, où je devois apprendre la Pratique, et où je pris ma place dans l'instant.
Il y avoit dans cette Etude un neveu du célèbre Muratori, qui me procura la connoissance de son oncle, homme universel, qui embrassoit tous les genres de Littérature, qui fit tant d'honneur à sa nation et à son siècle, et auroit été Cardinal, s'il eut moins bien soutenu dans ses écrits les intérêts de la maison d'Est.
Mon nouveau camarade me fit voir tout ce qu'il y avoit de plus curieux dans la Ville. Le Palais ducal entr'autres qui est de la plus grande beauté et de la plus grande magnificence, et cette collection de tableaux si précieuse qui existoit encore à Modene dans ce tems-là, et que le Roi de Pologne acheta pour le prix considérable de cent mille sequins (1100000 liv.).
J'étois curieux de voir ce fameux sceau, qui est le sujet de la Secchia rapita (le Sceau enlevé) du Tassoni: je le vis dans le clocher de la Cathédrale, où il est suspendu perpendiculairement à une chaîne de fer. Je m'amusois assez bien, et je crois que le séjour de Modene m'auroit convenu, à cause de la société de Gens-de-lettres qui y abondent, à cause des Spectacles qui y sont très-fréquens, et par l'espérance que j'avois d'y réparer mes pertes.
Mais un spectacle affreux que je vis peu de jours après mon arrivée, une cérémonie horrible, une pompe de jurisdiction religieuse, me frappa si fort, que mon esprit fut troublé, et mes sens agités.
Je vis au milieu d'une foule de monde un échallaud élevé à la hauteur de cinq pieds, sur lequel un homme paroissoit tête nue et mains liées: c'étoit un Abbé de ma connoissance, homme de Lettres très-éclairé, Poëte célebre, très-connu, très-estimé en Italie; c'étoit l'Abbé J... B... V... Un Religieux tenoit un livre à la main; un autre interrogeoit le patient; celui-ci répondoit avec fierté: les spectateurs claquoient des mains, et l'encourageoient: les reproches augmentoient: l'homme flétri frémissoit: je ne pus plus y tenir. Je partis rêveur, agité, étourdi; mes vapeurs m'attaquèrent sur-le-champ: je rentrai chez moi, je m'enfermai dans ma chambre, plongé dans les réflexions les plus tristes et les plus humiliantes pour l'humnanité.
Grand Dieu! me disois-je à moi-même, à quoi sommes-nous sujets dans cette courte vie que nous sommes forcés de traîner? Voilà un homme accusé d'avoir tenu des propos scandaleux à une femme qui venoit de faire son beau jour. Qui est-ce qui l'a dénoncé? C'est la femme elle-même. Ciel! Ne suffit-il pas d'être malheureux pour être puni?
Je passai en revue tous les événemens qui m'étoient arrivés, et qui auroient pu être dangereux pour moi: la malade de Chiozza, la femme-de-chambre et la limonadiere de Frioul, la satyre de Pavie, et d'autres fautes que j'avois à me reprocher.
Pendant que j'étois dans mes tristes rêveries, voilà le père Bastia, qui, me sachant rentré, vient me proposer d'aller réciter le Rosaire avec sa famille. J'avois besoin d'une distraction, j'acceptai avec plaisir: je dis mon Rosaire assez dévotement, et j'y trouvai ma consolation.
On servit le souper, et on parla de l'Abbé V... Je marquai l'horreur que cet appareil m'avoit fait; mon hôte, qui étoit de la société séculiere de cette jurisdiction, trouva la cérémonie superbe et exemplaire. Je lui demandai comment le spectacle s'étoit terminé: il me dit que l'orgueilleux avoit été humilié, que l'obstiné avoit enfin cédé; qu'il fut obligé d'avouer, à haute voix, tous ses crimes, de réciter une formule de rétractation qu'on lui avoit présentée, et qu'il étoit condamné à six années de prison.
La vue terrible de l'homme flétri ne me quittoit pas: je ne voyois plus personne: j'allois à la messe tous les jours avec Bastia: j'allois au sermon, au salut, aux offices avec lui: il étoit très-content de moi, et il cherchoit à nourrir cette onction qui paroissoit dans mes actions et dans mes discours, par des récits de visions, de miracles et de conversions.
Mon parti étoit pris; j'étois fermement résolu d'entrer dans l'ordre des Capucins. J'écris à mon père une lettre bien étudiée, et qui n'avoit pas le sens commun: je le priai de m'accorder la permission de renoncer au monde, et de m'envelopper dans un capuchon. Mon pere, qui n'étoit pas sot, se garda bien de me contrarier: il me flatta beaucoup: il parut content de l'inspiration que je lui marquois, et me pria seulement d'aller le rejoindre aussitôt sa lettre reçue, me promettant que lui et ma mere n'aimoient pas mieux que de me satisfaire.
A la vue de cette réponse, je me disposai à partir. Bastia, qui ne devoit pas ce jour-là conduire la barque de Venise, me recommanda à son camarade qui alloit partir. Je fis mes adieux à la dévote famille; je me recommandai bien à leurs prieres, et je partis dans les élans de la contrition.
Arrivé à Chiozza, mes chers parens me reçurent avec des caresses sans fin. Je leur demandai leur bénédiction: ils me la donnerent en pleurant: je parlai de mon projet; ils ne le trouverent pas mauvais. Mon pere me proposa de m'emmener à Venise, je le refusai avec la franchise de la dévotion: il me dit que c'étoit pour me présenter au Gardien des Capucins, j'y consentis de bon cœur.
Nous allons à Venise; nous voyons nos parens, nos amis: nous dînons chez les uns, nous soupons chez les autres. On me trompe: on m'emmene à la Comédie: au bout de quinze jours, il ne fut plus question de clôture. Mes vapeurs se dissiperent; ma raison revint. Je plaignois toujours l'homme que j'avois vu sur un échaffaud; mais je reconnus qu'il n'etoit pas nécessaire de renoncer au monde pour l'éviter.
Toujours à Chiozza. - Absence de mon frere cadet. - Mon nouvel emploi. - Anecdote d'une Religieuse et d'une Pensionnaire.
Mon pere me ramena à Chiozza, et ma mere qui étoit pieuse, sans être bigotte, fut bien contente de me revoir dans mon assiette ordinaire. Je lui devenois encore plus cher et plus intéressant, à cause de l'absence de son cadet.
Mon frere, qui avoit été de tout tems destiné pour le Militaire, étoit parti pour Zara, Capitale de la Dalmatie; on l'avoit adressé à M. Visinoni, cousin de ma mere, Capitaine de Dragons, et Aide-Major du Provéditeur- Général de cette Province, qui appartient à la République de Venise.
Ce brave Officier, que tous les Généraux qui se succédoient à Zara vouloient avoir auprès d'eux, s'étoit chargé de l'éducation de mon frere, et le plaça ensuite dans son Régiment.
Pour moi, je ne savois pas ce que j'allois devenir. J'avois, à l'âge de vingt-un ans, essuyé tant de revers, il m'étoit arrivé tant de catastrophes singulieres, tant d'événemens fâcheux, que je ne me flattois plus de rien, et je ne voyois d'autre ressource dans mon esprit que l'art dramatique, que j'aimois toujours, et que j'aurois entrepris depuis longtems, si j'eusse été maître de ma volonté.
Mon pere, fâché de me voir devenu le jouet de la fortune, ne perdit pas la tête dans des circonstances qui devenoient sérieuses pour lui et pour moi. Il avoit fait des dépenses considérables et inutiles pour me donner un état, et il auroit voulu me procurer un emploi honnête et lucratif, qui ne lui coutât rien. Cela n'étoit pas facile à trouver: il le trouva cependant, et si bien de mon goût, que j'oubliai toutes les pertes que j'avois faites, et je n'eus plus rien à regretter.
La République de Venise envoie à Chiozza pour Gouverneur un noble Vénitien, avec le titre de Podestà; celui-ci emmene avec lui un Chancelier, pour le criminel: emploi qui revient à celui de Lieutenant-Criminel en France; et ce Chancelier-Criminel doit avoir un Aide dans son Office, avec le titre de Coadjuteur.
Ces places sont plus ou moins lucratives, selon le pays où l'on se trouve; mais elles sont toujours très-agréables, puisqu'on a la table du Gouverneur, qu'on fait la partie de son Excellence, et qu'on voit ce qu'il y a de plus grand dans la Ville: et pour peu que l'on y travaille, on se tire d'affaire assez bien.
Mon pere jouissoit de la protection du Gouverneur, qui étoit alors le noble François Bonfadini. Il étoit aussi très-lié avec le Chancelier-Criminel, et connoissoit beaucoup le Coadjuteur. Bref, il me fit recevoir pour Adjoint à ce dernier.
Le tems des Gouvernemens Vénitiens est fixé; on les change toujours au bout dé seize mois. Quand je suis entré en place, il y en avoit quatre de passés. D'ailleurs, j'étois surnuméraire; je ne pouvois prétendre à aucune espèce d'émolumens; mais je jouissois de tous les agrémens de la société. Bonne table, beaucoup de jeu, des concerts, des bals, des festins. C'étoit un emploi charmant; mais comme ce ne sont pas des Charges, et que le Gouverneur est le maître d'en donner la commission à qui bon lui semble, il y a de ces Chanceliers qui pourrissent dans l'inaction; et il y en a qui passent et sautent pardessus les autres, et n'ont pas le tems de se reposer. C'est le mérite personnel qui les fait rechercher; mais le plus souvent ce sont les protections qui l'emportent.
J'étois prévenu de la nécessité de m'assurer une réputation; et en ma qualité de surnurnéraire, je cherchois tous les moyens de m'instruire, et de me rendre utile. Le Coadjuteur n'aimoit pas trop le travail. Je le soulageois autant qu'il m'étoit possible; et au bout de quelques mois, j'étois devenu aussi habile que lui. Le Chancelier ne tarda pas à s'en appercevoir; et sans passer par le canal de son Coadjuteur, il me donnoit des commissions épineuses, et j'avois le bonheur de le contenter.
La procédure criminelle est une leçon très-intéressante pour la connoissance de l'homme. Le coupable cherche à détruire son crime, ou à en diminuer l'horreur: il est naturellement adroit, ou il le devient par crainte: il sait qu'il a affaire à des des gens du métier, et il ne désespère pas de pouvoir les tromper.
La loi a prescrit aux Criminalistes des formules d'interrogatoire, qu'il faut suivre pour que les demandes ne soient pas captieuses, et que la foiblesse ou l'ignorance ne soit pas surprise. Cependant, il faut un peu connoître ou tâcher de deviner le caractère et l'esprit de l'homme qu'on doit examiner; et tenant le milieu entre la rigueur et l'humanité, on cherche à démêler la vérité sans contrainte.
Ce qui m'intéressoit davantage étoit le résumé de la procédure, et le rapport que je préparois pour mon Chancelier: c'est de ces résumés et de ces rapports que sou, vent l'état, l'honneur et la vie d'un homme dépendent. Les inculpés sont défendus, la matiere est discutée; mais le rapport fait une premiere impression. Malheur à ceux qui font des résumés sans connoissance, et des rapports sans réflexion.
Ne dites pas, mon cher Lecteur, que je me donne les violons; vous voyez que quand je fais des étourderies, je ne m'épargne pas, il faut bien que je prenne ma revanche, quand je suis content de moi.
Les seize mois de résidence du Podestà touchoient à leur terme. Notre Chancelier Criminel étoit déjà retenu pour Feltre; il me proposa la place de Coadjuteur en Chef, si je voulois le suivre: enchanté de cette proposition, je pris le tems convenable pour en parler à mon pere, et le lendemain nos engagemens furent arrêtés.
Enfin, me voilà établi; jusqu'alors je n'avois regardé les emplois que de loin: j'en tenois un qui me plaisoit, qui me convenoit; je me proposois bien de ne pas le quitter; mais l'homme propose, et Dieu dispose.
Au départ de notre Gouverneur de Chiozza, tout le monde s'empressa de lui faire honneur; les beaux esprits de la ville, s'il y en avoit, firent une assemblée littéraire, dans laquelle on célébra, en vers et en prose, le Préteur illustre qui les avoit gouvernés.
Je chantai aussi toutes les sortes de gloire du héros de la fête, et je m'étendis davantage sur les vertus et les qualités personnelles de Madame la Gouvernante; l'un et l'autre avoient des bontés pour moi, et à Bergame, où je les ai revus en charge quelque tems après, et à Venise, où son Excellence avoit été décorée du grade de Sénateur, ils m'ont toujours honoré de leur protection.
Tout ce monde partit; je restai à Chiozza en attendant que M. Zabottini (c'étoit le nom du Chancelier) m'appellât à Venise, pour le voyage de Feltre. J'avois toujours cultivé la connoissance des Religieuses de Saint François, où il y avoit de charmantes Pensionnaires; la dame B*** en avoit une sous sa direction, qui étoit fort belle, fort riche et très-aimable; elle m'auroit infiniment convenu, mais mon âge, mon état, ma fortune ne pouvoient pas me permettre de m'en flatter; la Religieuse, cependant, ne me désespéroit pas; quand j'allois la voir, elle ne manquoit jamais de faire descendre la Demoiselle dans le parloir. Je sentois que j'allois m'y attacher tout de bon; la Directrice en paroissoit contente; je ne la comprenois pas: je lui parlai un jour de mon inclination et de ma crainte; elle m'encouragea, et me confia le secret. Cette Demoiselle avoit du mérite et du bien; mais il y avoit du louche sur sa naissance: ce petit défaut n'étoit rien, disoit la Dame voilée, la fille est sage, elle est bien élevée, je réponds de son caractere et de sa conduite; elle a un Tuteur, continua-t-elle, il faudra le gagner: laissez-moi faire; il est vrai que ce Tuteur, très-vieux et très-cassé, a quelque prétention sur sa pupile, mais il a tort, et... comme j'y suis pour quelque chose... laissez-moi faire, encore une fois, j'arrangerai les choses pour le mieux.
J'avoue que d'après ces discours, d'après cette confidence et cet encouragement, je commençois à me croire heureux. Mademoiselle N*** ne me regardoit pas de mauvais œil, et je comptois la chose comme faite.
Tout le Couvent s'étoit apperçu de mon penchant pour la Pensionnaire, et il y a eu des Demoiselles, qui, connoissant les intrigues du parloir, prirent pitié de moi, me mirent au fait de ce qui se passoit: et voici comment.
Les fenêtres de ma chambre donnoient justement vis-à-vis le clocher du couvent; on avoit ménagé dans sa construction de faux jours, au travers desquels on voyoit confusément la figure des personnes qui s'y accostoient; j'avois vu plusieurs fois à ces trous, qui étoient des quarrés longs, des figures et des signes, et j'appris avec le tems, que ces signes marquoient les lettres de l'alphabet, qu'on formoit des mots, et qu'on pouvoit se parler de loin; j'avois presque tous les jours une demi-heure de cette conversation muette, dont les propos n'étoient que sages et décens.
C'est par le moyen de cet alphabet manuel, que j'appris que Midemoiselle N*** alloit se marier incessamment avec son Tuteur. Indigné des procédés de la dame B***, j'allai la voir l'après-dîné, bien déterminé à lui marquer mon ressentiment: je la fais demander; elle vient, elle me regarde fixement, elle s'apperçoit que j'ai du chagrin, et adroite comme elle étoit, elle ne me donne pas le tems de parler; elle m'attaque la premiere avec vigueur, et avec une sorte d'emportement.
Eh bien, Monsieur, me dit-elle, vous êtes fâché, je le vois à votre mine; - je voulois parler, elle ne m'écoute pas; elle hausse la voix, et continue: - Oui, Monsieur, Mademoiselle N*** se marie, et c'est son Tuteur qui va l'épouser; - je veux parler haut aussi: - Paix, paix, s'écrie-t-elle, écoutez-moi: ce mariage-là est mon ouvrage, c'est d'après mes réflexions que je l'ai secondé, et c'est pour vous que je l'ai sollicité. - Pour moi? dis-je. - Oui. Paix, dit-elle, et vous allez voir la marche d'une femme droite, et qui vous est attachée. Etes-vous, continua-t-elle, en état de vous marier? Non, pour cent raisons. La Demoiselle auroit-elle attendu votre commodité? Non, elle n'en étoit pas la maîtresse; il falloit la marier; un jeune homme l'auroit épousée, vous l'auriez perdue pour toujours. Elle se marie à un vieillard, à un homme valétudinaire, qui ne peut pas vivre long-tems, et quoique je ne connoisse pas les agrémens et les désagrémens du mariage, je sais qu'une jeune femme doit abréger les jours d'un vieux mari; vous aurez une jolie veuve, qui n'aura eu de femme que le nom; soyez tranquille là-dessus: elle aura été avantagée, elle sera encore plus riche, qu'elle ne l'est actuellement; en attendant vous ferez votre chemin. Ne craignez rien sur son compte, non, mon cher ami, ne craignez rien; elle vivra dans le monde avec son barbon, mais je veillerai sur sa conduite. Oui, oui, elle est à vous, je vous la garantis, je vous en donne ma parole d'honneur.
Voilà Mademoiselle N*** qui arrive, et qui s'approche de la grille. La Directrice me dit d'un air mistérieux: faites les compliment à Mademoiselle sur son mariage. Je ne puis plus y tenir; je tire ma révérence, et je m'en vais sans rien dire.
Je ne vis plus ni la Directrice, ni la Pensionnaire, et Dieu merci, je ne tardai pas à les oublier l'une et l'autre.
Mon arrivée à Feltre. - Troupe de Comédiens. - Spectacle de société. - Mes premiers Ouvrages Comiques. - Mes amours.
Aussitôt que je reçus la lettre d'avis pour aller à Feltre, je partis de Chiozza accompagné de mon père, et j'allai à Venise me présenter, avec lui, à son Excellence Paolo Spinelli, noble Vénitien, qui étoit le Podestà ou Gouverneur que je devois suivre. Nous allâmes voir aussi le Chancelier Zabottini, sous les ordres duquel je devois travailler. Je partis de Venise quelques jours après, et j'arrivai au bout de quarante-huit heures à l'endroit de ma résidence.
Feltre ou Feltri est une ville qui fait partie de la Marche Trévisane, province de la République de Venise, à soixante lieues de la Capitale; il y a évêché et beaucoup de noblesse.
La Ville est montagneuse, escarpée, et si bien couverte de neige pendant tout l'hiver, que les portes dans les petites rues étant bouchées par les glaces, on est obligé de sortir par les fenêtres des entresols. On attribue à César ce vers latin:
Feltria perpetuo nivium damnata rigori.
En François:
Feltre toujours livrée à la rigueur des neiges.
Arrivé avant les autres pour recevoir de mon prédécesseur la consigne des Archives et des procédures entamées, j'appris, avec une surprise agréable, qu'il y avoit dans la Ville une Troupe de Comédiens que l'ancien Gouverneur avoit fait venir, et qui comptoit donner quelques représentations à l'arrivée du nouveau.
Le Directeur de cette Troupe étoit Charles Véronese, celui qui, trente ans après, vint à Paris jouer les rôles de Pantalon à la Comédie Italienne, et y emmena ses filles: la belle Coraline et la charmante Camille.
La Troupe n'étoit pas mauvaise, le Directeur, malgré son œil de verre, jouoit les premiers amoureux; et je vis, avec plaisir, ce Florinde dei Macaroni, que j'avois vu à Rimini, et qui, ayant vieilli, ne jouoit plus que les Rois dans la Tragédie, et les pères nobles dans la Comédie.
Quatre jours après, le Gouverneur arriva avec le Chancelier et un autre Officier de Justice, avec le titre de Vicaire, qui, dans ce pays-là, et dans bien d'autres de l'Etat de Venise, réunit sa voix à celle du Podestà dans les Arrêts et dans les Jugemens.
Je mis de côté, pendant quelques mois, toute idée de plaisir et d'amusement, et je m'appliquai sérieusement au travail, d'autant plus qu'après ce second gouvernement que je faisois en qualité de Coadjuteur, je pouvois aspirer à devenir Chancelier. Je parcourus les papiers de la Chancellerie, et je trouvai une commission du Sénat, qui avoit été négligée par mes prédécesseurs: j'en rendis compte à mon principal; il jugea l'affaire intéressante, et il me chargea de la suivre de toutes mes forces.
C'étoit un procès criminel, à cause d'une coupe de bois de construction dans les forêts de la République; et il y avoit deux cens personnes impliquées dans ce crime. Il falloit se transporter sur les lieux pour constater le corps du délit. J'y allai moi-même avec des arpenteurs et des gardes, à travers des rochers, des torrens et des précipices. Cette procédure faisoit grand bruit, tout le monde étoit allarmé; car il y avoit cent ans qu'on détruisoit les bois impunément, et il y avoit à craindre une révolte qui auroit bien pu tomber sur ce pauvre diable de Coadjuteur, qui avoit réveillé le chat qui dormoit.
Heureusement, cette grande affaire se termina comme l'accouchement de la montagne. La République se contenta de garantir ses bois à l'avenir. Le Chancelier n'y perdit rien, et le Coadjuteur fut dédommagé de sa peur.
On me chargea quelque tems après d'une autre commission bien plus agréable et plus amusante. Il s'agissoit d'un procès-verbal à dix lieues de la Ville, à cause d'une dispute avec explosion d'armes à feu et blessures dangereuses. Comme c'étoit un pays plat, et qu'on y alloit en cotoyant des terres et des maisons de campagnes charmantes, j'engageai plusieurs de mes amis à me suivre; nous étions douze, six hommes, six femmes, et quatre domestiques. Tout le monde étoit à cheval, et nous employâmes douze jours pour cette expédition délicieuse. Pendant ce tems-là, nous n'avons jamais dîné et soupé dans le même endroit; et pendant douze nuits, nous n'avons jamais couché sur des lits.
Nous allions très-souvent à pied dans des chemins délicieux bordés de vignes et ombragés par des figuiers, déjeûnant avec du lait et quelquefois avec la nourriture quotidienne des paysans, qui est la bouillie de bled de Turquie, appellée polenta, et dont nous faisions des roties appétissantes.
Partout où nous arrivions, c'étoit des fêtes, des réjouissances, des festins: où nous nous arrêtions le soir, c'étoit des bals qui duroient toute la nuit, et nos femmes tenoient bon aussi bien que les hommes.
Il y avoit, dans cette société, deux sœurs dont l'une étoit mariée et l'autre ne l'étoit pas. Je trouvois celle-ci fort à mon gré, et je puis dire que ce n'étoit que pour elle que j'avois fait la partie. Elle étoit sage et modeste autant que sa sœur étoit folle: la singularité de notre voyage nous fournit la commodité de nous expliquer, et nous devinmes amoureux l'un de l'autre.
Mon procès-verbal fut expédié à la hâte en deux heures de tems; nous prîmes une autre route pour revenir, afin de varier nos plaisirs; mais à notre arrivée à Feltre, nous étions tous rompus, fracassés, abymés; je m'en ressentis pendant un mois, et ma pauvre Angélique eut une fièvre de quarante jours.
Les six Cavaliers de notre cavalcade vinrent me proposer une autre espèce de plaisir. Il y avoit dans le Palais du Gouvernement une salle de Spectacle; ils avoient envie d'en faire quelque chose, et ils me firent l'honneur de me dire que ce n'étoit que pour moi qu'ils en avoient conçu le projet, et ils me laissoient le maître du choix des pieces, et de la distribution des rôles.
Je les remerciai; j'acceptai la proposition, et sous le bon plaisir de son Excellence et de mon Chancelier, je me mis à la tête de ce nouveau divertissement.
J'aurois bien desiré que ce fût du genre comique; je n'aimois pas les arlequinades; de bonnes Comédies, il n'y en avoit pas. Je préférai donc le tragique. Comme on donnoit par-tout, dans ce tems-là, les Opéras de Métastase, même sans musique, je mis les airs en récitatifs; je tâchai de me rapprocher le mieux que je pus du style de ce charmant Auteur, et je choisis la Didone et le Siroé pour nos représentations. Je distribuai les rôles adaptés au personnel de mes Acteurs, que je connoissois; je gardai pour moi les derniers, et je fis bien; car, pour le tragique, j'étois complètement mauvais.
Heureusement, j'avois composé deux petites pieces; j'y jouois deux rôles de caractere, et je réparai ma réputation. La premiere de ces pieces étoit le bon Pere; la seconde, la Cantatrice (la Chanteuse). L'une et l'autre furent trouvées bonnes, et mon jeu assez passable pour un Amateur. Je vis la dernière de ces deux pieces à Venise, quelque tems après. Un jeune Avocat s'en étoit emparé: il la donnoit comme son ouvrage, et il en recevoit les complimens; mais ayant osé la faire imprimer sous son nom, il eut le désagrément de voir son plagiat démasqué.
Je fis tout ce que je pus pour engager ma belle Angélique à accepter un rôle dans nos Tragédies: il ne fut pas possible; elle étoit timide, et d'ailleurs ses parens ne l'auroient pas permis. Elle vint nous voir; mais ce plaisir lui coûta des larmes; car elle étoit jalouse, et souffroit beaucoup de me voir familiarisé avec mes jolies camarades.
La pauvre petite m'aimoit tendrement et de bonne foi; je l'aimois aussi de toute mon ame, et je puis dire que c'étoit la premiere personne que j'eusse aimée. Elle aspiroit à devenir ma femme, et elle le seroit devenue, si des réflexions singulières, et cependant bien fondées, ne m'eussent pas détourné.
Sa sœur aînée avoit été une beauté rare; et à ses premieres couches, elle devint laide. La Cadette avoit la même peau, les mêmes traits; c'étoit de ces beautés délicates que l'air flétrit, que la moindre peine dérange: j'en ai vu une preuve évidente. La fatigue du voyage que nous fîmes ensemble l'avoit furieusement changée. J'étois jeune; et si ma femme, au bout de quelque tems, eût perdu sa fraîcheur, je prévoyois quel auroit dû être mon désesepoir.
C'étoit trop raisonner pour un amant; mais soit vertu, soit foiblesse, soit inconstance, je quittai Feltre sans l'épouser.
Réflexions morales. - Changement de position de mon pere. - Mon embarquement pour Ferrare. - Mauvaise rencontre. - Mon arrivée à Bagnacavallo. - Petit voyage à Fayence. - Mort de mon pere.
J'eus de la peine à me détacher de cet objet charmant, qui m'avoit fait goûter les premiers charmes d'un amour vertueux. Il faut dire cependant que cet amour n'étoit pas d'une trempe bien vigoureuse, puisque je quittai ma maîtresse. Un peu plus d'esprit, un peu plus de grace, m'auroient peut-être fixé; mais il n'y avoit que de la beauté; cette beauté même me paroissoit sur son déclin: j'eus le tems de la réflexion, et l'amour-propre fut plus fort que ma passion.
Il me falloit une distraction, et j'en trouvai de plusieurs especes. Mon pere qui ne pouvoit se fixer nulle part, manie qu'il a laissée en héritage à son fils, avoit changé de pays. En revenant de Modene où il s'étoit transporté pour des affaires de famille, il passa par Ferrare; et là, on lui proposa un parti très-avantageux, pour qu'il allât s'établir à Bagnacavallo, en qualité de Médecin, avec des honoraires fixes. L'affaire étoit bonne, il accepta la proposition, et je devois aller le rejoindre aussi-tôt que je serois libre.
En partant de Feltre, je passai par Venise sans m'y arrêter, et je m'embarquai avec le Courier de Ferrare. Il y avoit, dans la barque, beaucoup de monde, mais mal assorti. Un jeune homme entr'autres, maigre, pâle, cheveux noirs, la voix cassée et une phisionomie sinistre, fils d'un Boucher de Padoue, et qui tranchoit du grand. Monsieur s'ennuyoit; il invitoit tout le monde à jouer; personne ne l'écoutoit: c'est moi qui eus l'honneur de faire sa partie. Il me proposa d'abord un petit pharaon tête-à-tête. Le Courier ne l'auroit pas permis. Nous jouâmes à un jeu d'enfans appellé cala-carte; celui qui a le plus de cartes à la fin du coup, gagne une fiche, et celui qui se trouve avoir ramassé plus de piques, en gagne une autre. Je perdois toujours les cartes, et je n'avois jamais de piques dans mon jeu: à trente sols la fiche, il m'escamota deux sequins; je le soupçonnois, mais je payai sans rien dire.
Arrivé à Ferrare, j'avois besoin de me reposer; j'allai me loger à l'hôtel de Saint-Marc, où étoit la poste aux chevaux; et pendant que je dînois tout-seul dans ma chambre, voilà mon joueur qui vient me rendre visite, et me proposer ma revanche: je refuse; il se moque de moi; il tire de sa poche un jeu de cartes et une poignée de sequins, et me propose le pharaon; je refuse encore.
Allons, dit-il, allons, Monsieur, je vous dois une revanche; je suis honnête homme, je veux vous la donner, et vous ne pouvez pas la refuser. Vous ne me connoissez pas, continua-t-il: pour vous assurer sur mon compte, voilà les cartes, tenez vous-même la banque, je ponterai. La proposition me parut honnête; je n'étois pas encore assez fin pour prévoir les tours d'adresse de Messieurs les Escamoteurs; je crus tout bonnement que le sort en décideroit, et que j'étois dans le cas de ratrapper mon argent.
Je tire de ma bourse dix sequins pour faire face à ceux de mon vis-à-vis; je mêle, je donne à couper: l'ami met deux pontes; je les gagne, me voilà joyeux comme Arlequin; je mêle de nouveau et je donne à couper; l'honnête homme double sa mise, il gagne, il fait paroli; ce paroli décidoit de la banque, je ne pouvois pas refuser de le tenir: je le tiens, et je le gagne; le drôle jure comme un charretier, prend les cartes qui étoient tombées sur la table, il les compte. Il trouve une carte impaire, il dit que la taille est fausse, il soutient qu'il a gagné; il veut s'emparer de mon argent, je le défends; il tire un pistolet de sa poche, je recule; mes sequins ne sont plus à moi. Au bruit de ma voix plaintive et tremblante, un garçon de l'hôtel entre, et d'accord peut-être avec le filou, nous annonce que nous avions encouru, l'un et l'autre, les peines les plus rigoureuses lancées contre les jeux de hasard, et nous menaçoit d'aller nous dénoncer sur-le- champ, si nous refusions de lui donner quelqu'argent. Je lui donnai bien vite un sequin pour ma part; je pris la poste sur- le-champ, et je partis enragé d'avoir perdu mon argent, et encore plus d'avoir été filouté.
En arrivant à Bagnacavallo, je trouvai ma consolation dans la vue de mes chers parens. Mon pere avoit eu une maladie mortelle; son unique regret étoit, disoit-il, de mourir sans me voir. Hélas! il m'a vu, je l'ai vu; mais ce plaisir réciproque n'a pas duré long-tems.
Bagnacavallo n'est qu'un gros bourg, dans la légation de Ravenne, très-riche, très-fertile et très-commerçant.
Après avoir été présenté dans les bonnes sociétés du pays, mon pere, pour me procurer de nouveaux plaisirs, me conduisit à Faenza (Fayence); c'est dans cette ville qu'on a commencé à connoître la matiere argilleuse, mêlée de glaise et de sable, dont on a composé cette terre émaillée, que les Italiens appellent majolica, et les François fayence.
Il y a en Italie beaucoup de plats de fayence peints par Raphaël d'Urbino, ou par ses Eleves. Ces plats sont encadrés avec des bordures élégantes, et se gardent précieusement dans les cabinets de tableaux; j'en ai vu une collection très-abondante et très-riche à Venise, dans le Palais Grimani, à Santa-Maria Formosa.
Faenza est une très-jolie ville de la Romagne, mais il n'y a pas grand'chose à voir. Nous fûmes très-bien reçus, et très-bien traités par le Marquis Spada; nous vîmes quelques Comédies d'une Troupe roulante, et au bout de six jours nous fûmes de retour à Bagnacavallo.
Quelques jours après, mon pere tomba malade. Il y avoit un an que sa derniere maladie l'avoit saisi; il s'apperçut en se couchant que cette rechute devoit être sérieuse, et son pouls annonçoit le danger dans lequel il étoit; sa fievre devint maligne au septieme jour, il alloit de mal en pis. Il se vit à sa fin, m'appella au chevet de son lit, il me recommanda sa chere femme, il me dit adieu, il me donna sa bénédiction. Il fit venir tout de suite son Confesseur, il fut administré; et le quatorzieme jour mon pauvre pere n'étoit plus; il fut enterré dans l'Eglise de Saint Jérôme de Bagnacavallo, le 9 Mars 1731.
Je ne m'arrêterai pas ici à peindre la fermeté d'un pere vertueux, la désolation d'une femme tendre, et la sensibilité d'un fils chéri et reconnoissant. Je tracerai rapidement les momens les plus cruels de ma vie; cette perte coûta cher à mon cœur, et occasionna un changement essentiel dans mon état et dans ma famille.
J'essuyois les larmes de ma mere, elle essuyoit les miennes; nous en avions besoin l'un et l'autre. Notre premier soin fut de partir; nous allâmes rejoindre ma tante maternelle, qui étoit à Venise, et nous nous logeâmes avec elle dans la maison d'un de nos parens, où il y avoit par bonheur un appartement à louer.
Pendant tout le voyage de la Romagne jusqu'à Venise, ma mere n'avoit fait que me parler de mon emploi dans les Chancelleries de Terre-Ferme, qu'elle appelloit emploi de Bohémiens, car il falloit être à l'affut des places, et changer toujours de pays. Elle vouloit vivre avec moi, me voir sédentaire auprès d'elle; et les larmes aux yeux, elle me conjuroit, me sollicitoit pour que j'embrassasse l'état d'Avocat. A mon arrivée à Venise, tous nos parens, tous nos amis s'unirent à ma mere pour le même objet; je résistai tant que je pus, mais enfin il fallut céder.
Ai-je bien fait? Ma mere jouira-t-elle long-tems de son fils? Elle avoit tout lieu de l'espérer; mais mon étoile venoit toujours à la traverse de mes projets, Thalie m'attendoit a son Tempie, elle m'y entraîna par des chemins tortueux, et me fit endurer les ronces et les épines avant de m'accorder quelques fleurs.
Mon Doctorat. - Singularités qui le précéderent.
Me voyant sur le point de paroître en robe longue dans les salles du Palais, où, quelques années auparavant, j'avois paru en robe courte, j'allai voir mon oncle Indric, chez lequel j'avois appris la pratique. Il fut bien aise de me revoir, et m'assura que je pouvois compter sur lui. Il me fallut néanmoins surmonter beaucoup de difficultés.
Pour être reçu Avocat à Venise, il falloit commencer par être licencié dans l'Université de Padoue; et pour obtenir les lettres de licence, il falloit avoir fait son droit dans la même Ville, et y avoir passé cinq années consécutives avec les certificats d'avoir suivi les différentes classes de ces Ecoles publiques. Il n'y a que les Etrangers qui puissent se présenter au college, soutenir leurs theses, et être licenciés sur-le-champ.
J'étois originaire Modenois, mais né à Venise, ainsi que mon pere, pouvois-je jouir de l'avantage des Etrangers? Je n'en sais rien; mais une lettre écrite par ordre du Duc de Modene à son ministre à Venise me fit placer dans la classe des privilégiés.
Me voilà donc dans la possibilité de me rendre bien vite à Padoue, et d'y recevoir le bonnet doctoral; mais voilà une nouvelle difficulté encore plus forte. Au Barreau de Venise, on ne suit que le code Vénitien; on ne cite jamais ni Bartole, ni Balde, ni Justinien. On ne les connoît presque pas; mais il faut les connoître à Padoue. C'est à Venise comme à Paris, les jeunes gens perdent leur tems dans une étude inutile.
J'avois perdu mon tems, ainsi que les autres, j'avois étudié le droit romain à Pavie, à Udine, à Modene; mais j'étois hors d'exercice depuis quatre ans; j'avois perdu la trace des loix impériales, et je me vis dans la nécessité de devenir encore écolier.
Je m'adressai à un de mes anciens amis. M. Radi que j'avois connu dans mon enfance, et ayant employé son tems beaucoup mieux que moi, étoit devenu bon Avocat et excellent maître en droit pour instruire les Candidats qui n'alloient à Padoue que quatre fois par an, pour se montrer et pour rapporter les certificats de présence. M. Radi étoit un brave homme; mais il aimoit le jeu, ce qui faisoit qu'il n'étoit pas trop à son aise; ses écoliers profitoient de ses leçons, et lui emportoient souvent son argent.
Quand M. Radi me crut en état de pouvoir m'exposer, nous allâmes ensemble à Padoue. J'avoue qu'instruit comme je l'étois et avec une certaine hardiesse que l'usage du monde m'avoit donnée, je ne laissois pas cependant d'appréhender ces mines graves et imposantes, qui devoient me juger: mon ami se moquoit de moi; il m'assuroit qu'il n'y avoit rien à craindre; que c'étoit des cérémonies par lesquelles il falloit passer, et qu'il faudroit être bien ignorant pur ne pas être couronné des lauriers de l'Université.
Arrivés dans la grande Ville des Docteurs, nous allâmes d'abord chez M. Pighi, Professeur en droit civil, pour le prier de vouloir bien être mon Promoteur; c'est-à-dire, celui qui, en qualité d'assistant, devoit me présenter et me soutenir. Il m'accorda la grace que je lui demandai, et il reçut avec beaucoup d'honnêteté un cabaret d'argent dont je lui fis présent.
Nous allâmes ensuite au bureau de l'Université, pour remettre entre les mains du Caissier la somme que les Professeurs partagent entr'eux: on fait cette avance à titre de dépôt; mais on dit là, comme à la Comédie, on ne rend plus l'argent quand la toile est levée.
Il falloit faire des visites à tous les Docteurs du College, et nous en fîmes beaucoup avec des cartes; mais arrivés chez M. l'Abbé Arrighi, un des premiers Professeurs de l'Université, le portier avoit ordre de nous faire entrer. Nous le trouvâmes dans son cabinet; nous lui fîmes le compliment ordinaire de vouloir bien m'honorer de sa présence, et m'accorder son indulgence. Il parut très-étonné de nous voir bornes a ce compliment sec et inutile: nous ne savions ce qu'il vouloit dire; voici de quoi il s'agissoit.
Il avoit paru une nouvelle Ordonnance qui avoit été publiée par ordre des Réformateurs des Etudes de Padoue, par laquelle les aspirans au bonnet doctoral, avant que de paroître dans le College rassemblé, devoient être examinés particulierement, pour voir s'ils étoient suffisamment instruits, et s'ils étoient dignes de s'y exposer.
C'étoit M. Arrighi lui-même, qui, par un zele excessif, voyant que l'acte public des Candidats n'étoit plus qu'un jeu, qu'on favorisoit trop la jeunesse paresseuse, qu'on choisissoit les questions à plaisir, qu'on communiquoit même les argumens, qu'on fournissoit les réponses, et qu'on ne faisoit que des Docteurs sans doctrine, avoit sollicité et obtenu cette fameuse Ordonnance, qui alloit détruire l'Université de Padoue, si elle eût été de longue durée.
Je devois donc subir cet examen, et l'Abbé Arrighi devoit être mon examinateur. Il pria M. Radi de passer dans sa bibliotheque, et se mit tout de suite à l'ouvrage: il ne me ménagea pas; il sautoit du Code Justinien aux Canons de l'Eglise, des Digestes aux Pandectes; je répondois tant bien que mal, peut-être plus mal que bien, marquant cependant assez de connoissance et beaucoup de hardiesse. Mon examinateur, très-strict et très-délicat, n'étoit pas tout à fait content de moi: il auroit voulu que j'eusse encore étudié: je lui dis ouvertement que j'étois venu à Padoue pour être licencié, que ma réputation seroit compromise, si je m'en retournois sans le bonnet doctoral, que mon dépôt étoit fait... - Comment, dit-il, vous avez déposé l'argent?... - Oui, Monsieur. - Et il a été reçu sans mon ordre? - Le Caissier l'a reçu tout simplement, et en voici la quittance. - Tant-pire, vous risquez de le perdre. Avez-vous le courage de vous y exposer? - Oui, Monsieur, j'y suis déterminé, à tel prix que ce soit. J'aime mieux renoncer pour toujours à être Avocat, que de revenir une seconde fois. Vous êtes bien hardi. - Monsieur, j'ai de l'honneur. C'est assez; prenez votre jour, je m'y trouverai; mais prenez-y garde: la plus petite faute vous fera manquer votre coup. - Je tire ma révérence, et je m'en vais.
Radi avoit tout entendu; il étoit plus tremblant que moi. Je savois que mes réponses n'avoient pas été bien exactes; mais au College des Docteurs les questions sont bornées, et on ne vous fait pas parcourir d'un bout à l'autre le cahos immense de la jurisprudence.
Nous allons, le jour suivant, à l'Université, pour voir tirer de l'urne les points que le sort m'avoit destinés. Celui du droit civil étoit sur les successions des Intestats, et celui du droit canon rouloit sur la Bigamie. Je connoissois bien les titres de l'un et les chapitres de l'autre: je les repassai ce même jour dans la bibliotheque du Docteur Pighi, mon Promoteur; et je m'appliquai sérieusement jusqu'à l'heure du souper.
Nous nous mettions à table, mon ami et moi, lorsque cinq jeunes gens entrent dans la salle, et veulent souper avec nous. - Très-volontiers: nous sommes servis, on soupe, on rit, on s'amuse. Un des cinq écoliers étoit un Candidat qui avoit été refusé à l'examen du Professeur Arrighi. Il pestoit contre cet Abbé, Corse de nation, et badinoit sur la barbarie du pays et du regnicole.
Je souhaite le bon soir à ces Messieurs. C'est demain le jour de mon Doctorat; il faut que j'aille me coucher: ils se moquent de moi: ils tirent de leurs poches des jeux de cartes; un d'entr'eux met des sequins sur la table; Radi, le premier, fait son livret pour ponter: nous jouons, nous passons la nuit au jeu, et nous perdons, Radi et moi, notre argent.
Voilà le Bedeau du College qui arrive, et m'apporte la robe longue que je devois endosser. On entend la cloche de l'Université, il faut partir, il faut aller s'exposer sans avoir fermé l'œil, et dans le chagrin d'avoir perdu mon tems et mon argent.
Qu'importe? allons, courage; j'arrive; mon Promoteur vient au-devant de moi, me prend par la main, et me place à côté de lui sur une balustrade, en face du demi-cercle de la nombreuse assemblée.
Je me leve quand tout le monde est assis; je commence par réciter le cérémonial d'usage, et je propose les deux theses que je devois soutenir. Un des députés à l'argumentation me flanque un sillogisme in barbara, avec citations de textes à la majeure et à la mineure; je résume l'argument, et dans la citation d'un paragraphe, je me trompe du numéro 5 au numéro 7; mon Promoteur m'avertit tout bas de cette faute légere; je veux me corriger. M. Arrighi se leve de son siege, dit tout haut, en adressant la parole à M. Pighi: je proteste, Monsieur, que je ne souffrirai pas la moindre infraction aux loix de l'Ordonnance. Les avis aux Candidats sont défendus dans ces momens. Passe pour cette fois-ci, mais je vous préviens pour l'avenir.
Je m'apperçus que tout le monde étoit indigné de cette sortie déplacée; je saisis l'instant favorable, je repris le fond de ma these, et les propositions de l'argument. Je mis à la place de la méthode scholastique, la doctrine, les raisonnemens, les discussions des compilateurs et des interprètes. Je fis une dissertation sur toute l'étendue des successions des Intestats; tout le monde m'applaudit; voyant que ma hardiesse m'étoit pardonnée, je tombai tout-à-coup du droit civil au droit canon; j'entrepris l'article de la Bigamie; je le traitai comme l'autre. Je parcourus les loix des Grecs et des Romains, je citai les Conciles; le sort m'avoit favorisé dans la sortie des questions; je les savois par cœur; je me fis un honneur immortel. On va aux voix. Le Greffier en publie le résultat; je suis licencié nemine penitus, penitusque discrepante. C'est-à-dire, pas une voix contre; pas même M. Arrighi contre moi? Au contraire, il en étoit très-content. Alors mon Promoteur, après m'avoir mis sur la tête le bonnet doctoral, fit l'éloge du Licencié; mais comme je n'avois pas suivi la route ordinaire, il créa sur-le-champ de la prose et des vers latins qui firent beaucoup d'honneur à ma personne, et à la sienne.
Tout le monde entre quand une fois le Candidat a été reçu; tout le monde entra, et je fus étourdi par les complimens et les embrassades.
Nous rentrons, Radi et moi, dans notre hôtel, très-contens que l'affaire soit terminée, et très-embarrassés de nous voir sans argent; il falloit en chercher; nous en trouvâmes sans beaucoup de peine, et nous partîmes glorieux et triomphans pour Venise.
Ma réception dans le Corps des Avocats. - Ma présentation au Palais. - Dialogue entre une femme et moi.
Arrivé à Venise, après avoir embrassé ma mere et ma tante, qui étoient au comble de leur joie, j'allai voir mon oncle le Procureur, et le priai de me placer chez un Avocat, pour m'instruire des formes qui se pratiquent au Barreau. Mon oncle qui étoit dans le cas de choisir, me recommanda à M. Terzi, un des meilleurs plaidans et des meilleurs consultans de la République. Je devois y rester pendant deux ans; mais j'y entrai au mois d'Octobre 1731, et j'en sortis et fus reçu Avocat au mois de Mai 1732. Apparemment qu'on a regardé seulement la date de l'année, et non celle des mois, je remplis les formalités en huit mois de tems; il y avoit toujours dans mes arrangemens quelque chose d'extraordinaire, et (il faut dire la vérité) presque toujours à mon avantage. J'étois né heureux; si je ne l'ai pas toujours été, c'est ma faute.
Les Avocats à Venise doivent avoir leurs logemens, ou du moins leurs Etudes, dans le quartier de la Robe. Je louai un appartement à Saint Paternien, et ma mere et ma tante ne me quitterent pas. J'endossai la robe de mon état, qui est la même que la Patricienne, j'enveloppai ma tête dans une immense perruque, et j'attendois avec impatience le jour de ma présentation au Palais.
Cette présentation ne se fait pas sans cérémonies. Le novice doit avoir deux assistans, qu'on appelle à Venise Comperes de Palais; le jeune homme les cherche parmi les anciens Avocats qui lui sont les plus attachés, et je choisis M. Uccelli et M. Roberti, tous deux mes voisins.
J'allai donc au milieu de mes deux Comperes, au bas du grand Escalier, dans la grande Cour du Palais, faisant pendant une heure et demie tant de révérences et de contorsions, que mon dos en étoit brisé, et ma perruque étoit devenue la criniere d'un Lion. Chaque personne qui passoit devant moi, disoit son mot sur mon compte; les uns, voilà un garçon qui a de la phisionomie; les autres, voilà un nouveau balayeur du Palais; quelques-uns m'embrassoient, d'autres me rioient au nez. Enfin, je montai, j'envoyai mon domestique chercher une gondole, n'osant pas paroître dans les rues décoëffé comme j'étois, et je lui donnai rendez-vous dans la Salle du Grand Conseil, où je m'assis sur un banc, et où je voyois passer tout le monde sans être vu de personne.
Je faisois mes réflexions sur l'état que je venois d'embrasser. Il y a ordinairement à Venise 240 Avocats sur le tableau; il y en a dix à douze du premier rang, vingt, peut-être, qui occupent le second; tous les autres vont à la chasse des cliens, et les petits Procureurs veulent bien être leurs chiens, à condition qu'ils partagent ensemble la proie. Je craignois pour moi étant le dernier arrivé, et je regrettois les Chancelleries que j'avois abandonnées.
Mais en me tournant d'un autre côté, je voyois qu'il n'y avoit pas d'état plus lucratif et plus estimé que celui d'Avocat. Un noble Vénitien, un Patricien, Membre de la République, qui ne daigneroit pas être Négociant, ni Banquier, ni Notaire, ni Médecin, ni Professeur d'une Université, embrasse la profession d'Avocat, il l'exerce au Palais, et appelle les autres Avocats ses Confreres. Il s'agit d'avoir du bonheur; et pourquoi devois-je en avoir moins qu'un autre? Il falloit s'essayer, il falloit entrer dans le cahos du Barreau, où le travail et la probité conduisent au temple de la fortune.
Pendant que j'étois-là tout seul, faisant des châteaux en Espagne, je vois approcher de moi une femme d'environ trente ans, qui n'étoit pas mal de figure, blanche, ronde, potelée, le nez écrasé, les yeux malins, avec beaucoup d'or au col, aux oreilles, aux bras, aux doigts, et dans un accoutrement qui annonçoit une femme du commun, mais à son aise: elle m'accoste et me salue.
Bon jour, Monsieur. - Bon jour, Madame. - Permettez-vous que je vous fasse mon compliment? - De quoi? - De votre entrée au Palais. Je vous ai vu dans la Cour faisant vos salamalecs; pardi, Monsieur, vous êtes joliment coëffé! - N'est-ce pas? Suis-je beau garçon? - La coëffure n'y fait rien, M. Goldoni est toujours bien. - Vous me connoissez, Madame? - Ne vous ai-je pas vu il y a quatre ans dans le pays de la Chicanne, en perruque longue et petit manteau? - Oui, vous avez raison, quand j'étois chez le Procureur. - Oui, chez M. Indric. - Vous connoissez mon oncle? - Moi? je connois ici depuis le Doge jusqu'aux Scribes de la Cour. - Etes-vous mariée? - Non. - Etes-vous veuve? - Non. - Je n'ose pas vous en demander davantage. - Vous faites bien. - Avez-vous un emploi? - Non. - Cependant, à votre air... vous me paroissez honnête femme. - Aussi le suis-je. - Vous avez donc des rentes. - Point du tout. - Mais vous êtes bien nippée, comment faites-vous donc - Je suis fille du Palais, et le Palais m'entretient. - Ah! la singuliere chose! Vous êtes fille du Palais, dites-vous - Oui, Monsieur, mon pere y étoit employé. - Qu'y faisoit-il? - Il écoutoit aux portes, et il alloit apporter les bonnes nouvelles à ceux qui attendoient des graces, ou des arrêts, ou des jugemens favorables; il avoit de bonnes jambes, et il arrivoit toujours le premier. Ma mere étoit toujours ici comme moi; elle n'étoit pas fiere, elle recevoit la piece, et se chargeoit de quelques commissions. Je suis née et élevée dans ces salles dorées, et j'ai de l'or sur moi, comme vous voyez. - Votre histoire est très-singuliere; et vous suivez les traces de votre mere? - Non, Monsieur, je fais autre chose. - C'est-à- dire? - Je suis solliciteuse de Procès. - Solliciteuse de Procès! Je n'y comprends rien. - Je suis connue comme Barabas : on sait que tous les Avocats, tous les Procureurs sont de mes amis, et plusieurs personnes s'adressent à moi, pour leur procurer des conseils et des défenseurs. Ces personnes qui ont recours à moi, ordinairement ne sont pas riches, et je m'adresse à de nouveaux arrivés, à des désœuvrés qui ne demandent pas mieux que de travailler pour se faire connoître. Savez-vous, Monsieur, que telle que vous me voyez, j'ai fait la fortune d'une bonne douzaine des plus fameux Avocats du Barreau? Allons, Monsieur, courage: si vous voulez, je ferai la vôtre. - (Je m'amusois à l'entendre, mon domestique n'arrivoit pas, et je continuai la conversation).
Eh bien, Mademoiselle, avez-vous quelque bonne affaire actuellement? - Oui, Monsieur, j'en ai plusieurs; j'en ai d'excellentes. J'ai une veuve soupçonnée d'avoir caché le magot; une autre qui voudroit faire valoir un contrat de mariage fait après coup; j'ai des filles qui demandent à être dotées; j'ai des femmes qui voudroient plaider en séparation; j'ai des enfans de famille poursuivis par leurs créanciers: vous voyez, vous n'avez qu'à choisir.
Ma bonne, lui dis-je, vous avez parlé, je vous ai laissé dire; je vais parler à mon tour. Je suis jeune, je vais commencer ma carriere, et je désire des occasions de m'occuper et de me produire; mais l'envie de travailler, la démangeaison de plaider, ne me feront jamais commencer par les mauvaises causes que vous me proposez. - Ah, ah, dit-elle en riant, vous méprisez mes cliens, parce que je vous avois prévenu qu'il n'y avoit rien à gagner; mais écoutez: mes deux veuves sont riches; vous serez bien payé, vous serez même payé d'avance, si vous le voulez. - Je vois venir mon domestique de loin, je me leve, et je dis à la bavarde d'un ton ferme et résolu: - non, vous ne me connoissez pas; je suis homme d'honneur... - Elle me prend par la main, et me dit d'un air sérieux: Bravo. Continuez toujours dans les mêmes sentimens. - Ah! ah! lui dis-je, vous changez de langage. - Oui, reprit-elle, et celui que je prends vaut mieux que l'autre, dont je m'étois servie. Notre conversation n'a pas été sans mystere; souvenez-vous-en, et prenez garde de n'en parler à personne. Adieu, Monsieur, soyez toujours sage, soyez toujours honnête, et vous vous en trouverez bien; - elle s'en va, et je reste interdit. Je ne savois ce que cela vouloit dire, mais je sus depuis que c'étoit une espionne, qu'elle étoit venue pour me sonder, et je ne sus et ne voulus savoir qui me l'avoit adressée.
L'heureuse condition d'un bon Avocat. - Trait singulier d'un AvocatVénitien. - Almanach de ma façon. - Amalasonte, Tragédie Lyrique de macomposition.
J'étois Avocat; j'avois été présenté au Barreau: il s'agissoit d'avoir des cliéns: j'allois tous les jours au Palais voir plaider les maîtres de l'art, et regardant de tous les côtés, si ma phisionomie pouvoit sympathiser avec quelque plaideur, qui voulût bien me faire débuter dans une cause d'appel. Ce n'est pas dans les Tribunaux de premiere instance qu'un nouvel Avocat peut briller, et se faire honneur; c'est dans les Cours supérieures que l'on peut étaler la science, l'éloquence, la voix et la grace: quatre moyens également nécessaires pour qu'un Avocat, à Venise, soit placé au premier rang.
Mon oncle Indric me promettoit beaucoup; tous mes amis me flattoient sans cesse; mais en attendant, il falloit passer tout l'après-midi et une partie de la soirée dans un cabinet, pour ne pas manquer l'instant heureux qui pouvoit arriver.
Un des profits les plus essentiels de l'Avocat Vénitien ce sont les Consultations; à un Avocat du premier ordre on paie une Consultation de trois quarts-d'heure seulement deux on trois sequins: et avant de paroître devant le juge, il y a quelquefois, dans une cause de conséquence et compliquée, douze, quinze et vingt Consultations.
Si l'Avocat est chargé d'écrire et de former une demande ou une réponse, dans les actes de la procédure, ce sont quatre, six, douze sequins qu'on lui remet sur-le-champ.
Les plaidoyers ne s'écrivent pas à Venise. L'Avocat plaide de vive voix, et sa harangue lui est payée à proportion de l'intérêt de la cause, et du mérite du défenseur.
Tout cela monte très-haut: je m'amusois à calculer dans ma solitude et dans mes momens d'ennui, qu'un Avocat, qui a du crédit et du bonheur, peut gagner, sans se gêner, quarante mille livres par an, et c'est beaucoup pour un pays où la vie est de moitié moins chere qu'à Paris.
Je me souviens d'un trait singulier d'un des plus fameux Avocats de mon tems.
C'étoit un homme qui avoit beaucoup gagné, qui tenoit un état honnête à Venise, mais qui avoit fait bâtir une maison superbe et très-ornée dans une Ville de terreferme, où il déployoit tout son faste et toute sa magnificence.
Un jour qu'un de ses cliens alla chez lui pour le consulter et lui dire qu'il alloit partir pour Milan, l'Avocat le pria de lui faire construire un carrosse, et de le lui envoyer à sa maison de V...
Le client s'en chargea avec plaisir. Il fit exécuter la commission sous ses yeux; la voiture étoit de la plus grande beauté. Il l'envoya, comme ils étoient convenus, et en fit part au commettant sans lui parler du prix.
Le client revient à Venise, et va, avec son Procureur, consulter l'Avocat sur le courant de ses affaires. Au milieu de la conversation, l'Avocat se souvient du carrosse; il l'avoit vu, il en étoit bien content, et lui demande le mémoire. Le client refuse de le donner, et prie son défenseur de vouloir bien l'accepter, comme une marque d'amitié et de considération. L'Avocat le remercie, et fait semblant d'insister pour le paiement; mais les trois quarts d'heure s'écouloient; il y avoit, dans l'antichambre, des plaideurs qui attendoient; et la montre à la main, on reprit bien vite la Consultation. Le tems fini, tout le monde se leve, l'Avocat va accompagner à la porte son client comme de coutume. Le Procureur lui présente trois sequins, l'Avocat les prend, et rentre dans son cabinet.
Le Procureur trouva le trait singulier. Il ne put pas se passer d'en faire part à ses amis; ses amis le dirent à d'autres, et quelqu'un d'entr'eux en parla à l'Avocat; voici sa réponse et sa justification.
M. le Comte A*** m'a fait un présent; je l'ai remercié, et nous voilà quittes. Je lui ai donné ma Consultation, il l'a payée, et nous voilà encore quittes. Je me moque des sots, et je vais mon train.
Cet homme avoit raison de se moquer du monde; car il avoit toujours ses tablettes remplies de noms de cliens, et ses quarts d'heure employés.
Chez moi, il ne venoit que quelques curieux pour me sonder, ou quelques chicaneurs dangereux; je les écoutois patiemment: je leur donnois mes avis; je n'avois pas la montre à la main; je les gardois tant qu'ils vouloient; je les accompagnois jusqu'a la porte, et ils ne me donnoient rien: c'est le lot des commençans; il faut trois ou quatre ans avant que de parvenir à se faire un nom, et à gagner quelque argent.
Je suis fondé à croire cependant que si j'avois continué ma carriere au Barreau, j'aurois fait mon chemin beaucoup plus promptement que bien d'autres de mes confreres; car, au bout de six mois, j'avois plaidé une cause, et je l'avois gagnée; mais mon étoile me menaçoit déjà d'un nouveau changement, que je n'ai pu éviter, et je réserve pour le chapitre suivant l'origine et les conséquences d'une révolution encore plus forte que celle que j'avois éprouvée dans le College de Pavie.
En attendant, je passois le tems dans mon cabinet seul, ou mal accompagné, et je faisois des Almanachs; faire des Almanachs, soit en Italien, soit en François, c'est s'occuper à des imaginations inutiles; mais pour cette fois-ci, c'est différent. Je fis vraiment un Almanach qui fut imprimé, qui fut goûté, et qui fut applaudi.
Je lui donnai pour titre: l'Expérience du passé Astrologue de l'avenir, Almanach critique pour l'année 1732. Il y avoit un discours général sur l'année, et quatre discours sur les quatre saisons en tersets, entrelassés à la maniere de Dante, contenant des critiques sur les mœurs du siecle, et il y avoit, pour chaque jour de l'année, un pronostic qui renfermoit une plaisanterie, ou une critique, ou une pointe.
Je ne vous rendrai pas compte d'un enfantillage qui n'en mérite pas la peine. Je vais vous transcrire seulement le couplet du jour de Pâques, parce que cette plaisanterie, qui étoit peut-être la moins saillante, fit un effet admirable à cause du pronostic vérifié, et me procura de l'agrément et des services essentiels. Voici la prédiction en vers italiens:
In sì gran giorno una gentil Contessa
al parucchier sacrifica la Messa.
La voici en François:
Dans ce grand jour une aimable Comtesse
A son coëffeur sacrifira la Messe.
Ce petit ouvrage, tel qu'il étoit, m'amusa beaucoup; car, dans ces tems-là, il n'y avoit pas de Spectacles à Venise, et mes différentes occupations m'avoient empêché d'y songer. Les critiques et les plaisanteries de mon Almanach étoient vraiment d'un genre comique, et chaque pronostic auroit pu fournir le sujet d'une Comédie.
L'envie me reprit alors de revenir à mon ancien projet, et j'ébauchai quelques pieces; mais faisant réflexion que le genre comique ne convenoit pas infiniment à la gravité de la robe, je crus plus analogue à mon état la majesté tragique, et fis infidélité à Thalie, en me rangeant sous les drapeaux de Melpomene.
Comme je ne veux rien cacher à mon Lecteur, il faut que je lui révele mon secret. Mes affaires alloient mal, j'étois dérangé (on va voir tout-à-l'heure comment et pourquoi). Mon cabinet ne me rapportoit rien: j'avois besoin de tirer parti de mon tems. Les profits de la Comédie sont très-médiocres, en Italie, pour l'Auteur; il n'y avoit que l'Opéra qui pût me faire avoir cent sequins d'un seul coup.
Je composai, dans cette vue, une tragédie lyrique, intitulée Amalasonte. Je crus bien faire, je trouvai des gens qui, à la lecture, me parurent contens: il est vrai que je n'avois pas choisi des connoisseurs. Je parlerai de cette Tragédie musicale dans un autre moment. Voici mon oncle Indric qui vient me proposer une cause, il faut l'écouter.
Mon premier Plaidoyer. - Mon Histoire avec une tante et une niece.
La cause que mon oncle venoit de me proposer étoit une contestation provenante d'une servitude hydraulique. Un Meûnier avoit acheté un filet d'eau pour faire aller ses moulins. Le Propriétaire de la source l'avoit détournée; il s'agissoit de rétablir le demandeur dans ses droits, et de dommages et intérêts. La Ville de Crème avoit pris fait et cause pour le Meûnier. Il y avoit un modele démonstratif; il y avoit eu des procès-verbaux, des faits, des violences, des rébellions. La cause étoit mixte au civil et au criminel; les Avogadeurs, Magistrature très-grave semblable à celle des Tribuns du peuple romain, devoient en juger. J'avois pour Avocat adversaire le célebre Cordelina, l'homme le plus savant et le plus éloquent du Barreau de Venise: celui-ci devoit parler le premier: je devois répondre sur-le-champ sans écrits, sans méditations.
Le jour est appointé; je me rends au Tribunal de l'Avogarie. Mon adversaire parle pendant une heure et demie; je l'écoute, je ne le crains pas. Sa harangue finie, je commence la mienne; je tâche, par un préambule pathétique, de me concilier la faveur de mon juge. C'étoit la premiere fois que je m'exposois, j'avois besoin d'indulgence: j'entre en matière: j'attaque de front la harangue de Cordelina; mes faits sont vrais, mes raisons sont bonnes, ma voix est sonore, mon éloquence ne déplaît pas; je parle pendant deux heures, je conclus, et je m'en vais trempé de la tête aux pieds.
Mon domestique m'attendoit dans une chambre voisine; je changeai de chemise; j'étois fatigué, épuisé. Voilà mon oncle qui arrive: mon cher neveu, nous avons gagné, la partie adverse est condamnée aux dépens. Courage, continua-t-il, courage, mon ami; ce premier coup d'essai vous annonce pour un homme qui doit faire son chemin, vous ne manquerez pas de cliens. Me voilà donc bien heureux!... Ciel! quelle destinée! que de vicissitudes! que de revers!
L'événement malheureux que je vais raconter, et que j'ai annoncé dans le chapitre précédent, auroit pu se trouver entremêlé parmi les anecdotes des deux années précédentes; mais j'ai mieux aimé rassembler l'histoire en entier, que d'en couper le fil, et de la morceler.
Ma mere avoit été très-liée avec Madame St*** et Mademoiselle Mar***, qui étoient deux sœurs faisant chacune ménage à part, quoique logées dans la même maison.
Ma mere les avoit perdues de vue à cause de ses voyages, et renouvella connoissance avec elles, aussi-tôt que nous vinmes nous rétablir à Venise.
Je fus présenté à ces Dames; et comme la demoiselle étoit la plus riche, elle logeoit au premier: elle tenoit appartement, et on alloit de préférence chez elle.
Mademoiselle Mar*** n'étoit pas jeune; mais elle avoit encore de beaux restes: à l'âge de quarante ans, elle étoit fraîche comme une rose, blanche comme la neige, avec des couleurs naturelles, de grands yeux vifs et spirituels, une bouche charmante et un embonpoint agréable; elle n'avoit que le nez qui gâtoit un peu sa phisionomie: c'étoit un nez aquilain, un peu trop relevé, qui, cependant, lui donnoit un air d'importance quand elle prenoit son sérieux.
Elle avoit toujours refusé de se marier, quoique par son air honnête et par sa fortune elle n'eût jamais manqué de partis; et pour mon bonheur, ou pour mon malheur, je fus l'heureux mortel qui put la toucher le premier: nous étions d'accord, et nous n'osions pas nous le dire; car Mademoiselle faisoit la prude, et je craignois un refus. Je me confiai à ma mere; elle n'en fut pas fâchée: au contraire, croyant le parti convenable pour moi, elle se chargea d'en faire les avances; mais elle alloit lentement pour ne pas me distraire de mes occupations, et elle auroit voulu que je prisse un peu plus de consistance dans mon état.
En attendant j'allois passer les soirées chez Mademoiselle Mar***. Sa sœur descendoit pour faire la partie, et conduisoit avec elle ses deux filles qui déjà étoient nubiles. L'aînée étoit contrefaite, l'autre étoit ce qu'on appelle en François une Laidron. Elle avoit cependant de beaux yeux noirs et frippons, un petit masque d'Arlequin fort drôle, et des grâces naïves et piquantes. Sa tante ne l'aimoit pas, car elle l'avoit contre-carrée maintes fois dans ses inclinations passageres, et ne manquoit pas de faire son possible pour la supplanter à mon égard. Pour moi, je m'amusois avec la niece, et je tenois bon pour la tante.
Dans ces entrefaites un Excellence s'introduisit chez Mademoiselle Mar***, il fit les yeux doux à la belle, et elle donna dans le panneau. Ils ne s'aimoient ni l'un, ni l'autre; la Demoiselle en vouloit au titre, et le Monsieur à la fortune.
Cependant je me vis déchu de la place d'honneur que j'avois occupée; j'en fus piqué, et pour me venger je fis la cour à la rivale détestée, et je poussai si loin ma vengeance, qu'en deux mois de tems, je devins complettement amoureux, et je fis à ma laidron un bon contrat de mariage dans toutes les réglés, et dans toutes les formes.
Il est vrai que la mere de la Demoiselle et ses adhérens ne manquerent pas d'adresse pour m'attrapper. Il y avoit dans notre contrat des articles très-avantageux pour moi; je devois recevoir une rente qui appartenoit à la Demoiselle, sa mere devoit lui céder ses diamans, et je devois toucher une somme considérable d'un ami de la maison qu'on n'a pas voulu me nommer.
Je continuois toujours à me montrer chez Mademoiselle Mar*** et j'y passois les soirées comme à mon ordinaire, mais la tante se méfioit de sa niece; elle voyoit que j'avois pour celle-ci des attentions un peu moins réservées. Elle savoit que depuis quelque tems je montois toujours au second, avant que d'entrer au premier; le dépit la rongeoit, et elle vouloit se défaire de sa sœur, de ses nieces et de moi.
Elle sollicita à cet effet son mariage avec le Gentilhomme qu'elle croyoit tenir dans ses filets; elle lui fit parler pour convenir du tems et des conditions; mais quel fut son étonnement et son humiliation, quand elle reçut en réponse que son Excellence demandoit la moitié du bien de la Demoiselle en donation en se mariant, et l'autre moitié après sa mort. Elle donna dans des transports de rage, de haine et de mépris; elle envoya un refus formel à son prétendu, et manqua mourir de douleur.
Les gens de la maison, qui écoutent et qui parlent, rapporterent tout ce qu'ils savoient à la sœur aînée, et voilà la niece ainsi que la mere dans la plus grande joie.
Mademoiselle Mar*** n'osoit rien dire, elle dévoroit son chagrin, et me voyant affecter des égards pour sa niece, elle me lançoit des regards terribles avec ses gros yeux qui étoient enflammés de colere; nous étions tous dans cette société de mauvais politiques.
Mademoiselle Mar***, qui ne savoit pas où nous en étions sa niece et moi, se flattoit encore de m'arracher à l'objet de sa jalousie, et vu la difièrence des fortunes, elle croyoit me revoir à ses pieds; mais le trait de perfidie dont je vais m'accuser la détrompa entierement.
J'avois composé une chanson pour ma prétendue, j'avois fait composer la musique par un amateur plein de goût, et j'avois projetté de la faire chanter dans une sérénade sur le canal où donnoit la maison de ces Dames. Je crus le moment favorable pour faire exécuter mon projet, sûr de plaire à l'une, et de faire enrager l'autre.
Un jour que nous étions dans le sallon de la tante, faisant une partie sur le neuf heures du soir, une symphonie très-bruyante se fait entendre dans le canal, sous le balcon du premier, et par conséquent sous les fenêtres aussi du second. Tout le monde se leve et se met à portée d'en jouir; l'ouverture finie, on entendit la charmante voix d'Agnèse , qui étoit la Chanteuse à la mode pour les sérénades, et qui, par la beauté de son organe, et par la netteté de son expression, fit goûter la musique, et applaudir les couplets.
Cette chanson fit fortune à Venise, car on la chantoit par-tout; mais elle mit le trouble dans l'esprit des deux rivales, qui chacune se croyoit en droit de se l'approprier. Je tranquillisai la niece tout bas, l'assurant que la fête lui étoit consacrée, et je laissai l'autre dans le doute et dans l'agitation. Tout le monde m'adressoit des complimens; je me défendois, je gardois l'incognito; mais je n'étois pas fâché qu'on me soupçonnât.
Le jour après je me rendis chez ces Dames à l'heure ordinaire. Mademoiselle Mar***, qui me guettoit, me vit entrer; elle vint au-devant de moi, et me fit passer dans sa chambre; elle me fit asseoir à côté d'elle, et d'un air sérieux et passionné: vous nous avez régalées, me dit-elle, d'un divertissement très-brillant, mais nous sommes plusieurs femmes dans cette maison; à qui cette galanterie a-t-elle pu être adressée? je ne sais pas si c'est à moi à vous remercier. Mademoiselle, lui répondis-je, je ne suis pas l'auteur de la sérénade... Elle m'interrompt d'un air fier et presque menaçant: eh, ne vous cachez pas, dit-elle, c'est un effort inutile; dites-moi seulement si c'est pour moi, ou pour d'autre, que cet amusement a été imaginé? je vous préviens, continua-t-elle, que cette déclaration peut devenir sérieuse, qu'elle doit être décisive, et je ne vous en dirai pas davantage.
Si j'avois été libre, je ne sais pas ce que j'aurois répondu; mais j'étois lié, et je n'avois qu'une réponse à faire. Mademoiselle, lui dis-je, en supposant que je fusse l'auteur de la sérénade, je n'aurois jamais osé vous l'adresser. Pourquoi? dit-elle. Parce que, répondis-je, vos vues sont trop au-dessus de moi, il n'y a que les grands Seigneurs qui puissent mériter votre estime... C'est assez, dit-elle en se levant, j'ai tout compris; allez, Monsieur, vous vous en repentirez. Elle avoit raison; je m'en suis bien repenti.
Voilà la guerre déclarée. Mademoiselle Mar*** piquée de se voir supplantée par sa niece, et craignant de la voir mariée avant elle, se tourna d'un autre côté. Il y avoit vis-à-vis ses fenêtres une famille respectable, point titrée, mais alliée à des familles Patriciennes, et dont le fils aîné avoit fait la cour à Mademoiselle Mar*** et avoit été refusé; elle tâcha de renouer avec le jeune homme, qui ne refusa pas; elle lui acheta une charge très-honorable au Palais, et en six jours de tems tout fut d'accord, et le mariage fut fait.
M. Z*** qui étoit le nouveau mari, avoit une sœur qui devoit être mariée dans le même mois à un Gentilhomme de Terre-Ferme; c'étoit deux mariages de gens à leur aise, et ma prétendue et moi devions faire le troisieme, et tout gueux que nous étions, il falloit faire semblant d'être riche, et se ruiner.
Voilà ce qui m'a dérangé, voilà ce qui m'a mis aux abois. Comment faire pour se tirer d'affaire? Vous allez le voir dans le Chapitre suivant.
Suite du Chapitre précédent.
Ma mere ne savoit rien de ce qui se passoit dans une maison où elle n'alloit pas souvent. Mademoiselle Mar*** emprunta des cérémonies d'usage un trait de méchanceté pour l'en instruire: elle lui envoya un billet de mariage: ma mere en fut très-étonnée: elle m'en parla: je fus obligé de tout avouer; et tâchant cependant de rendre moins répréhensible la sottise que j'avois faite, en faisant valoir pour bonnes des promesses qui étoient sujettes à caution, et finissant par dire qu'à mon âge une femme de quarante ans ne me convenoit pas; cette derniere raison appaisa ma mere encore plus que les autres. Elle me demanda si le tems de mon mariage avoit été fixé; je lui dis qu'oui, et que nous avions encore trois bons mois devant nous.
Pour se marier à Venise dans les grandes réglés, et avec toutes les folies d'usage, il faut beaucoup plus de cérémonies que par-tout ailleurs.
Premiere cérémonie. La signature du contrat avec intervention de parens et d'amis; formalités que nous avions évitées, ayant signé notre contrat à la sourdine.
Seconde cérémonie. La présentation de la bague: ce n'est pas l'anneau; c'est une bague, c'est un diamant solitaire, dont le futur doit faire présent à sa prétendue. Les parens et les amis sont invités pour ce jour-là; grand étalage dans la maison, beaucoup de faste, la plus grande parure; et on ne se rassemble jamais à Venise sans qu'il n'y ait des rafraîchissemens très-coûteux: nous n'avons pu l'éviter: notre mariage, tout ridicule qu'il étoit, devoit faire du bruit; il falloit faire comme les autres, et aller jusqu'au bout.
Troisieme cérémonie. La présentation des perles: quelques jours avant celui de la Bénédiction nuptiale, la mere, ou la plus proche parente du prétendu, va chez la Demoiselle, lui présente un collier de perles fines que la jeune personne porte régulierement à son col, depuis ce jour-là jusqu'au bout de l'an de son mariage. Il y a peu de familles qui possedent ces colliers de perles, ou qui veulent en faire la dépense; mais on les loue; et pour peu qu'elles soient belles, le louage en est très-cher. Cette présentation entraîne à sa suite des bals, des festins, des habits, et par conséquent beaucoup de dépenses.
Je ne dirai mot des autres cérémonies successives qui sont à peu-près pareilles à celles qui se font par-tout. Je m'arrête à celle des perles que j'aurois dû faire, et que je ne fis pas par cent raisons; la premiere étoit que je n'avois plus d'argent.
Quand je vis approcher ce dernier préliminaire de la noce, je fis parler à ma belle-mere prétendue, pour qu'elle m'assurât les trois conditions de notre contrat.
Il s'agissoit de rentes dont il falloit me donner les titres, de diamans que la mere devoit mettre entre les mains de sa fille, ou entre les miennes, avant le jour de la présentation des perles, et de me faire passer en totalité ou en partie cette somme considérable que le protecteur inconnu lui avoit promise.
Voici le résultat de la conférence dont un de mes cousins s'étoit chargé. Les rentes de la Demoiselle consistoient en une de ces pensions viageres que la République avoit destinées pour un certain nombre de Demoiselles; mais il faut que chacune attende son tour, et il y en avoit encore quatre à mourir avant que Mademoiselle St*** en pût jouir: elle-même pouvoit mourir avant que d'en toucher le premier quartier.
Pour les diamans, ils étoient décidemment destinés pour la fille; mais la mere qui étoit encore jeune, ne vouloit pas s'en priver de son vivant et elle ne les auroit donnés qu'a près son décès.
A l'égard de ce Monsieur, qui (on ne sait pas pourquoi) devoit donner de l'argent, il avoit entrepris un voyage, et il ne devoit pas revenir de si-tôt.
Me voilà bien arrangé et bien content. Je n'avois pas un état suffisant pour soutenir un ménage coûteux, encore moins pour égaler le luxe de deux couples fortunés: mon cabinet ne me rendoit presque rien: j'avois contracté des dettes, je me voyois au bord du précipice, et j'étois amoureux, je rêvai, je réfléchis, je soutins le combat déchirant de l'amour et de la raison; cette derniere faculté de l'âme l'emporta sur l'empire des sens.
Je fis part à ma mere de ma situation; elle convint avec moi, les larmes aux yeux, qu'un parti violent étoit nécessaire pour éviter ma perte. Elle engagea ses fonds pour payer mes dettes de Venise; je lui cédai les miens de Modene pour son entretien, et je pris la résolution de partir.
Dans le moment le plus flatteur pour moi, après l'heureux début que je venois de faire au Palais au milieu des acclamations du Barreau, je quitte ma Patrie, mes parens, mes amis, mes amours, mes espérances, mon état: je pars, je mets pied à terre à Padoue. Le premier pas étoit fait, les autres ne me couterent plus rien: grâce à mon bon tempérament, excepté ma mere, j'oubliai tout le reste; et l'agrément de la liberté me consola de la perte de ma maîtresse.
J'écrivis, en partant de Venise, une lettre à la mere de l'infortunée; je mis sur son compte la cause immédiate du parti auquel j'avois été réduit; je l'assurai que les trois conditions du contrat une fois remplies, je n'aurois pas tardé à revenir; et en attendant la réponse, je marchois toujours.
Je portois avec moi mon trésor: c'étoit Amalasonte que j'avois composée dans mes loisirs, et sur laquelle j'avois des espérances que je croyois bien fondées; je savois que l'Opéra de Milan étoit un des plus considérables de l'Italie et de l'Europe.
Je me proposois de présenter mon Drame à la Direction, qui étoit entre les mains de la noblesse de Milan. Je comptois que mon Ouvrage seroit reçu, et que cent sequins ne pouvoient pis me manquer; mais qui compte sans son hôte compte deux fois.
Mon voyage de Padoue à Milan. - Station à Vicence et Vérone. - Course parle Lac de Garde à Salò. - Ressource inattendue dans cette ville. - Station àBresse. - Agréable rencontre à Bergame.
Faisant route de Padoue à Milan, j'arrivai à Vicence, où je m'arrêtai pendant quatre jours. Je connoissois dans cette ville le Comte Parminion Trissino, de la famille du célebre auteur de la Sophonishe, Tragédie composée à la maniere des Grecs, et une des meilleures pieces du bon siècle de la littérature Italienne. J'avois connu M. Trissino dans ma premiere jeunesse à Venise. Nous avions l'un et l'autre beaucoup de goût pour l'art dramatique. Je lui fis voir mon Amalasonte, il l'applaudit très-froidement, et il me conseilla de m'appliquer toujours au comique pour lequel il me connoissoit des dispositions. Je fus fâché de ce qu'il ne trouva pas mon opéra charmant, et j'attribuai sa froideur à la préférence qu'il donnoit lui-même à la comédie.
Je vis avec plaisir à Vicence le fameux Théâtre Olimpique de Palladio, très-célebre architecte du seizieme siecle, natif de cette ville, et j'admirai son arc de triomphe, qui, sans autres ornemens que ceux de proportions régulieres, passe pour le chef-d'œuvre de l'architecture moderne; les beaux modeles existent, et les imitateurs sont rares.
Je passai de Vicence à Vérone, où je desirois faire la connoissance du Marquis Maffei, auteur de Mérope , Ouvrage très-heureux qui a été heureusement imité.
Cet homme versé dans tous les genres de littérature, connoissoit mieux que personne, que le Théâtre Italien avoit besoin de réforme. Il essaya de l'entreprendre, il publia un volume sous le titre de Réforme du Théâtre Italien contenant sa Mérope, et deux comédies, les Cérémonies, et Raguet; la tragédie fut généralement applaudie; ses deux comédies n'eurent pas le même succès.
M. Maffei n'étant pas à Vérone, je pris la route de Brescia ou Bresse, et je m'arrêtai pour la couchée à Desenzano sur le lac de Garde, et précisément dans la même auberge, où quelques années auparavant j'avois couru le risque d'être assassiné: je demandai aux gens de l'hôtellerie s'ils se souvenoient de cette aventure, ils me dirent que oui, et que le scélérat, qui avoit commis d'autres crimes, avoit été pendu.
Etant à souper à table d'hâte, et malgré mon chagrin et mon amour, mangeant du meilleur appétit du monde, je me trouvai à côté d'un Abbé de la ville de Salò: la conversation agréable de cet Abbé me fournit l'occasion d'aller voir ce pays charmant, où l'on marche parmi les orangers en plein vent, et toujours au bord d'un lac délicieux.
Une autre raison me détermina à me détourner de ma route. J'étois fort court d'argent. Ma mere heureusement étoit propriétaire d'une maison à Salò, et étant connu du locataire, je pouvois me flatter d'en tirer parti.
Il n'y avoit que quatre lieues de Desenzano à Salò. Nous les fîmes, l'Abbé et moi, à cheval pour jouir davantage de cette promenade agréable, et je revins le troisieme jour, tout seul, m'étant beaucoup amusé, et avec quelques sequins que le locataire de ma mere m'avoit avancés.
Je payai au voiturier qui m'avoit attendu ses trois journées de repos, et je repris la route de Brescia.
J'avois écrit de Vicence à M. Novello, que j'avois connu à Feltre en qualité de Vicaire du Gouvernement, et qui pour lors étoit Assesseur du Gouverneur de Brescia.
J'allai descendre au Palais du Gouvernement. M. Novello me fit un accueil très-gracieux, et comme il se souvenoit de quelques babioles comiques que j'avois composées à Feltre, il me demanda le soir, pendant le souper, si j'avois quelques choses dans le même genre à lui faire voir. Je lui parlai de mon Opéra. Il étoit très-curieux de l'entendre. Nous nous arrangeâmes pour le jour suivant. Il pria à dîner avec nous des gens de lettres, qui sont très-nombreux et très-estimables dans ce pays-là, et le lendemain, après le Café, je fis la lecture de mon Drame, qui fut écouté avec attention, et unanimement applaudi.
C'étoit des connoisseurs qui m'avoient jugé, je devois être content; ils firent même l'analyse de ma Piece. Le caractere d'Amalasonte étoit bien imaginé et bien soutenu et c'étoit une leçon de morale pour les Reines meres, chargées de la tutele et de l'éducation de leurs augustes enfans.
Les bons et les mauvais courtisans mis avec art en opposition, formoient un tableau intéressant, et la catastrophe malheureuse d'Atalaric, et le triomphe d'Amalasonte, formoient un dénouement qui remplissoit en même-tems la sévérité qu'exige la Tragédie, et les agrémens qui sont propres au Mélodrame.
Mon style parut à cette assemblée judicieuse plus tragique que musical, et ils auroient desiré que j'eusse supprimé les airs et la rime, pour en faire à leur avis une bonne Tragédie.
Je les remerciai de leur indulgence, mais je n'étois pas dans le cas de profiter de leurs conseils. Une Tragédie, fut-elle aussi excellente que celles de Corneille et de Racine, m'auroit rapporté en Italie beaucoup d'honneur, et très-peu de profit, et j'avois besoin de l'un et de l'autre. Je quittai Brescia bien décidé de ne pas toucher à mon Drame, et d'aller le proposer à l'Opéra de Milan.
On pouvoit aller de Brescia à Milan par une voie plus courte; mais j'avois envie de voir Bergame, et je pris la route de cette ville.
En traversant le pays des Arlequins, je regardois de tous les côtés si je voyois quelque trace de ce personnage comique qui faisoit les délices du Théâtre Italien; je ne rencontrai ni ces visages noirs, ni ces petits yeux, ni ces habits de quatre couleurs qui faisoient rire, mais je vis des queues de lievre sur les chapeaux, qui font encore aujourd'hui la parure des paysans de ce canton-là. Je parlerai du masque, du caractere et de l'origine des Arlequins, dans un chapitre qui doit être consacré à l'histoire des quatre masques de la Comédie Italienne.
Arrivé à Bergame, je descendis dans une hôtellerie des fauxbourgs, les voitures ne montent pas à la ville qui est très-haute et très-escarpée, et j'allai à pied jusqu'au quartier du Gouvernement qui occupe précisément le sommet de cette rude montagne.
Extrêmement fatigué, et maudissant la curiosité qui m'avoit entraîné, ne connoissant personne, et ayant besoin de me reposer, je me souvins que M. Porta, mon ancien camarade dans la Chancellerie Criminelle de Chiozza, avoit été nommé Chancelier Civil de Bergame. Je cherchai son habitation, je la trouvai, mais mon ami n'y étoit pas; il étoit à six lieues de distance pour une commission relative à sa charge. Je priai son valet-de-chambre de vouloir bien me permettre de me reposer un instant, et causant avec lui, je demandai qui étoit le Gouverneur de la ville.
Quelle bonne nouvelle! quelle surprise agréable pour moi! C'étoit son Excellence Bonfadini: celui qui avoit été Podestà à Chiozza, auprès duquel j'avois servi en qualité de Vice-Chancelier; je me trouvai tout d'un coup en pays de connoissance, j'allai au Palais, et je me fis annoncer.
J'étois dans l'anti-chambre en attendant qu'on me fît entrer, et j'entends le Gouverneur lui-même qui rit, et qui prononce à haute voix: Ah! ah! l'Astrologue! c'est l'Astrologue. Faites-le entrer. Mesdames, vous allez voir l'Astrologue.
Je ne savois pas ce que cela vouloit dire; je craignois que on ne voulût me donner un ridicule; j'entrai, mais fort déconcerté. Le Gouverneur me rassura, et me mit bientôt à mon aise; il vint au-devant de moi, il me présenta à Madame la Gouvernante, et à la société: Voici, dit-il, M. Goldoni; vous souvenez-vous, Mesdames, de la Comtesse C***, que nous avons plaisantée sur sa toilette éternelle et sur ses messes manquées, et sur le pronostic de l'anonyme? Eh bien; c'est M. Goldoni qui est l'Auteur de cet Almanach critique que vous connoissez. - Tout le monde me fit politesse; le Gouverneur m'offirit un appartement et sa table; j'acceptai, j'en profitai pendant quinze jours, et je menai la vie du monde la plus agréable; mais il falloit faire la partie des Dames, et je n'étois ni riche, ni heureux.
Le Gouverneur, très-honnête et très-discret, ne me demandoit pas le motif de mon voyage. Au bout de quelques jours, je crus devoir l'instruire de mes aventures et de mon état; il en parut pénétré, et il m'offrit de me garder chez lui pendant les dix mois qui lui restoient encore pour achever son Gouvernement. Je ne devois pas l'accepter, aussi je le remerciai, et je le priai de me donner des lettres de recommandation pour Milan. Il m'en donna plusieurs; une entr'autres, que Madame la Gouvernante me donna pour le Résident de Venise, fut pour moi très-utile.
Au bout de la quinzaine, je pris congé de son Excellence: je n'avois pas l'air content; il me questionna beaucoup; je n'osois rien dire; il s'apperçut que mon embarras n'étoit pas l'embarras des richesses. Il m'ouvrit sa bourse; je refusai; il insista. Je pris modestement dix sequins; je voulois lui faire mon billet, il n'en voulut pas. Que de bontés! que de graces! il falloit partir, et le lendemain je me mis en route.
Mon arrivée à Milan. - Ma premiere visite au Résident de Venise. - Lecture de mon Amalasonte.
Me voilà à Milan; me voilà dans cette Métropole de la Lombardie, ancien apanage de la domination Espagnole, où j'aurois dû paroître avec le manteau et la fraise, suivant le costume Castillan, si la muse satyrique ne m'eût pas éloigné de la place qui m'étoit destinée. Je viens maintenant y briguer le cothurne; mais je n'aurai les honneurs du triomphe qu'en chaussant le brodequin.
J'allai me loger à l'Hôtel du Puits, un des plus fameux hôtels garnis de Milan; car, pour se présenter avec avantage, si on n'est pas riche, il faut au moins le paroître; et le lendemain, je portai la lettre de recommandation de Madame la Gouvernante au Résident de Venise.
C'étoit alors M. Bartolini, Secrétaire du Sénat, qui avoit été Vice-Bay à Constantinople; il étoit très- riche, très-magnifique, et aussi considéré à Milan qu'à Venise. Il fut nommé par scrutin, quelques années après, grand Chancelier de la République, et il jouit pendant long-tems, et jusqu'à sa mort, de cette charge, qui donne le titre d'Excellence à celui qui l'exerce, et le place immédiatement après la noblesse regnante.
Le Résident de Venise étant le seul Ministre étranger qui réside à Milan, à cause des affaires journalieres qui se passent entre les deux états limitrophes, cet envoyé Vénitien jouit de la plus haute considération, et marche de pair avec les grands Seigneurs du Duché de Milan.
Ce Ministre me reçut avec une bonté ouverte et encourageante. Il faisoit grand cas de la Dame qui étoit ma protectrice, et m'offrit tout ce qui pouvoit dépendre de sa personne et de son crédit; mais d'un air grave et ministériel, il me demanda le motif qui me conduisoit à Milan, et quelles étoient les aventures que Madame Bonfadini lui motivoit dans sa lettre.
La question étoit juste, et ma réponse fut simple. Je lui contai, d'un bout à l'autre, toute l'histoire de la tante et de la niece; M. le Résident connoissoit les personnes; mon récit le fit beaucoup rire, et sur la crainte que j'avois marquée d'être poursuivi et molesté, il m'assura que je n'avois rien à craindre à Milan.
La naïveté de mon discours, et le détail de mes aventures, avoient fait comprendre au Ministre que je n'étois pas riche: il me demanda très-noblement si j'avois besoin de quelque chose pour le moment: je le remerciai; j'avois encore quelques sequins de Bergame: j'avois mon Opéra, je n'avois besoin de personne. M. Bartolini m'invita à dîner pour le jour suivant: j'acceptai son invitation, je pris congé et je partis.
Il me tardoit de présenter ma piece et d'en faire la lecture: nous étions justement dans le tems du Carnaval: il y avoit un Opéra à Milan, et je connoissois Caffariello, qui en étoit le premier Acteur; je connoissois aussi le Directeur et Compositeur des Ballets, et sa femme qui étoit la premiere Danseuse (M. et Madame Grossatesta).
Je crus plus décent, et plus avantageux pour moi, de me faire présenter aux Directeurs des Spectacles de Milan par des personnes connues; c'étoit précisément ce jour-là un Vendredi, jour de relâche presque par-tout en Italie; et j'allai le soir chez Madame Grossatesta, qui tenoit appartement, et où étoit le rendez-vous des Acteurs, des Actrices, et de la danse de l'Opéra.
Cette excellente Danseuse qui étoit ma compatriote, et que j'avois connue à Venise, me reçut très-poliment; et son mari qui étoit Modenois, qui avoit beaucoup d'esprit, et qui étoit très-instruit, se disputa avec son épouse sur l'article de ma Patrie, soutenant très-galamment que j'étois originaire de la sienne.
Il étoit encore de bonne heure; nous étions presque seuls, je profitai du moment pour leur annoncer mon projet: ils en furent enchantés, ils me promirent de me présenter, et ils me féliciterent d'avance sur la réception de mon Ouvrage.
Le monde alloit toujours en augmentant: Caffariello arrive; il me voit, il me reconnoît, il me salue avec le ton d'Alexandre, et prend sa place à côté de la maîtresse de la maison; quelques minutes après, on annonce le Comte Prata, qui étoit un des Directeurs des Spectacles, et celui qui avoit le plus de connoissance pour la partie dramatique. Madame Grossatesta me présente à M. le Comte, et lui parle de mon Opéra; celui-ci s'engage de me proposer à l'Assemblée de la Direction; mais il auroit été charmé que j'eusse bien voulu lui donner quelque connoissance de mon Ouvrage en particulier: ma compatriote auroit été bien aise de l'entendre aussi; moi, je ne demandois pas mieux que de lire. On fait approcher une petite table et une bougie; tout le monde se range; j'entreprends la lecture: j'annonce le titre d' Amalasonte. Caffariello chante le mot Amalasonte; il est long, et il lui paroît ridicule: tout le monde rit, je ne ris pas: la Dame gronde; le rossignol se tait. Je lis les noms des personnages; il y en avoit neuf dans ma piece: et on entend une petite voix qui partoit d'un vieux castrat qui chantoit dans les chœurs, et crioit comme un chat: trop, trop, il y au moins deux personnages de trop. Je voyois que j'étois mal à mon aise, et je voulois cesser la lecture. M. Prata fit taire l'insolent qui n'avoit pas le mérite de Caffariello, et me dit, en se tournant à moi: - Il est vrai, monsieur, que pour l'ordinaire, il n'y a que six ou sept personnages dans un Drame; mais quand l'ouvrage en mérite la peine, on fait, avec plaisir, la dépense de deux Acteurs; ayez, ajouta-t-il, ayez la complaisance de continuer la lecture, s'il vous plaît.
Je reprends donc ma lecture: acte premier, scene premiere, Clodesile et Arpagon. Voilà M. Caffariello qui me demanda quel étoit le nom du premier dessus dans mon Opéra. Monsieur, lui dis-je, le voici, c'est Clodesile. - Comment, reprit-il, vous faites ouvrir la scene par le premier Acteur, et vous le faites paroître pendant que le monde vient, s'asseoit et fait du bruit? Pardi! Monsieur, je ne serai pas votre homme. (Quelle patience!) M. Prata prend la parole: voyons, dit-il, si la scene est intéressante. Je lis la premiere scene; et pendant que je débite mes vers, voilà un chétif impuissant qui tire un rouleau de sa poche, et va au clavessin, pour repasser un air de son rôle. La maîtresse du logis me fait des excuses sans fin; M. Prata me prend par la main, et me conduit dans un cabinet de toilette très-éloigné de la salle.
Là, M. le Comte me fait asseoir; il s'asseoit à côté de moi, me tranquillise sur l'inconduite d'une société d'étourdis; il me prie de lui faire la lecture de mon Drame à lui tout seul, pour pouvoir en juger et me dire sincerement son avis. Je fus très-content de cet acte de complaisance; je le remerciai; j'entrepris la lecture de ma Piece: je lus depuis le premier vers jusqu'au dernier: je ne lui fis pas grace d'une virgule. Il m'écouta avec attention, avec patience; et ma lecture finie, voici à peu-près le résultat de son attention et de son jugement.
Il me paroît, dit-il, que vous n'avez pas mal étudié l'art poétique d'Aristote et d'Horace, et vous avez écrit votre piece d'après les principes de la Tragédie. Vous ne savez donc pas que le Drame en musique est un Ouvrage imparfait, soumis à des regles et à des usages qui n'ont pas le sens commun, il est vrai, mais qu'il faut suivre à la lettre. Si vous étiez en France, vous pourriez vous donner plus de peine pour plaire au public; mais ici, il faut commencer par plaire aux Acteurs et aux Actrices; il faut contenter le Compositeur de musique; il faut consulter le Peintre-Décorateur; il y a des règles pour tout, et ce seroit un crime de lese dramaturgie, si on osoit les enfreindre, si on manquoit de les observer. Ecoutez, poursuivit-il; je vais vous indiquer quelquesunes de ces regles, qui sont immuables, et que vous ne connoissez pas.
Les trois principaux sujets du Drame doivent chanter cinq airs chacun; deux dans le premier acte, deux dans le second, et un dans le troisieme. La seconde Actrice, et le second dessus ne peuvent en avoir que trois, et les derniers rôles doivent se contenter d'un ou de deux tout au plus. L'Auteur des paroles doit fournir au Musicien les différentes nuances qui forment le clair-obscur de la musique, et prendre garde que deux airs pathétiques ne se succedent pas; il faut partager, avec la même précaution, les airs de bravoure, les airs d'action, les airs de demi- caracteres, et les menuets, et les rondeaux.
Sur-tout, il faut bien prendre garde de ne pas donner d'airs passionnés, ni d'airs de bravoure, ni des rondeaux aux seconds rôles; il faut que ces pauvres gens se contentent de ce qu'on leur donne, et il leur est défendu de se faire honneur.
M. Prata vouloit encore continuer: j'en ai assez, Monsieur, lui dis-je, ne vous donnez pas la peine d'en dire davantaae: je le remerciai de nouveau, et je pris congé de lui.
Je vis alors que les gens qui m'avoient jugé à Bresse avoient raison. Je compris que le Comte Trissino de Vicence avoit encore plus raison, et qu'il n'y avoit que moi qui eût tort.
Sacrifice de mon Amalasonte. - Visite inopinée à M. le Résident. - Ressource encore plus inopinée pour moi. - Arrivée d'un Anonyme à Milan. - Ouverture de Spectacle par mon entremise. - Petite Piece de ma composition. Départ du Président pour Venise.
En rentrant chez moi, j'avois froid, j 'avois chaud, j'étois humilié. Je tire ma Piece de ma poche, l'envie me prend de la déchirer. Le garçon de l'auberge vient me demander mes ordres pour mon souper. - Je ne souperai pas. Faites-moi bon feu. J'avois toujours mon Amalasonte à la main; j'en relisois quelques vers que je trouvois charmans. Maudites regles! ma Piece est bonne, j'en suis sûr, elle est bonne; mais le Théâtre est mauvais, mais les Acteurs, les Actrices, les Compositeurs, les Décorateurs... Que le Diable les emporte, et toi aussi malheureux Ouvrage qui m'as coûté tant de peines, qui m'as trompé dans mes espérances; que la flamme te dévore! Je le jette dans le feu, et je le vois brûler de sang-froid avec une espece de complaisance. Mon chagrin, ma colere avoient besoin d'éclater, je tournai ma vengeance contre moi-même, et je me crus vengé.
Tout étoit fini, je ne pensois plus à ma Piece; mais en remuant la cendre avec les pincettes, et en rapprochant les débris de mon manuscrit pour en achever la consommation, je pensai que jamais, dans quelque occasion que ce fût, je n'avois sacrifié mon souper à mon chagrin: j'appelle le garçon, je lui dis de mettre le couvert, et de me servir sur-le-champ. Je n'attendis pas long-tems; je mangeai bien, je bus encore mieux; j'allai me coucher, et je dormis tranquillement.
Tout ce que j'éprouvai d'extraordinaire, c'est que je me réveillai le matin deux heures plutôt que de coutume. Mon esprit en me réveillant vouloit se tourner du mauvais côté. Allons, allons, me dis-je à moi-même, point de mauvaise humeur; il faut avoir du courage, il faut aller chez M. le Résident de Venise; il m'avoit invité à dîner, mais il faut lui parler tête à tête; il faut y aller tout à l'heure. Je m'habille, et j'y vais.
Le Ministre, me voyant à neuf heures du matin, se doutoit bien que quelque motif pressant devoit m'y amener. Il me reçut à sa toilette; je lui fis comprendre que les témoins me gênoient, et il fit sortir tout le monde. Je lui contai mon histoire de la veille; je lui traçai le tableau de la conversation dégoûtante qui m'avoit révolté; je lui parlai du jugement du Comte Prata, et je finis par dire: que j'étois l'homme du monde le plus embarrassé.
M. Bartolini s'amusa beaucoup au récit de la scene comique des trois Acteurs heroiques, et me demanda mon Opéra pour le lire. - Mon Opéra, Monsieur? il n'existe plus. - Qu'en avez-vous fait? - Je l'ai brûlé. - Vous l'avez brûlé? - Oui, Monsieur, j'ai brûlé tous mes fonds, tout mon bien, ma ressource et mes espérances.
Le Ministre se mit à rire encore davantage, et en riant et en causant, il en résulta que je restai chez lui, qu'il me reçut en qualité de Gentilhomme de sa chambre, qu'il me donna un très-joli appartement et qu'au bout du compte à l'échec que je venois d'essuyer, j'avois plus gagné que perdu.
Mon emploi ne m'occupoit que pour des commissions agréablcs. Pour aller, par exemple, complimenter les nobles Vénitiens voyageurs, ou chez le Gouverneur et chez les Magistrats de Milan, pour les affaires de la République. Ces occasions n'étoient pas fréquentes; j'avois tout mon loisir pour m'amuser et pour m'occuper à mon gré.
Il arriva dans cette ville, au commencement du Carême, un Charlatan d'une espece fort rare, et dont la mémoire mérite peut-être d'être enregistrée dans les annales du siecle.
Son nom étoit Bonafede Vitali, de la ville de Parme, et se faisoit appeller l'Anonyme. Il étoit de bonne famille; il avoit eu une éducation excellente, et il avoit été Jésuite. Dégoûté du Cloître, il s'appliqua à la Médecine, et il eut une chaire de Professeur dans l'Université de Palerme.
Cet homme singulier, à qui aucune science n'étoit étrangere, avoit une ambition effrénée de faire valoir l'étendue de ses connoissances, et comme il étoit meilleur parleur qu'écrivain, il quitta la place honorable qu'il occupoit, et prit le parti de monter sur les trétaux, pour haranguer le public; et n'étant pas assez riche pour se contenter de la simple gloire, il tiroit parti de son talent, et il vendoit ses médicamens.
C'étoit bien faire le métier de Charlatan, mais ses remedes spécifiques étoient bons, et sa science et son éloquence lui avoient mérité une réputation et une considération peu communes.
Il résolvoit publiquement toutes les questions les plus difficiles qu'on lui proposoit sur toutes les sciences, et les matières les plus abstraites. On envoyoit sur son Théâtre Empirique des Problèmes, des Points de Critique, d'Histoire, de Littérature, etc. Il répondoit sur-le-champ, et il faisoit des dissertations très-satisfaisantes.
Il passa quelques années après à Venise; il fut appellé à Vérone, à cause d'une maladie épidémique, qui faisoit périr tous ceux qui en étoient attaqués. Son arrivée dans cette ville fut comme l'apparition d'Esculape en Grece; il guérit tout le monde avec des pommes d'api et du vin de Chypre. Il fut nommé par reconnoissance premier Médecin de Vérone; mais il n'en jouit pas long-tems, car il mourut dans la même année, regretté de tout le monde, excepté des Médecins.
L'Anonyme avoit à Milan la satisfaction de voir la place où il se montroit au public toujours remplie de gens à pied, et de gens en voiture; mais comme les savans étoient ceux qui achetoient moins que les autres, il falloit garnir l'échaffaud d'objets attrayans, pour entretenir le public ignorant, et le nouvel Hyppocrate débitoit ses remedes et prodiguoit sa réthorique, entouré des quatre masques de la Comédie Italienne.
M. Bonafede Vitali avoit aussi la passion de la Comédie, et entretenoit à ses frais une Troupe complette de Comédiens, qui, après avoir aidé leur maître à recevoir l'argent qu'on jettoit dans des mouchoirs, et à rejetter ces mêmes mouchoirs chargés de petits pots ou de petites boîtes, donnoient ensuite des Pièces en trois actes, à la faveur de torches de cire blanches, avec une sorte de magnificence.
C'étoit autant pour l'homme extraordinaire que pour ses acolytes, que j'avois envie de faire connoissance avec l'Anonyme. J'allai le voir un jour sous prétexte d'acheter de son alexipharmaque; il me questionna sur la maladie que j'avois, ou que je croyois avoir; il s'apperçut que ce n'étoit que la curiosité qui m'avoit attiré chez lui; il me fit apporter une bonne tasse de chocolat, et il me dit que c'étoit le meilleur médicament qui pouvoit convenir à mon état.
Je trouvai la galanterie charmante. Nous causâmes ensemble pendant quelque tems; il étoit aussi aimable dans son particulier qu'il étoit savant en public. Je m'étois annoncé, dans le courant de notre conversation, comme étant attaché au Résident de Venise. Il crut que j'aurois pu lui être utile à l'égard d'un projet qu'il avoit imaginé. Il m'en fit part; j'entrepris de le servir, et je fus assez heureux pour réussir. Voici de quoi il s'agissoit.
Ne vous ennuyez pas, mon cher Lecteur, à cette digression; vous verrez combien elle aura été nécessaire à l'enchaînement de mon histoire.
Les Spectacles de Milan avoient été suspendus pendant le Carême, comme c'est l'usage par toute l'Italie. La Salle de la Comédie devoit se rouvrir à Pâques, et l'engagement avoit été pris avec une des meilleures troupes de Comédiens; mais le Directeur fut appellé en Allemagne, il partit sans rien dire, et il manqua aux Milanois. La ville alors se trouvant sans Spectacles, alloit envoyer à Venise et à Bologne, pour former une compagnie. L'Anonyme auroit desiré qu'on donnât la préférence à la sienne, qui n'étoit pas excellente, mais qui pouvoit compter sur trois ou quatre sujets de mérite, et dont l'ensemble étoit bien concerté. Effectivement, M. Casali, qui jouoit les premiers Amoureux, et M. Rubini, qui soutenoit à ravir les rôles de Pantalon, ont été appellés l'année suivante à Venise, le premier pour le Théâtre de Saint- Samuel, l'autre pour celui de Saint-Luc.
Je me chargeai avec plaisir d'une commission, qui, de toute façon, me devoit être agréable. J'en fis part à mon Ministre qui prit sur lui d'en parler aux Dames principales de la ville; j'en parlai au Comte Prata que j'avois toujours cultivé; j'employai mon crédit et celui du Résident de Venise auprès du Gouverneur, et en trois jours de tems le contrat fut signé, l'Anonyme fut satisfait, et j'eus pour pot de vin une seconde loge en face, qui pouvoit contenir dix personnes.
Profitant de l'occasion de cette Troupe, que je voyois familièrement, je me remis à composer quelques bagatelles théâtrales. Je n'aurois pas eu assez de tems pour faire une Comédie, car l'arrangement avec l'Anonyme n'avoit été fait que pour le printems et l'été, jusqu'au mois de Septembre, et comme il y avoit parmi les gagistes de l'Anonyme un Compositeur de musique, et un homme et une femme qui chantoient assez bien, je fis un Intermede à deux voix, intitulé le Gondolier Vénitien, qui fut exécuté, et eut tout le succès qu'une pareille composition pouvoit mériter. Voilà le premier ouvrage Comique de ma façon qui parut en public, et successivement à la presse, car il a été imprimé dans le quatrieme volume de mes Opéras Comiques, édition de Venise, par Pasquali.
Pendant que l'on donnoit à Milan mon Gondolier Vénitien avec des Comédies à canevas, on annonça la premiere représentation de Bélisaire, et on continua à l'annoncer pendant six jours, avant que de la donner, pour exciter la curiosité du public, et s'assurer d'avoir une chambrée complette; les Comédiens ne se tromperent point. La Salle de Milan de ce tems-là, qui a subi dans les flammes la destinée presque ordinaire des Salles de Spectacles, étoit la plus grande d'Italie, après celle de Naples; et à la premiere représentation de Bélisaire, l'affluence fut si considérable, que l'on étoit foulé même dans les corridors.
Mais quelle détestable Piece! Justinien étoit un imbécile, Théodore une courtisanne, Bélisaire un prédicateur. Il paroissoit les yeux crevés sur la scene. Arlequin étoit le conducteur de l'aveugle, et lui donnoit des coups de batte pour le faire aller; tout le monde en étoit révolté, et moi plus que tout autre, ayant distribué beaucoup de billets à des personnes du premier mérite.
Je vais le lendemain chez Casali; il me reçoit en riant, et me dit d'un ton goguenard: Eh bien, Monsieur, que pensez-vous de nostre fameux Bélisaire? Je pense, lui dis-je, que c'est une indignité à laquelle je ne m'attendois pas. Hélas, Monsieur, reprit-il, vous ne connoissez pas les Comédiens. Il n'y a pas de Troupe qui ne se serve de tems à autre de ces tours d'adresse pour gagner de l'argent, et cela s'appelle, en jargon de Comédien, una arrostita. (Une grillade.) Que signifie, lui dis-je, una arrostita? Cela veut dire, dit-il, en bon Toscan, una corbellatura, en langue Lombarde, una minchionada, et en François, une attrappe. Les Comédiens sont dans l'usage de s'en servir; le Public est accoutumé à les souffrir; tout le monde n'est pas délicat, et les Arrostites iront toujours leur train, jusqu'à ce qu'une réforme parvienne à les supprimer. Je vous prie, M. Casali, lui dis-je, de ne pas me rôtir une seconde fois, et je vous conseille de brûler votre Bélisaire; je crois qu'il n'y a rien de plus détestable.
Vous avez raison, me dit-il, mais je suis persuadé que de cette mauvaise Piece on pourroit en faire une bonne. - Sans doute, lui répliquai-je; l'histoire de Bélisaire peut fournir le sujet d'une Piece excellente. - Allons, Monsieur, reprit Casali, vous avez envie de travailler pour le Théâtre, faites que ce soit votre début. - Non, dis-je, je ne commencerai pas par une Tragédie. - Faites-en une Tragi-Comédie. - Pas dans le goût de la vôtre. - Il n'y aura point de masques ni de bouffonneries. - Je verrai, j'essayerai. - Attendez un istant. Voici Bélisaire. - Je n'en ai que faire. Je travaillerai d'après l'histoire. - Tant mieux. Je vous recommande mon ami Justinien. - Je ferai de mon mieux. - Je ne suis pas riche, mais je tâcherai... - Propos inutiles. Je travaille pour m'amuser. Monsieur, je vous confie mon secret. Je dois aller l'année prochaine à Venise, si je pouvois y apporter avec moi un Bélisaire... Là, un Bélisaire in fiochi. - Vous l'aurez, peut-être. - Il faut me le promettre. Eh bien, je vous le promets. - Parole d'honneur? - Parole d'honneur.
Voilà Casali content. Je le quitte, et je vais chez moi, bien déterminé à lui tenir parole avec exactitude, et avec soin.
Monsieur le Résident, sachant que j'étois rentré, me fit demander pour me dire qu'il alloit partir pour Venise, pour ses affaires particulières, ayant eu la permission du Sénat de s'absenter pour quelques jours de Milan.
Il avoit un Secrétaire Milanois, mais ils n'étoient pas bien ensemble; celui-ci étoit un peu trop délicat, et le Ministre étoit vif et sujet à des emportemens très-violens. Il me fit l'honneur de me charger de plusieurs commissions, et entr'autres, comme des bruits sourds faisoient craindre une guerre qui pouvoit intéresser la Lombardie, il me chargea de lui écrire tous les jours, et d'être attentif à tout ce qui pouvoit se passer. C'étoit empiéter sur les droits du Secrétaire; mais je ne pouvois pas m'y refuser, et mon Ministre n'auroit pas entendu raison là-dessus. Je ne manquai pas d'exécuter les commissions dont j'étois chargé; mais je ne tardai pas en même tems à entreprendre l'ouvrage que j'avois promis sous ma parole d'honneur.
J'étois parvenu en peu de jours à la fin du premier acte. Je l'avois communiqué à Casali qui en étoit enchanté, et qui auroit voulu le copier sur-le-champ; mais il arriva deux événemens à la fois, dont le premier me fit rallentir le travail, et le second me fit cesser de travailler pour longtems.
Rencontre d'une Vénitienne. - Milan surpris par les armes du Roi de Sardaigne. - Mon embarras à cause de la guerre, et de la Vénitienne. - Retour du Résident de Venise à Milan. - Son départ et le mien pour Crême.
En me promenant un jour à la campagne du côté de Porta Tosa, avec M. Carrara, Gentilhomme Bergamasque, et mon ami intime, nous nous arrêtâmes à la fameuse hôtellerie de la Cazzola (lampe de cuisine), que les Milanois prononcent Cazzeura, car les Lombards ont la diphtongue eu comme les François, et la prononcent de même.
A Milan on ne fait de parties de promenade ni d'autres parties quelconques sans qu'il n'y soit question de manger; aux spectacles, aux assemblées de jeu, à celles des familles, soit de cérémonies, ou de complimens, aux courses, aux processions, même aux conférences spirituelles, on mange toujours. Aussi les Florentins, généralement sobres et économes, appellent les Milanois les loups lombards. Nous ordonnâmes, M. Carrara et moi, un petit goûter composé de Polpettino (boulettes de viande achée) de petits oiseaux, et d'écrevisses; et en attendant que notre collation fût prête, nous fîmes un tour de jardin.
En revenant nous passâmes du côté de la cuisine de l'auberge, et je vis à une croisée du premier un très-joli minois, qui faisoit semblant de se cacher derriere le rideau. Je vais tout de suite aux informations. L'Hôte ne connoissoit pas la personne. Il y avoit trois jours qu'elle étoit arrivée en poste avec un homme bien équipé, qui s'étoit absenté le lendemain, et n'avoit plus reparu. On la voyoit dans le chagrin, et on la croyoit Vénitienne.
Jeune, jolie, Vénitienne et affligée! Allons, dis-je à mon camarade, il faut aller la consoler: je monte; Carrara me suit; je frappe; la belle ne veut pas ouvrir: je parle vénitien, je m'annonce comme un homme attaché au Résident de Venise; elle ouvre les deux battans, et me reçoit fondant en larmes, et dans la plus grande désolation.
Quel spectacle frappant, intéressant! Une jolie femme qui pleure a des droits sur un cœur sensible: je partageois ses peines, je faisois mon possible pour la tranquilliser, et mon ami Carrara rioit. Quel homme dur! Comment pouvoit-il rire? J'étois de cire, et je m'attendrissois toujours de plus en plus.
Je parvins enfin à essuyer les larmes de ma charmante compatriote, et à la faire parler. Elle étoit, me dit-elle, une Demoiselle de très-bonne maison de Venise; devenue amoureuse d'un homme d'une condition au-dessus de la sienne, elle s'étoit flattée d'en faire un époux; mais ils avoient trouvé des oppositions par-tout, et il falloit aller en pays étranger.
La belle avoit mis dans sa confidence un oncle maternel qui l'aimoit beaucoup, et qui avoit eu la foiblesse de la seconder. Ils s'étoient sauvés tous les trois, ils avoient pris la route de Milan, et avoient passé par Crème: on les avoit poursuivis et atteints dans cette Ville, l'oncle fut arrêté et conduit en prison. Les deux amans avoient eu le bonheur de s'échapper. Ils étoient arrivés à Milan de nuit, s'étoient logés dans l'hôtellerie où nous étions; son amant étoit sorti de bon matin, pour chercher un logement dans la Ville; il n'étoit pas revenu. Il y avoit trois jours que la Demoiselle étoit seule, désespérant de ne plus revoir son ravisseur, son indigne séducteur; et les pleurs redoublés de cette beauté languissante achevent l'histoire, et mettent le comble à ma sensibilité.
Carrara, qui ne rioit plus, mais qui étoit fâché que la longue kirielle nous empêchât de goûter, me fit des remontrances très-pathétiques sur son appétit. Mon cœur ne me permettoit pas de quitter ma compatriote sans prendre avec elle quelque arrangement. Je la priai de nous permettre de faire apporter dans sa chambre notre collation pour contenter le gourmand; elle y consentit de bonne grâce, et nous fûmes servis.
Pendant que nous étions à table, je continuois ma conversation avec la Demoiselle; Carrara mangeoit toujours, et se moquoit de moi.
Le soleil commençoit à disparoître, il falloit partir; je pris congé de ma belle compatriote, je lui promis de venir la voir le lendemain; et en lui souhaitant le bon-soir bien affectueusement, je la priai de me confier son nom. Elle parut faire quelque difficulté; mais enfin, elle me dit à l'oreille qu'elle s'appelloit Marguerite Biondi. Je sus depuis qu'elle n'étoit ni Marguerite, ni Biondi, ni niece, ni Demoiselle; mais elle étoit jeune, jolie, aimable: elle avoit l'air honnête, j'étois de bonne foi. Pouvois-je l'abandonner dans la détresse et dans l'affliction?
J'essuyai, en revenant à la Ville, toutes les railleries et toutes les plaisanteries de Carrara; mais cela n'empêcha pas que je ne tinsse parole à la belle Etrangere; je trouvai un très-joli appartement tout meublé, et en bon air sur la place d'armes: j'allai dîner avec elle le lendemain, et je la conduisis dans un bon carrosse prendre possession de son logement; elle me pria de m'intéresser à son oncle pour le faire sortir de prison, d'en parler au Résident de Venise à son retour à Milan, et de l'engager à la raccommoder avec ses parens: je n'avois rien à lui refuser: j'allois la voir très- souvent, et sa société me paroissoit tous les jours plus intéressante.
J'étois très-content de mon état, et cette derniere aventure ajoutoit aux agrémens de ma situation; mais je n'étois pas fait pour jouir long-tems d'un bonheur quelconque. Les plaisirs et les chagrins se succédoient rapidement chez moi; et le jour où je jouissois davantage, étoit presque toujours la veille d'un événement disgracieux.
Mon domestique entre un jour dans ma chambre de très-bonne heure; il ouvre les rideaux; et me voyant réveillé: - Ah! Monsieur, dit-il, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre: quinze mille Savoyards, tant à pied qu'à cheval, viennent de s'emparer de la Ville, et on les voit escadronner sur la place de la Cathédrale.
Etonné de cette nouvelle si inattendue, je fis cent questions à mon laquais, qui n'en savoit pas davantage: je m'habille bien vîte: je sors, je vais au café; dix personnes me parlent à la fois: chacun veut être le premier à m'instruire: il y avoit différentes versions, mais voici le fait.
C'étoit le commencement de la guerre de 1733, appellée la guerre de Don Carlos. Le Roi de Sardaigne venoit de se déclarer pour ce Prince, et de réunir ses armes à celles de France et d'Espagne contre la Maison d'Autriche. Les Savoyards, qui avoient marché la nuit, arriverent au point du jour aux portes de Milan; le Général demanda les clefs de la Ville: Milan est trop vaste pour se défendre, et les clefs lui furent apportées.
Sans approfondir la chose davantage, je crus en savoir assez pour en faire part à mon Résident. Je rentre, j'écris, j'envoie un exprès à Venise; et trois jours après, le Ministre revint à sa résidence.
Pendant ce tems-là les Troupes Françoises ne tarderent pas à paroître, et à se réunir aux Sardes, leurs alliés, formant ensemble cette armée formidable, que les Italiens appelloient l'armata dei Gallo-Sardi.
Les alliés se disposant à faire le siège du château de Milan firent les approches pour se mettre en état de battre la Citadelle, et les habitans de la place d'armes furent obligés de décamper. Ma pauvre Vénitienne, qui étoit de ce nombre, me fit avertir de son embarras: j'y accourus sur-le-champ: je la fis déloger promptement; et ne voulant pas la mettre dans un hôtel garni, je fus forcé de la confier à un Marchand Génois, où je ne pouvois la voir qu'au milieu d'une famille nombreuse et excessivement difficile.
Les assiégeans ne tarderent pas à former leurs tranchée et leurs chemins couverts: le siège alloit grand train; les batteries de canons faisoient voler jour et nuit leur boulets, auxquels ripostoient ceux de la Citadelle, et le bombes mal dirigées venoient nous visiter dans la Ville.
Un Courier de la République de Venise apporta quelques jours après, à mon Ministre, une lettre ducale en parchemin, et cachetée en plomb, avec ordre de partir de Milan, et d'aller, pendant la guerre, établir sa résidence à Crème.
M. le Résident m'en fit part aussi-tôt. Il profita de cette occasion pour se défaire de son Secrétaire, qu'il n'aimoit pas, me conféra cette commission honorable et lucrative, et m'ordonna de me tenir prêt le lendemain; et comme il nous falloit un Correspondant à Milan pendant notre absence, je proposai mon ami Carrara, qui fut approuvé par le Ministre, et vint se loger à l'hôtel.
Je fis bientôt mes paquets; je ramassai les papiers, et j'allai faire mes adieux à la belle Vénitienne, qui pleuroit, qui craignoit, qui se désoloit: elle me recommande son oncle qui étoit précisément prisonnier à Crême: je tâche de la consoler, je lui donne de l'argent, ainsi qu'à son hôte; il semble que cette cérémonie ait contribué à la tranquilliser: nous nous embrassons, je me rends chez moi; et au point du jour, je pars avec le Ministre.
Arrivé à Crême, môn premier soin fut d'aller à la geôle; je demande M. Léopold Scacciati, qui étoit l'oncle en question. Il n'y étoit plus; mes recommandations avoient avancé son élargissement; il étoit sorti la veille de mon arrivée, et il étoit parti pour Milan.
Cet homme, qui ne se doutoit pas de mon départ de cette Ville, comment auroit-il fait pour retrouver Mademoiselle Biondi dans un pays si vaste et si peuplé? Cette réflexion m'inquietoit beaucoup; j'écrivis au Marchand Génois, j'écrivis à M. Carrara, et voici à-peu-près la réponse de ce dernier.
"Votre Léopold Scacciati est arrivé à Milan; il est venu à l'hôtel, croyant vous y trouver: le Portier l'a fait monter, il m'a parlé: il a réclamé sa niece: je l'ai conduit chez le Génois; et j'ai cru vous rendre un service essentiel, en lui faisant consigner cette fille qui vous étoit à charge, et qui n'en méritoit pas la peine".
Eloigné de cet objet enchanteur, j'avouai que mon ami s étoit bien conduit; et n'ayant pas reçu de nouvelles depuis ni de la Demoiselle ni de son oncle, leur ingratitude m'affecta, mais fort légerement: je les oubliai l'une et l'autre, et je m'appliquai sérieusement à remplir les devoirs de ma charge.
Reddition du Château de Milan. - Siége de Pizzighetone. - Armistice. -Reddition de la Place. - Reprise de mes occupations théâtrales. - Visiteimportune. - Rupture entre le Résident et moi.
Crême est une Ville de là République de Venise, gouvernée par un noble Vénitien, avec le titre de Podestà, à quarante-huit lieues de la Capitale, et à neuf de la Ville de Milan.
Le Résident de Venise étoit à portée, dans cette Ville, de veiller sur le événemens et sur les desseins des Puissances belligérantes, sans compromettre la République, qui étoit neutre, et qui ne pouvoit pas reconnoître les nouveaux maîtres du Milanois.
Mais ce Ministre n'étoit pas le seul qui en étoit chargé: on avoit envoyé de Venise en même-tems, et dans la même Ville, un Sénateur avec le titre de Provéditeur extraordinaire; et tous les deux faisoient, à l'envi, leurs efforts pour avoir des correspondances, et pour envoyer au Sénat les nouvelles les plus récentes et les plus sûres.
Nous avions tous les jours pour notre part dix à douze, et quelquefois jusqu'à vingt lettres, qui nous venoient de Milan, de Turin, de Bresse, et de tous les pays de traverse où il étoit question de passage de Troupes, ou de fourrages, ou de magasins. C'étoit à moi à les ouvrir, à en faire les extraits, à les confronter, et à établir un plan de dépêche, d'après les relations qui paroissoient les plus uniformes et les mieux constatées.
Mon Ministre, d'après mon travail, choisissoit, faisoit des remarques, des réflexions, et nous dépêchions quelquefois quatre estafettes en un jour à la Capitale.
Cet exercice m'occupoit beaucoup, il est vrai, mais il m'amusoit infiniment; je me mettois au fait de la politique et de la diplomatique: connoissances qui me furent très-utiles lorsque je fus nommé, quatre ans après, Consul de Genes à Venise.
Au bout de vingt jours de siège et quatre de brèche ouverte, le château de Milan fut forcé de capituler et de se rendre, ayant demandé et obtenu tous les honneurs de la guerre, tambour battant, drapeaux déployés, chariots couverts jusqu'à Mantoue, où étoit le rendez-vous général des Allemands, qui n'avoient pas encore assez de forces rassemblées pour s'opposer aux progrès de leurs ennemis.
Les armées combinées qui profitoient du tems favorable, mirent le siège quelques jours après devant Pizzighetone, petite Ville frontiere dans le Crémonois, au confluent du Serio et de l'Adda, très-bien fortifiée, et avec une citadelle très-considérable.
Le théâtre de la guerre s'étant beaucoup rapproché de la Ville de Crême, nous étions encore plus à portée d'avoir des nouvelles, puisque nous entendions très-distinctement les coups de canon; mais les hostilités n'allerent pas bien loin; car les Allemands qui attendoient de ordres de Vienne, ou de Mantoue, demanderent un armistice de trois jours, qui leur fut accordé sans difficulté.
Je fus envoyé, dans cette occasion, en qualité d'espion honorable au camp des alliés: il n'est pas possible de tracer au juste le tableau frappant d'un camp en armistice. C'est la fête la plus brillante, le spectacle le plus étonnant qu'il soit possible d'imaginer.
Un pont jetté sur la brèche donne la communication entre les assiégeans et les assiégés: on voit des tables dressées par-tout: les Officiers se régalent réciproquement: on donne en dedans et en dehors, sous des tentes ou sous des berceaux, des bals, des festins, des concerts. Tout le monde des environs y accourt à pied, à cheval, en voiture; les vivres y arrivent de toute part: l'abondance s'y établit dans l'instant; les Charlatans, les Voltigeurs ne manquent pas de s'y rendre. C'est une foire charmante, c'est un rendez-vous délicieux.
J'en jouissois, pendant quelques heures, tous les jours; et au troisieme, je vis sortir la garnison Allemande, avec les mêmes honneurs qui avoient été accordés à celle du château de Milan. Je m'amusois à voir des Soldats François et Piémontois, sortant de la place sous leurs étendards, se fourrer dans les haies de leurs compatriotes, et déserter impunément.
Je faisois, le soir en rentrant, à mon Ministre, le rapport de ce que j'avois vu et de ce que j'avois appris; et je pouvois l'assurer, d'après les entretiens que j'avois eu avec des Officiers, que les armées combinées devoient aller se camper dans les Duchés de Parme et de Plaisance, pour les garantir des incursions qu'on pouvoit craindre de la part des Allemands.
L'effet répondit aux notices qu'on m'avoit données: les Alliés défilerent peu à peu du côté du Crémonois, et s'établirent dans les environs de Parme, où la Duchesse Douairière, à la tête de la Régence, gouvernoit ses Etats.
L'éloignement des Troupes diminua de beaucoup mon travail, et me donna le loisir de me livrer à des occupations plus agréables: je repris mon Bélisaire; j'y travaillai avec assiduité, avec intérêt, je ne le quittai que quand je le crus fini, et lorsqu'il me parut que je pouvois en être content.
Dans ces entrefaites, mon frere, qui, après la mort de M. Visinoni, avoit quitté le service de Venise, et s'étoit transporté à Modene, croyant que le Duc l'auroit employé; n'ayant rien obtenu de ce côté-là, vint me rejoindre à Crème. Je le reçus avec amitié, je le présentai à M. le Résident. Ce Ministre lui accorda la place de Gentilhomme que j'avois occupée; mais si l'un avoit la tête chaude, l'autre l'avoit brûlante, et ils ne pouvoient pas tenir ensemble. M. le Résident remercia mon frere, et celui-ci s'en alla de mauvaise humeur.
L'inconduite de mon frere me fit quelque tort dans l'esprit du Ministre. Il ne me regardoit plus depuis ce tems-là avec la même bonté, ni avec la même amitié. Un Tartuffe Dominicain s'étoit emparé de sa confiance et quand je n'étois pas au logis, il se mêloit d'écrire sous la dictée du Ministre. Tout cela m'avoit déjà indisposé. Nous n'étions plus, mon Supérieur et moi, que deux êtres dégoûtés l'un de l'autre, et l'aventure que je vais raconter, produisit une rupture totale.
J'étois un jour dans ma chambre, lorsqu'on m'annonça un étranger qui vouloit me parler. Je dis qu'on le fasse entrer, et je vois un homme maigre, petit, boiteux, pas trop bien vêtu, et avec une phisionomie fort douteuse. Je lui demande son nom; Monsieur, dit-il, je suis votre serviteur Léopold Scacciati. - Ah! ah! Monsieur Scacciati? - Oui, Monsieur, celui que vous avez eu la bonté de protéger, et de faire sortir de prison. - D'où venez-vous actuellement? - De Milan, Monsieur. - Comment se porte Mademoiselle votre niece? - Très-bien, à merveille, vous allez la voir. - La voir? Où donc? - Ici. Elle est ici? - Oui, Monsieur, à l'hôtellerie du Cerf, où elle vous attend, et vous prie de venir dîner avec elle. - Doucement, M. Scacciati, qu'avez-vous fait pendant long-tems à Milan? - J'y connoissois beaucoup d'Officiers, ils me faisoient l'honneur de venir me voir. - Vous voir? - Oui, Monsieur. - Et Mademoiselle? - Elle faisoit les honneurs de la table. - Rien que de la table?...
Un valet-de-pied vint interrompre une conversation que j'aurois voulu pousser plus loin; mais il me dit que le Ministre me demandoit. Je prie M. Scacciati de rester, et de m'attendre; je monte. M. le Résident me présente un manuscrit à copier. C'étoit le Manifeste du Roi Sardaigne, avec les raisons qui l'avoient engagé dans le parti des François. Ce cahier étoit précieux pour le moment, car l'original étoit encore sous la presse à Turin, et il falloit le copier pour l'envoyer à Venise.
Le Ministre ne dînoit ni soupoit chez lui ce jour-là. Il m'ordonna de lui rapporter le manuscrit et la copie, le lendemain à son réveil. Le cahier étoit assez volumineux et mal écrit, cependant il falloit bien l'expédier. Je rentre chez moi; je préviens M. Scacciati que je ne pouvois pas dîner en ville ce jour-là, et que j'irois le soir voir sa niece, aussi- tôt que je le pourrois. Il m'annonce que Mademoiselle doit partir incessamment. Je répète les mêmes mots avec un mouvement d'impatience, et le boiteux fait une pirouette et s'en va.
Je me mets tout de suite à l'ouvrage; je dîne avec une tasse de chocolat; je travaille jusqu'à neuf heures du soir; je finis: je serre les deux copies dans mon secrétaire, et je m'en vais à l'hôtellerie du Cerf. Je trouve la belle Vénitienne engagée dans una partie de pharaon avec quatre Messieurs que je ne connoissois pas. Au moment que j'entre, la taille finissoit. On se leve, on me fait beaucoup de politesses, on fait servir le souper, on me donne la place d'honneur près de la Demoiselle. J'avois une faim enragée, je mangeai comme quatre.
Le souper fini, on reprend le jeu. Je ponte, je gagne, et je n'osois pas m'en aller le premier. La nuit se passe en jouant. Je regarde ma montre; il étoit sept heures du matin. Je gagnois toujours, mais je ne pouvois rester davantage; je fais mes excuses à la compagnie, et je m'en vais.
A quatre pas de l'auberge, je rencontre un de nos valet-de-pied. M. le Résident m'avoit fait chercher par-tout; il s'étoit levé à cinq heures du matin, il m'avoit fait demander, on lui avoit dit que j'avois découché de l'hôtel. Il étoit furieux.
Je cours, je rentre; je vais dans ma chambre, je prends les deux cahiers, je les apporte au Ministre. Il me reçoit fort mal. Il va jusqu'à me soupçonner d'avoir été communiquer le Manifeste du Roi de Sardaigne au Provéditeur extraordinaire de la République de Venise.
Cette imputation me blesse, me désole. Je succombe contre mon ordinaire à un mouvement de vivacité. Le Ministre me menace de me faire arrêter. Je sors, je vais me réfugier chez l'Evêque de la ville. Celui-ci prend mon parti, et s'engage de me raccommoder avec le Résident. Je le remercie, mon parti étoit pris, je ne voulois que me justifier et partir.
M. le Résident eut le tems de s'informer où j'avois passé la nuit; il étoit revenu sur mon compte, mais je ne voulus plus m'exposer à de pareils désagrémens, et je demandai la permission de me retirer. Le Ministre me l'accorda. J'allai le voir; je lui fis mes excuses et mes remerciemens. Je fis mes paquets, je louai une chaise pour Modene, où ma mere demeuroit encore, et trois jours après je partis.
Mon arrivée à Parme. - Térrible frayeur des Parmesans. - La Bataille de Parme de 1731. - Mort du Général Allemand - Vue du Camp après la Bataille. - Changement de route. - Evénement très fâcheux pour moi.
Arrivé à Parme le 28 du mois de juin, la veille de la Saint-Pierre, en 1733, jour mémorable pour cette Ville, j'allai me loger all'osteria del Gallo (à l'hôtel du Coq).
Le matin, un bruit effrayant me réveille. Je sors de mon lit, j'ouvre la croisée de ma chambre, je vois la place remplie de monde, qui court d'un côté, qui court de l'autre: on se heurte, on pleure, on crie, on se désole; des femmes portent leurs enfans sur leurs bras; d'autres les traînent sur le pavé. On voit des hommes chargés de hottes, de paniers, de coffre-forts, de paquets; des vieillards qui tombent, des malades en chemise, des charrettes qu'on renverse, des chevaux qui s'échappent: qu'est-ce donc que cela? dis- je; est-ce la fin du monde?
Je passe ma redingotte sur ma chemise, je descends bien vite, j'entre dans la cuisine, je demande, je questionne, personne ne me répond. L'Aubergiste ramasse son argenterie; sa femme, toute échevelée, tient un écrin à la main, et ses hardes dans son tablier: je veux lui parler, elle me jette contre la porte, et sort en courant. Qu'est-ce donc? qu'est-ce donc? Je demande à tous ceux que je rencontre: je vois un homme à l'entrée de l'écurie: je reconnois mon voiturier; je vais à lui: il étoit dans le cas de satisfaire ma curiosité.
Voilà, Monsieur, me dit-il, toute une ville effrayée, et ce n'est pas sans raison: les Allemands sont à la porte de la ville; s'ils entrent, le pillage est sûr. Tout le monde se sauve dans les Eglises; chacun porte ses effets sous la garde de Dieu. - Est-ce que les Soldats, lui dis-je, dans une pareille occasion, auroient le tems de la réflexion? D'ailleurs, les Allemands sont-ils tous Catholiques?
Pendant que je causois avec mon guide, voilà la scene qui change; voilà des cris de joie; on fait sonner les cloches par-tout; on tire des pétards. Tout le monde sort de l'Eglise, tout le monde remporte son bien; on se cherche, on se rencontre, on s'embrasse. Quel a été le sujet de ce changement? Voici le fait en totalité.
Un espion double, à la solde des alliés aussi bien qu'à celle des Allemands, avoit été, la nuit précédente, au camp des premiers, dans le village de Saint-Pierre, à une lieue de la ville, et il avoit rapporté qu'un détachement de Troupes Allemandes devoit aller, ce jour-là, fourrager dans les environs de Parme, avec intention de tenter un coup de main sur la ville.
Le Maréchal de Coigny, qui commandoit alors l'armée, fit un détachement de deux Régimens, Picardie et Champagne, et les envoya à la découverte; mais comme ce brave Général ne manquoit jamais de précaution ni de vigilance, il fit arrêter l'espion dont il se défioit, et fit mettre tout le camp sous les armes.
M. de Coigny ne se trompa pas; les deux Régimens arrivés à la vue des remparts de la ville, découvrirent l'armée Allemande, composée de quarante mille hommes, conduits par le Maréchal de Mercy, avec dix pieces de campagne.
Les François marchant par le grand chemin entouré de larges fossés, ne pouvoient pas reculer: ils avancerent bravement; mais ils furent presque tous renversés par l'artillerie des ennemis.
Ce fut le signal de la surprise pour le Commandant François. L'espion fut pendu sur-le-champ, et l'armée se mit en marche, en redoublant le pas: le chemin étoit borné: la Cavalerie ne pouvoit pas avancer; mais l'Infanterie chargea si vigoureusement l'ennemi, qu'elle le força de reculer; et ce fut dans ce moment-là que la frayeur des Parmesans se convertit en joie.
Tout le monde couroit alors sur les remparts de la ville: j'y courus aussi: on ne peut pas voir une bataille de plus près: la fumée empêchoit souvent de bien distinguer les objets; mais c'étoit toujours un coup-d'œil fort rare, dont bien peu de monde peut se vanter d'avoir joui.
Le feu continuel dura pendant neuf heures sans interruption: la nuit sépara les deux armées, les Allemands se disperserent dans les montagnes de Reggio, et les alliés resterent les maîtres du champ de bataille.
Le jour suivant, je vis conduire à Parme sur un brancard le Maréchal de Mercy, qui avoit été tué dans la chaleur du combat. Ce Général fut embaumé et envoyé en Allemagne, ainsi que le Prince de Wirtemberg, qui avoit subi le même Sort.
Un spectacle bien plus horrible et plus dégoûtant s'offrit à mes yeux le jour suivant dans l'après-midi. C'étoit les morts qu'on avoit dépouillés pendant la nuit, et qu'on faisoit monter à vingt-cinq mille hommes; ils étoient nuds et amoncelés; on voyoit des jambes, des bras, des crânes, et du sang par-tout. Quel carnage!
Les Parmesans craignoient l'infection de l'air, vu la difficulté d'enterrer tous ces corps massacrés; mais la République de Venise qui est presque limitrophe du Parmesan, et qui étoit intéressée à garantir la salubrité de l'air, envoya de la chaux en abondance, pour faire disparoître tous ce cadavres de la surface de la terre.
Le troisieme jour après la bataille je voulois continue ma route pour Modene. Mon voiturin m'observa que le chemins de ce côté-tà étoient devenus impraticables à cause des incursions continuelles des troupes des deux partis. Il m'ajouta que si je voulois aller à Milan, qui étoit sa patrie, il m'y conduiroit; et que si je voulois aller à Bresse, il connoissoit un de ses camarades qui alloit partir pour cette ville, avec un Abbé dont je pourrois être compagnon de voyage.
J'acceptai cette derniere proposition. Bresse me convenoit mieux, et je partis le lendemain avec M. l'Abbé Garoffini, jeune homme très-instruit et grand amateur de Spectacles.
Nous causâmes beaucoup en route; et comme j'avois la maladie des Auteurs, je ne manquai pas de parler de mon Bélisaire. M. l'Abbé paroissoit curieux de l'entendre; et à la premiere dînée, je tirai ma piece de mon coffre-fort, et j'en commençai la lecture.
Je n'avois pas achevé le premier acte, que le voiturin vient nous presser pour partir. M. l'Abbé en étoit fâché, il y avoit pris quelqu'intérêt; allons, dis-je, je lirai en voiture aussi bien qu'ici: nous reprenons nos places dans la chaise; et comme les voiturins vont au pas, je continuai ma lecture sans la moindre difficulté.
Pendant que nous étions occupés l'un et l'autre, la voiture s'arrête, et nous voyons cinq hommes à moustaches et en uniforme militaire, qui, le sabre à la main, nous ordonnent de descendre. Falloit-il récalcitrer contre les ordres absolus de ces Messieurs-là? Je descends de mon côté, l'Abbé de l'autre. Un d'entr'eux me demande la bourse; je la donne sans me faire prier; un autre m'arrache la montre; un troisieme fouille dans mes poches, et prend ma boîte, qui n'étoit que d'écaille. Les deux derniers en firent autant à l'Abbé; et tous les cinq se jetterent ensuite sur les malles, sur mon petit coffre-fort et sur nos sacs de nuit.
Quand le voiturin se vit déchargé, il fit prendre le galop à ses chevaux, et moi je pris le mien: je sautai un fossé fort large, et je me sauvai au travers des champs, craignant toujours que ces canailles n'en voulussent à ma redingotte, à mon habit, à ma culotte et à ma vie, bienheureux d'en avoir été quitte pour mon argent et pour mes effets, et d'avoir sauvé du naufrage mon Bélisaire.
Ayant perdu de vue les voleurs, et ne sachant pas ce qu'étoit devenu mon compagnon de voyage, je trouvai une allée d'arbres, et je me reposai tranquillement à côté d'un ruisseau. Je me servis du creux de ma main pour me désaltérer, et je trouvai cette eau délicieuse.
Mon corps délassé, et mon esprit plus calme, ne voyant personne à qui m'adresser, je pris au hasard un côté de l'allée que j'étois persuadé devoir aboutir à quelqu'endroit habité. Je ne tardai pas à rencontrer des paysans qui travailloient dans les champs; je les accostai avec confiance, et je leur fis part de mon aventure. Ils en savoient déjà quelque chose; ils avoient vu passer les coquins qui m'avoient dépouillé, par un chemin de traverse, chargés comme des mulets. C'étoient des déserteurs qui attaquoient les passans, et n'épargnoient pas même les hameaux et les métairies. Ce sont les fruits malheureux de la guerre qui tombent indistinctement sur les amis et les ennemis, et qui désolent les innocens. Comment, dis-je, comment ces voleurs peuvent-ils se défaire impunément des effets volés sans être arrêtés? Tous ces paysans vouloient me répondre à la fois, et leur empressement marquoit leur indignation. Il y avoit à peu de distance de l'endroit où nous étions, une compagnie d'hommes riches, tolérée pour acheter les dépouilles des victimes de la guerre, et les acheteurs ne prenoient pas garde si les effets venoient du champ de bataille ou du grand chemin.
Le soleil alloit se coucher. Ces bonnes gens m'offrirent un petit reste de leur goûter que, malgré mon désastre, je savourai avec appétit, ils me proposerent d'aller passer la nuit chez eux. J'allois accepter avec reconnoissance l'hospitalité que ces bonnes gens vouloient bien m'accorder, mais un respectable vieillard qui étoit le pere et le grand per de mes bienfaiteurs, me fit remarquer qu'il n'y avoit chez eux que de la paille et du foin pour me reposer, et qu'il valoit mieux me conduire à Casal Pasturlengo, qui n'étoit qu'à une lieue de distance, et où le Curé, très-honnête et très-complaisant, se seroit fait un plaisir de me recevoir et de me loger.
Tout le monde applaudit à son avis. Un jeune homme se chargea de m'y conduire; je le suivis, et je bénis le ciel qui tolere d'un côté les méchans, et anime de l'autre les cœurs sensibles et vertueux.
Hospitalité du Curé de Casal Pasturlengo. - Lecture de mon Bélisaire au Curé. - Mon arrivée à Bresse. - Rencontre inattendue dans cette ville. - Ressource fâcheuse, mais nécessaire. - Route pour Vérone.
Arrivé à Casal Pasturlengo, je priai mon guide d'aller prévenir M. le Curé de mon accident. Quelques minutes après, ce bon Pasteur vient au-devant de moi, me tend la main, et me fait monter chez lui: enchanté de ce bon accueil, je tourne les yeux vers le jeune homme qui m'avoit escorté; et en le remerciant, je lui marque mon regret de ne pouvoir pas le récompenser. Le Curé s'en apperçoit et donne quelques sols au paysan qui s'en va content. C'est peu de chose, mais cela prouve la façon de penser d'un homme juste et compatissant.
A la campagne, on soupe de bonne heure. Le soupé du Curé étoit prêt quand j'arrivai; je ne fis pas de façons; il partagea avec moi ce que sa gouvernante lui avoit préparé.
Notre conversation tomba d'abord sur la guerre: je parlai de ce que j'avois vu à Parme, à Milan, à Pizzighetone. Insensiblement, je me trouvai engagé, dans quelques détails, sur mes emplois et sur mes occupations; mes discours aboutirent, comme à l'ordinaire, à l'article de Bélisaire.
Le Curé, qui étoit un Ecclésiastique très-sage et très-exemplaire, ne condamnoit pas les Spectacles honnêtes et morigénés, et paroissoit curieux d'entendre la lecture de ma Piece; mais j'étois trop fatigué pour l'instant; nous remîmes la partie au lendemain, et j'allai me coucher dans un lit délicieux, où j'oubliai tous mes chagrins, et je dormis jusqu'à dix heures du matin.
Aussi-tôt que je fus réveillé, on m'apporta une bonne tasse de chocolat. Ensuite, comme le tems étoit beau, j'allai me promener jusqu'à midi, qui étoit l'heure du diné; nous nous revîmes avec plaisir, nous dînâmes avec deux autres Abbés de sa Paroisse; et après dîné, j'entrepris la lecture de ma Piece. M. le Curé me demanda la permission de faire entrer sa gouvernante et son régisseur. Pour moi, j'aurois voulu qu'il fît venir tout le village.
Ma lecture fut extrêmement goûtée. Les trois Abbés, qui n'étoient pas sots, saisirent les endroits les plus intéressans et les plus saillans, et les villageois me prouverent, par leurs applaudissemens, que ma Piece étoit à la portée de tout le monde, et qu'elle pouvoit plaire aux gens instruits comme aux ignorans.
M. le Curé me fit compliment, et me remercia de ma complaisance: les deux autres Abbés de même, et chacun d'eux vouloit me donner à dîner; mais je ne voulois pas gêner mon hôte, et d'ailleurs j'étois pressé de continuer ma route. M. le Curé me demanda comment je comptois partir: j'étois très-disposé à m'en aller à pied; mais ce digne homme ne le permit pas. Il me donna son cheval et son domestique, avec ordre à celui-ci de payer pour moi à la dînée, et je partis le lendemain, confondu, comblé de bienfaits et de politesses.
En arrivant à Bresse, j'étois plus embarrassé que jamais; je n'avois d'autre ressource que celle d'aller chez le Gouverneur, que je ne connoissois pas; mais devois-je trouver à la ville cette cordialité que j'avois rencontrée dans un bourg.
Un de mes chagrins c'étoit de ne pouvoir pas récompenser le domestique du Curé. Je le priai de m'attendre à une petite Auberge où nous étions descendus, et je tournai mes pas vers le Palais du Gouvernement. En tournant le coin d'une rue qu'on m'avoit indiquée, je vois un homme qui, tout en boitant, vient au-devant de moi. C'étoit M. Léopold Scacciati , l'oncle de ma belle compatriote.
Etonné de me voir, comme moi de le rencontrer, il me fait des plaintes de ne m'avoir pas revu à Crême, à l'hôtel du Cerf. Je lui rends compte de mon départ précipité de cette ville; je lui fais le récit des événemens fâcheux que je venois d'essuyer, et je lui peins l'état douloureux auquel je me voyois réduit. Cet homme, tel qu'il étoit, paroissoit touché jusqu'aux larmes, et me pria d'aller chez lui.
J'avois besoin de tout; mais ne sachant pas ce que Scacciati et sa niece faisoient à Bresse, je refusai d'y aller. Le boiteux, qui étoit plus petit que moi, me saute au col, me prie, m'embrasse, me parle de ses obligations, de sa reconnoissance, de son attachement pour moi: il me prend par la main; il me traîne après lui: sa demeure n'étoit pas loin; nous arrivons à la porte; il me pousse en dedans, et crie de toutes ses forces, Marguerite, Marguerite, c'est M. Goldoni. Mademoiselle Marguerite descend; elle m'embrasse, elle m'engage à monter, m'y force, et je monte avec eux.
La Vénitienne me demanda bien de choses concernant ma personne; je voulois la satisfaire; mais me rappellant le domestique du Curé, je marquai de l'inquiétude; ils m'en demanderent le sujet, je le dis, et Scacciati partit sur- le-champ pour aller donner quelque argent à cet homme qui m'attendoit.
Etant resté seul avec ma compatriote, je lui traçai mon histoire, et elle me rendit compte de la sienne.
Scacciati n'étoit pas son oncle; c'étoit un coquin qui l'avoit enlevée à ses parens, et l'avoit vendue à un homme riche, qui l'avoit quittée au bout de deux mois, et avoit mieux payé le courtier que la Demoiselle. Elle étoit lasse de vivre avec ce fainéant, qui dépensoit avec profusion ce qu'elle gagnoit avec répugnance. Elle avoit amassé beaucoup d'or à Milan, et ils étoient partis de cette ville avec plus de dettes que d'argent. A Bresse, ils en ont fait autant. Scacciati étoit l'homme du monde le plus vicieux et le moins raisonnable: elle vouloit s'en défaire, et me demandoit conseil pour exécuter son projet.
Si j'avois été riche, je l'aurois délivrée de son tyran; mais dans la position où j'étois, je ne pus lui donner d'autre avis que celui d'avoir recours à ses parens, et tâcher de se rapprocher de ceux qui avoient le droit de la réclamer.
Pendant que nous nous entretenions de la sorte, le boiteux rentre. Il nous voit l'un auprès de l'autre: il badine, et croit que la Demoiselle a eu soin de me faire oublier mes chagrins. Le méchant homme! Il ne connoissoit que la débauche.
J'étois fâché d'être obligé de le condamner pendant qu'il ne cherchoit qu'à m'obliger. Allons, dit-il, puisque nous n'avons personne aujourd'hui, nous souperons nous trois. Venez, Monsieur, venez avec moi. Je le suis, il me conduit dans une chambre très-bien meublée avec un lit à baldaquin: c'est ici, dit-il, la chambre de cérémonie de Mademoiselle; vous l'occuperez seul, ou accompagné, comme vous voudrez.
L'endroit me fit horreur. Je voulois m'en aller sur-le-champ; l'homme adroit s'apperçut de ma répugnance; il me fit voir un petit cabinet que je ne refusai pas, vu l'heure et la position où j'étois; mais je lui dis en même-tems que le lendemain j'étois décidé à partir.
Ayant tenté envain de me faire rester davantage, Scacciati me dit tout bonnement, et avec une effusion de cœur que j'aurois admiré si elle ne fut pas partie d'une ame corrompue, qu'il savoit que j'étois dans la détresse, et qu'il m'offroit tous les secours dont je devois avoir besoin. Eh bien! lui dis-je, puisque vous êtes disposé à m'obliger, prêtez-moi six sequins, et je vais vous faire mon billet. Il me donna les six sequins, et refusa le billet, et sans m'écouter davantage, il sortit du cabinet où nous étions, et fit servir le soupé.
Nous soupâmes très-bien; j'allai me coucher dans mon petit lit. Le matin je déjeûnai avec l'oncle et la niece supposée, je les remerciai l'un et l'autre, et je partis en poste pour Vérone.
Comme je n'aurai plus occasion de parler de ces deux personnages, je dirai en deux mots à mon Lecteur, que je vis quelques années après la Demoiselle assez bien mariée à Venise, et que M. Scacciati finit par être condamné aux galeres.
Vérone. - Son Amphithéâtre, ouvrage des Romains. -Comédie pendant le jour contre l'usage d'Italie. - Heureuse rencontre. - Lecture et réception de mon Bélisaire. - Ma premiere liaison avec les Comédiens.
Faisant route dans la plaine pierreuse de Bresse à Vérone, je réfléchissois sur mes aventures, tantôt bonnes, tantôt mauvaises, rencontrant toujours le mal à côté du bien, et le bien à côté du mal.
Ma derniere ressource de Bresse fixa davantage mes réflexions. Des coquins me dépouillent, un coquin vient à mon secours; comment est-il possible que, dans un cœur criminel, la vertu puisse pénétrer? Non, ce n'est que par amour-propre, par ostentation, que Scacciati a été généreux envers moi. Mais quel que soit le motif qui l'ait déterminé, je lui devrai toujours de la reconnoissance.
La Providence se sert de différens moyens pour partager ses faveurs. Souvent elle se sert du méchant pour secourir l'honnête homme, et nous devons bénir l'auteur du bienfait, et en reconnoître l'intermédiaire.
Arrivé à Desenzano, je dînai dans cette même hôtellerie sur le lac de Garda, où j'avois couché deux fois, et j'arrivai a Vérone à la nuit tombante.
Vérone est une des belles villes de l'Italie; elle mériteroit, sans doute, que je m'occupasse de ses beautés, de ses ornemens, de ses Académies, et des talens qu'elle a produits et cultivés dans tous les tems; mais cette digression me meneroit trop loin; je me bornerai uniquement à parler de ce monument, qui peut avoir quelque relation à l'objet de mes Mémoires.
Il y a à Vérone un Amphithéâtre qui est un ouvrage des Romains. On ne sait pas si c'est du tems de Trajan ou de Domitien, mais il est si bien conservé, qu'on peut s'en servir aujourd'hui comme dans le tems où il a été construit.
Ce vaste édifice que l'on appelle en Italie l'Arena di Verona, est d'une forme ovale; son grand diamètre intérieur est de deux cens vingt-cinq pieds, sur cent trente-trois de largeur pour le petit diamètre. Quarante-cinq rangées de gradins de marbre l'entourent, et peuvent contenir vingt mille personnes assises, et à leur aise.
Dans cet espace qui en fait le centre, on donne des Spectacles de toute espece: des courses, des joûtes, des combats de taureaux; et en été on y joue même la Comédie sans autre lumiere que celle du jour naturel.
On construit, à cet effet au milieu de cette place sur des trétaux très-solides, un théâtre en planche, qui se défait en hiver, et se remonte à la nouvelle saison, et les meilleures Troupes d'Italie viennent alternativement y exercer leurs talens.
Il n'y a point de loges pour les spectateurs, une clôture de planches forme un vaste parterre avec des chaises. Le bas peuple se range à très-peu de frais sur les gradins qui sont en face du Théâtre, et malgré la modicité du prix de l'entrée, il n'y a pas de Salle en Italie qui rapporte autant que l'Arena.
En sortant de mon auberge le lendemain de mon arrivée, je vis des affiches de Comédie, et j'y lus qu'on donnoit ce jour-là Arlequin muet par crainte.
J'y vais l'après-midi, et je me place dans l'enclos, au milieu de l'Arène, où il y avoit une chambrée très- nombreuse.
On leve la toile; les Comédiens devoient faire une excuse à cause du changement de la Piece; ce n'étoit plus le Muet par crainte qu'on alloit donner, c'étoit une autre Piece du nom de laquelle je ne me souviens plus. Mais quelle agréable surprise pour moi! l'Acteur qui vient pour haranguer le public est mon cher Casali, le promoteur et le propriétaire de mon Bélisaire.
Je quitte ma place pour monter sur le Théâtre. Comme le local n'étoit pas bien vaste, on ne vouloit pas me laisser entrer; je fais demander Casali; il vient, il me voit il en est enchanté. Il me fait monter, il me présente au Directeur, à la premiere Actrice, à la seconde, à la troisieme, à toute la Troupe. Tout le monde vouloit me parler: Casali m'arrache du cercle; il m'emmene derriere une toile; on change de décoration; je me trouve à découvert; je me sauve, et je suis sifflé. Mauvais prélude pour un Auteur, mais les Véronois m'ont bien dédommagé par la suite de ce petit désagrément. Cette compagnie étoit celle dont Casali m'avoit parlé à Milan; elle étoit attachée au Théâtre Grimani à Saint Samuel à Venise, où elle se rendoit tous les ans, pour y jouer l'automne et l'hiver, et aller passer en Terre-Ferme le printems et l'été.
M. Imer étoit le Directeur de la Troupe; c'étoit un Génois très-poli et très-honnête; il me pria à dîner chez lui le lendemain, qui étoit jour de relâche. J'acceptai son invitation; je lui promis en revanche la lecture de mon Bélisaire, nous étions tous d'accord et contens.
Je me rends le lendemain chez le Directeur; j'y trouve toute la compagnie rassemblée. Imer vouloit régaler ses camarades d'une nouveauté dont Casali les avoit prévenus. Le dîné étoit splendide; la gaîté des Comédiens charmante. On faisoit des couplets, on chantoit des chansons à boire; ils me prévenoient sur tout, c'étoit des racoleurs qui vouloient m'engager.
Le dîné fini, on se rassembla dans la chambre du Directeur, et je lus ma Piece; elle fut écoutée avec attention; et ma lecture finie, l'applaudissement fut général et complet. Imer, avec un ton magistral, me prit par la main, et me dit: Bravo. Tout le monde me fit compliment; Casali pleuroit de joie. Un des Acteurs me demanda très-poliment si ses camarades seroient assez heureux pour jouer ma Piece les premiers. Casali se leve, et dit d'un air assuré: Oui, Monsieur, M. Goldoni m'a fait l'honneur de travailler pour moi, et en prenant la Piece qui étoit restée sur la table, je vais, dit- il, sous le bon plaisir de l'Auteur, je vais la copier moi-même; et sans attendre la réponse de l'Auteur, il l'emporte.
Imer me prit en particulier; il me pria d'accepter un appartement de garçon qui étoit dans la même maison, et à côté du sien; il me pria aussi d'accepter sa table pendant tout le tems que sa Troupe devoit rester à Vérone. Dans la situation où j'étois, je ne pouvois rien refuser.
Réunion des Intermedes à la Comédie. - L'Opéra Comique inconnu enLombardie, et dans l'Etat de Venise. - La Pupile, Intermede. - Présent de Casali bien employé. - Mon arrivée à Venise. - Coup d'œil de cette ville pendant la nuit. - Ma présentation au noble Grimani. - Ses promesses et mes espérances.
Imer, sans avoir eu une éducation bien suivie, avoit de l'esprit et des connoissances; il aimoit la Comédie de passion; il étoit naturellement éloquent, et auroit très-bien soutenu les rôles d'amoureux à l'impromptu, suivant l'usage Italien, si sa taille et sa figure eussent répondu à ses talens. Court, gros, sans col, avec de petits yeux et un petit nez écrasé, il étoit ridicule dans les emplois sérieux, et les caracteres chargés n'étoient pas à la mode.
Il avoit de la voix; il imagina d'introduire à la Comédie les Intermedes en musique, qui pendant long-tems avoient été réunis au grand Opéra, et avoient été supprimés pour faire place aux Ballets.
L'Opéra Comique a eu son principe à Naples et à Rome, mais il n'étoit pas connu en Lombardie, ni dans l'Etat de Venise, de maniere que le projet d'Imer eut lieu, et la nouveauté fit beaucoup de plaisir, et rapporta aux Comédiens beaucoup de profit.
Il avoit deux Actrices dans cette Troupe pour les Intermedes; l'une étoit une veuve très-jolie et très-habile, appellée Zanetta Casanova qui jouoit les jeunes amoureuses dans la Comédie; et l'autre une femme qui n'étoit pas Comédienne, mais qui avoit une voix charmante. C'étoit Madame Agnese Amurat, la même Chanteuse que j'avois employée à Venise dans ma sérénade.
Ces deux femmes ne connoissoient pas une note de musique, et Imer non plus; mais tous les trois avoient du goût, l'oreille juste, l'exécution parfaite, et le public en étoit content.
Le premier Intermede par lequel ils avoient débuté, avoit été la Cantatrice, petite Piece que j'avois faite à Feltre pour un Théâtre de société, et j'avois contribué aux avantages de la compagnie de Venise sans le savoir, et sans être connu. Je devois donc être accrédité dans l'esprit du Directeur, à qui Casali m'avoit annoncé pour l'Auteur de la Cantatrice, et voilà la véritable raison des politesses dont il me combla; car ordinairement on ne donne rien pour rien, et mon Bélisaire n'auroit pas suffi, si je n'eusse pas fait mes preuves pour la Poësie Dramatique.
Imer, qui avoit le coupd'œil juste, prévoyoit que mon Bélisaire feroit fortune par-tout; il n'en étoit pas fâché, mais il auroit voulu que sa personne et son nouvel emploi eussent eu part aux succès qu'il se promettoit. Il me pria de composer un Intermede à trois voix, et de le faire le plus promptement possibile, pour avoir le tems de le faire mettre en musique.
Je fis mon Intermede en trois actes, et je le nommai la Pupile. Je pris l'argument de cette petite Piece dans la vie privée du Directeur; je m'apperçus qu'il avoit une inclination décidée pour la veuve sa camarade; je voyois qu'il en étoit jaloux, et je le jouai lui-même.
Imer ne tarda pas à s'en appercevoir, mais l'Intermede lui parut si bien fait, et la critique si honnête et si délicate, qu'il me pardonna cette plaisanterie, Il me remercia, il m'applaudit, et envoya tout de suite mon ouvrage à Venise, au Musicien qu'il avoit déjà prévenu.
En attendant, Bélisaire avoit été copié, les rôles distribués. Quelques jours après on fit la premiere répétition les rôles à la main et la piece fit encore plus d'effet à cette seconde lecture, qu'elle n'en avoit fait à la premiere.
Casali, content de moi plus que jamais, après m'avoir asssuré que le Directeur et le Propriétaire du Théâtre auroient eu soin de me récompenser, me pria en grâce de vouloir bien recevoir de lui particulierement une marque de sa reconnoissance, et me présenta six sequins. Scacciati me revint à l'esprit au même instant; je remerciai Casali, je pris les six sequins d'une main, et je les envoyai à Scacciati de l'autre.
Voici mon systeme. J'ai tâché toujours d'éviter les bassesses, mais je n'ai jamais été fier; j'ai secouru quand je l'ai pu tous ceux qui ont eu besoin de moi, et j'ai reçu sans difficulté, et je demandois même sans rougir les secours qui m'étoient nécessaires.
Je restai tranquillement à Vérone jusqu'à la fin de Septembre. Je partis ensuite pour Venise avec Imer, dans sa chaise de poste, et nous y arrivâmes le même jour à huit heures du soir. Imer me fit descendre chez lui, me fit voir la chambre qu'il m'avait destinée, me présenta à sa femme, à ses filles, et comme j'avois grande envie d'aller voir ma tante maternelle, je les priai de me dispenser de souper avec eux.
J'étois très-curieux d'avoir des nouvelles de Madame St*** et de sa fille, et de savoir si elles avoient encore des prétentions sur moi. Ma tante m'assura que je pouvois être tranquille, que ces Dames hautes comme le tems, sachant que j'avois pris quelques engagemens avec les Comédiens, m'avoient cru indigne de les accoster, et n'avoient pour moi que du mépris et de l'indignation.
Tant mieux, dis-je, tant mieux, c'est un avantage de plus que je devrai à mon talent. Je suis avec les Comédiens comme un Artiste dans son attelier. Ce sont d'honnêtes gens, beaucoup plus estimables que les esclaves de l'orgueil et de l'ambition.
Je parlai ensuite de mes affaires de famille. Ma mere qui étoit encore à Modene, se portoit bien, mes dettes étoient presque payées en entier, je soupai avec ma tante et avec mes Parens.
Après avoir pris congé d'eux pour aller chez mon hôte, je pris le chemin le plus long, je fis le tour du Pont de Rialto et de la place Saint-Marc, et je jouis du spectacle charmant de cette ville encore plus admirable de nuit que de jour.
Je n'avois pas encore vu Paris, je venois de voir plusieurs villes, où le soir on se promene dans les ténebres. Je trouvai que les lanternes de Venise formoient une décoration utile et agréable, d'autant plus que les particuliers n'en sont pas chargés, puisqu'un tirage de plus par an de la Loterie est destiné pour en faire les frais.
Indépendamment de cette illumination générale, il y a celle des boutiques, qui de tout tems sont ouvertes jusqu'à dix heures du soir, et dont une grande partie ne se ferme qu'à minuit, et plusieurs autres ne se ferment pas du tout.
Ou trouve à Venise, à minuit, comme en plein midi, les comestibles étalés, tous les cabarets ouverts, et des Soupés tout prêts dans les auberges et dans les hôtels garnis; car les dinés et les soupers de société ne sont pas communs à Venise, mais les parties de plaisirs et les piqueniques rassemblent les sociétés avec plus de liberté et plus de gaîté.
En tems d'été la place Saint-Marc et ses environs sont fréquentés la nuit comme le jour. Les cafés sont remplis de beau monde, hommes et femmes de toute espece.
On chante dans les places, dans les rues, et sur les canaux. Les marchands chantent en débitant leurs marchandises, les ouvriers chantent en quittant leurs travaux, les gondoliers chantent en attendant leurs maîtres. Le fond du caractere de la nation est la gaîté, et le fond du langage Vénitien est la plaisanterie.
Enchanté de revoir ma Patrie, qui me paroissoit toujours plus extraordinaire et plus amusante, je rentrai dans mon nouveau logement, et je trouvai Imer qui m'attendoit et m'annonça qu'il iroit le lendemain chez M. Grimani, propriétaire du Théâtre; qu'il me meneroit avec lui, et qu'il me présenteroit à son Excellence, si je n'avois pas d'autres enigagemens.
Comme j'étois libre, j'acceptai la proposition; et nous y allâmes ensemble. M. Grimani étoit l'homme du monde le plus poli; il n'avoit pas cette hauteur incommode qui fait du tort aux grands, pendant qu'elle humilie les petits. Illustre par sa naissance, estimé par ses talens, il n'avoit besoin que d'être aimé, et sa douceur captivoit tous les cœurs.
Il me reçut avec bonté, il m'engagea à travailler pour la Troupe qu'il entretenoit; et pour m'encourager davantage, il me fit espérer qu'étant propriétaire aussi de la Salle de Saint-Jean-Chrisostôme et Entrepreneur du grand Opéra, il tâcheroit de m'employer, et de m'attacher à ce Spectacle.
Très-content de son Excellence, et des bons offices qu'Imer venoit de me rendre auprès de lui, je ne pensai plus qu'à mériter les suffrages du public.
La premiere représentation de Bélisaire étoit fixée pour la Sainte-Catherine, tems où les vacances du Palais se terminent, et où le monde revient de la campagne; en attendant nous faisions des répétitions, tantôt de ma Tragi- Comédie, tantôt de mon Intermede, et comme mes occupations n'étoient pas bien considérables, je préparai des nouveautés pour le carnaval.
J'entrepris la composition d'une Tragédie intitulée Rosimonde, et d'un autre Intermede intitulé la Birba . Pour la grande Piece c'étoit la Rosimonda del Muti, mauvais Roman du siècle dernier, qui m'avoit fourni l'argument, et j'avois calqué la petite Piece sur les Batteleurs de la Place Saint-Marc, dont j'avois bien étudié le langage, les ridicules, les charges et les tours d'adresse.
Les traits comiques que j'employois dans les Intermedes, étoient comme de la graine que je semois dans mon champ pour y recueillir un jour des fruits mûrs et agréables.
Premiere représentation de Bélisaire, son succès. - Premiere représentation de la Pupile. - Celle de Rosimonde. - Celle de la Birba. - Clôture des Spectacles.
Enfin, le 24 Novembre 1734, mon Bélisaire parut pour la premiere fois sur la scene. C'étoit mon début, et il ne pouvoit être ni plus brillant, ni plus satisfaisant pour moi.
Ma Piece fut écoutée avec un silence extraordinaire, et presque inconnu aux Spectacles d'Italie. Le public, habitué an bruit, prenoit l'essor dans les entr'actes, et par des cris de joie, par des claquemens de mains, par des signes réciproques entre le Parterre et les loges, on prodiguoit à l'Auteur et aux Acteurs les applaudissemens les plus éclatans.
A la fin de la Piece, tous ces élans d'une satisfaction peu commune redoublerent, de maniere que les Acteurs en étoient pénétrés. Les uns pleuroient, les autres rioient, et c'étoit la même joie qui produisoit ces effets différens.
On n'appelle pas en Italie l'Auteur de la Piece pour le voir, et pour l'applaudir sur la scene. Mais lorsque le premier Amoureux se présenta pour annoncer, tous les Spectateurs crierent unanimement: Questa, questa, questa; c'est-à-dire la même, la même, et l'on baissa la toile. On donna le lendemain la même, on continua de la donner tous les jours jusqu'au 14 Décembre, et on fit avec elle la clôture de l'automne.
Ce début fut très-heureux pour moi; car la Piece ne valoit pas tout le prix qu'on l'avoit estimée, et j'en fais moi- même si peu de cas, qu'elle ne paroîtra jamais dans le recueil de mes ouvrages.
La bonne Littérature est aussi bien connue et aussi bien cultivée à Venise, que par-tout ailleurs; mais les connoisseurs ne purent pas s'empêcher d'applaudir un ouvrage dont ils connoissoient les imperfections. En voyant la supériorité qu'avoit ma Piece sur les farces et sur les puérilités ordinaires des Comédiens, ils auguroient, de ce premier essai, une suite qui auroit pu donner de l'émulation, et frayer le chemin à une réforme du Théâtre Italien.
Le principal défaut de ma Piece étoit la presence de Bélisaire, les yeux crévés et ensanglantés; à cela près ma Piece, que j'avois nommée Tragi-Comédie, n'étoit pas destituée d'agrémens; elle intéressoit le Spectateur d'une maniere sensible, et d'après nature. Mes Héros étoient des hommes, et non pas des demi-Dieux, leurs passions avoient le degré de noblesse convenable à leur rang, mais ils faisoient paroître l'humanité telle que nous la connoissions, et ils ne portoient pas leurs vertus et leurs vices à un excès imaginaire.
Mon style n'étoit pas élégant, ma versification n'a jamais donné dans le sublime; mais voilà précisément ce q'il falloit pour ramener peu à peu à la raison un public accoutumé aux hyperboles, aux antitheses et au ridicule du gigantesque et du romanesque.
A la sixieme représentation de Bélisaire, Imer crut pouvoir y joindre la Pupile; cette petite Piece fut très-bien reçue du public; mais Imer croyoit que l'Intermede soutenoit la Tragi-Comédie, et c'étoit celle-ci qui soutenoit l'Intermede.
De toute façon, j'y gagnai beaucoup pour ma part; car le public me voyant paroître en même-tems dans les deux genres, et d'une maniere tout-à-fait nouvelle, je méritai l'estime générale de mes compatriotes, et j'eus des encouragemens très-flatteurs et très-distingués.
Ce fut dans cette occasion que je fis la connoissance de son Excellence Nicolas Balbi, Patricien et Sénateur Vénitien, dont la protection vive et constante me fit en tout tems le plus grand honneur, et dont les avis, le crédit et les adhérences me furent toujours de la plus grande utilité.
Le 17 Janvier, on donna la premiere représentation de ma Rosimonde. Elle ne tomba pas; mais après Bélisaire, je ne pouvois pas me flatter d'avoir un succès aussi brillant; elle eut quatre représentations assez passables. A la cinquieme, Imier l'étaya d'un nouvel Intermede. La Birba fit le plus grand plaisir: cette bagatelle, très-comique et tres-gaie, soutint Rosimonde pendant quatre autres représentations; mais il fallut revenir à Bélisaire. Cette piece eut, à la reprise, le même succès qu'elle avoit eu à son début; et Bélisaire et la Birba furent joués ensemble jusqu'au Mardi gras, et firent la clôture du Carnaval; ce qui termina l'année théâtrale.
A Venise, ou ne rouvre les salles de Spectacles qu'au commencement du mois d'Octobre; mais il y a pendent les quinze jours de la foire de l'Ascension un grand Opéra, et quelquefois deux, qui ont jusqu'à vingt représentations.
Le noble Grimani, propriétaire du Théâtre de Saint-Samuel, faisoit représenter dans cette saison un Opéra pour son compte; et connue il m'avoit promis de m'attacher à ce Spectacle, il me tint parole.
Ce n'étoit pas un nouveau Drame qu'on devoit donner cette année-là, mais on avoit choisi la Griselda, Opéra d'Apostolo Zeno et de Pariati, qui travailloient ensemble avant que Zeno partît pour Vienne au service de l'Empereur, et le Compositeur qui devoit le mettre en musique étoit l'Abbé Vivaldi qu'on appelloit à cause de sa chevelure, il Prete rosso (le Prêtre roux). Il étoit plus connu par ce sobriquet, que par son nom de famille.
Cet Ecclésiastique, excellent Joueur de violon et Compositeur médiocre, avoit élevé et formé pour le chant Mademoiselle Giraud, jeune Chanteuse, née à Venise, mais fille d'un Perruquier François. Elle n'étoit pas jolie, mais elle avoit des graces, une taille mignonne, de beaux yeux, de beaux cheveux, une bouche charmante, peu de voix, mais beaucoup de jeu. C'étoit elle qui devoit représenter le rôle de Griselda.
M. Grimani m'envoya chez le Musicien pour faire dans cet Opéra les changemens nécessaires, soit pour raccourcir le Drame, soit pour changer la position et le caractere des airs au gré des Acteurs et du Compositeur. J'allai donc chez l'Abbé Vivaldi, je me fis annoncer de la part de son Excellence Grimani; je le trouvai entouré de musique, et le bréviaire à la main. Il se leve, il fait le signe de la croix en long et en large, met son bréviaire de coté, et me fait le compliment ordinaire: - Quel est le motif qui me procure le plaisir de vous voir, Monsieur? - Son Excellence Grimani m'a chargé des changemens que vous croyez nécessaires dans l'Opéra de la prochaîne foire. Je viens voir, Monsieur, quelles sont vos intentions. - Ah, ah, vous êtes chargé, Monsieur, des changemens dans l'Opéra de Griselda? M. Lalli n'est donc plus attaché aux Spectacles de M. Grimani? M. Lalli, qui est fort âgé, jouira toujours des profits des Epîtres Dedicatoires et de la vente des livres, dont je ne me soucie pas. J'aurai le plaisir de m'occuper dans un exercice qui doit m'amuser, et j'aurai l'honnieur de commencer sous les ordres de M. Vivaldi. (L'Abbé reprend son bréviaire, fait encore un signe de croix, et ne répond pas). - Monsieur, lui dis-je, je ne voudrois pas vous distraire de votre occupation religieuse; je reviendrai dans un autre moment. - Je sais bien, mon cher Monsieur, que vous avez du talent pour la Poésie; j'ai vu votre Bélisaire, qui m'a fait beaucoup de plaisir, mais c'est bien différent: on peut faire une Tragédie, un Poëme Epique, si vous voulez, et ne pas savoir faire un Quatrain musical. - Faites-moi le plaisir de me faire voir votre Drame. - 0ui, oui, je le veux bien; où est donc fourrée Griselda? Elle étoit ici... Deus in adjutorium meum intende. Domine... Domine... Domine... elle étoit ici tout à l'heure. Domine ad adjuvandum... Ah! la voici. Voyez, Monsieur, cette scene entre Gualtiere et Griselda; c'est une scene intéressante, touchante. L'Auteur y a placé à la fin un air pathétique, mais Mademoiselle Giraud n'aime pas le chant langoureux, elle voudroit un morceau d'expression, d'agitation, un air qui exprime la passion par des moyens différens, par des mots, par exemple, entrecoupés, par des soupirs élancés, avec de l'action, du mouvement; je ne sais pas si vous comprenez. - Oui, Monsieur, je comprends très-bien; d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'entendre Mademoiselle Giraud, je sais que sa voix n'est pas assez forte... - Comm ent, Monsieur, vous insultez mon écoliere? Elle est bonne à tout, elle chante tout. - Oui, Monsieur, vous avez raison, donnez-moi le livre, laissez-moi faire. - Non, Monsieur, je ne puis pas m'en défaire, j'en ai besoin, et je suis pressé. - Eh bien, Monsieur, si vous êtes pressé, prêtez-le-moi un instant, et sur-le-champ je vais vous satisfaire. Sur-le-champ? - Oui, Monsieur, sur-le-champ.
L'Abbé en se moquant de moi me présente le Drame, me donne du papier et une écritoire, reprend son bréviaire, et récite ses Psaumes et ses Hymnes en se promenant. Je relis la scene que je connoissois déjà; je fais la récapitulation de ce que le Musicien desiroit, et en moins d'un quart-d'heure, je couche sur le papier un air de huit vers partagé en deux parties; j'appelle mon Ecclésiastique, et je lui fais voir mon ouvrage. Vivaldi lit, il déride son front, il relit, il fait des cris de joie, il jette son office par terre, il appelle Mademoiselle Giraud. Elle vient; ah! lui dit-il, voilà un homme rare, voilà un Poëte excellent: lisez cet air; c'est Monsieur qui l'a fait ici, sans bouger, en moins d'un quart-d'heure; et en revenant à moi: ah! Monsieur, je vous demande pardon; et il m'embrasse, et il proteste qu'il n'aura jamais d'autre Poëte que moi.
Il me confia le Drame, il m'ordonna d'autres changemens; toujours content de moi, et l'opéra réussit à merveille.
Me voilà donc initié dans l'Opéra, dans la Comédie et dans les Intermedes, qui furent les avant-coureurs des Opéras Comiques Italiens.
Mes Comédiens à Padoue. - Changemens arrivés dans leur Troupe. - Ma prédilection pour une belle Comédienne - Griselda, Tragédie. - Mon voyage à Udine. - Entrevue avec mon ancienne Limonadiere. - Spectacle préparé pour l'ouverture de la Salle de Venise. - Mort de la belle Comédienne.
La compagnie Grimani étoit allée à Padoue pour y jouer pendant la saison du printems, et m'attendoit avec impatience, pour donner mes Pieces.
Débarrassé de l'Opéra de Venise, je me transférai à Padoue. Mes nouveautés parurent sur le Théâtre de cette ville, et les applaudissemens de mes Confreres les Docteurs égalerent ceux de mes compatriotes.
Je trouvai beaucoup de changemens dans la Troupe; la Soubrette étoit partie pour Dresde, au service de cette Cour, et l'Arlequin ayant été remercié, on avoit fait venir à sa place M. Campagnani, Milanois, qui, parmi les Amateurs, faisoit les délices de son pays, et n'étoit pas supportable avec les Comédiens.
Mais la perte la plus considérable que la compagnie venoit de faire, c'étoit celle de la veuve Casanova, qui, malgré sa liaison avec le Directeur, s'étoit engagée au service du Roi de Pologne; elle fut remplacée, pour le chant, par Madame Passalacqua, qui, en même-tems, s'étoit chargée de l'emploi de Soubrette; et pour les rôles d'Amoureuse, on avoit fait l'acquisition de Madame Ferramonti, charmante Actrice, jeune, jolie, très-aimable, très-instruite, pleine de talens et de qualités intéressantes.
Je ne tardai pas à m'appercevoir de son mérite; je m'y attachai particulierement; je devins l'ami de son mari, qui n'étoit pas employé dans la Troupe, et j'avois formé le projet de faire de cette jeunesse une Actrice essentielle: les autres femmes ne manquerent pas d'en devenir jalouses; j'essuyai des désagrémens; et j'en aurois souffert davantage, si la mort ne l'eût pas enlevée dans la même année.
Au bout de quelques jours que j'étois à Padoue, le Directeur me parla des nouveautés qu'il falloit préparer pour Venise. Madame Collucci, surnommée la Romana, étoit premiere Amoureuse dans la compagnie, alternativement avec la Bastona; et malgré ses cinquante ans, que le fard et la parure ne pouvoient pas cacher, elle avoit un son de voix si clair et si doux, une prononciation si juste et des graces si naturelles et si naïves, qu'elle paroissoit encore dans la fraîcheur de son âge.
Madame Collucci avoit une Tragédie de Pariati, intitulée Griselda: c'étoit sa Piece favorite; mais elle étoit en prose, et on me chargea de versifier cet Ouvrage.
Rien de plus aisé pour moi: je venois de m'occuper de ce même sujet à Venise; et la Griselda de Pariati n'étoit pas autre chose que l'Opéra qu'il avoit composé lui-même, en société avec Apostolo Zeno.
J'entrepris, avec plaisir, de contenter la Romana; mais je ne suivis pas exactement les Auteurs du Drame; je fis beaucoup de changemens; j'y ajoutai le pere de Griselda: un pere vertuéux qui avoit vu sans orgueil monter sa fille au trône, et la voyoït descendre sans regret. J'avois imaginé ce nouveau personnage pour donner un rôle à mon ami Casali: cette épisode donna un air de nouveauté à la Tragédie, la rendit plus intéressante, et me fit passer pour Auteur de la Piece.
Dans l'Edition de mes œuvres faite à Turin en 1777, par Guibert et Orgeas, cette Griselda se trouve imprimée comme une Piece à moi appartenante: je déteste les plagiats, et je déclare que je n'en suis pas l'inventeur.
Mes Comédiens avoient rempli, à Padoue, le nombre des représentations convenues, et ils faisoient leurs paquets pour aller à Udine, dans le Frioul Vénitien.
Imer me proposa de m'y emmener avec lui. Je n'avois plus rien à craindre du côté de la Limonadiere, qui s'étoit mariée; je consentis de suivre la compagnie; mais ce ne fut pas avec le Directeur que je voyajeai. Je lui fis mes excuses, et je partis dans une bonne voiture, avec Madame Ferramonti et le bon-homme son mari.
A Udine, mes ouvrages furent très-applaudis: j'avois, dans cette ville, la prévention en ma faveur, et on trouva que l'Auteur du Carême poétique étoit, à leur avis, un assez bon Poëte dramatique.
Cette Limonadiere, que je n'avois pas aimée, mais que avois connue et fréquentée, et qui avoit fini par me mettre dans le plus grand embarras, sut que j'étois à Udine, et voulut me voir. Elle étoit mariée à un homme de son état, et elle m'écrivit une lettre fort drôle et fort engageante. J'allai la voir à une heure marquée; je la trouvai fort changée: notre conversation ne fut pas longue; je n'avois pas envie de lui sacrifier mes nouvelles inclinations; je ne la revis qu'une seconde fois, et pas plus.
J'avois d'ailleurs mes occupations théâtrales qui m'intéressoient: je desirois faire quelque chose d'extraordinaire pour l'ouverture du Spectacle dans la Capitale. Je ruminois plusieurs idées dans ma tête; j'en communiquai quelques-unes au Directeur. Voici celle à laquelle nous nous arrêtâmes, et que je mis en exécution.
C'étoit un divertissement partagé en trois parties différentes, et qui remplissoit les trois actes d'une représentation ordinaire.
La premiere partie n'étoit qu'une assemblée littéraire. Tous les Acteurs, au lever de la toile, se trouvoient assis, et rangés sur la scene en habillement bourgeois. Le Directeur ouvroit l'assemblée par un discours sur la Comédie et sur les devoirs des Comédiens, et finissoit par complimenter le public. Les Acteurs, les Actrices récitoient chacun à leur tour des couplets, des sonnets, des madrigaux analogues à leurs emplois, et les quatre masques qui étoient pour lors à visage découvert, débitoient des vers dans les différens langages des personnages qu'ils représentoient.
La seconde partie étoit remplie par une Comédie à canevas en un acte, dans laquelle je tâchai de donner des situations intéressantes aux Acteurs nouveaux.
La troisieme partie contenoit un Opéra Comique en trois actes, et en vers, intitulé la Fondation de Venise.
Cette petite Piece qui étoit peut-être le premier Opéra Comique qui parut dans l'Etat Vénitien, se trouve dans le vingt-huitieme volume de mes œuvres, de l'édition de Turin.
Imer étoit très-content de mon idée, et de la maniere dont je l'avois exécutée. Toute la compagnie en étoit enchantée; il n'y avoit que la Bastona qui se plaignoit de moi, et disoit tout haut que dans la charlatannerie de mon ouverture, j'avois fait pour Madame Ferramonti, qui n'étoit qu'une seconde Actrice, une Piece de vers que les premieres avoient le droit de réclamer, et excitoit la Romana à s'en plaindre aussi, et à me tracasser.
Hélas! la pauvre Ferramonti ne fut pas long-tems en but à la jalousie de ses camarades. Elle étoit enceinte, le tems de ses couches s'annonça par des préliminaires fâcheux; la nature se refusa à son soulagement; la sage-femme se trouva embarrassée. On fit venir un accoucheur, l'enfant étoit mal tourné; on en vint à l'opération césarienne. Le fils étoit mort, et la mere le suivit de près.
Le mari vint me voir, il étoit désolé, je l'étois autant que lui; je ne pouvois plus me souffrir dans cette ville, je ne pouvois plus soutenir l'aspect de ces femmes qui jouissoient de mon affliction, et sous prétexte d'aller rejoindre ma mere qui étoit de retour de Modene, je partis sur-le-champ pour Venise.
Mon retour à Venise. - Entretien avec ma mere. - Démarche de mon ancienne prétendue. - Retour de la Troupe de mes Comédiens à Venise. - Mon attachement pour Madame Passalacqua, ses infidélités.
Arrivé a Venise, je n'eus rien de plus pressé que d'aller embrasser ma mere; nous eûmes une longue conversation ensemble: mes fonds de Venise étoient dégagés; mes rentes de Modene étoient augmentées; mon frere étoit rentré dans le service; ma mere auroit desiré que j'eusse repris mon état d'Avocat.
Je lui fis voir que l'ayant une fois quitté et ayant reparu dans ma Patrie sous un aspect tout-à-fait différent, je ne pouvois plus me flatter de cette confiance que j'avois déméritée, et que la carriere que je venois d'entreprendre étoit également honorable, et pouvoit devenir lucrative.
Ma mere, les larmes aux yeux, dit qu'elle n'osoit pas s'opposer à mes volontés, qu'elle avoit à se reprocher de m'avoir détourné de la route des Chancelleries Criminelles, et me connoissant de la raison, de l'honneur et de l'activité, elle me laissoit maître de choisir mon état.
Je la remerciai, je l'embrassai une seconde fois, et de propos en propos je vins à l'article de Madame St*** et de sa fille, bien content que le mépris que ces dames avoient marqué pour l'emploi que j'avois entrepris, m'eut délivré de toute crainte et de tout embarras.
Point du tout, dit ma mere, tu te trompes; Madame St*** et sa fille sont venues me voir; elles m'ont comblée de politesses, elles m'ont parlé de toi comme d'un garçon estimable, admirable; l'éclat de tes succès t'a rendu digne de leur considération, et elles comptent toujours sur toi.
Non, dis-je, avec le ton de l'indignation; non, ma mere, je ne me lierai jamais avec une famille qui m'a trompé, qui m'a ruiné, et qui a fini par me dédaigner.
Ne t'inquiété pas, répliqua ma mere; elles ne sont pas plus riches qu'elles ne l'étoient; j'irai leur rendre visite, je leur parlerai raison, et je prends sur moi de te dégager. Parlons d'autres choses, continua-t-elle, conte-moi ce que tu as fait pendant le tems de notre séparation: je la satisfis sur-le-champ, je lui fis part de plusieurs de mes aventures, et j'en cachai une grande partie; je la fis rire, je la fis pleurer, je la fis trembler. Nous dinâmes avec nos parens: ma mere à table vouloit redire à la société ce que j'avois conté; elle s'embrouilloit, elle ne faisoit qu'exciter la curiosité: j'étois obligé de recommencer; la gaieté du repas m'animoit; je disois des choses que je n'avois pas dites à ma mere: ah! fripon, disoit-elle de tems en tems, tu ne m'avois pas dit cela, ni ceci, ni cet autre: je passai ma journée fort agréablement, et je fis rire à mes dépens de vieux oncles et de vieilles tantes qui ne rioient jamais: j'avois plus de grace à causer peut-être que je n'en ai peur écrire.
Vers la fin du mois de Septembre, la Troupe de mes Comédiens revint à la Capitale: nous fîmes les répétitions de notre ouverture, et le 4 d'Octobre elle parut sur la scene.
La nouveauté surprit; l'assemblée littéraire fut goûtée, la Comédie en un acte tomba, à cause de l'Arlequin qui ne plaisoit pas; l'Opéra Comique fut bien reçu et resta an Théâtre.
Le Directeur étoit satisfait que la partie musicale l'emportât; mais il n'étoit pas trop content de Madame Passalacqua: sa voix étoit fausse, sa maniere étoit monotonne, et sa phisionomie grimaciere: Imer vouloit soutenir les Intermedes, et un Musicien de l'Orchestre lui en proposa le moyen.
Ce vieux bon-homme de soixante ans venoit d'épouser une demoiselle qui n'en avoit que dix-huit: il la faisoit chanter avec son violon; la jeune personne avoit des dispositions: Imer la trouva à son gré, me pria d'en prendre soin, et je m'en chargeai avec plaisir, la trouvant très-jolie et très-docile.
Madame Passalacqua en devint jalouse; elle avoit fait des tentatives inutiles à Udine pour me gagner, et elle ne manqua pas son coup à Venise.
Je reçois un jour un billet de sa main, par lequel elle me prie d'aller chez elle sur les cinq heures du soir: je ne pouvois pas honnêtement m'y refuser: j'y vais; elle me reçoit dans un ajustement de Nymptie de Cythere, me fait asseoir sur un canapé auprès d'elle, et me dit les choses du monde les plus flatteuses et les plus galantes: je la connoissois, j'étois sur mes gardes, et je soutenois la conversation avec une contenance héroïque. D'ailleurs je ne l'aimois pas; elle étoit maigre, elle avoit les yeux verds, et beaucoup de fard couvroit son teint pâle et jaunâtre.
Madame Passalacqua, ennuyée de mon indifférence, fit jouer tous les ressorts de son adresse: est-il possible, me dit-elle d'un ton passionné, que de toutes les femmes de cette Troupe, je sois la seule qui ait le malheur de vous déplaire? Je sais me rendre justice, j'ai su respecter le mérite tant que je vous ai vu attaché à Madame Ferramonti; mais vous voir préférer actuellement une jeunesse stupide, une femme sans talent, sans éducation, cela est honteux pour vous, et c'est humiliant pour moi. Hélas! je n'aspire pas au bonheur de posséder votre cœur; je n'ai pas assez de mérite pour m'en flatter; mais je suis Comédienne, je n'ai pas d'autre état, je n'ai pas d'autre ressource; jeune, sans expérience, j'ai besoin d'exercice, de Conseil, de protection: si j'avois le bonheur de plaire à Venise, ma réputation seroit établie, et ma fortune seroit assurée; vous pourriez contribuer à mon bonheur; avec votre talent, avec votre intelligence, en sacrifiant vos instans perdus pour moi, vous pourriez me rendre heureuse, mais vous m'abandonnez, Vous me méprisez. Ciel! que vous ai-je fait? (et quelques larmes s'échappoient de ses yeux). J'avoue que son discours m'avoit attendri, et ses larmes acheverent ma défaite: je lui promis mon assistance, mes soins, mes bons offices; elle n'étoit pas contente; elle vouloit le sacrifice total de la femme du Musicien: cette proposition me révolta; je lui dis que c'étoit trop vouloir, et je voulois m'en aller.
Madame Passalacqua m'arrête, prend le ton de la gaieté, regarde en l'air, trouve le tems fort beau, et me propose d'aller prendre le frais avec elle dans une gondole, qu'elle avoit fait venir à sa rive; je refuse: elle en rit, elle insiste, et prend mon bras et m'entraîne: comment faire pour ne pas la suivre?
Nous entrons dans cette voiture, où l'on est aussi commodément que dans le boudoir le plus délicieux. Nous allons gagner le large de la vaste Lacune qui environne la ville de Venise. Là notre adroit Gondolier ferme le petit rideau de derriere, fait de sa rame le gouvernail de la gondole, et la laisse aller doucement an gré du reflux de la mer.
Nous causâmes beaucoup, gaiement, agréablement, et au bout d'un certain tems la nuit nous paroissoit avancée, et nous ne savions pas où nous étions. Je veux regarder à ma montre; il faisoit trop sombre pour y voir: j'ouvre le petit rideau de la poupe; je demande au Gondolier l'heure qu'il étoit; je n'en sais rien, Monsieur, me dit-il, mais je crois, si je ne me trompe pas, que c'est l'heure du berger. Allons, allons, lui dis-je, au logis de Madame. Le Gondolier reprend sa rame; il tourne la proue de sa gondole du côté de la Ville, et nous chante en chemin faisant la strophe vingt-sixieme du seizieme chant de la Jérusalem délivrée.
Nous entrâmes chez Madame Passalacqua à dix heures et demie du soir: on nous servit un petit souper délicieux; nous soupâmes tête-à-tête; je la quittai à minuit, et je partis très-décidé à lui tenir compte des politesses dont elle m'avoit comblé.
En attendant que ma mere trouvât un appartement convenable pour me loger avec elle, je demeurois toujours chez le Directeur de la compagnie. Le lendemain de la soirée singulière dont je viens de parler, je vis mon hâte, et je lui dis que le caractere farouche et jaloux du vieux Musicien m'avoit dégoûté, et je le priai de me dispenser des soins dont il m'avoit chargé pour la jeune femme. Je crayonnai ensuite un Intermede pour Madame Passalacqua, et j'allai la voir, et lui lire les premieres épreuves de ma reconnoissance.
Dans ces entrefaites on mit sur la scene Griselda. Cette Tragédie fut reçue du public comme un ouvrage nouveau; elle plut beaucoup, elle attira beaucoup de monde. La Romana qu'on voyoit sur ce Théâtre depuis vingt ans, fut applaudie dans cette Piece comme dans son début. Casali intéressoit et faisoit pleurer, et Vitalba qui avoit si bien soutenu le rôle de Bélisaire, se surpassa dans celui de Gualtiero.
Vitalba me ramene tout de suite sur le compte de Madame Passalacqua. C'étoit un bel homme, un excellent Comédien, grand coureur de femmes, et fort libertin. Il en vouloit à la Passalacqua, et il ne falloit pas se donner beaucoup de peine pour la subjuguer. Je sus que, pendant que je fréquentois cette Comédienne, Vitalba la voyoit aussi; je sus qu'ils avoient fait des parties ensemble, j'en fus piqué, et je m'éloignai de cette femme infidelle, sans daigner m'en plaindre, et sans lui dire le motif de ma retraite.
Elle m'écrivit une lettre touchante et plaintive; je lui détaillai dans ma réponse tout ce que j'avois à dire de ses mauvais procédés. Elle m'en envoya une seconde, dans laquelle sans nier, et sans s'excuser, elle me prioit en grace d'aller chez elle pour une seule fois, pour la derniere fois, ayant quelque chose à me confier qui regardoit son état, son honneur et sa vie.
Irai-je? ou n'irai-je pas? Je balançai pendant quelque tems; mais enfin, soit par curiosité, soit par besoin d'exhaler ma rage, je pris le parti d'y aller.
J'entre après m'être fait annoncer, et je la trouve étendue sur un canapé, la tête appuyée sur un oreiller; je la salue, elle ne me dit rien; je lui demande ce qu'elle avoit à me dire, elle ne me répond pas; le feu me monte au visage, la colere m'enflamme et m'aveugle, je laisse un libre cours à mon ressentiment, et sans aucun ménagement, je l'accable de tous les reproches qu'elle méritoit. La Comédienne ne disoit mot; elle essuyoit de tems en tems ses yeux; je craignois ces larmes insidieuses, et je voulois partir. Allez, Monsieur, me dit-elle avec une voix tremblante, mon parti est pris, vous aurez de mes nouvelles dans peu d'instans. Je ne m'arrête pas à ces mots vagues, je prends le chemin de la porte; je me retourne pour lui dire adieu, je la vois le bras levé, et un stilet à la main tourné contre son sein. Cette vue m'effraye, je perds la tête; je cours, je me jette à ses pieds, j'arrache le couteau de sa main, j'essuye ses larmes, je lui pardonne tout, je lui promets tout, je reste; nous dînons ensemble, et... nous voilà comme auparavant.
J'étois content de ma victoire, je bénissois le moment où je m'étois retourné en sortant; j'etois amoureux, je l'aimois de bonne foi; j'étois convaincu qu'elle m'aimoit aussi. Je cherchois des raisons pour excuser sa faute; Vitalba l'avoit surprise, elle en étoit repentante, elle avoit renoncé à Vitalba à jamais, pour jamais... et au bout de quelques jours je sus, à n'en pouvoir douter, que Madame Passalacqua et M. Vitalba avoient dîné et soupé ensemble, et qu'ils s'étoient moqués de moi.
Mon Festin de Pierre sous le titre de Don Jouan Tenorio, ou le Dissolu. - Vengeance complette contre la Passalacqua. - Mon voyage pour Genes. - Coup-d'œil de cette ville. - Origine de la Loterie Royale. - Mon mariage. - Mon retour à Venise.
Ce n'est pas pour orner mes Mémoires ni pour recevoir les complimens sur ma bonhomie, que j'ai détaillé, dans le Chapitre précédent, les infidélités d'une Comédienne qui m'a trompé; mais ayant inséré cette anecdote dans un Ouvrage qui a servi à me venger, j'ai cru nécessaire de faire précéder l'historique de l'épisode avant de parler du sujet principal.
Tout le monde connoît cette mauvaise Piece espagnole, que les Italiens appellent il Convitato di Pietra, et les François le Festin de Pierre.
Je l'ai toujours regardée, en Italie, avec horreur, et je ne pouvois pas concevoir comment cette farce avoit pu se soutenir pendant si long-tems, attirer le monde en foule, et faire les délices d'un pays policé.
Les Comédiens Italiens en étoient étonnés eux-mêmes; et soit par plaisanterie, soit par ignorance, quelques-uns disoient que l'Auteur du Festin de Pierre avoit contracté un engagement avec le diable pour le soutenir.
Je n'aurois jamais songé à travailler sur cet Ouvrage; mais ayant appris assez de françois pour le lire, et voyant que Moliere et Thomas Corneille s'en étoient occupés, j'entrepris aussi de régaler ma Patrie de ce même sujet, afin de tenir parole au diable avec un peu plus de décence.
Il est vrai que je ne pouvois pas lui donner le même titre; car, dans ma Piece, la Statue du Commendeur ne parle pas, ne marche pas, et ne va pas souper en ville; je l'ai intitulée Don Jouan, comme Moliere, en y ajoutant, ou le Dissolu.
Je crus ne devoir pas supprimer la foudre qui écrase Don Jouan, parce que l'homme méchant doit être puni; mais je ménageai cet événement de maniere que ce pouvoit être un effet immédiat de la colere de Dieu, et qu'il pouvoit provenir aussi d'une combinaison de causes secondes, dirigées toujours par les loix de la Providence.
Comme dans cette Comédie, qui est en cinq actes et en vers blancs, je n'avois pas employé d'Arlequin, ni d'autres masques italiens, je remplaçai le comique par un Berger et une Bergere, qui, avec Don Jouan, devoient faire reconnoître la Passalacqua, Goldoni et Vitalba; et rendre, sur la scene, l'inconduite de l'une, la bonne foi de l'autre, et la méchanceté du troisieme.
Elise étoit le nom de la Bergere, et la Passalacqua s'appelloit Elisabeth. Le nom de Carino, que je donnai au Berger, étoit, à une lettre près, le diminutif de mon nom de Baptême (Carlino); et Vitalba, sous le nom de Don Jouan, rendoit exactement son vrai caractere.
Je faisois tenir à Elise les mêmes propos dont la Passalacqua s'étoit servie pour me tromper; elle faisoit usage, sur la scene, de ces larmes et de ce couteau dont j'avois été la dupe; et je me vengeois de la perfidie de la Comédienne, en même-tems que Carino se vengeoit de sa Bergéré infidelle.
La Piece étoit faite; il s'agissoit de la faire jouer: j'avois prévu que la Passalacqua ne consentiroit pas à se jouer elle-même. J'avois prévenu le Directeur et le Propriétaire du Théâtre; je fis distribuer les rôles sans faire la lecture de la Piece. La Passalacqua, qui ne tarda pas à reconnoître le personnage qu'elle devoit soutenir, alla s'en plaindre au Directeur, et à son Excellence Grimani. Elle protesta, à l'un et à l'autre, qu'elle ne paroîtroit pas dans cette Piece, à moins que l'Auteur n'y fît des changemens essentiels; mais il fut décidé qu'elle joueroit le rôle d'Elise comme il étoit, ou qu'elle sortiroit de la compagnie.
La Comédienne, effrayée de l'alternative, prit son parti en brave, apprit son rôle, et le rendit en perfection.
A la premiere représentation de cette Piece, le public accoutumé à voir, dans le Convitato di Pietra, Arlequin se sauver du naufrage à l'aide de deux vessies, et Don Jouan sortir à sec des eaux de la mer, sans avoir dérangé sa coëffure, ne savoit pas ce que vouloit dire cet air de que l'Auteur avoit donné à une ancienne bouffonnerie. Mais comme mon aventure avec la Passalacqua et Vitalba étoit connue de beaucoup de monde, l'anecdote releva la Piece; on y trouva de quoi s'amuser, et on s'apperçut que le comique raisonné étoit préférable au comique trivial.
Mon Don Jouan augmentoit tous les jours de crédit et de concours; on le donna, sans interruption, jusqu'au Mardi gras, et il fit la clôture du Théâtre.
Malgré son succès, il n'étoit pas destiné à paroître dans le Recueil de mes Ouvrages, non plus que mon Bélisaire ; car c'étoit bien le Festin de Pierre reformé; mais cette réforme n'étoit pas celle que j'avois en vue; ayant retrouvé cette Piece imprimée à Bologne, et horriblement maltraiée, je consentis à lui donner place dans mon Théâtre, d'autant plus que si mon Don Jouan n'étoit pas du nouveau genre que je m'étois proposé, il n'étoit pas non plus de celui que j'avois rejetté.
La compagnie de Saint-Samuel devoit aller cette année passer le printems à Genes, et l'été à Florence; et comme il y avoit six Acteurs nouveaux dans la Troupe, Imer crut ma présence nécessaire, et me proposa de m'y conduire avec lui.
Il s'agissoit d'aller voir deux des plus belles villes de l'Italie; je devois être défrayé de tout: l'occasion me paroissoit excellente: j'en parlai à ma mere; mes raisons étoient toujours bonnes avec elle, et je partis pour Genes avec le Directeur.
Notre voyage fut heureux; toujours du beau tems en traversant cette haute montagne que l'on appelle la Boquere , nous fûmes légerenient incommodés, plus de la chaleur du soleil que du froid de la saison.
Après avoir traversé le très-riche et très-délicieux village de Saint-Pierre d'Arena, nous découvrîmes Genes du côté de la mer. Quel spectacle charmant, surprenant! C'est un amplaitéâtre en demi cercle, qui, d'un côté, forme le vaste bassin du port, et s'éleve de l'autre par gradation sur la pente de la montagne avec des bâtimes immenses, qui semblent, de loin, placés les uns sur le autres, et se terminent par des terrasses, par des balustrades, ou par des jardins qui servent de toit aux différents habitations.
En face de ces rangées de palais, d'hôtels, et de logeimens bourgeois, les uns incrustés de marbre, les autres ornés de peintures, on voit les deux moles, qui forment l'embouchure du port: ouvrage digne des Romains, puisque les Génois, malgré la violence et la profondeur de la mer, vainquirent la nature qui s'opposoït à leur établissement.
En descendant du côté du Fanal pour gagner la porte de Saint-Thomas, nous vîmes cet immense Palais Doria, où trois Princes souverains furent logés en même tems; et nous allâmes ensuite à l'hôtellerie de Sainte-Marte, en attendant le logement qu'on devoit nous avoir destiné.
On tiroit la loterie ce jour-là, et j'avois envie d'aller voir cette cérémonie. La loterie, qu'on appelle en Italie il lotto di Genova, et à Paris la loterie royale de France, n'étoit pas encore établie à Venise. Il y avoit cependant des Receveurs cachés, qui prenoient pour les tirages de Genes, et j'avois une reconnoissance dans ma poche pour une mise que j'avois faite chez moi.
C'est à Genes que cette loterie a été imaginée, et ce fut le hasard qui en donna la premiere idée. Les Génois tirent au sort deux fois par an les noms des cinq Sénateurs qui doivent remplacer ceux qui sortent de charge. On connoît, à Genes, tous les noms de ceux qui sont dans l'urne, et qui peuvent sortir; les particuliers de la ville commencerent par dire entr'eux: je parie qu'au tirage prochain un tel sortira; l'autre disoit: je parie pour tel autre, et le pari étoit égal.
Quelque tems après, il y eut des gens adroits qui tenoient une banque pour et contre, et donnoient de l'avantage aux mettans. Le Gouverneur le sut; les petites banques furent défendues; mais des fermiers se présenterent et furent écoutés. Voilà la loterie êtablie pour deux tirages; et quelque tems après, le nombre en fut augmenté.
Cette loterie est devenue aujourd'hui presque universelle: je ne dirai pas si c'est un bien ou si c'est un mal; je me mêle de tout sans décider de rien; et tâchant de voir les choses du côté de l'optimisme, il me paroît que la loterie de Genes est un bon revenu pour le Gouvernement, une occupation pour les désœuvrés, et une espérance pour les malheureux.
Pour mon compte, je trouvai, cette fois, la loterie charmante. Je gagnai un ambe de cent pistoles, dont j'étois fort content.
Mais j'eus à Genes un bonheur bien plus considérable, et qui fit le charme de ma vie: j'épousai une jeune personne, sage, honnête, charmante, qui me dédommagea de tous les mauvais tours que les femmes m'avoient joués, et me raccommoda avec le beau-sexe. Oui, mon cher Lecteur, je me suis marié, et voici comment.
Nous étions logés, le Directeur et moi, dans une maison attenante au Théâtre. J'avois vu, vis-à-vis les croisées de ma chambre, une jeune personne qui me paroissoit assez jolie, et dont j'avois envie de faire la connoissance. Un jour qu'elle étoit seule à sa fenêtre, je la saluai un peu tendrement; elle me fit une révérence, mais elle disparut sur-le- champ, et ne se laissa plus voir depuis.
Voilà ma curiosité et mon amour-propre piqués; je tâche de savoir quelles sont les personnes qui logent en face de mon appartement; c'est M. Conio, Notaire du College de Genes, et un des quatre Notaires députés à la banque de Saint-Georges, homme respectable, qui avoit de la fortune; mais qui ayant une famille très-nombreuse, n'étoit pas aussi aisé qu'il auroit dû l'être.
C'est bon: je veux faire connoissance avec M. Conio; je savois qu'Imer avoit des effets de cette banque, provenans des loyers des loges, et qu'il négocioit sur la place par des Agens de change; je le priai de me confier un de ces effets, ce qu'il fit sans aucune difficulté; et j'allai à Saint-Georges pour le présenter à M. Conio, et profiter de cette occasion pour sonder son caractere.
Je trouvai le Notaire entouré de monde: j'attendis qu'il fût seul; je m'approchai de son bureau, et je le priai de vouloir bien me faire payer la valeur de mon effet.
Ce brave homme me reçut très-poliment, mais il me dit que je m'y étois mal pris; que ces billets ne se payoient pas à la banque, mais que le premier Agent de change, ou le premier Négociant m'auroit donné mon argent sur-le-champ. Je lui fis mes excuses; j'étois étranger, j'étois son voisin... Je voulois lui dire bien des choses; mais l'heure étoit avancée, il me demanda la permission de fermer son bureau, et me dit que nous causerions chemin faisant.
Nous sortons ensemble, il me propose d'aller prendre une tasse de café, en attendant l'heure du dîné; j'accepte, car en Italie on prend dix tasses de café par jour. Nous entrons dans la boutique d'un Limonadier, et comme M. Conio m'avoit vu avec les Comédiens, il me demanda quels étoient les rôles que je jouois à la Comédie.
Monsieur, lui dis-je, votre question ne me choque point, quelqu'autre se seroit trompé comme vous. Je lui dis ce que j'étois et ce que je faisois; il me fit des excuses: il aimoit les Spectacles, il alloit à la Comédie, il avoit vu mes Pieces, il étoit enchanté d'avoir fait ma connoissance, et moi d'avoir fait la sienne. Nous voilà rapprochés; il venoit chez moi, j'allois chez lui; je voyois Mademoiselle Conio, je lui trouvois tous les jours plus d'agrémens et plus de mérite. Au bout d'un mois je demandai moi-même à M. Conio sa fille.
Il n'en fut pas surpris, il s'étoit apperçu de mon inclination, et ne craignoit pas un refus de la part de la Demoiselle; mais sage et prudent comme il étoit, il me demanda du tems, et il fit écrire au Consul de Genes à Venise, pour avoir des informations sur mon compte. Je trouvai le délai raisonnable, j'écrivis aussi en même-tems; je fis part à ma mere de mon projet, je lui fis le portrait de ma prétendue, et je la priai de m'envoyer sur-le-champ tous les certificats qui sont nécessaires dans de pareilles occasions.
Au bout d'un mois je reçus le consentement de ma mere, et les papiers requis; quelques jours après, M. Conio reçut de son côté les témoignages les plus flatteurs en ma faveur. Notre mariage fut fixé pour le mois de Juillet, la dot fut convenue, et le contrat signé.
Imer ne savoit rien de tout cela; j'avois des raisons pour craindre qu'il ne traversât mon projet; il en fut très- fâché, il devoit aller à Florence pour y passer l'été, il fallut bien qu'il y allât sans moi.
Je promis cependant que je ne quitterois pas la compagnie, que je travaillerois pour Venise, que je m'y trouverois à tems; et je tins parole.
Me voilà l'homme du monde le plus content et le plus heureux; mais pouvois-je avoir une satisfaction sans qu'elle fut suivie d'un désagrément? La premiere nuit de mon mariage, la fievre me prend, et la petite vérole que j'avois eue à Rimini dans ma premiere jeunesse, vient m'attaquer pour la seconde fois.
Patience! heureusement elle n'étoit pas dangereuse, et je ne devins pas plus laid que je n'étois. Ma pauvre femme a bien pleuré au chevet de mon lit, elle étoit ma consolation, et l'a toujours été.
Nous partîmes, enfin, mon épouse et moi, pour Venise, au commencement de Septembre. Oh ciel! que de larmes répandues, quelle séparation cruelle pour ma fenme! elle quittoit tout d'un coup pere, mere, des freres, des sœurs, des oncles, des tantes... Mais elle partoit avec son mari.
Mon retour à Venise avec ma femme. - Renaud de Montauban, Tragi-Comédie. - Henri, Roi de Sicile, Tragédie. - Arrivée à Venise du fameux Arlequin Sacchi et de sa fimille. - Leur entrée dans la Troupe de Saint-Samuel. - Acquisitions d'autres bons sujets. - L'Homme accompli, Comédie de caractere, en trois actes, partie écrite, partie à canevas.
Arrivé à Venise avec ma femme, je la présentai à ma mere et à ma tante: ma mere fut enchantée de la douceur de sa bru, et ma tante qui n'étoit pas aisée, fit de sa niece sa bonne amie. C'étoit un ménage charmant: la paix y régnoit; j'étois l'homme du monde le plus heureux.
Mes Comédiens qui ne comptioient plus sur moi, furent contens de me revoir, d'autant plus que je leur avois apporté une Piece nouvelle; c'étoit Renaud de Montauban, Tragi-Comédie en cinq Actes et en vers.
Ce sujet étoit du fond de la Comédie Italienne, et aussi mauvais que l'ancien Bélisaire et le Festin de Pierre. Je l'avois purgé des défauts grossiers qui le rendoient insupportable, et je l'avois rapproché, autant qu'il m'avoit été possible, du genre de l'ancienne Chevalerie, et de la décence convenable dans une Piece où paroissoit Charle- magne.
Le public habitué à voir Renaud, Paladin de France, paroître au Conseil de guerre enveloppé dans un manteau déchiré, et Arlequin défendre le château de son Maître, et terrasser les soldats de l'Empereur à coups de marmites et pots cassés, vit avec plaisir le Héros calomnié soutenir sa cause avec dignité, et ne fut pas mécontent de voir supprimer des bouffonneries déplacées.
Renaud de Montauban fut applaudi, moins cependant que Bélisaire et le Festin de Pierre: il acheva la saison de l'Automne; mais je ne l'avois pas destiné à la presse, et j'ai été fâché de le voir imprimé dans l'Edition de Turin.
Ma premiere année de mariage m'avoit occupé, de maniere que je n'avois pas eu le tems de travailler pour la Comédie. Il falloit pourtant donner quelque nouveauté pour l'hiver: j'avois ébauché à Genes une Tragédie; j'en étois au quatrieme Acte; je fis bien vite le cinquieme; je changeai, je corrigeai à la hâte, et je mis les Acteurs en état de donner cette Piece au commencement du Carnaval. Henri, Roi de Sicile, étoit le titre de ma Piece; j'avois pris le sujet dans le Mariage de vengeance, nouvelle insérée dans le Roman de Giblas. C'est le même fond que celui de Blanche et Guiscard, de M. Saurin de l'Académie Françoise; la Trogédie de l'Auteur François n'a pas eu un grand succès, la mienne non plus; il faut dire qu'il est des sujets malheureux, qui ne sont pas faits pour réussir.
La reprise de Renaud dédommagea les Comédiens, et fit la clôture de l'année comique.
Pendant le Carême on fit dans cette Troupe des changemens qui la porterent, autant qu'il étoit possible, au point de sa perfection.
On avoit changé la Bastona mere contre la Bastona sa fille, excellente Actrice, pleine d'intelligence, noble dans le sérieux, et très-agréable dans le comique. Vitalba, premier Amoureux, avoit été remplacé par Simonetti , moins brillant que son prédécesseur, mais plus décent, plus instruit et plus docile. On avoit fait l'acquisition du Pantalon Golinetti, médiocre avec son masque, mais supérieur pour jouer les jeunes Vénitiens à visage découvert; et celle du Docteur Lombardi, qui par sa figure et pour son talent étoit le premier dans cet emploi; et pour mon bonheur, la Passalacqua avoit été renvoyée: je n'avois pas de rancune; mais je me portois mieux quand je ne la voyois pas.
Ce qui rendit cette Compagnie completement bonne, fut le fameux Arlequin Sacchi dont la femme jouoit passablement les secondes Amoureuses, et la sœur, à quelque charge près, soutenoit fort bien l'emploi de Soubrette.
Me voilà, me disois-je à moi-même, me voilà à mon aise; je puis donner l'essor à mon imagination; j'ai assez travaillé sur de vieux sujets, il faut créer, il faut inventer; j'ai des Acteurs qui promettent beaucoup; mais pour les employer utilement, il faut commencer par les étudier: chacun a son caractere naturel; si l'Auteur lui en donne un à représenter qui soit analogue au sien, la réussite est presque assurée. Allons, continuois-je dans mes réflexions; voici le moment peut-être d'essayer cette réforme que j'ai en vue depuis si long-tems. Oui, il faut traiter des sujets de caractere; c'est-là la source de la bonne Comédie: c'est par là que le grand Moliere a commencé sa carriere, et est parvenu à ce degré de perfection, que les anciens n'ont fait que nous indiquer, et que les modernes n'ont pas encore égalé, Avois-je tort de m'encourager ainsi? Non: car la Comédie étoit mon penchant, et la bonne Comédie devoit être mon but: j'aurois eu tort, si mon ambition eût été de me rapprocher des Maîtres de l'art; mais je n'aspirois qu'à réformer les abus du Théâtre de mon pays, et il ne falloit pas être bien savant pour y parvenir.
D'après ces raisonnemens qui me paroissoient justes, je cherchai dans la compagnie l'Acteur qui m'auroit le mieux convenu pour soutenir un caractere nouveau et agréable en même tems.
Je m'arrêtai au Pantalon Golinetti, non pas pour l'employer avec un masque qui cache la phisionomie, et empêche que l'Acteur sensible fasse paroître sur son visage la passion qui l'anime; mais je faisois grand cas de sa maniere d'être dans les sociétés où je l'avois vu et sondé; je crus que je pouvois en faire un excellent personnage, et je ne me trompai pas.
Je fis donc une Comédie de caractere dont le titre étoit Momolo Cortesano. Momolo en Vénitien est le diminutif de Girolamo (Jérôme). Mais il n'est pas possible de rendre l'adjectif Cortesan par un adjectif françois. Ce terme Cortesan n'est pas une corruption du mot courtisan; mais il dérive plutôt de courtoisie et courtois . Les Italiens eux-mêmes ne connoissent pas généralement le Cortesan Vénitien; aussi quand je donnai cette Piece à la presse, je l'intitulai l'Uomo di Mondo; et si je devois la mettre en François, je crois que le titre qui pourroit lui convenir, seroit celui de l'Homme accompli.
Voyons si je me trompe. Le véritable Cortesan Vénitien est un homme de probité, serviable, officieux. Il est généreux sans profusion, il est gai sans être étourdi, il aime les femmes sans se compromettre, il aime les plaisirs sans se ruiner, il se mêle de tout pour le bien de la chose, il préfere la tranquillité, mais il ne souffre pas la supercherie, il est affable avec tout le monde, il est ami chaud, protecteur zélé. N'est-ce pas là l'Homme accompli?
Y en a-t-il beaucoup, me dira-t-on, de ces Cortesani à Venise? Oui, il n'y en a pas mal. Il y en a qui possedent plus ou moins les qualités de ce caractere; mais quand il s'agit de l'exécuter aux yeux du public, il faut toujours le montrer dans toute sa perfection.
Pour qu'un caractere quelconque fasse plus d'effet sur la scene, j'ai cru qu'il falloit le mettre en contraste avec des caractercs opposés; j'ai introduit dans ma Picce un mauvais sujet Vénitien qui trompe des Etrangers; mon Cortesan , sans connoître les personnes trompées, les garantit des pieges et démasque le fripon. Arlequin n'est pas dans cette Piece un valet étourdi; c'est un fainéant qui prétend que sa sœur entretienne ses vices; le Cortesan donne un état à la fille, et met le paresseux dans la nécessité de travailler pour vivre; enfin l'Homme accompli acheve sa brillante carriere par se marier, et choisit parmi les femmes de sa connoissarice celle qui a le moins de prétentions et le plus de mérite.
Cette Piece eut un succès admirable; j'étois content. Je voyois mes compatriotes revenir de l'ancien goût de la farce, je voyois la réforme annoncée, mais je ùe pouvois pas encore m'en vanter. La Piece n'étoit pas dialoguée.
Il n'y avoit d'écrit que le rôle de l'Acteur principal. Tout le reste étoit à canevas: j'avois bien concerté les Acteurs; mais tous n'étoient pas en état de remplir le vuide avec art. On n'y voyoit pas cette égalité de style, qui caracterise les Auteurs: je ne pouvois pas tout réformer à la fois sans choquer les Amateurs de la Comédie nationale, et j'attendois le moment favorable pour les attaquer de front avec plus de vigueur et plus de sureté.
Gustave Vasa, Opéra. - Courte digression sur Metastasio et Apostolo Zeno. - Entretien avec ce dernier sur mon Opéra. - Le Prodigue, Comédie en trois Actes, partie écrite, partie à canevas. - Plaintes des Acteu rs à masque. - Les trente-deux Infortunes d'Arlequin, Comédie à canevas. - Quelques mots sur l'Arlequin Sacchi. - La Nuit Critique, Comédie à canevas.
Mes Comédiens devoient aller jouer en Terre-Femie pendant le printems et l'été; ils auroient desiré que je les eusse suivis; mais je leur disois, avec l'Evangile, uxorem duxi, je suis marié.
Une autre raison me confrrna dans le dessein de rester à Vcnise. Le propriétaire de ce même Théâtre, où l'on donnoit mes Comédies en automne et en hiver, m'avoit chargé d'un Drame musical, pour la foire de l'Ascension de la même année. Je fis cet Ouvrage pendant le Carême, et j'étois bien aise de présider à l'execution.
Le célebre Galuppi, dit le Buranello, devoit le mettre en musique, et paroissoit content de mon Drame; mais, avant que de le lui livrer, me rappellant combien je m'étois trompé dans mon Amalassunta, et ne sachant pas si j'avois exactement rempli toutes les extravagances que l'on appelle des regles dans le Drame musical, je voulois le faire voir et me consulter avant que de l'exposer an public, et je choisis pour mon juge et pour mon conseil Apostolo Zeno, qui étoit de retour de Vienne, où il avoit été remplacé par l'Abbé Metastasio.
L'Italie doit à ces deux illustres Auteurs la réforime de l'Opéra. On ne voyoit, avant eux, dans ces Spectacles harmonieux, que des Dieux, et des diables, et des machines, et du merveilleux. Zeno crut le premier que la Tragédie pouvoit se représenter en vers lyriques sans la dégrader, et qu'on pouvoit la chanter sans l'affoiblir. Il exécuta son projet de la maniere la plus satisfaisante pour le public, et la plus glorieuse pour lui-même et pour sa nation.
On voit, dans ses Opéras, les héros tels qu'ils étoient, du moins tels que les historiens nous les représentent; les caracteres vigoureusement soutenus, ses plans toujours bien conduits; les épisodes toujours liés à l'unité de l'action: son style étoit mâle, robuste, et les paroles de ses airs adaptées à la musique de son tems.
Métastase, qui lui succéda, mit le comble à la perfection dont la Tragédie lyrique étoit susceptible: son style pur et élégant; ses vers coulans et harmonieux; une clarté admirable dans les sentimens; une facilité apparente qui cache le pénible travail de la précision; une énergie touchante dans le language des passions, ses portraits, ses tableaux, ses descriptions riantes, sa douce morale, sa philosophie insinuante, ses analyses du cœur humain, ses connoissances répandues sans profusion, et appliquées avec art; ses airs, ou, pour mieux dire, ses madrigaux incomparables, tantôt dans le goût de Pindare, tantôt dans celui d'Anacréon, l'ont rendu digne d'admiration, et lui ont mérité la couronne immortelle que les Italiens lui ont déférée, et que les étrangers ne refusent pas de lui accorder.
Si j'osois faire des comparaisons, je pourrois avancer que Métastase a imité Racine par son style, et que Zeno a imité Corneille par sa vigueur. Leurs génies tenoient à leurs caracteres. Métastase étoit doux, poli, agréable dans la société. Zeno étoit sérieux, profond et instructif.
C'est donc à ce dernier que je m'étois adressé pour faire analyser mon Gustave.
Je trouvai ce savant respectable dans son cabinet; il me reçut très-honnêtement; il écouta la lecture de mon Drame sans prononcer un seul mot. Je m'appercevois cependant, à ses mines, des bons et des mauvais endroits de mon ouvrage. La lecture finie, je lui demandai son avis. C'est bon, me dit-il en me prenant par la main, c'est bon pour la foire de l'Ascension.
Je compris ce qu'il vouloit dire, et j'allois déchirer mon Drame; il m'en empêcha, et, me dit, pour me consoler, que mon Opèra, tout médiocre qu'il étoit, valoit cent fois mieux que tous ceux dont les Auteurs, sous le prétexte d'imitation, ne faisoient que copier les autres. Il n'osa pas se nommer; mais je connoissois les plagiaires dont il avoit raison de se plaindre.
Je profitai des corrections muettes de M. Zeno; je fis quelques changemens dans les endroits qui avoient fait grincer les dents à mon juge; mon Opéra fut donné; les Acteurs étoient bons, la musique excellente, les ballets fort gais; on ne disoit rien du Drame; je me tenois derriere le rideau; je partageois les applaudissemens qui ne m'appartenoîent pas; et je disois, pour me tranquilliser, ce n'est pas mon genre; j'aurai ma revanche à ma premiere Comédie.
L'ouvrage que j'avois préparé pour le retour de mes Comédiens, étoit il Prodigo, le Prodigue.
Je n'avois pas cherché le sujet dans la classe des vicieux, mais dans celle des ridicules. Mon Prodigue n'étoit ni joueur, ni débauché, ni magnifique. Sa prodigalité n'étoit qu'une foiblesse; il ne donnoit que pour le plaisir de donner; le fond de son cœur étoit excellent; mais sa bonhomie et sa crédulité l'exposoient au dérangement et à la dérision.
C'étoit un caractere nouveau; j'en connoissois les originaux, je les avois vus, et je les avois étudiés sur les bords de la Brenta, parmi les habitans de ces délicieuses et magnifiques maisons de campagne, où l'opulence éclate, et la médiocrité se ruine.
L'Acteur excellent qui avoit si bien soutenu le brillant personnage du Cortesan Vénitien, rendit en perfection le caractere lent et apathique de mon Prodigue.
J'avois donné à l'homme riche et foncierement libéral un Intendant frippon et adroit, qui, profitant des dispositions de son maître, lui fournissoit les occasions et les moyens de se satisfaire. Toutes les fois qu'il s'agissoit de trouver de l'argent, le bon-homme finîssoit par dire au traître qui le séduisoit: caro vecchio, fè vu; c'est-à- dire, mon ami, je me rapporte à vous, faites pour le mieux.
Cette phrase avoit fait reconnoître à Venise des personnes à qui elle étoit familiere. On vouloit deviner mon original; je l'avois pris dans la foule des gens riches, qui sont dupes de leur foiblesse et de leurs séducteurs: mais une anecdote de mon imagination fut trouvée malheureusement historique, et manqua de me perdre.
Mon Prodigue a pour maîtresse une jeune personne qui seroit devenue sa femme, s'il eût été moins dérangé: la Demoiselle se trouve chez lui avec ses parens sur la Brenta. L'amant lui offre une bague de prix; la Demoiselle la refuse. Quelque tems après, le Procureur du Prodigue arrive de Venise, et apporte la nouvelle à son client, qu'il a gagné son procès. L'homme généreux veut marquer sa joie et sa reconnoissance; il n'a pas d'argent, il donne, au Procureur, la bague: le Procureur l'accepte, et s'en va.
Dans ces entrefaites, on avoit conseillé à la Demoiselle d'accepter le bijou, afin que le jeune étourdi ne s'en défît pas mal-à-propos. Elle revient; elle parle de la bague; elle s'excuse de l'avoir refusée; elle ne pouvoit pas la recevoir sans permission, elle venoit de l'obtenir... Hélas! la bague n'étoit plus, l'amant est désolé, le Prodigue est au désespoir; quel trouble! quel embarras!
Voilà une de ces situations heureuses qui amusent les Spectateurs, qui produisent des révolutions et conduisent tout naturellement l'action à son dénouement.
On disoit que cette aventure étoit arrivée à un personnage de haute condition à qui j'avois en mon particulier beaucoup d'obligations. Heureusement, ce Seigneur ne s'en apperçut pas, ou fit semblant de ne pas s'en appercevoir. Il étoit intéressé à mes succès; ma Piece avoit bien réussi, et il en étoit content aussi bien que moi.
Mon Prodigue eut vingt représentations de suite à son début; le même bonheur le suivit à la reprise du carnaval, mais les personnages à masque se plaignoient de moi, je ne les faisois pas travailler; j'allois les perdre, et ils avoient des amateurs et des protecteurs qui les soutenoient.
D'après ces plaintes, et d'après la conduite que je m'étois proposée, je donnai, au commencement de l'année comique, une Comédie à sujet, intitulée les trente-deux Infortunes d'Arlequin. C'étoit Sacchi qui devoit l'exécuter à Venise; j'étois sûr qu'elle ne pouvoit pas manquer de réussir.
Cet Acteur, connu sur la scene Italienne sous le nom de Trouffaldin, ajoutoit aux graces naturelles de son jeu, une étude suivie sur l'art de la Comédie et sur les différens Théâtres de l'Europe.
Antonio Sacchi avoit l'imagination vive et brillante; il jouoit les Comédies de l'art, mais les autres Arlequins ne faisoient que se répéter, et Sacchi, attaché toujours au fond de la scene, donnoit, par ses saillies nouvelles et par des réparties inattendues, un air de fraîcheur à la Pièce, et ce n'étoit que Sacchi que l'on alloit voir en foule.
Ses traits comiques, ses plaisanteries n'étoient pas tirées du langage du peuple, ni de celui des Comédiens. Il avoit mis à contribution les Auteurs Comiques, les Poëtes, les Orateurs, les Philosophes; on reconnoissoit, dans ses impromptus, des pensées de Seneque, de Cicéron, de Montaigne; mais il avoit l'art d'approprier les maximes de ces grands hommes à la simplicité du balourd; et la même proposition, qui étoit admirée dans l'Auteur sérieux, faisoit rire sortant de la bouche de cet Acteur excellent.
Je parle de Sacchi comme d'un homme qui a existé, car à cause de son grand âge, il ne reste à l'Italie que le regret de l'avoir perdu, sans l'espérance de le voir remplacer.
Ma Piece soutenue par l'Acteur dont je viens de parler, eut tout le succès qu'une Comédie à sujet pouvoit avoir. Les amateurs des masques et des canevas étoient contens de moi. Ils trouverent que dans mes trente-deux Infortunes il y avoit plus de conduite et de sens commun, que dans les Comédies de l'art.
J'observai que ce qui avoit plu davantage dans ma Piece, c'étoit les événemens que j'avois accumulés les uns sur les autres; je profitai de la découverte, et je donnai quinze jours après une seconde Comédie dans le même genre, et bien plus chargée de situations et d'événemens, puisque j'avois intitulée la Nuit Critique, ou les cent quatre Evénemens dans la même nuit.
Cette Piece pouvoit s'appeller l'épreuve des Comédiens, car elle étoit si compliquée et si finement travaillée, qu'il n'y falloit pas moins que les Acteurs auxquels je la confiai pour la pouvoir exécuter d'une maniere aussi exacte, et avec tant de facilité.
J'en vis l'expérience quatre ans après. J'étois à Pise en Toscane. Une Troupe de campagne s'avisa de la donner pour me faire sa cour. J'entendis dire le lendemain dans un café, sur le Quai de l'Arno: Dio mi guardi da mal di denti, e da cento e quattro accidenti. Dieu me préserve de la rage de dents, et de cent et quatre accidens.
Cela prouve que la réputation d'un Auteur dépend souvent de l'execution des Acteurs. Il ne faut pas se dissimuler cette vérité, nous avons besoin les uns des autres, nous devons nous aimer, nous devons nous estimer réciproquement, servatis servandis.
Changement dans mon état. - Oronte, Roi des Scythes, Opéra.
J'avois satisfait le goût baroque de mes compatriotes, dont je recevois les complimens en riant, et je mourois d'envie de hâter la réforme jusqu'au bout. Mais il arriva dans cette année un événement, qui me fit interrompre pendant quelques mois le cours de mes travaux favoris.
Le Comte Tuo, Consul de Genes à Venise, venoit de mourir. Les parens de ma femme qui avoient du crédit et des protections, demanderent la place pour moi, et l'emporterent d'emblée.
Me voilà donc dans le sein de ma Patrie chargé de la confiance d'une République étrangere. Il me falloit du tems pour prendre connoissance d'un emploi que je ne connoissois pas encore. Les Genois n'avoient auprès des Vénitiens d'autre Ministre que leur Consul. J'étois donc chargé de tout: j'expédiois mes dépêches tous les huit jours; je me mêlois de nouvelles, j'osois trancher du politique. J'avois appris cet art à Milan, et je ne l'avois pas oublié. Mes relations, mes réflexions, mes conjectures étoient agréées à Genes, et je n'étois pas mal dans le corps diplomatique de Venise.
Mon nouvel état et mes nouvelles occupations ne m'empêcherent pas de reprendre le fil de mes occupations Théâtrales; et dans le Carnaval de la même année, je donnai un Opéra au Théâtre de Saint-Jean-Chrisostôme, et une Comédie de caractere à celui de Saint-Samuel.
Mon Opéra qui portoit le titre d'Oronte, Roi des Scythes, eut un succès très-brillant. La musique de Buranello étoit divine; les décorations de Jolli, superbes; les Acteurs excellens; on ne disoit mot du livre, mais l'Auteur des paroles ne jouissoit pas moins du bonheur de ce spectacle charmant.
A la Comédie, au contraire, où je faisois donner en même tems une nouvelle Piece, intitulée la Banqueroute, tous les applaudissemens, tous les battemens de mains, tous les bravo: tout étoit pour moi.
Un Banqueroutier de mauvaise foi est un criminel, qui, en abusant de la confiance du Public, se deshonore lui-même, perd sa famille, vole, trahit les particuliers, et fait du tort au commerce en général.
Initié par mon nouvel emploi dans la connoissance des Négocians, je n'entendois parler que de faillites; et je voyois, que tous ceux qui se retiroient, qui se sauvoient, ou se laissoient prendre, ne devoient leur perte qu'à l'ambition, à la débauche, et à l'inconduite, et partant de l'emblême de la Comédie ridendo castigat mores, je crus que le Théâtre pouvoit s'ériger en licée pour prévenir les abus, et en empêcher les suites.
Je ne me tins pas dans ma Piece uniquement aux Banqueroutiers; mais je fis connoître en même tems ceux qui contribuent davantage à leurs dérangemens, et je m'étendis jusqu'aux gens de loix, qui jettant de la poudre aux yeux des Créanciers, donnent le tems aux Banqueroutiers frauduleux de rendre leurs faillites plus lucratives et plus assurées.
Je ne sais pas si ma Piece a fait quelque conversion; mais je sais bien qu'elle a été généralement applaudie, et les Négocians que j'aurois dû craindre, ont été les premiers à en marquer leur satisfaction, les uns de bonne foi, les autres par politique.
La Banqueroute fut jouée sans intervalle pendant le reste du Carnaval, et elle fit la clôture de l'année comique 1740.
Il y avoit dans cette Piece des scenes écrites beaucoup plus que dans les deux précédentes. Je m'approchois, tout doucement, vers la liberté d'écrire mes Pieces en entier, et malgré les masques qui me gênoient, je ne tardai pas à y parvenir.
Fâcheuse découverte dans mon nouvel emploi. - Commission difficile heureusement terminée. - Imputations démenties. - Suspension de mes rentes à Modene. - Arrivée de mon frere à Venise. - Changement dans la Troupe de Saint-Samuel. - Portrait de la Soubrette. - La Donna di garbo, la brave Femme, Comédie de caractere en trois Actes, en prose, et la premiere entierement écrite.
J'étois comblé d'honneurs et de joie; mais vous savez, mon cher Lecteur, que mes jours heureux n'ont jamais été de longue durée.
Quand on m'offrit le Consulat de Genes, je l'acceptai avec reconnoissance et respect, sans demander quel étoit le traitement de la Charge. Ce fut encore une de mes sottises, qui ne me coûta pas moins que les autres.
Je ne pensai d'abord qu'à me rendre digne de la bienveillance de la République qui m'honoroit de sa confiance. Je pris un logement qui pût me rendre en état de recevoir les Ministres étrangers. J'augmentai mon domestique, ma table, mon train. Je crus ne pouvoir pas faire autrement.
En écrivant au bout de quelque tems au Secrétaire d'Etat avec lequel j'étois en correspondance, je lui motivai l'article de mon traitement. Voici à-peu-près ce que M. le Secrétaire me fit l'honneur de me mander pour me consoler.
Le comte Tuo (mon prédécesseur) avoit servi la République pendant vingt années sans émolumens: le Sénat étoit content de moi: le Gouvernement trouvoit juste que je fusse récompensé; mais la guerre de Corse mettoit la République hors d'état de se charger d'une dépense à laquelle depuis long-tems elle avoit cessé de songer.
Quelle triste nouvelle pour moi! Les profits du Consulat ne montoient pas à cent écus par an. Je voulois remercier sur-le-champ; mais par le Courier suivant une lettre m'arrive d'un Sénateur Génois qui me charge d'une commission épineuse, et m'encourage à rester.
Une personne chargée des affiaires de la République de Genes, et qui réunissoit dans une Cour étrangere la Commission du Sénat et les Procurations des Rentiers, avoit abusé de la confiance des Génois, s'étoit sauvée avec des sommes considérables, et vivoit depuis quelques jours tranquillement à Venise.
Le Sénateur m'envoyoit des Lettres de crédit sur le Banquier Santin Cambiasio, et carte blanche pour obtenir la prise de corps, ou la saisie des effets de son débiteur.
La Commission étoit délicate, et l'exécution en paroissoit difficile. Cependant je connoissois mon pays: dans un Gouvernement où il y a presqu'autant de Tribunaux de premiere instance, que de matieres sujettes à contestation, si l'affaire est bonne, on trouve la maniere d'obtenir justice sans blesser la délicatesse du droit des gens.
Je fus écouté, je fus bien servi; mon Client fut dédommagé, et l'argent et les effets passerent de mes mains à celles de M. Cambiasio à la disposition du Patricien Génois.
Cette affaire si bien conduite et si heureusement terminée, me fit un honneur infini; mais mon étoile ne tarda pas à m'accabler de ses influences.
Dans l'inventaire des effets que j'avois recouvrés, il y avoit deux boîtes d'or enrichies de diamans. J'étois chargé d'en procurer la vente. Je les confiai à un Courtier: ce malheureux les mit en gage chez un Juif, laissa la note du prêteur et se sauva. J'en étois responsable; il falloit payer pour les ravoir. M. Cambiasio fournit l'argent pour le compte du Sénateur, et mon beau-pere paya à Genes l'équivalent, moyennant un revirement de parties pour un reste de la dot de sa fille qu'il me devoit encore.
Tous ces faits furent constatés à Genes et à Venise, et les propos qu'on tenoit sur mon compte furent amplement démentis.
Des gens d'affaires qui m'en vouloient à cause de ma Piece du Banqueroutier, ne cesserent pas cependant de me tracasser.
Imer, le Directeur de la Comédie de Saint-Samuel, avoit été constitué Procureur de Monsieur Berio, Génois son beau-frere, pour toucher à la Monnoie de Venise la somme de quinze cens ducats.
Imer, qui avoit la faculté de substituer d'autres Procureurs, me nomma à sa place. Je touchai l'argent; j'envoyai six cens vingt ducats à M. Berio, par le canal de MM. Lembro & Simon freres Maruzzi, Banquiers, dont je conserve encore la quittance, et je passai le reste de la totalité à M. Imer dont j'eus une décharge passée pardevant Notaires.
On m'avoit imputé d'avoir distrait cette derniere somome. Je n'eus pas de peine à prouver le contraire; mais les propos, les écrits de ce tems-là pourroient revivre encore après ma mort; et je suis intéressé à conserver dans ces Mémoires ma défense et ma justification.
J'ai un neveu qui porte mon nom; si je n'ai pas d'autres bien à lui laisser, qu'il jouisse au moins de la réputation de cet oncle qui lui a tenu lieu de pere, et lui a procuré une éducation dont il a heureusement profité.
Je n'étois donc pas à mon aise au commencement de l'année 1740; et pour surcroît de malheur, je me vis privé tout- d'un-coup de la meilleure partie de mes rentes.
La guerre s'étoit allumée dans ces tems-là entre les François et les Espagnols d'un côté, et les Autrichiens de l'autre. On l'appelloit la guerre de Dom Philippe, et la Lombardie étoit inondée de Troupes étrangeres pour installer ce Prince dans les Etats de Parme et Plaisance.
Le duc de Modene avoit réuni ses forces à celles des Bourbons. Il avoit été Généralissime de leur armée: et pour soutenir les frais de la guerre, il avoit arrêté le paiement des rentes de la banque ducale appellée Luoghi di Monte.
Ce vuide dans mes affaires domestiques acheva de me consterner. Je ne pouvois plus soutenir mon état.
Je pris le parti d'aller à Modene chercher de l'argent à tout prix; passer à Genes, et réclamer justice. J'écrivis en conséquence à la République, j'exposai la nécessité d'un voyage, je demandai la permission de mettre un substitut à ma place, et j'attendois l'agrément du Sénat.
Dans cette attente, et au milieu de mes chagrins et de mes embarras, mon frere arrive de Modene, fâché ainsi que moi de la suspension de nos rentes, mais encore plus piqué de n'avoir pas été avancé dans la nouvelle promotion que S. A. S. venoit de faire dans ses Troupes. Il avoit tout bonnement quitté le service, et il venoit jouir de sa tranquillité à mes dépens.
D'un autre côté, les Comédiens me demandoient de l'ouvrage. C'étoit mon unique consolation; mais Sacchi étoit parti; la moitié de ses camarades l'avoit suivi. Le Pantalon Golinetti s'étoit retiré, et les Acteurs les plus essentiels étoient tous nouveaux pour moi.
Je cherchois parmi eux le sujet qui auroit pu m'intéresser davantage, et ma prédilection pour les Soubrettes m'arrêta sur Madame Baccherini, qui avoit remplacé dans cet emploi la sœur de Sacchi.
C'étoit une jeune Florentine, très-jolie, fort gaie, très-brillante, d'une taille arrondie, potelée, la peau blanche, les yeux noirs, beaucoup de vivacité, et une prononciation charmante. Elle n'avoit pas le talent et l'expérience de celle qui l'avoit précédée, mais on voyoit en elle des dispositions heureuses, et elle ne demandoit que du travail et du tems, pour parvenir à la perfection.
Madame Baccherini étoit mariée, je l'étois aussi. Nous nous liâmes d'amitié; nous avions besoin l'un de l'autre; je travaillois pour sa gloire, et elle dissipoit mon chagrin.
C'étoit un usage invétéré parmi les Comédiens Italiens, que les Soubrettes donnassent tous les ans, et à plusieurs reprises, des Pieces qu'on appelloit de transformations, comme l'Esprit follet, la Suivante Magicienne et d'autres du même genre, dans lesquelles l'Actrice paroissant sous différentes formes, elle changeoît plusieurs fois de costume, jouoit plusieurs personnages, et parloit différens langages.
Parmi quarante ou cinquante Soubrettes que je pourrois nommer, il n'y en avoit pas deux de supportables. On voyoit les caracteres faux, les costumes chargés, les langages bégayés, l'illusion manquée, et cela devoit être, car pour qu'une femme soutienne agréablement toutes ces métamorphoses, il faudroit qu'elle eût vraiement sur elle ce charme qu'on suppose dans la Piece.
Ma belle Florentine mouroit d'envie de montrer son joli minois sous différentes coëffures. Je corrigeai sa folie, et je tâchai en même-tems de la contenter.
J'imaginai une Comédie dans laquelle, sans changer de langage ni d'habillement, elle put soutenir plusieurs caracteres, chose qui n'est pas bien difficile pour une femme, et encore moins pour une femme d'esprit.
Cette Piece avoit pour titre la Donna di garbo, la brave Femme. Elle plut infiniment à la lecture, Madame Baccherini en étoit enchantée, mais les Spectacles à Venise touchoient à leur fin. La Compagnie devoit aller à Genes pour y passer le printems, et c'étoit-là, où l'on devoit la jouer pour la premiere fois. Je me proposois de m'y rendre aussi à son début, mais je devins tout d'un coup le jouet de la fortune. Des événemens singuliers renverserent mes projets, et je ne vis jouer ma Piece que quatre ans après.
Préparatifs pour mon voyage. - Prétentions de mon frere. - Lettres de Genes. - Mort de la Baccherini. - Nouvelle commission à Venise. - Statira, Opéra sérieux. - Mauvais présent de mon frere. - Subtilités d'un faux Capitaine. - Mon désastre. - Mon départ de Venise.
Les Comédiens partis, je me trouvai isolé; car, dans la position désagréable où j'étois, toute autre société m'ennuyoit.
Je ne m'occupois que de mon voyage: ma mere et ma tante n'avoient pas besoin de moi; ma femme alloit me suivre, il n'y avoit que mon frere qui étoit à charge à tout le monde.
Il avoit la plus haute idée de lui-même; je n'étois pas de son avis, et il étoit scandalisé de ma façon de penser.
Il auroit prétendu, par exemple, que je l'eusse proposé pour me remplacer pendant mon absence à Venise, ou que je l'eusse envoyé à Genes, pour solliciter les appointemens de mon emploi; mais je ne le croyois pas fait pour aucune de ces Commissions, et j'allois mon train, en attendant les lettres de Genes, pour exécuter mon projet.
Ces lettres arrivent; la permission m'est accordée, mon substitut est approuvé, me voilà content. J'irai à Modene demander le paiement de mes rentes; j'irai à Genes reclamer le traitement de ma charge: j'assisterai aux répétitions de la Donna di garbo; la Baccherini aura peut-être besoin de moi, et sera bien aise de me revoir. Les attraits de cette Actrice charmante ajoutoient encore à mon empressement; je me faisois une fête de lui voir remplir ce rôle important dans ma Picce.
Mais, ô Ciel! le frere de Madame Baccherini étoit encore à Venise. Il vient chez moi; je le vois éploré; il ne peut pas prononcer un mot; il me donne à lire une lettre de Genes; sa sœur étoit morte.
Quel coup pour moi! Ce n'étoit pas l'amant qui pleuroit sa maîtresse, c'étoit l'Auteur qui regrettoit l'Actrice. Ma femme, qui me voyoit dans le chagrin, étoit assez raisonnable pour s'en rapporter à moi.
D'après cet événement, je ne changeai pas de projet: mais je n'étois plus si pressé de partir, et je crus pouvoir retarder mon départ.
Une société de nobles Vénitiens avoit pris à bail, pour cinq années, le Théâtre de Saint-Jean-Chrysostôme, et m'avoit demandé un Opéra pour la Foire de l'Ascension. J'avois refusé de les satisfaire; mais devenu maître de mon tems, j'acceptai la commission; j'achevai, en peu de jours, un Opéra intitulé Statira, que j'avois dans mon porte-feuille.
J'assistai aux répétitions et à l'exécution de ce Drame, et je profitai des droits d'Auteur et d'une récompense extraordinaire de ces entrepreneurs généreux.
J'avois lieu d'être satisfait d'avoir prolongé mon séjour à Venise; mais je le payai bien cher par la suite, et c'est à mon frere que j'eus l'obligation du cruel embarras où je me trouvai.
Il entre un jour à deux heures après-midi chez moi: il pousse, avec sa canne, la porte battante de mon cabinet; je le vois le chapeau enfoncé sur sa tête, le visage enflammé, les yeux étincelans; je ne savois pas si c'étoit de joie ou de colère; et en me fixant avec un air dédaigneux: Parbleu, mon frère, me dit-il, vous ne vous moquerez pas toujours de moi! - A propos de quoi, mon frère? lui dis-je. Je ne fais pas des vers, reprend-il, mais chacun vaut son prix. Je viens de faire une découverte... - Si elle peut vous être utile, lui dis-je, j'en serai enchanté. - Oui, utile et honorable pour moi, et encore plus utile et plus honorable pour vous. - Pour moi? - Oui: je viens de faire la connoissance d'un Capitaine Ragusien, d'un homme... d'un homme comme il n'y en a pas. Il est en correspondance avec les principales Cours de l'Europe; il a des commissions qui font trembler; il est chargé de faire des recrues pour un nouveau Régiment de deux mille Esclavons; mais, ô Ciel! si le Gouvernement de Venise venoit à le pénétrer, nous serions perdus. Mon frère... mon frère... J'ai lâché le mot, vous connoissez l'importance de la discrétion.
Je voulois lui faire quelques réflexions. Ecoutez-moi, reprit-il en m'interrompant; il s'agit d'une place de Capitaine pour moi; j'ai servi en Dalmatie, comme vous savez; mon ami le sait aussi; il a connu mon oncle Visinoni à Zara, et il me destine une Compagnie. Mais pour vous, continua-t-il, pour vous, mon frère, il y a bien autre chose. - Pour moi? Que diable veut-il faire de moi? - Il vous connoît de réputation, il vous estime, vous serez l'Auditeur, vous serez le grand Juge du Régiment. - Moi? Oui, vous.
Dans cet instant le domestique entre, et nous annonce que nous sommes servis. Va-t-en à tous les diables, lui dit mon frère; nous avons des affaires, laisse-nous tranquilles. - Mais ne pourrions-nous pas, lui dis-je, différer après le dîné? - Point du tout; il faut attendre. - Pourquoi? - Monsieur le Capitaine va venir. - Vous l'avez prié? - Oui; trouvez- vous mauvais que j'aie pris la liberté de prier un ami? - Monsieur le Capitaine est donc votre ami? - Je n'en doute point. - Vous venez de faire sa connoissance, et il est déjà votre ami? - Nous ne sommes pas des courtisans, nous autres Militaires; nous nous connoissons au premier abord; l'honneur et la gloire forment notre liaison, et nous devenons amis un instant après.
Ma femme arrive, et nous prie de finir. Mon Dieu! Madame, crie mon frère, c'est impatientant. - C'est Madame votre mère, dit-elle, qui s'impatiente. - Ma mère, ma mère... qu'elle dîne et qu'elle aille se coucher. - Ce que vous dites-là, mon frère, lui dis-je, sent furieusement la poudre à canon. - J'en suis fâché, j'en suis fâché; mais le Capitaine ne doit pas tarder. - On frappe; voilà Monsieur le Capitaine; bien de complimens; bien des excuses, allons diner.
Cet homme avoit plus l'air d'un courtisan que d'un Militaire. Il étoit souple, doux, maniéré, le visage pâle, allongé, le nez aquilain, et de petits yeux ronds et verdâtres; il étoit fort galant, très-attentif à servir les dames, débitant des moralités aux vieilles, et tenant des propos agréables aux jeunes, sans que ses historiettes l'empêchassent de bien diner. Nous prîmes le café à table; mon frère me fit souvenir de tous les restes de liqueurs que j'avois pour en régaler son ami, et nous allons enfin, le Ragusien, mon frère et moi, nous renfermer dans mon cabinet.
Comme la recommandation de mon frère ne me fournissoit pas une idée avantageuse en faveur de l'homme inconnu, celui- ci, qui ne manquoit pas d'adresse et de prévoyance, m'étala dans un préambule très-rapide et très-élégant son nom, sa patrie, sa condition, ses titres, ses exploits, et finit par mettre sous mes yeux les lettres-patentes, écrites en langue Italienne, par lesquelles il étoit chargé de recruter deux mille hommes de nation Illirique, pour un nouveau Régiment, au service de la Puissance dont il tenoit la commission.
Dans ces lettres, le Ragusien étoit nommé Colonel du nouveau Régiment, avec faculté de nommer à sa volonté les Officiers, le Juge, les Fourriers, les Fournisseurs etc., et il y avoit la signature du Souverain, celle du Ministre et Secrétaire d'Etat du département de la Guerre, avec le sceau de la Couronne.
Je ne connoissois pas trop ces signatures étrangères, et je me méfiois toujours d'un homme que je voyois pour la première fois; et en attendant que je fusse à portée d'en vérifier l'authenticité, je fis des questions à M. le Capitaine, auxquelles il ne manqua pas de donner des réponses satisfaisantes.
Je lui demandai d'abord par quel hasard nous serions assez heureux, mon frere et moi, pour intéresser sa bienveillance en notre faveur.
Monsieur votre frere, répondit-il, est un homme qui peut être très-utile à mes intérêts. Il connoît la Dalmatie. et l'Albanie, où il a servi, ce sont les deux Provinces qui peuvent fournir de beaux hommes pour mon Régiment. Je compte le munir de lettres et d'argent, et l'envoyer y faire des recrues. - Mon frere se jette au col du Ragusien. Vous verrez, vous verrez, mon ami; je vous emmenerai des Dalmatiens, des Albanois, des Croates, des Morlaques, des Turcs, des Diables; laissez-moi faire, Gospodina, Gospodina, dobro jutro, Gospodina.
Le Capitaine qui étoit Esclavon lui-même, et se moquoit peut-être de la salutation Illirique et déplacée de mon frere, se mit à rire, et en se tournant de mon côté: Pour vous, Monsieur, me dit-il, je me fais un honneur en vous priant d'accepter dans mon Régiment la charge d'Auditeur Général. Vous êtes homme de lois, et votre état de Consul... Mais à propos de la place que vous occupez, continua-t-il, j'ai une grace à vous demander. Je suis à Venise, c'est un pays libre, mais l'affaire que j'y traite actuellement est fort délicate, et pourroit choquer le Gouvernement, à cause de ses nationaux Dalmatiens; il y a des mouchards qui ne me quittent pas, je crains la surprise; si vous pouviez me loger chez vous, je ne serois peut-être pas à l'abri des poursuites de la République, mais j'aurois le tems de les éviter.
Monsieur, lui dis-je, mon logement n'est pas assez commode... Mon frere crie, en m'interrompunt: Je céderai ma chambre à M. le Capitaine; je me défends, c'est inutilement. Voilà le Ragusien établi chez moi.
La société de cet homme étoit assez agréable; je n'étois pas difficile à me laisser gagner, et j'avois de la peine à le soupçonner. Je ne voulois cependant avoir rien à me reprocher. A mesure que j'entendois parler des personnes intéressées au secret de l'affaire en question, j'allois aux informations.
Je vis des Négocians chargés des uniformes du Régiment. Je parlai à des Officiers engagés par le Colonel breveté. Cet homme reçut un jour une lettre-de-change de six mille ducats sur les freres Pommer, Banquiers Allemands; la lettre ne fut point acceptée, parce qu'il n'y avoit pas de lettre d'avis, mais les signatures étoient parfaitement imitées. Enfin je crus, et je tombai dans le panneau.
Trois jours après, le Ragusien rentra chez moi agité, consterné; il devoit payer six mille livres dans la journée, il n'avoit pu obtenir de délai; il alloit être poursuivi; la nature de la dette alloit le découvrir tout-à-fait; il étoit au désespoir, tout étoit perdu. Son discours me touche; mon frere me sollicite, mon cœur me détermine. Je fais des efforts pour ramasser cet argent. Je suis assez heureux pour y parvenir, je le donne dans la journée à mon hâte, et le lendemain le scélérat s'enfuit.
Je reste dans l'embarras; mon frere le cherche pour le tuer; il étoit heureusement hors de danger. Toutes les dupes du Ragusien se rassembloient chez moi, mais nous étions forcés d'étoufer nos plaintes, pour éviter l'indignation du Gouvernement et les risées du Public.
Quel parti prendre? Le voleur étoit sorti de Venise le 15 Septembre 1741. Je m'embarquai le 18 avec ma femme pour Bologne.
Mon embarquement pour Bologne. - Profits casuels dans cette ville. -Mauvaîse nouvelle. - Voyage à Rimini. - Mon arrivée en cette ville. - Raprésentation au Duc de Modene. - Observations sur le Camp Espagnol. - Troupe de Comédiens à Rimini. - Le Monde de la Lune, Comédie. - Mouvemens des Troupes Autrichiennes. - Retraite des Espagnols.
Ma femme plus raisonnable que moi, au lieu de se plaindre de sa situation, ne cherchoit que les moyens de me consoler. Ranimé par son exemple et par ses conseils, je tâchai de remplacer les regrets du passé par l'espérance d'un avenir plus heureux. Je m'endormis, et je me trouvai à mon réveil comme un homme qui a fait naufrage, et qui se sauve à la nage.
Arrivé au Pont de Lago Scuro sur le Po, à une lieue de Ferrare, je pris la poste, et j'arrivai le soir à Bologne. Je connoissois beaucoup cette Ville; et j'y étois très-connu.
Les Directeurs des Spectacles vinrent me voir: ils me demanderent quelques-unes de mes Pieces; je fis des difficuités: mais j'avois besoin d'argent; ils ne manquerent pas de m'en offrir, et je ne manquai pas d'en accepter.
Je leur confiais trois de mes originaux, pour qu'ils en fissent tirer des copies. Il falloit donc attendre: j'attendis, et je ne perdis pas mon tems.
On m'avoit demandé à Venise une Comédie sans femmes, et susceptible d'exercices militaires, pour un College de Jésuites. Le faux Capitaine qui m'avoit trompé, me revint à l'esprit, et m'en fournit l'argument. J'intitulai ma Piece l'Imposteur; j'y employai toute la chaleur que l'indignation pouvoit m'inspirer; j'y couchai en long et en large mon frere, je ne m'épargnai pas moi-même, et je donnai à ma bonhomie tout le ridicule qu'elle avoit méritée.
Ce petit travail me fit un bien infini: il effaça de mon esprit tout le noir que la méchanceté d'un frippon y avoit imprimé; je me crus vengé.
Ma Piece étoit finie, les Directeurs m'avoient rendu mes manuscrits; j'allois partir pour Modene.
Il y avoit à Bologne un excellent Acteur qui jouoit les Pantalons, et qui étant à son aise, aimoit mieux se reposer dans la belle saison, et ne jouoit la Comédie qu'en hiver.
Cet homme, appellé Ferramonti, ne m'avoit pas quitté pendant mon séjour à Bologne; une Troupe de Comédiens qui étoit à Rimini au service du Camp Espagnol l'avoit engagé; il étoit prêt à partir, et il venoit me faire ses adieux.
Vous allez à Rimini, lui dis-je, et je vais partir pour Modene. - Qu'allez-vous faire, dit-il, à Modene: tout e monde y est dans la consternation: le Duc n'y est pas. Comment! le Duc n'y est pas? - Il s'est engagé dans une guerre ruineuse. - Je le sais; mais où est-il? - Il est à Rimini, il est au Camp Espagnol, et il y passera l'hiver.
Me voilà désolé; j'ai manqué mon coup, c'est ma faute; j'ai perdu trop de tems. Venez, me dit Ferramonti, venez à Rimini avec moi, vous y trouverez une Troupe qui est assez bonne. Je vous présenterai à mes camarades; ils doivent vous connoître, ils doivent vous estimer. Venez avec moi, vous ferez quelque chose pour nous, et nous ferons tout pour vous.
La proposition ne me déplaisoit pas; mais je voulois consulter ma femme: elle étoit Génoise; nous étions en chemin pour aller revoir ses parens; mais la pauvre enfant! elle étoit la bonté, la complaisance personnifiées. Tout ce que son mari proposoit, elle le trouvoit bon: contente de me voir tranquille et satisfait, elle m'encouragea à suivre mon nouveau projet, et nous partîmes trois jours après avec le bon vieillard Vénitien.
Arrivés à la vue des remparts de Rimini, nous fûmes arrêtés au premier poste avancé, et on nous fit escorter à la grand'garde. Là le Comédien fut expédié sur la déclaration de son état, et nous fûmes envoyés ma femme et moi à la Cour de Modene.
Je connoissois dans tous les rangs plusieurs personnes attachées à son Altesse Sérénissime: je fus bien reçu; je fus fêté: on me trouva un logement, et le lendemain je fus présenté à ce Prince qui me reçut avec bonté, et me demanda quel étoit le motif qui me conduisoit à Rimini.
Je n'eus pas de peine à lui dire la vérité; mais quand je prononçai les mots de banque ducale et de rentes arriérées, son Altesse tourna la conversation sur la Comédie, sur mes Pieces, sur mes succès, et l'audience se termina deux minutes après.
Je vis qu'il n'y avoit rien à espérer de ce côté-là; je me tournai de celui des Comédiens, et j'y trouvai mieux mon compte.
J'allai dîner chez le Directeur: Ferramonti avoit beaucoup parlé de moi. Tout le monde y étoit: la première Amoureuse étoit une Actrice excellente, mais fort âgée; la seconde une beauté, stupide et mal élevée. Colombine étoit une brune fraîche et piquante, qui étoit prête d'accoucher, et qui par parenthèse devint bientôt ma commere c'étoit la Soubrette, c'étoit mon lot.
Tout le monde me demanda des Pièces; chacun auroit voulu en être le sujet principal: à qui donner la préférence? M. le Comte de Grosberg me tira d'embarras.
Ce brave Officier, Brigadier des Armées de S. M. Catholique, dans le Régiment des Gardes Valonnes, étoit un de ceux qui s'intéressoient le plus au Spectacle: il protégeoit particülierement l'Arlequin; il me pria de travailler pour ce personnage, et je le fis avec d'autant plus de plaisir que l'Acteur étoit bon, et que le protecteur étoit généreux.
L'Arlequin étoit M. Bigottini, bon Acteur pour les rôles de son emploi, mais surprenant pour les métamorphoses et pour les transformations.
M. de Grosberg se souvenoit d'une Pièce de l'ancienne Foire de Paris, intitulée Arlequin, Empereur dans la lune . Il croyoit que ce sujet auroit pu faire briller son protégé; il n'avoit pas tort. Je travaillai la Pièce à ma fantaisie d'après le titre: elle eut beaucoup de succès. Tout le monde fut content et moi aussi.
Le carnaval finit, le Théâtre fut fermé. M. de Gages, qui à côté du Généralissime étoit le Général Commandant, faisoit observer la police la plus exacte et la discipline la plus rigoureuse à toute l'armée; point de jeux, point de bals, point de femmes suspectes. On vivoit à Rimini comme dans un couvent.
Les Espagnols faisoient la cour aux dames du pays à la manière Castillane; elles étoient bien aises de voir les enfans de Mars plier le genou devant elles. Les sociétés étoient nombreuses, sans tumulte, et la galanterie brilloit sans scandale.
Je jouissois comme les autres de cette douce tranquillité, répandu dans les meilleures maisons de la ville, faisant la partie des Dames avec la noble contenance des Espagnols, voyant quelquefois ma commère avec la gaîté Italienne, et j'attendois la bonne saison pour aller à Genes. Mais que d'entraves! que de révolutions! que d'événemens!
Les Troupes Allemandes qui étoient cantonnées dans le Bolonois, firent des mouvemens qui donnèrent l'allarme aux Espagnols. Ceux-ci n'étoient point disposés à attendre l'ennemi de pied ferme, et à mesure que les premiers avançoient vers la Romagne, les derniers battoient en retraite, et alloient partager leur camp entre Pesaro et Fano.
Tous les Espagnols qui étoient à Cesena, à Cervia et à Cesenatico, vinrent se réunir dans Rimini au gros de l'armée; je fus obligé de partager mon appartement; mais ce n'est pas tout, ce n'est rien.
Mon frère, mon aimable frère vint en même-tems de Venise, avec deux Officiers Vénitiens, pour proposer à M. de Gages la levée d'un nouveau Régiment, et la place d'Auditeur m'étoit réservée. J'avois appris à me défier des projets; je ne voulus pas les écouter, mais il falloit bien les loger et les nourrir.
Au bout de trois jours l'armée décampa, mon frère et ses compagnons la suivirent. Je restai à Rimini, mais plus embarrassé que jamais.
J'étois sujet du Duc de Modene, et j'étois Consul de Genes à Venise; ces deux Nations suivoient dans cette guerre le parti des Bourbons. J'avois à craindre que les Autrichiens ne me prissent pour un homme suspect.
Je communiquai mes craintes à des gens du pays que je connoissois. Tout le monde les trouvoit justes, et me conseilloit de partir; mais comment faire? Il n'y avoit ni chevaux, ni voitures. L'armée avoit tout entraîné.
Je trouvai des Marchands étrangers qui étoient dans le même cas que moi. Je m'arrangeai avec eux; nous prîmes la route de mer, et nous louâmes une barque pour Pesaro.
Le tems étoit beau, mais la nuit avoit été orageuse, et la mer étoit encore agitée. Nos femmes souffroient beaucoup, la mienne crachoit le sang; nous nous arrêtames à la rade de la Catholica, à moitié chemin du voyage projetté; nous achevâmes notre route par terre sur une charrette de paysans. Nous laissâmes à la garde de nos effets quelques-uns de nos domestiques qui devoient nous rejoindre à Pesaro, et nous arrivâmes dans cette ville fatigués, fracassés, sans connoissances, sans logemens, et c'étoit le moindre des maux qui nous étoient réservés.
Mauvais gîte. - Fâcheuse nouvelle. - Entreprise hasardée. - Triste aventure. - Course fatiguante. - Bonheur inattendu.
Tout étoit en confusion dans la Ville de Pesaro, qui venoit de recevoir plus de monde qu'elle n'en pouvoit contenir. Point de places dans les Auberges, point de chambres à louer.
Le Comte de Grosberg étoit à Fano; tous les Officiers de ma connoissance étoient occupés, et les personnes attachées au Duc de Modene ne pouvoient m'offrir que la table. Un valet-de-pied Modenois, qui avoit eu en partage un grenier, me céda, pour de l'argent, son joli appartement.
Le lendemain, je laissai ma femme dans son galetas, et j'allai à l'embouchure de la Foglia, pour voir si mes hardes étoient arrivées. J'y trouvai tous mes compagnons de voyage, qui étoient-là pour la même raison, et qui avoient passé la nuit encore plus mal gîtés que moi. Point de barques de Rimini, point de nouvelles de nos effets.
Je reviens à la Ville. Le Comte de Grosberg étoit de retour; il prend pitié de moi, me loge auprès de lui, me voilà content; mais je retombe, deux heures après, dans une terrible consternation.
Je rencontre un de ces Commerçans que j'avois vu au rivage de la mer; je le vois triste, agité. Eh bien, Monsieur, lui dis-je, n'avons-nous rien de nouveau? - Hélas! me dit-il, tout est perdu; les Houssards Autrichiens se sont emparés de la Catholica; notre barque, nos effets, nos domestiques sont entre leurs mains. Voici la lettre de mon Correspondant de Rimini, qui m'en fait part. - Oh Ciel! que ferons-nous? lui dis-je. - Je n'en sais rien, répond-il, et me quitte brusquement.
Je reste interdit. La perte que je venois de faire, étoit pour moi irréparable; nous étions, ma femme et moi, très- bien équipés; trois coffres, deux porte-manteaux, des boîtes, des cartons, et nous étions restés sans chemise.
Pour les grands maux, il ne faut que de grands remedes. Je forme sur-le-champ mon projet; je le crois bon, et je vais le communiquer à mon protecteur. Je le trouve prévenu de l'invasion de la Catholica, et convaincu de la perte de mes effets; j'irai, lui dis-je, les réclamer; je ne suis pas Militaire, je ne suis pas attaché à l'Espagne; je ne demande qu'une voiture pour moi et pour ma femme.
M. le Comte de Grosberg admire mon courage; et pour se débarrasser de moi, peut-être, commence par me faire avoir le passe-port du Commissaire Allemand, qui, à cet effet, suivoit les Troupes Espagnoles, et donne ses ordres pour qu'on me procure une chaise.
La Poste n'alloit pas dans ce tems-là; les voiturins se tenoient cachés: on en trouva un à la fin; on le força de me mener; on le fit passer la nuit dans les écuries de M. de Grosberg, et je partis le lendemain de très-bon matin.
Jé n'ai point parlé de mon épouse depuis ce nouvel accident, pour ne pas ennuyer mon Lecteur: on peut imaginer facilement quelle devoit être la situation d'une femme qui perd tout d'un coup ses habillemens, ses bijoux, ses chiffons: mais elle étoit foncierement bonne, elle étoit raisonnable, et la voilà en route avec moi.
Le voiturin, fort souple et fort adroit, étoit venu nous chercher, sans nous donner la moindre marque de mécontentement, et nous partîmes après un petit déjeûné, fort tranquilles et assez gais.
Il y avoit dix milles de Pesaro jusqu'à la Catholica; nous en avions fait trois, lorsqu'il prit à ma femme un besoin pressant de descendre. Je fais arrêter; nous descendons, nous faisons quelques pas pour aller gagner une masure délabrée; le scélérat qui nous conduisoit fait tourner les chevaux, prend le galop du côté de Pesaro, et nous plante-là au milieu du grand chemin, sans ressource et sans espérance d'en retrouver.
On ne voyoit âme vivante passer par-là. Pas un paysan dans les champs, pas un habitant dans les maisons; tout le monde craignoit les approches des deux armées: ma femme pleure, je leve les yeux au Ciel, et je me vois inspiré.
Courage, dis-je, ma chere amie, il y a six milles d'ici à la Catholica; nous sommes assez jeunes et assez bien constitués pour les soutenir; il ne faut pas reculer; il ne faut avoir rien à se reprocher: elle s'y prêta de la meilleure grâce du monde, et nous continuâmes notre route à pied.
Au bout d'une heure de chemin, nous rencontrâmes un ruisseau qui étoit trop large pour pouvoir le sauter, et trop profond pour que ma femme pût le passer à gué; on voyoit un petit pont de bois pour la commodité des piétons, mais les planches en étoient brisées.
Je ne me démonte pas; je mets un genou par-terre, ma femme accroche ses bras à mon cou, je me leve en riant, je traverse les eaux avec une joie inexprimable, et je me dis à moi-même: OMNIA BONA MEA MECUM PORTO, je porte tout mon bien sur moi.
J'avois les pieds et les jambes mouillées; patience: nous suivons notre marche; voilà, au bout de quelque tems, un autre ruisseau pareil à celui que nous venions de passer; même profondeur, le pont cassé de même: point de difficultés, nous le passâmes de la même maniere, et toujours avec la même gaieté.
Mais ce fut bien autre chose lorsqu'en nous approchant de la Catholica, nous rencontrâmes un torrent fort étendu, et dont les eaux rouloient à gros bouillons; nous nous assimes au pied d'un arbre, en attendant que la Providence nous offrît un moyen pour le traverser sans danger.
On ne voyoit ni voitures, ni chevaux, ni charrettes passer par-là: il n'y avoit pas un cabaret dans ces environs; nous étions fatigués, nous avions passé la journée sans aucune nourriture, et nous avions besoin de nous rafraîchir.
Je me leve, je tâche de m'orienter. Ce torrent, dis-je, doit de toute nécessité se décharger dans la mer. Suivons les bords, et nous en trouverons l'embouchure.
Marchant toujours, poussé par la détresse et soutenus par l'espérance, nous découvrîmes des voiles qui nous indiquoient la proximité de la mer; nous prîmes courage, et nous doublâmes le pas; nous voyions à mesure que nous avancions le torrent devenir praticable, et nous fîmes des sauts et des cris de joie, lorsque nous découvrîmes un bateau.
C'étoient des pêcheurs qui nous reçurent très-honnêtement, qui nous transporterent au rivage opposé, et nous remercierent mille fois pour un paul que je leur donnai.
Après cette premiere consolation, nous en eûmes une seconde, qui ne fut pas moins agréable et pas moins nécessaire. Une branche d'arbre attachée à une maison rustique nous annonce les moyens de nous rafraîchir; nous y trouvons du lait et des œufs frais, nous voilà contens.
Le repos, le peu de nourriture que nous venions de prendre, nous donnant assez de forces pour achever notre course, nous nous faisons conduire, par un earçon de l'Auberge, au premier poste avancé des Houssards Autrichiens.
Je présente mon passe-port au Sergent; celui-ci détache deux soldats pour nous faire escorter, et nous arrivons à travers les bleds écrasés, et la vigne, et les arbres abattus, au quartier du Colonel Commandant.
Cet Officier nous reçoit d'abord comme deux personnes qui voyageoient à pied; en lisant le passe-port qu'un des deux soldats lui avoit remis, il nous fait asseoir; et me regardant d'un air de bonté: Comment, dit-il, vous êtes M. Goldoni? - Hélas! oui, Monsieur. - L'Auteur de Bélisaire? L'Auteur du Cortesan Vénitien? - C'est moi-même. - Et cette Dame est Madame Goldoni? - C'est tout le bien qui me reste. - On m'avoit dit que vous étiez à pied. - Cela n'est que trop vrai, Monsieur.
Je lui fis le récit du tour indigne que m'avoit joué le voiturin de Pesaro; je lui traçai le tableau de notre triste voyage, et je finis par lui parler de nos effets arrêtés, et lui faire sentir que mes projets, mes ressources et mon état dépendoient de leur perte ou de leur recouvrement.
Tout doucement, dit le Commandant; par quelle raison suiviez-vous l'armée? Quel intérêt vous attache aux Espagnols? Comme la vérité ne m'avoit jamais fait de tort, et qu'au contraire elle avoit toujours été mon appui et ma défense, je lui fis l'abrégé de mes aventures; je lui parlai de mon Consulat de Genes, de mes rentes de Modene, de mes vues pour être dédommagé, et je lui dis que tout étoit perdu pour moi, si je me voyois privé du petit reste de ma fortune délabrée.
Consolez-vous, me dit-il d'un ton d'amitié, vous ne le perdrez pas; ma femme se leve en pleurant de joie; je veux marquer ma reconnoissance, le Colonel ne m'écoute pas. Il appelle, il ordonne qu'on fasse venir mon domestique et tous mes effets, mais à une condition, me dit-il: allez par-tout où vous voudrez, je ne vous défends que la voie de Pesaro. Non, certainement, lui dis-je, vos bontés, mes obligations... Il ne me donne pas le tems de tout dire, il a des affaires, il m'embrasse, il baise la main à ma femme, et va se renfermer dans son cabinet.
Son valet-de-chambre nous accompagne à une hôtellerie qui étoit fort propre. Je lui offre un sequin, il le refuse très-noblement, et s'en va. Une demi-heure après, mon domestique arrive fondant en larmes, se voyant libre et nous voyant contens; nos coffres étoient ouverts, j'en avois les clefs. Un serrurier les mit bientôt en état de servir.
Je louai, le lendemain de très-bon matin, une charrette pour mon bagage. Je pris la poste pour ma femme et moi, et nous allâmes retrouver, à Rimini, nos bons amis.
Mon arrivée à Rimini. - Heureuse rencontre. - Commission honorable et lucrative. - Ma renonciation au Consulat de Genes. - Autre Commission encore plus lucrative. - Marche des Allemands de Rimini à la pour-suite des Espagnols. - Mon départ pour la Toscane.
Arrivé au premier poste avancé, je déploye mon passe-port; on me fait escorter jusqu'à la grand'garde de Rimini. Le Capitaine étoit à table; il apprend qu'il y a un homme et une femme qui arrivent en poste; il nous fait entrer: la premiere personne que je vois en entrant, c'est M. Borsari, mon ami, et mon compatriote, premier Secrétaire du Prince de Lobcowitz, Feld-Maréchal et Commandant Général de l'Armée Impériale.
M. Borsari savoit que j'avois passé l'hiver à Rimini, et que j'étois parti à la suite des Espagnols; je lui fis part du motif de mon retour, des singularités de mon voyage, et de mon dessein d'aller à Genes.
Non, dit-il, tant que nous resterons ici, vous n'irez pas à Genes. - Que ferai-je ici? lui dis-je. - Vous vous amuserez. - C'est le meilleur métier, que je connoisse; mais encore faut-il s'occuper à quelque chose. - Nous vous occuperons: il y a une Comédie passable. - Quels sont les Acteurs principaux? - Il y a Madame Casalini, très-bonne Actrice; il y a Madame Bonaldi... - Est-ce la Soubrette? Oui. - C'est ma commere: tant mieux, tant mieux, je la reverrai avec plaisir. Pendant que nous causions, M. Borsari et moi, ma femme soutenoit un peu forcément la conversation de Messieurs les Officiers Allemands, qui ne plioient pas le genou devant les dames comme les Espagnols; elle me fit signe qu'elle en avoit assez; nous primes congé de la compagnie, et Borsari ne nous quitta pas.
Mon domestique m'attendoit à la porte pour me prévenir que mon ancien logement étoit occupé. Borsari me promit que je l'aurois, qu'il feroit changer de quartier l'Officier qui étoit de sa connoissance; et en attendant il nous amena chez lui, et nous proposa une chambre à côté de la sienne, que nous acceptâmes avec plaisir, et que nous occupâmes pendant trois jours.
Le lendemain mon ami me présenta à son maître. Le Prince avoit entendu parler de moi; il me communiqua le projet d'une fête, et me chargea de l'exécution.
L'Impératrice Reine Marie-Thérese venoit de marier l'Archiduchesse sa sœur au Prince Charles de Lorraine. M. le Maréchal Lobcowitz vouloit que Rimini fît aussi des réjouissances pour cette auguste hyménée; il m'ordonna une Cantate , et se rapportoit à Borsari et à moi pour le choix du Compositeur et pour le nombre et la qualité des voix. Il nous laissoit les maîtres en tout; il ne nous recommandoit que de l'ordre et de la promptitude.
Il y avoit à Rimini un Maître de Musique, Napolitain, nommé Ciccio Muggiore, qui n'étoit pas du premier ordre, mais qui pouvoit passer en tems de guerre. Nous le chargeâmes de la commission; nous fîmes venir de Bologne deux Chanteurs et deux Chanteuses; je fis des paroles sur de la vieille musique de notre Compositeur, et au bout d'un mois, notre Cantate fut exécutée sur le Théâtre de la Ville, au contentement de celui qui l'avoit ordonnée, et à la satisfaction des Officiers étrangers et de la noblesse du pays.
Nous fûmes, le Compositeur et moi, très-largement récompensés par le Général Allemand; mais le Napolitain qui n'étoit pas sot, m'avoit suggéré d'avance d'un moyen, qu'il avoit peut-être expérimenté, pour augmenter nos profits.
Nous fîmes assez noblement relier une quantité considérable d'exemplaires de notre Cantate imprimée. Nous allâmes dans un beau carrosse la présenter à tous les Officiers de l'Etat Major des différens Régimens qui étoient logés dans la Ville et dans les environs, et nous rapportâmes chez moi une bourse honnêtement remplie de sequins de Venise, de pistoles d'Espagne, et de quadruples de Portugal, que nous partageâmes tranquillement et modestement.
Pendant ce tems-là, on m'écrivit de Genes qu'un Négociant de Venise, sans intention de me faire aucun tort, demandoit mon emploi de Consul en cas que je ne voulusse pas le garder, et s'offroit de servir sans émolumens, content d'un titre, qui, vu son état, pouvoit lui être avantageux beaucoup plus qu'à moi: le Sénat Génois ne me renvoyoit pas, mais il me mettoit dans le cas ou de me retirer, ou de servir gratis. J'adoptai le premier de ces deux partis, ie remerciai la République, et je n'y pensai pas davantage.
D'ailleurs j'avois tant souffert, que j'étois bien aise de me tranquilliser pendant quelque tems; j'avois de l'argent, je n'avois rien à faire, j'étois heureux.
Rimini, pour ceux qui l'avoient vu pendant le séjour des Espagnols, n'étoit pas reconnoissable: il y avoit dés amusemens de toute espèce: des bals, des concers, des jeux publics, des sociétés brillantes, des filles galantes: il y avoit des amusemens pour tous les caractères et pour tous les états; j'aimois ma femme, je partageois mes plaisirs avec elle, et elle me suivoit par-tout.
Ce n'étoit que chez ma commère qu'elle ne me suivoit pas; elle ne m'empêchoit pas d'y aller; mais cette Actrice n'étoit pas de son goût, et on ne peut pas disputer des goûts.
Enfin ma pauvre commère fut obligée de partir: les Officiers Allemands vouloient avoir un Opéra pour le Carnaval, et les Comédiens furent contraints de céder la place.
Le Comte Novati, Milanois, Lieutenant-Général des Armées de Leurs Majestés Royales et Impériales, s'étoit chargé des soins du nouveau Spectacle; il me fit l'honneur de m'en proposer la direction; je l'acceptai avec plaisir, et je n'eus pas lieu de m'en repentir; car la générosité de ce Seigneur me fit jouir de profits auxquels je ne pouvois pas m'attendre.
J'allois donc de mieux en mieux; la fortune paroissoit avoir changé à mon égard. Effectivement depuis le dernier désastre de la Catholica, et celui de mon retour à Rimini, je n'ai plus essuyé de ces coups terribles qui paroissoient vouloir m'écraser.
L'Opéra cessa avec le Carnaval, et aux distractions amusantes succédèrent les affaires politiques et les intérêts de la guerre.
Au commencement du Carême, le Feld-Maréchal Autrichien rappella auprès de lui toutes ses Troupes, qui étoient cantonnées dans la Romagne, et je jouis du coup-d'œil charmant d'une revue générale de quarante mille hommes.
C'étoit le signal du décampement des Autrichiens; je fis mes adieux à mon ami Borsari, et quarante jours après il n'y avoit pas un Allemand dans ce pays que l'on appelle aujourd'hui la Romagne, et qui s'appelloit du tems des Empereus Romains l'Exarquat de Ravenne.
Je voulois partir aussi; le voyage de Genes étoit devenu inutile pour moi; j'etois libre; j'étois maître de ma volonté; j'avois suffisamment d'argent, je mis en exécution un ancien projet. Je voulois voir la Toscane, je voulois la parcourir, et l'habiter pendant quelque tems; j'avois besoin de me familiariser avec les Florentins et les Siennois, qui sont les textes vivans de la bonne langue Italienne. J'en fis part à ma femme; je lui fis voir que cette route nous rapprochoit de Genes; elle en parut satisfaite, et notre voyage fut décidé pour Florence.
Mon arrivée à Florence. - Quelques mots sur cette ville. - Mon voyage àSienne. - Connoissance du Chevalier Perfetti, et son talent extraordinaire. - Sociétés de Sienne. - Route pour Volterre. - Vues des Catacomhes. - Curiosités ramassées dans ce Pays, et dans celui de Peccioli. - Mon arrivéeà Pise.
La nouvelle route de Bologne à Florence n'étoit pas encore ouverte en 1742. On y va actuellement en un jour, et il en falloit au moins deux pour traverser ces hautes montagnes, où la Toscane est enclavée.
Ne pouvant donc éviter le mauvais chemin, je choisis le plus court; je confiai mes hardes à un Conducteur de mulets.
Nous prîmes la poste, ma femme et moi, jusqu'à Castrecarro; delà nous traversâmes à cheval les alpes de Saint Benoît, et nous arrivâmes dans ce beau pays auquel on doit la renaissance des lettres.
Je ne m'étendrai pas sur la beauté et sur les agrémens de la ville de Florence. Tous les écrivains, tous les voyageurs lui rendent justice: de belles rues, des palais magnifiques, des jardins délicieux, des promenades superbes, beaucoup de sociétés, beaucoup de littérature, beaucoup de curiosités; les arts en crédit, les talens estimés, la cultivation très-soignée, les productions de la terre excellentes, le commerce favorisé, une riche riviere qui traverse la Ville, un port de mer très-considérable dans ses dépendances, de beaux hommes, de belles femmes, de la gaieté, de l'esprit, des étrangers de toutes nations, des amusemens de toute espece... C'est un pays charmant.
Je restai quatre mois dans cette Ville avec un véritable plaisir. J'y fis des connoissances très-intéressantes: celle du Sénateur Rucellai, Auditeur de la Jurisdiction; celle du Docteur Cocchi, Médecin systématique et Philosophe agréable; celle de l'Abbé Gori, antiquaire très-éclairé et très-savant dans la langue Etrusque; et celle de l'Abbé Lami, auteur d'un Journal Littéraire, le meilleur ouvrage que l'on ait vu en Italie dans ce genre.
J'avois projetté de passer l'été à Florence, et l'automne à Sienne; mais l'envie que j'avois de voir et d'entendre le Chevalier Perfetti, me détermina à partir dans les premiers jours du mois d'Août.
Perfetti étoit un de ces Poëtes qui font à l'impromptu des Pieces de vers, et qu'on ne rencontre qu'en Italie; mais il étoit si supérieur à tout autre, et il ajoutoit tant de science et tant d'élégance à la facilité de sa versification, qu'il merita d'être couronné à Rome dans le Capitole: honneur qui n'avoit été conféré à personne depuis le Petrarque.
Cet homme célebre étoit fort âgé; on le voyoit rarement dans les sociétés, et encore moins en public; on me dit qu'il devoit paroître le jour de l'Assomption à l'Académie des Intronati de Sienne: je partis sur-le-champ avec ma fidelle compagne: nous fûmes admis et placés à l'Académie en qualité d'étrangers. Perfetti étoit assis sur une espece de chaire; un des Académiciens lui adressa la parole; et comme il ne pouvoit s'écarter du sujet de la solemnité du jour, pour laquelle l'Académie s'étoit assemblée, il lui proposa pour argument la réjouissance des Anges à l'approche du corps immaculé de la Vierge.
Le Poëte chanta pendant un quart-d'heure des strophes à la maniere de Pindare. Rien de si beau, rien de si surprenant; c'étoit Petrarque, Milton, Rousseau,; c'étoit Pindare lui-même. J'étois bien aise de l'avoir entendu: j'allai lui faire ma visite le lendemain; sa connoissance m'en fit faire d'autres: je trouvai les sociétés de Sienne charmantes: il n'y a pas de parties de jeu qui ne soient précédées par une conversation littéraire: chacun lit sa petite composition, ou celle d'un autre, et les dames s'en mêlent aussi bien que les hommes; du moins c'étoit ainsi de mon tems; je ne sais pas si la galanterie n'y a pas obtenu la préférence exclusive, comme dans tout le reste de l'Italie.
Curieux de parcourir la Toscane, je pris en partant de Sienne la route de ce pays marécageux, que l'on appelle les Maremmes, vaste terrain inutile, défriché en grande partie par les soins du Marquis Ginori de Florence, où il avoit établi une manufacture de porcelaine, et je montai à la ville de Volterre, une des anciennes Républiques de la Toscane, bâtie sur le sommet d'une montagne très-haute et très-escarpée.
Ce pays, que peu de voyageurs vont voir, est assez intéressant par sa position, et par les vestiges qu'on y voit encore des monumens des Etrusques, et du Paganisme qui étoit leur religion.
J'entrai ventre à terre dans des catacombes; je les parcourus à l'aide de torches de cire jaune, et je reconnus ma poltronnerie das toute son étendue. Les deux guides qui me précédoient, se consultoient sur les endroits à choisir pour marcher dans le souterrain: n'allons pas par-là, disoit l'un, car la voûte a tombé il n'y a pas long-tems: allons donc par- ici, disoit l'autre; mais si cette autre voûte alloit tomber, disois-je en tremblant à mes deux conducteurs... Eh! cela n'arrive pas toujours, me répondoient-ils. J'en sortis enfin, Dieu merci, et je me promis bien de n'y plus retourner.
Qu'ai-je vu? Rien: j'étois la dupe de ma curiosité; mais je fis ce que tant d'autres avoient fait avant moi.
Ce que je vis avec plus de plaisir et sans danger, ce fut des coquilles entassées sur ces hautes montagnes, qui avoient au moins une demie-lieue d'élévation du niveau de la Méditerranée, à leur sommet; c'étoit pour la premiere fois que je voyois cette preuve incontestable de grandes révolutions de la nature, dont l'origine est encore incertaine, et dont le méchanisme n'a pas encore été découvert.
J'emportai avec moi des blocs de ces coquillages entassés, j'emportai aussi des pieces assez bien travaillées d' albâtre de Volterre, transparent, mais fort tendre.
J'ajoutai à mes nouvelles richesses de petits tuyaux, travaillés par des insectes qui en font leur retraite pendant l'hiver, et qu'on ne trouve que dans le pays de Peccioli que je traversai; et à la nuit tombante, je me trouvai aux portes de Pise, où j'allai me loger à l'Hôtel de la Poste.
Quelques mots sur la ville de Pise. - Mon aventure à la Colonie des Arcades. - Mon nouvel emploi. - Mes succès. - Mes distractions.
Pise est un pays fort intéressant: l'Arno qui traverse la Ville est plus navigable qu'il ne l'est à Florence, et le canal de communication entre cette riviere et le port de Livourne procure à l'Etat des avantages considérables.
Il y a à Pise une Université aussi ancienne et aussi fréquentée que celles de Pavie, de Padoue et de Bologne.
L'Ordre des Chevaliers de Saint-Etienne, fondé en 1562, par Côme de Médicis, tient tous les trois ans son Chapitre général dans cette Ville.
Les bains de Pise sont très-salutaires, l'air de la Ville et des environs passe pour le meilleur de l'Italie, et l'eau y est aussi pure, aussi légere et aussi passante que celle de Nocera.
Je ne devois rester à Pise que quelques jours, et j'y passai trois ans consécutifs. Je m'y étois fixé sans le vouloir: j'avois pris des engagemens sans y penser: mon génie comique n'étoit pas éteint, mais il étoit étouffé. Thalie, piquée de ma désertion, m'envoyoit de tems en tems des émissaires pour me ramener à ses drapeaux: je cédai enfin à la douce violence d'une séduction agréable, et je quittai pour la seconde fois le temple de Thémis pour revenir à celui d'Apollon.
Je ferai mon possible pour resserrer en peu de mots le cours d'un triennal, qui demanderoit pour lui tout seul un volume.
Je m'amusois à Pise, les premiers jours de mon arrivée, à examiner des curiosités qui en méritoient la peine: la Cathédrale très-riche en marbres et peintures, le clocher singulier qui penche extrêmement en dehors, et paroit droit en dedans: le cimetiere environné d'un superbe portique, et contenant une terre imprégnée de sels alcalis ou calcaires, qui en vingt-quatre heures de tems réduit les cadavres en cendre; mais je commençois à m'ennuyer, car je ne connoissois personne.
En me promenant un jour du côté du Château, je vis une grande porte-cochere, et des carrosses arrêtés, et du monde qui y entroit; je regarde en dedans, je vois une cour très-vaste, un jardin au bout, et quantité de personnes assises sous une espece de berceau.
Je m'approche davantage; je vois un homme à livrée, mais qui avoit l'air et les façons d'un homme d'importance; je lui demande à qui étoit cet hôtel, et quel étoit le motif qui rassembloit tant de monde.
Ce valet très-poli et assez bien instruit ne manqua pas de satisfaire ma curiosité. Cette assemblée que vous voyez- là, me dit-il, est une Colonie des Arcades de Rome, appellée la Colonia Alfea: la Colonie d'Alphée, fleuve très-célebre en Grece qui arrosoit l'ancienne Pise, en Aulide.
Je demande si je pouvois en jouir; très-volontiers, répond le Portier; il m'accompagne lui-même jusqu'à l'entrée du jardin; il me présente à un valet de l'Académie: celui-ci me place dans le cercle; j'écoute, j'entends du bon et du mauvais, et j'applaudis l'un et l'autre également.
Tout le monde me regardoit, et paroissoit curieux dé savoir qui j'étois: l'envie me prit de les contenter. L'homme qui m'avoit placé, n'étoit pas loin de ma chaise; je l'appelle, et je le prie d'aller demander au chef de l'assemblée, s'il étoit permis à un étranger d'exprimer en vers la satisfaction qu'il venoit d'éprouver: le chef annonce ma demande à haute voix, et l'Assemblée y consent.
J'avois dans ma tête un sonnet, que j'avois composé dans ma jeunesse dans une pareille occasion: je changeai à la hâte quelques mots qui pouvoient regarder le local; je débitai mes quatorze vers avec ce ton et ces inflexions de voix, qui relevent les sentimens et la rime. Le sonnet paroissoit avoir été fait sur-le-champ; il fut extrêmement applaudi: je ne sais si la séance devoit durer davantage, mais tout le monde se leva, et tout le monde vint autour de moi.
Voilà bien de connoissances entamées; voilà bien de sociétés à choisir: celle de M. Fabri fut pour moi la plus utile et la plus agréable. Il étoit Chancelier de la jurisdietion de l'Ordre de Saint-Etienne, et il présidoit sous le titre pastoral de Gardien à l'assemblée des Arcades.
Je vis par la suite tous les bergers d'Arcadie, que j'avois vus rassemblés: je dinois chez les uns, je soupois chez les autres: les Pisans sont très-officieux envers les étrangers: ils conçurent pour moi de l'amitié, de la considération: je m'étois annoncé comme Avocat de Venise; j'avois conté une partie de mes aventures; ils voyoient que j'étois un homme sans emploi, mais susceptible d'en avoir: ils me proposerent de reprendre la robe que j'avois quittée; ils me promirent des cliens et des livres; tout licencié étranger pouvoit exercer ses fonctions au Barreau de Pise; j'entrepris hardiment l'exercice d'Avocat Civil et d'Avocat Criminel.
Les Pisans me tinrent parole en tout, et j'eus le bonheur de les contenter. Je travaillois jour et nuit; j'avois plus de causes que je n'en pouvois soutenir: j'avois trouvé le secret d'en diminuer le fardeau à la satisfaction des cliens; je leur prouvois le tort qu'ils avoient de plaider, je tâchois de les raccommoder avec leurs parties adverses: ils me payoient mes consultations, et nous étions tous contens.
Pendant que mes affaires alloient au mieux, et que mon cabinet fleurissoit de maniere à inspirer de la jalousie à mes confreres, le diable fit venir à Pise une Troupe de Comédiens: je ne pus m'empêcher d'aller les voir; la démangeaison me prit de leur donner quelque chose du mien; ils étoient trop médiocres pour que je leur confiasse une Piece de caractere; je leur abandonnai ma Comédie à canevas, intitulée les Cent quatre accidens arrivés dans la même nuit, et ce fut dans cette occasion que j'essuyai le désagrément rapporté dans le Chapitre XLI.
Mortifié de la chûte de ma Piece, je me proposois de ne plus revoir les Comédiens, de ne plus songer à la Comédie; je redoublai l'ardeur de mon travail juridique, et je gagnai trois procès dans le même mois.
Une défense au criminel me fit aussi un honneur infini. Un jeune homme de famille avoit dérobé son voisin; il y avoit une porte forcée, et on alloit le condamner aux galeres.
Une famille respectable, un fils unique, des sœurs à marier, ne falloit-il pas le sauver?
La partie plaignante indemnisée, je fis changer la serrure de l'appartement du premier; la clef du second pouvoit l'ouvrir; le jeune homme s'étoit trompé d'étage, il avoit ouvert par méprise; l'argent étoit exposé, et l'occasion l'avoit séduit.
Je commençai mon Mémoire par le septieme verset du Psaume vingt-cinquieme: Delicta juventutis meae et ignorantias meas ne memineris, Domine. Oubliez, mon Dieu, les fautes de ma jeunesse et celles de mon ignorance; j'étayai le plaidoyer par des autorités classiques, des décisions de la Rote Romaine, de celles de la Chambre Criminelle de Florence, que l'on appelle il Magistrato degli Otto, le Tribunal des VIII; j'y mis du raisonnement et du pathétique; ce n'étoit point un coupable habitué au crime, et qui tâchoit de pallier son délit; c'étoit un étourdi qui avouoit sa faute, et ne demandoit grâce que pour l'honneur d'un pere respectable, et de deux demoiselles de qualité prêtes à marier et intéressantes.
Enfin, mon petit voleur fut condamné à garder prison pendant trois mois: la famille fut très-contente de moi, et le Juge Criminel me fit compliment. Me voilà donc attaché de plus en plus à une profession qui me rapportoit à la fois beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir et un profit raisonnable.
Au milieu de mes travaux et de mes occupations, une lettre de Venise vient me distraire, et met tout mon sang et tous mes esprits en mouvement; c'étoit une lettre de Sacchi.
Ce Comédien étoit de retour en Italie; il me savoit à Pise, il me demandoit une Comédie, et il m'envoyoit même le sujet sur lequel il me laissoit libre de travailler à ma fantaisie.
Quelle tentation pour moi! Sacchi étoit un Acteur excellent, la Comédie avoit été ma passion; je sentis renaître dans mon individu l'ancien goût, le même feu, le même enthousiasme; c'étoit le Valet de deux Maîtres le sujet qu'on me proposoit; je voyois quel parti j'aurois pu tirer de l'argument de la Piece, et de l'Acteur principal qui devoit la jouer; je mourois d'envie de m'essayer encore... Je ne savois comment faire... Les procès, les cliens venoient en foule... Mais mon pauvre Sacchi... Mais le Valet de deux Maîtres... Allons encore pour cette fois... Mais non... Mais oui... Enfin, j'écris, je réponds, je m'engage.
Je travaillois le jour pour le Barreau, et la nuit pour la Comédie; j'acheve la Piece, je l'envoye à Venise: personne ne le sait; il n'y avoit que ma femme qui étoit dans le secret; aussi a-t-elle souffert autant que moi: hélas! je passois les nuits.
Mon aggrégation aux Arcades de Rome. - Ma Comédie de l'Enfant d'Arlequin perdu et retrouvé. - Cause intéressante à Pise. - Autre Cause à Florence. - Mon voyage à Lucques. - Musique extraordinaire. - Opéra charmant. - Route délicieuse.
Pendant que je travaillois à ma Piece, je faisois fermer ma porte à la nuit tombante, et je n'allois pas passer les soirées au café des Arcades.
La premiere fois que j'y reparus, j'essuyai des reproches; je m'excusai sous prétexte d'affaires de cabinet. Ces Messieurs étoient bien aises de me voir occupé; mais ils ne vouloient pas que j'oubliasse l'amusement délicieux de la poésie.
M. Fabri arrive; il est charmé de me voir; il tire de sa poche un gros paquet, et me présente deux diplomes qu'il avoit fait venir pour moi: l'un étoit la chartre qui m'aggrégeoit à l'Arcadie de Rome, sous le nom de Polisseno; l'autre me donnoit l'investiture des campagnes fégées. Tous alors me saluerent, en chorus, sous le nom de Polisseno Fegeio , et m'embrasserent en qualité de leur Compasteur et de leur Confrere.
Nous sommes riches, comme vous voyez, mon cher Lecteur, nous autres Arcadiens; nous possédons des terres en Grece; nous les arrosons de nos sueurs, pour y recueillir des branches de lauriers; et les Turcs y sement du bled, y plantent des vignes, et se moquent de nos titres et de nos chansons.
Malgré mes occupations, je ne laissois pas de composer de tems en tems des sonnets, des odes, et d'autres Pieces de poésie lyrique, pour les séances de notre Académie.
Mais les Pisans avoient beau être contens de moi, je ne l'étois pas; je me rends justice, je n'ai jamais été bon Poëte; je l'étois peut-être pour l'invention, le Théâtre en est la preuve; c'est de ce côté-là que mon génie s'est tourné.
Sacchi me fit part, quelque tems après, du succès de ma Piece. Le Valet de deux Maîtres étoit applaudi, étoit couru on ne pouvoit pas davantage, et il m'envoya un présent auquel je ne m'attendois pas; mais il me demandoit encore une Piece, et il me laissoit le maître du sujet; il desîroit cependant que ma derniere Comédie, n'étant fondée que sur le comique, celle-ci eût pour base une fable intéressante, susceptible de sentimens et de tout le pathétique convenable à une Comédie.
C'étoit un homme qui parloit; je le connoissois bien; j'avois grande envie de le satisfaire, et ses procédés m'y engageoient encore davantage; mais mon cabinet... voilà mon esprit à la torture. J'avois dit, à ma derniere Piece, encore pour cette fois. J'avois trois jours de tems pour répondre. Pendant ces trois jours, marchant, dînant, dormant, je ne révois que Sacchi; je ne pensois qu'à lui; il falloit bien débarrasser ma tête de cet objet, pour être bon à quelque autre chose.
J'imaginai donc cette Piece connue, en France comme en Italie, sous le titre de l'Enfant d'Arlequin perdu et retrouvé. Le succès qu'a eu cette bagatelle, ne se peut concevoir; c'est elle qui m'a fait venir à Paris: Piece heureuse pour moi, mais qui ne verra jamais le jour tant que je vivrai, et qui n'aura jamais place dans mon Théâtre Italien.
Je la composai dans un tems où mon esprit étoit agité. Je donnai à cette Comédie des situations intéressantes, mais je n'eus pas le tems de les amener avec cette précision qui caractérise les bons Ouvrages. Il y avoit des diamans, peut- être, mais il étoient enchassés dans du cuivre: on voyoit qu'un Auteur avoit fait des scenes, mais l'ensemble paroissoit l'ouvrage d'un écolier. J'avoue que le dénouement de cette Piece pourroit passer pour un chef-d'œuvre de il art, si des défauts essentiels ne prévenoient pas contre la totalité de la Comédie. Son défaut principal est celui de l'invraisemblance; elle est manquée en tout point; je l'ai toujours jugée de sang froid, et je ne me suis jamais laissé séduire par les applaudissemens.
Aussi-tôt ma Piece finie, je la lus avec attention. Je reconnus toutes les beautés qui pouvoient la rendre agréable, et toutes les imperfections dont elle étoit remplie; je l'envoyai cependant à sa destinée.
L'Italie n'avoit fait que goûter les premiers essais de la réforme que j'avois projettée. Il y avoit encore assez de partisans de l'ancienne Comédie, et j'étois sûr que la mienne, sans s'éloigner beaucoup de la marche ordinaire et triviale, devoit plaire, et devoit même surprendre par ce mélange de comique et de pathétique, que j'avois artistement ménagés.
Je sus par la suite combien son succès avoit été brillant, et je n'en fus pas étonné; mais quelle fut ma surprise lorsque je vis, en arrivant en France, cette Piece suivie, applaudie, portée aux nues sur le Théâtre de la Comédie Italienne!
Il faut dire qu'en entrant aux Spectacles les hommes se forment des idées et des préventions différentes, et que les François apptaudissoient dans la Salle des Italiens ce qu'ils auroient condamné sur le Théâtre de leur Nation.
Après avoir envoyé le fils d'Arlequin à Monsieur Sacchi, qui devoit être le pere, je pris le cours de mes occupations journalieres. J'avois plusieurs Causes à faire expédier; je commençai par celle qui me paroissoit la plus intéressante.
Le Client que j'avois à défendre n'étoit qu'un paysan, mais les paysans de la Toscane sont fort à leur aise, plaident toujours, et payent assez bien.
Ils ont presque tous des héritages à bail emphitéotique pour eux, pour leurs enfans et leurs petits-enfans. Ils donnent une somme convenue à l'entrée du bail, et une redevance annuelle; ils regardent ces biens comme à eux apo partenans, ils s'y attachent, ils ont soin de les améliorer, et à la fin du bail les propriétaires en profitent.
Mon Plaideur avoit affaire à un Prieur de Couvent qui vouloit faire résilier le bail, par la raison que les Moines sont toujours mineurs, et qu'on pouvoit tirer meilleur parti de leurs terres; Je découvris le monopole. C'étoit une jeune veuve, qui, sous la protection du Révérend Pere, vouloit déposséder le villageois.
Je fis un Mémoire qui intéressoit la nation, qui prouvoit l'importance de la conservation des baux eraphitéotiques; je gagnai mon Procès, et mon plaidoyer me fit un honneur infini.
Je fus obligé quelques jours après d'aller à Florence, pour solliciter un ordre du Gouvernement pour faire enfermer, pendant la Procédure entamée, une Demoiselle au couvent.
C'étoit une fille majeure, et riche héritiere, qui avoit signé un contrat de mariage avec un Gentilhomme Florentin, Officier dans les troupes de la Toscane, et qui vouloit épouser un jeune homme qui lui plaisoit davantage.
Pendant que nous étions dans la Capitale, mon Client et moi, la fille majeure s'arrangea avec son nouveau Pretendu de maniere à éluder nos démarches. Le Procès alloit changer de face, et pouvoit devenire sérieux. Nous écoutâmes des propositions, la Demoiselle étoit riche, l'affaire fut arrangée à l'amiable.
De retour à Florence, un autre Proces m'engagea pour Lucques. J'étois bien aise de voir cette République, qui n'est ni étendue, ni puissante, mais qui est riche, agréable et très-sagement gouvernée.
J'amenai ma femme avec moi, et nous y passâmes six jours le plus agréablement du monde. C'étoit au commencement de Mai. Le jour de l'Invention de la Sainte Croix est la fete principale de la Ville; il y a dans la Cathédrale une Image de notre Sauveur, que l'on appelle il Volto Santo, la Sainte Image, et on l'expose ce jour-là avec la pompe la plus brillante, et une musique si nombreuse en voix et en înstrumens, que je n'en ai pas vu de pareilles ni à Rome, ni à Venise.
Il existe une fondation faite par un dévot Lucquois, qui ordonne de recevoir ce jour-là à la Cathédrale tous les Musiciens qui se présenteront, et de les payer, non pas a proportion de leurs talens, mais a proportion de la route qu'ils auront faite; et la récompense est fixée à tant par lieue, ou par mille.
Cette musique devoit être plus bruyante qu'agréable, mais l'Opéra que l'on donnoit à Lucques en même-tems, étoit des mieux choisis et des mieux composés. La charmante Gabrielli faisoit les délices de ce Spectacle harmonieux. Elle étoit de bonne humeur; le célebre Guadagni, qui étoit son héros sur la scene et dans le particulier, avoit soumis les caprices de la Virtuose à l'empire de l'amour. Il la faisoit chanter tous les jours, et le public accoutumé à la voir malingre, dégoûtée et dégoûtante, jouissoit pleinement de sa belle voix et de son talent supérieur.
Mes affaires arrangées, et ma curiosité satisfaite, je quittai à regret ce pays respectable, qui, sous la protection de l'Empereur, pro tempore, jouit d'une liberté tranquille, et s'occupe de la plus salutaire et de la plus exacte police.
J'étois bien aise de voir et de faire voir à ma femme une autre partie très-intéressante de la Toscane, nous traversâmes les territoires de Pescia, de Pistoia et de Prato.
Il n'y a pas de coteaux mieux exposés, de terres mieux cultivées, de campagnes plus riantes, plus délicieuses. Si l'Italie est le jardin de l'Europe, la Toscane, est le jardin d'Italie.
Mon retour à Pise. - Arrivée de mon beau-frere de Genes. - Son départ et celui de ma femme pour le même pays. - Désagrément essuyé dans mon emploi. - Réfroidîssement de mon zele. - Conversation singulière avec un Comédien. - Pièce nouvelle composée à sa requisition. - Mon voyage à Livourne.
Quelques jours après mon retour à Pise, le frere ainé de ma femme arriva de Genes; il venoit réclamer de la part de ses parens l'engagement que j'avois pris avec eux d'aller les voir.
J'avois fait deux absences pour affaires, je ne pouvois pas m'en permettre une troisieme pour mon plaisir: ma femme ne disoit rien; mais je connoissois le desir qu'elle avoit de revoir sa famille, et je prévoyois le chagrin de mon beau- frere, s'il eût été obligé de revenir tout seul chez lui: j'arrangeai les choses à la satisfaction de tous trois: mon épouse partit pour Genes avec son frere, et je restai seul et tranquille occupé des affaires de mon cabinet.
J'avois des causes dans tous les tribunaux de la Ville, j'avois des cliens de tous les états, des nobles de la premiere classe, des bourgeois des plus riches, des commerçans des plus accrédités, des Curés, des Moines, de gros Fermiers, jusqu'à un de mes confreres, qui étant impliqué dans un procès criminel, me choisit pour son défenseur.
J'avois donc toute la Ville pour moi; tout le monde au moins l'auroit cru, et je le croyois aussi; mais je ne tardai pas à m'appercevoir que je m'étois trompé; l'amitié et la considération m'avoient naturalisé dans les cœurs des particuliers, mais j'étois toujours étranger, quand ces mêmes individus se rassembloient en corps.
Il mourut dans ce tems-là un ancien Avocat Pisan, qui, selon l'usage du pays, étoit le défenseur appointé de plusieurs Communautés Religieuses, de quelques Corps d'arts et métiers, et de différentes maisons de la Ville; ce qui lui faisoit en vin, en bled, en huile et en argent, un état très-honnête, et le défrayoit de la dépense de sa maison.
Je demandai à sa mort toutes ces places vacantes pour en avoir quelques-unes: les Pisans les obtinrent toutes, et le Vénitien fut exclus.
On me disoit pour me consoler, qu'il n'y avoit que deux ans et demi que j'étois à Pise, qu'il y en avoit quatre au moins que mes antagonistes faisoient des démarches pour succéder au vieillard qui venoit de mourir, qu'il y avoit des engagemens pris, des paroles données, et qu'à la premiere occasion je serois content.
Tout cela pouvoit être vrai; mais, de vingt places, pas une pour moi! Cet événement me donna de l'humeur, et m'indisposa de maniere que je ne regardois plus mon emploi que comme un établissement casuel et précaire.
Un jour que j'étois concentré dans mes réflexions, on m'annonce un étranger qui vouloit me parler. Je vois un homme de près de six pied, gros et gras à proportion, qui traverse la salle, ayant une canne à la main, et un chapeau rond à l'Angloise.
Il entre à pas comptés dans mon cabinet; je me leve: il fait une gesticulation pittoresque, pour me dire de ne pas me gêner; il s'avance, je le fais asseoir; voici notre conversation:
Monsieur, dit-il, je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous; mais vous devez connoître mon pere et mon oncle à Venise; je suis votre très-humble serviteur Darbes. - Comment, Monsieur Darbes? Le fils du Directeur de la Poste du Frioul, cet enfant qu'on croyoit perdu, qu'on a tant cherché, qu'on a tant regretté? - Oui, Monsieur, cet enfant prodigue qui ne s'est pas encore prosterné aux genoux de son pere. - Pourquoi différez-vous à lui donner cette consolation? - Ma famille, mes parens, ma patrie ne me reverront que couronné de laurier. - Quel est votre état, Monsieur?
Il se leve, il frappe de sa main sur la rotondité de son ventre, et d'un ton mêlé de fierté et de plaisanterie: Monsieur, dit-il: je suis Comédien. Tous les talens, lui dis-je sont estimables, si celui qui les possede sait se faire distinguer; je suis, répondit-il, le Pantalon de la compagnie qui est actuellement à Livourne, je ne suis pas le dernier de mes camarades, et le public ne se refuse pas de courir en foule aux Pieces de mon emploi; Medebac, notre Directeur, a fait cent lieues pour me déterrer; je ne fais pas déshonneur à mes parens, à mon pays, à ma profession, et sans me vanter, Monsieur (donnant encore un coup de main sur son ventre), Garelli est mort, Darbes l'a remplacé.
Je veux lui faire compliment; il se range dans une posture comique qui me fait rire et m'empêche de continuer: ce n'est pas par gloriole, reprend-il, que je vous ai étalé les avantages dont je jouis dans mon état; mais je suis Comédien, je m'annonce à un Auteur, j'ai besoin de lui... - Vous avez besoin de moi? - Oui, Monsieur, je viens vous demander une Comédie; j'ai promis à mes camarades une Comédie de Goldoni, je veux tenir parole à mes camarades.
Vous le voulez? lui dis-je, en riant. - Oui, Monsieur, je vous connois de réputation; vous êtes aussi honnête qu'habile; vous ne me refuserez pas. - J'ai des occupations, je ne le puis pas. - Je respecte vos occupations, vous ferez la Piece à votre aise quand vous voudrez.
Il s'empare de ma boite en causant, il prend une prise de tabac, il laisse couler dans la tabatiere quelques ducats d'or, il la referme, il la jette sur ma table avec un de ce lazzis qui semblent vouloir cacher ce qu'on est bien aise de faire appercevoir; j'ouvre ma boite: je ne veux pas me prêter à la plaisanterie; de grâce, de grâce, dit-il, ne vous fâchez pas; c'est un à compte pour le papier; je veux rendre l'argent; des postures, des révérences; il se leve, il recule, il gagne la porte, et il s'en va.
Qu'aurois-je dû faire dans pareille circonstance? Je pris, ce me semble, le meilleur parti; j'écrivis à Darbes qu'il pouvoit compter sur la Piece qu'il m'avoit demandée et je le priai de me dire, si c'étoit en Pantalon masqué ou sans masque qu'il la desiroit.
Darbes ne tarda pas à me répondre: il ne pouvoit pas y avoir dans la lettre des postures et des contorsions, mais il y avoit des traits singuliers.
J'aurai donc, dit-il, une Comédie de Goldoni? ce sera la lance et le bouclier avec les quels j'irai affronter tous les Théâtres du monde... Que je suis heureux! j'ai parié cent ducats avec mon Directeur, que j'aurois une Pièce de Goldoni: si je gagne le pari, le Directeur paye et la Piece est à moi... Je suis jeune; je ne suis pas encore assez répandu, mais j'irai défier à Venise les Pantalons Rubini à Saint-Luc, et Cortini à Saint-Samuel; j'irai attaquer Ferramonti à Bologne, Pasini à Milan, Bellotti, dit Tiziani, en Toscane, et jusqu'à Gollinetti dans sa retraite, et Garelli dans son tombeau.
Il finissoit par dire, qu'il desiroit que son rôle fût celui d'un jeune homme sans masque, et m'indiquoit pour modele une ancienne Comédie de l'art, intitulée Pantalon Paroncin.
Ce mot Paroncin, soit pour la traduction littérale, soit pour le caractere du sujet, revient parfaitement au mot François, Petit-Maître; car Paron en dialecte Vénitien dit la même chose que Patrone en Toscan, et Maître en François; et Paroncin est le diminutif de Paron et de Patrone, comme Petit-Maître est le diminutif de Maître.
Les Paroncini Vénitiens jouoient de mon tems le même rôle à Venise que les Petits-Maitres à Paris, mais tout change. Il n'y en a plus en France, il n'y en a peut-être plus en Italie.
Je fis donc la Piece pour Darbes sous le titre de Tonin Bella Grazia, qu'on pourroit traduire en François: Toinet-le-Gentil.
J'expédiai mon Ouvrage en trois semaines; et je le portai moi-même à Livourne, Ville que je connoissois beaucoup, qui n'étoit qu'à quatre lieues de Pise, et où j'avois des amis, des cliens et des correspondans. Darbes, que j'avois fait prévenir de mon arrivée, vint me voir à l'auberge où j'étois logé; je lui fis lecture de ma Piece, il en parut très- content, et avec beaucoup de cérémonies, de révérences et de mots entrecoupés, me remit galamment le pari qu'il avoit gagné, et pour éviter les remercîmens, il s'enfuit sous prétexte d'aller communiquer la Piece à son Directeur. Je rendrai compte de cet Ouvrage à l'occasion de son début à Venise; car j'ai à entretenir actuellement mon Lecteur de quelque chose de plus intéressant.
Visite de M. Medebac, qui m'oblige d'aller dîner chez lui. - Portrait de Madame Medebac. - Je vois ma Comédie de la Donna di Garbo pour la première fois. - Détail de cette Piece. - Medebac m'engage. - Mes adieux à Pise. - Mon départ.
Après l'entretien que j'avois eu avec Darbes, je regardai à ma montre: il étoit deux heures; c'étoit trop tard pour aller demander la soupe à quelqu'un de mes amis, et j'envoyai ordonner mon dîné à la cuisine de mon Auberge.
Pendant que l'on mettoit le couvert, on m'annonce M. Medebac. Il entre, il me comble de politesses, et me prie à dîner chez lui. La soupe étoit servie sur ma table, je le remercie. Darbes, qui étoit revenu avec son Directeur, prend mon chapeau et ma canne, et me les présente. Medebac insiste de son côté; Darbes me prend par le bras gauche, l'autre par le bras droit; ils me serrent, ils me traînent, me voilà parti.
En entrant chez le Directeur, Madame Medebac vint nous recevoir à la porte de l'antichambre. Cette Actrice estimable, autant par ses mœurs que par son talent, étoit jeune, jolie et bien faite; elle me fit l'accueil le plus honnête et le plus gracieux. Nous nous mîmes à table; c'étoit un dîner de famille, mais fort honnête, et servi avec la plus grande propreté.
On avoit affiché, pour ce jour-là, une Comédie de l'art; mais on me fit la galanterie de changer les affiches, et de donner Griselda, en y ajoutant, Tragédie de M. Goldoni. Quoique cette Piece ne fut pas tout-à-fait de mot, mon amour-propre en étoit flatté, et j'allai la voir dans la loge qu'on m'avoit destinée.
Je fus estremement content de Madame Medebac, qui jouoit le rôle de Griselda. Sa douceur naturelle, sa voix touchante, son intelligence, son jeu, la rendoient à mes yeux un objet intéressant, une Actrice estimable, au-dessus de toutes celles que je connoissois.
Mais je fus bien plus satisfait le jour suivant, car l'on donna la Donna di Garbo, la brave Femme, qui avoit été jusqu'alors ma Comédie favorite.
J'avois composé cette Piece à Venise, pour Madame Baccherini; je devois la voir à Genes à son début; l'Actrice mourut avant que de la jouer, et mon voyage de Genes n'eut pas lieu; c'étoit donc pour la premiere fois que la Donna di Garbo paroissoit à mes yeux. Quel plaisir pour moi de la voir si bien jouée!
C'est ici l'occasion d'entrer dans le détail de cette Piece, que je n'ai fait qu'annoncer dans le Chapitre XLIII.
Rosaure, fille d'une Blanchisseuse en fin de la ville de Pavie, voyoit beaucoup d'étudians et quelques Professeurs de l'Université, chez sa mere, et elle étoit dans le cas de cultiver son génie pour les lettres, et se procurer en même tems un établissement honorable. Elle fut trompée par un jeune homme qui, après lui avoir tout promis, la quitta pour une autre.
Rosaure court après son amant, arrive avant lui, s'établit, à l'aide d'un domestique qu'elle connoissoit, femme-de- chambre de la belle-sœur de son infidele; elle tâche de gagner tout le monde, et elle parvient à mettre toute la famille dans ses intérêts. Le pere est un Avocat; elle connoît le droit romain et la pratique du Palais.
Le fils aîné a la passion de la loterie, Rosaure lui parle des phases de la lune, des influences, des constellations, des songes, des cabales, des combinaisons.
La femme est coquette, la suivante fait l'étalage le plus complet de tout ce qui peut flatter la coquetterie.
La demoiselle a une inclination secrette; Rosaure s'en apperçoit, la fait parler; lui promet de la seconder, donne du courage à l'amant timide, et s'engage à solliciter leur union.
Brighella est un valet fort adroit; il n'y a pas de ruses qu'elle ne connoisse. Arlequin est un valet balourd; il n'y a pas de singeries qu'elle ne fasse; elle amuse les uns, elle flatte les autres; mais son but principal est de gagner le chef de la maison, et elle le gagne si bien qu'il veut l'epouser.
Florinde arrive (c'est le nom de l'amant perfide); le pere déclare son inclination et son projet; le fils s'y oppose: il faut qu'il déclare le motif de son opposition; il est forcé d'avouer ses engagemens avec la femme-de-chambre de sa belle-sœur. Le pere voit l'impossibilité de l'épouser, force son fils à rendre justice à la jeune personne qu'il avoit trompée, et l'oblige à tenir la parole qu'il lui avoit donnée.
Florinde est récalcitrant; tout le monde est contre lui, il en rougit, il en est confondu, il l'épouse.
Voilà le triomphe de Rosaure. Mais est-elle une brave femme? Ce titre a excité beaucoup de critiques; cependant, je ne l'ai pas changé, et Rosaure fait elle-même sa justification à la fin de la Piece.
Tout le monde, dit-elle, m'a appellée jusqu'à présent une brave femme, parce que j'ai sçu flatter leurs passions et je me suis conformée à leurs caracteres et à leurs goûts; j'avoue que ce titre ne me convient pas, car j'aurois dû être, pour le mériter, plus sincere et moins séduisante.
Si Rosaure a été, pendant le cours de la Piece, une femme adroite et rusée, elle devient, par ses derniers mots, une femme raisonnable, une brave femme.
Il y eut une autre critique contre ma Piece. L'on disoit que Rosaure étoit trop instruite pour une femme; je remis ma défense entre les mains du beau-sexe, et j'eus de quoi démentir l'injustice et les préjugés.
Content de l'exécution de cette Comédie, j'en fis compliment à Madame Medebac et à son mari. Cet homme qui connoissoit mes ouvrages, et à qui j'avois confié les désagrémens que je venois d'essuyer à Pise, me tint, quelques jours après, un discours très-sérieux et très-intéressant pour moi; il faut que j'en rende compte à mes Lecteurs, car c'est d'après cet entretien avec Medebac que je renonçai à l'état que j'avois embrassé depuis trois ans, et que je repris le sentier que j'avois abandonné.
Si vous êtes décidé, me dit un jour Medebac, à quitter la Toscane, si vous comptez revenir dans le sein de vos compatriotes, de vos parens et de vos amis, j'ai un projet à vous proposer, qui vous prouvera au moins le cas que je fais de votre personne et de vos talens. Il y a à Venise, continua-t-il, deux Salles de Comédie; je m'engage d'en avoir une troisieme, et de la prendre à bail pour cinq à six ans, si vous voulez me faire l'honneur de travailler pour moi.
La proposition me parut flatteuse; il ne falloit pas d'efforts pour me faire pencher du côté de la Comédie. Je remerciai le Directeur de la confiance qu'il avoit en moi; j'acceptai la proposition, nous fimes nos conventions, et le contrat fut dressé sur-le-champ.
Je ne signai pas dans ce moment-là, car je voulois en faire part à ma femme, qui n'étoit pas encore de retour. Je connoissois sa docilité, mais je lui devois les égards de l'estime et de l'amitié; elle arrive, elle approuve, j'envoie ma signature à Livourne.
Voilà donc ma muse et ma plume engagées aux ordres d'un particulier. Un Auteur François trouvera peut-être cet engagement singulier. Un homme-de-lettres, dira-t-on, doit être libre, doit mépriser la servitude et la gêne.
Si cet Auteur est à son aise comme l'étoit Voltaire, ou cinique comme Rousseau, je n'ai rien à lui dire; mais si c'est un de ceux qui ne se refusent pas au partage de la recette et au profit de l'impression, je le prie en grâce de vouloir bien écouter ma justification.
Le prix le plus haut pour entrer à la Comédie en Italie ne passe pas la valeur d'un paole romain, dix sols de France.
Il est vrai que tous ceux qui vont dans les loges paient la même somme en entrant; mais les loges appartiennent au Propriétaire de la Salle, et la recette ne peut pas être considérable, de sorte que la part d'Auteur ne mériteroit pas la peine de courir après.
Il y a une autre ressource en France pour les gens à talens; ce sont les gratifications de la Cour, les pensions, les bienfaits du Roi. Rien de tout cela en Italie, et c'est par cette raison que la partie du monde la plus disposée peut- être aux productions d'esprit, gémit dans la léthargie et dans la paresse.
Je suis tenté quelquefois de me regarder comme un phénomene; je me suis abandonné sans réflexion au génie comique, qui m'a entraîné, j'ai perdu trois ou quatre fois les occasions les plus heureuses pour être mieux, et je suis toujours retombé dans les mêmes filets; mais je n'en suis pas fâché; j'aurois trouvé par-tout ailleurs plus d'aisance peut-être, mais moins de satisfaction.
J'étois très-content de mon état et de mes conventions avec Medebac; mes Pieces étoient reçues avant la lecture; elles étoient payées sans attendre l'événement. Une seule représentation me valoit pour cinquante: si je mettois plus d'attention, plus de zele dans les ouvrages, afin de les faire réussir, c'étoit l'honneur qui m'excitoit au travail, et la gloire me récompensoit.
Ce fut dans le mois de Septembre 1746, que je me liai avec Medebac, et je devois aller le rejoindre à Mantoue, dans le mois d'Avril de l'année suivante; j'avois donc six mois de tems pour arranger mes affaires à Pise, pour expedier des causes appointées, pour céder à d'autres celles que je ne pouvois pas continuer, pour prendre congé de mes juges et de mês cliens, et pour faire mes adieux poétiques à l'Académie des Arcades. Je remplis tous mes devoirs, et je partis après Pâques.
Mes adieux à Florence. - Le Sibillone, Amusement Littéraire. - Mon départ de la Toscane, et mes regrets. - Traversée de l'Appenin. - Mon passage par Bologne et Ferrare. - Mon arrivée à Mantoue. - Mes incommodités et mon départ pour Modene. - Arrangement de mes affaires à la Banque ducale. - Mon voyage pour Venise.
Avant que de quitter la Toscane, j'étois bien aise de revoir encore une fois la ville de Florence, qui en est la Capitale.
Faisant mes visites et mes adieux aux personnes de ma connoissance, on me proposa d'aller à l'Académie des Apatistes. Elle ne m'étoit pas inconnue, mais il s'agissoit de voir ce jour-là le Sibillone, amusement littéraire que l'on y donne de tems à autre, et que je n'avois pas encore vu.
Le Sibillone, ou la grande Sibille, n'est qu'un enfant de dix à douze ans que l'on place sur une chaire, au milieu de la salle de l'assemblée. Une personne prise au hasard parmi le nombre des assistans, adresse une demande à cette jeune Sibille; l'enfant doit sur-le-champ prononcer un mot, c'est l'oracle de la Prophétesse, c'est la réponse a la question proposée.
Ces réponses, ces oracles donnés par un Ecolier, sans même avoir le tems de la réflexion, n'ont pas pour l'ordinaire le sens commun; mais il se trouve à côté de la tribune un Académicien, qui, se levant de son siège, soutient que le Sibillone a très-bien répondu, et se propose de donner à l'instant l'interprétation de l'Oracle.
Pour faire connoître au Lecteur jusqu'où peut aller l'imagination et la hardiesse d'un esprit Italien, je vais rendre compte de la question, de la réponse et de l'interprétation dont je fus témoin.
Le demandeur qui étoit un étranger, comme moi, prie la Sibille de vouloir bien lui dire: Pourquoi les femmes pleurent plus souvent et plus facilement que les hommes. La Sibille pour toute réponse prononce le mot paille, et l'interprete, adressant la parole à l'auteur de la question, soutient que l'Oracle ne pouvoit être ni plus décisif, ni plus satisfaissant.
Ce savant Académicien qui étoit un Abbé d'environ quarante ans, gros et gras, ayant une voix sonore et agréable, parla pendant trois quarts-d'heure. Il fit l'analyse des plantes légeres, il prouva que la paille surpassoit les autres en fragilité; il passa de la paille à la femme; il parcourut, avec autant de vitesse que de clarté, une espece d'essai anatomique du corps humain. Il détailla la source des larmes dans les deux sexes. Il prouva la délicatesse des fibres dans l'un, la résistance dans l'autre. Il finit par flatter les Dames qui étoient assistantes, en donnant les prérogatives de la sensibilité à la foiblesse, et se garda bien de parler des pleurs de commande.
J'avoue que cet homme me surprit. On ne peut pas employer plus de science, plus d'érudition, plus de précision dans une matiere qui n'en paroissoit pas susceptible. Ce sont des tours de force, si vous voulez, c'est dans le goût à-peu-près du Chef-d'œuvre d'un inconnu, mais il n'est pas moins vrai que ces talens rares sont estimables, et qu'ils ne leur manque que de l'encouragement, pour se mettre au niveau de tant d'autres, et faire passer leurs noms à la postérité.
En rentrant ce même jour chez moi, je trouvai la lettre de voiture que j'attendois de Pise; mes coffres étoient à la Douane de Florence; j'allai le lendemain les faire expédier pour Bologne, et je ne tardai pas à les suivre.
Depuis la porte de la ville que je quittois à regret, jusqu'à Cafaggiolo, maison de plaisance du Grand Duc, à quatorze milles de la Capitale, je jouissois encore de l'exposition agréable et de l'industrieuse culture du pays Toscan; mais aussi-tôt que je commençai à grimper l'Appenin, je vis un changement étonnant dans le sol, dans l'air, dans la nature entiere. Je franchis, avec le dépit de la comparaison, ces trois hautes montagnes, le Giogo, l'Uccellatoio, et la Raticosa, en souhaitant que les Florentins et les Boulonnois trouvassent les moyens d'applanir cette route escarpée qui rendoit fatiguante et ennuyeuse la communication de ces deux pays intéressans; mes vœux furent exaucés quelques tems après.
Arrivés à Bologne, nous avions besoin, ma femme et moi, de nous reposer; nous ne vîmes personne: au bout de vingt- quatre heures, nous reprîmes notre route, et nous arrivâmes à Mantoue à la fin du mois d'Avril.
Medebac, qui m'attendoit avec impatience, et me reçut avec joie, m'avoit préparé mon logement chez Madame Balletti... C'étoit une ancienne Comédienne, qui, sous le nom de Fravoletta, avoit excellé dans l'emploi de Soubrette, qui jouissoit, dans sa retraite, d'une aisance fort agréable, et conservoit encore, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, des restes de sa beauté, et une lueur assez vive et piquante de son esprit.
C'étoit la belle-mere de Mademoiselle Silvia, qui fit les délices de la Comédie Italienne à Paris, et la grand'mere de M. Balletti, que je vis briller à Venise Par le talent de la danse, et qui sut se distinguer en France par celui de la Comédie.
Je passai un mois à Mantoue fort mal à mon aise, et pres-que toujours dans mon lit; l'air de ce pays marécageux ne me convenoit pas; je donnai au Directeur deux nouvelles Comédies que j'avois composées pour lui. Il en parut assez content, et ne trouva pas mauvais que j'allasse l'attendre à Modene, où il devoit se rendre pour y passer la saison de l'été; je fis bien de partir, car, à la seconde poste, je me sentis soulagé, et j'arrivai à Modene en parfaite santé.
La guerre étoit terminée: l'Infant Don Philippe étoit en possession des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalle; le Duc de Modene étoit revenu chez lui; la banque ducale proposoit des arrangemens aux rentiers, et j'étois bien aise de me trouver à portée de vaquer par moi-même à mes propres intérêts.
A la fin de Juillet, Medebac et sa Troupe arriverent à Modene; je donnai à ce Directeur une troisieme Piece; mais je gardai le début de mes nouveautés pour Venise.
C'étoit-là où j'avois jetté les fondemens d'un Théâtre Italien, et c'étoit-là où je devois travailler pour la construction de ce nouvel édifice. Je n'avois pas de rivaux à combattre, mais j'avois des préjugés à surmonter.
Si mon Lecteur a eu la complaisance de me suivre jusqu'ici, la matiere que je vais lui offrir l'engagera peut-être à me continuer sa bienveillance et son attention.
Mon style sera toujours le même, sans élégance et sans prétention, mais enflammé par le zele de mon art, et dicté par la verité.
CHAPITRE I
Ma route du bord du Var à Paris. - Ma premiere couchée à Vidauban. - Courte dissertation sur le souper et sur la soupe. - Vue de Marseille. - Vue d'Avignon. - Quelques mots sur Lyon. - Lettre de Paris. Union de l'Opéra-Comique à la Comédie Italienne. Réflexions sur moi-même. - Mon arrivée à Paris.
A l'entrée du Royaume de France, je commençai à m'appercevoir de la politesse Françoise; j'avois souffert quelques désagrémens aux douanes d'Italie, je fus visité en deux minutes à la barriere de Saint-Laurent, près du Var, et mes cofres ne furent point dérangés.
Arrivé à Antibes, que d'honnêtetés, que de politesses n'ai-je pas reçues du Commandant de cette place frontiere? J'allais lui faire voir mon passe-port: je vous en dispense, Monsieur, me dit-il, partez bien vite, on vous attend avec impatience à Paris; je continuai ma route, et je m'arrêtai pour ma premiere couchée à Vidauban.
On nous sert à souper: il n'y a pas de soupe sur la table: ma femme en avoit besoin, mon neveu en desiroit une; ils en demandent; c'est inutile; on n'en sert pas en France le soir; mon neveu soutient que c'est la soupe qui donne le nom au souper, et qu'il ne doit pas y avoir de souper sans soupe; l'Aubergiste n'y entend rien, tire sa révérence et s'en va.
Mon jeune homme dans le fond n'avoit pas tort, et je m'amusai à lui faire une petite dissertation sur l'étymologie du souper, et sur la suppression de la soupe.
Les anciens lui dis-je, ne faisoient qu'un repas par jour; c'étoit la cène qu'on servoit le soir; et comme ce repas commençoit toujours par la soupe, les François changerent le mot de cène en celui de souper: le luxe et la gourmandise multiplierent les repas; la soupe fut transportée de la cene au diner, et la cene n'est plus chez les François qu'un souper sans soupe.
Mon neveu qui avoit entrepris un petit Journal de notre voyage, ne manqua pas de placer dans ses tablettes mon érudition, qui toute bizarre qu'elle paroit, n'est pas destituée, peut-être, de quelques principes de fondement.
Nous partîmes le jour suivant de très-bonne heure de Vidauban, et nous arrivâmes le soir à Marseille. M. Cornet, Consul de Venise dans cette Ville, vint nous voir sur-le-champ; il nous offrit un appartement chez lui, nous le refusames par discrétion; mais tourmentés pendant la nuit par cette vermine insupportable qui pique et infecte en même tems, nous fûmes obligés d'accepter l'offre généreuse du frere de nos bons amis de Venise.
Nous jouîmes pendant six jours de la vue de Marseille: sa position est agréable; son commerce est très-riche, ses habitans très-aimables, et son port est un chef-d'œuvre de la nature et de l'art.
En continuant notre route, nous passâmes par Aix; nous ne fimes que traverser en voiture cette superbe promenade, appellée le Cours, et nous arrivâmes de bonne heure à Avignon.
Je reconnus à l'entrée de cette Ville les clefs de Saint Pierre, surmontées de la thiare Pontificale.
J'étois curieux de voir ce Palais qui a été pendant soixante-deux ans le siege du chef de la Religion Catholique; j'allai rendre visite au Vice-Légat; ce Prélat m'invita à diner pour le lendemain, et je vis cet ancien édifice si bien conservé, que si le Pape avoit envie d'y venir, il trouveroit encore de quoi s'y loger commodément.
Il y avoit quatre mois que j'étois parti de Venise; j'avois été malade à Bologne, mais je m'étois beaucoup amusé depuis, et je commençois à craindre que la lenteur de mon voyage ne me fit quelque tort dans l'esprit de ceux qui m'attendoient à Paris.
Arrivé a Lyon, je trouvai une lettre de M. Zanuzzi avec des reproches, à la vérité un peu vifs, mais pas aussi forts que je les avois mérités.
L'homme est un être inconcevable, indéfinissable; je ne saurois rendre compte moi-même des motifs qui me font agir quelquefois contre mes principes et contre mes projets.
Avec la meilleure volonté du monde d'être entierement à la chose qui m'intéresse, je trouve dans mon chemin des miseres, des inepties qui m'arrêtent ou qui me détournent.
Un plaisir innocent, une complaisance honnête, une curiosité; un conseil amical, un engagement sans conséquence ne sont pas des habitudes vicieuses: mais il est des cas, il est des circonstances où chaque distraction peut être dangereuse, et c'est de ces distractions dont je n'ai jas mais pu me garantir.
La lettre que je venois de lire en arrivant à Lyon, auroit dû me faire partir sur-le-chanip; mais pouvois-je quitter une des plus belles villes de France sans y donner un coups d'œil? Pouvois-je ne pas voir de près ces manufactures qui fournissent l'Europe de leurs étoffes et de leurs desseins? Je pris mon logement au Parc Royal, et j'y restai dix jours: falloit-il dix jours de tems, me dira-t-on, pour examiner les curiosités de Lyon? Non, mais ce n'étoit pas trop pour accepter tous les diners et tous les soupers que ces riches fabriquans m'offroient à l'envie.
D'ailleurs je ne faisois de tort à personne; mes honoraires à Paris ne devoient commencer que du jour de mon arrivée, et en supposant que les Comédiens Italiens eussent besoin de moi, j'étois sûr que l'activité de mon travail les auroit dédommagés en arrivant.
Mais ce besoin avoit cessé: on avoit uni pendant mon voyage l'Opéra-Comique à la Comédie Italienne, le nouveau genre l'emportoit sur l'ancien, et les Italiens qui faisoient la base de ce Théâtre, n'étoient plus que les accessoires du Spectacle.
Je fus instruit à Lyon de cette nouveauté, mais pas assez pour concevoir tout le désagrément que j'en devois ressentir; je crus au contraire que mes compatriotes, piqués d'honneur, profiteroient de l'émulation de leurs nouveaux camarades, et je les croyois en état de soutenir le combat.
Animé par cette confiance, je pris avec ma gaieté et mon courage ordinaires le chemin de la Capitale: et la beauté de la route et la fertilité des plaines que je traversois ne faisoient que me fournir des idées riantes et des espérances flatteuses.
Arrivé à Villejuif, je trouvai M. Zanuzzi et Madame Savi, premiere Actrice de la Comédie Italienne: ils nous firent passer ma femme et moi dans leur voiture; mon neveu nous suivit dans la mienne, et nous allâmes descendre au Faubourg Saint-Denis où ces deux Acteurs avoient dans la même maison leurs appartemens.
Mon arrivée fut fêtée le même jour par un souper fort galant et fort gai; une partie des Comédiens Italiens y etoit invitée; nous étions fatigués, mais nous soutînmes avec plaisir les agrémens d'une société brillante qui réunissoit les saillies françoises au bruit des conversations Italiennes.
Mon premier coup-d'œil sur la Ville de Paris. - Mes premieres visites. - Charmant dîner. - Vue de l'Opéra-Comique - Quelques mots sur ce Spectacle et sur ses Acteurs.
Fatigué du voyage, et restauré par ce nectar délicieux qui peut faire nommer la Bourgogne la terre de Promission, je passai une nuit douce et tranquille.
Mon réveil fut pour moi aussi agréable que l'avoient été les rêves de mon sommeil; j'étois à Paris, j'étois content, mais je n'avois rien vu, et je mourois d'envie de voir.
J'en parle à mon ami et mon hôte. Il faut commencer, dit-il, par faire des visites, attendons la voiture. Point du tout, lui dis-je, je ne verrai rien dans un fiacre. Sortons à pied. - Mais c'est loin. - N'importe! - Il fait chaud. Patience.
Effectivement, la chaleur cette année-là étoit aussi forte qu'en Italie: c'étoit égal pour moi; je n'avois alors que cinquante-trois ans, j'étois fort, sain, vigoureux, et la curiosité et l'impatience me prêtoient des ailes.
Je vis en traversant les Boulevarts un échantillon de cette vaste Promenade qui environne la Ville, et offre aux passans la fraicheur de l'ombre en été, et la chaleur du soleil en hiver.
J'entre au Palais-Royal. Que de monde! quel assemblage de gens de toutes especes! quel rendez-vous charmant! quelle promenade délicieuse!
Mais quel coup-d'œil surprenant frappa mes sens et mon esprit à l'approche des Tuileries! Je vois ce jardin immense, ce jardin unique dans l'Univers; je le vois dans toute sa longueur, et mes yeux ne peuvent pas en mesurer l'étendue; je parcours à la hâte ses allées, ses bosquets, ses terrasses, ses bassins, ses parterres; j'ai vu des jardins très-riches, des bâtimens superbes, des monumens précieux, rien ne peut égaler la magnificence des Tuileries.
En sortant de cet endroit enchanteur, voilà un autre spectacle frappant. Une riviere majestueuse, des ponts très- commodes et multipliés, des quais très-vastes; une affluence de voitures, une foule de monde perpétuelle; j'étois etourdi par le bruit, fatigué par la course, épuisé par la chaleur excessive; j'étois en nage, et je ne m'en appercevois pas.
Nous traversons le Pont-Royal, nous entrons dans l'Hôtel d'Aumont. M. le Duc étoit chez lui; ce premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui étoit dans son année d'exercice, m'avoit fait venir; il me reçut avec bonté, et m'honora toujours de sa bienveillance.
Il étoit tard, il ne nous restoit pas assez de tems pour faire les visites que nous avions projettées; nous prîmes une voiture, et nous allâmes chez Mademoiselle Camille Veronese où nous étions attendus pour dîner.
Il n'est pas possible d'être plus gaie et plus aimable que Mademoiselle Camille ne l'étoit. Elle jouoit les Soubrettes dans les Comédies Italiennes; elle faisoit les délices de Paris sur la scene, et celles de la société par-tout où l'on avoit le bonheur de la rencontrer.
Nous fûmes servis. Les convives étoient nombreux, le diner fort délicat, la compagnie très-amusante. Nous primes le café à table, et nous ne la quittâmes que pour aller à la Comédie.
La Salle des Italiens étoit alors rue Mauconseil, à l'ancien Hôtel de Bourgogne, où Moliere avoit déployé les lumieres de son esprit et de son art. C'étoit un jour d'Opéra-Comique, et on donnoit le Peintre amoureux de son modele , et Sancho Pança.
Ce fut pour la premiere fois que je vis ce mélange singulier de prose et d'ariettes; je trouvai d'abord que si le drame musical étoit par lui-même un ouvrage imparfait, cette nouveauté le rendoit encore plus monstrueux.
Cependant je fis des réflexions depuis; je n'étois pas content du récitatif Italien, encore moins de celui des François; et puisqu'on doit dans l'Opéra-Comique se passer de regles et de vraisemblance, il vaut mieux entendre un dialogue bien récité, que souffrir la monotonie d'un récitatif ennuyeux.
Je fus très-content des Acteurs de ce Spectacle. Le jeu de Madame La Ruette égaloit la beauté de sa voix. M. Clerval, Acteur excellent, très-agréable dans le comique, très-intéressant dans le pathétique, plein d'esprit, d'intelligence et de goût, ne faisoit alors qu'annoncer ses talens; il les porta par la suite au dernier degré de perfection, et jouit toujours du même crédit et des applaudissemens du Public.
M. Caillot étoit aussi un de ces personnages rares, auxquels rien ne manque pour se faire applaudir. M. La Ruette, supérieur dans les rôles de charge, toujours vrai, toujours exact, se faisoit estimer par son jeu, malgré la contrariété de son organe. Madame Bérard et Mademoiselle Desglands, l'une par sa vivacité, l'autre par sa belle voix, brilloient également dans les rôles de Duegnes.
Tous ces sujets admirables, estimables, ne pouvoient pas manquer de me plaire; mai je n'étois pas dans le cas de profiter de leurs talens, puisque l'inspection à laquelle j'étois destiné ne les regardoit pas.
Pour être mieux à portée de connoître mes Acteurs Italiens, je louai un appartement près de la Comédie, et je rencontrai dans cette maison une charmante voisine, dont la société m'a eté très-utile et très-agréable.
C'étoit Madame Riccoboni, qui, ayant renoncé au Théâtre, faisoit les délices de Paris par des Romans, dont la pureté du style, la délicatesse des images, la vérité des passions, et l'art d'intéresser et d'amuser en même-tems, la mettoient au pair avec tout ce qu'il y a d'estimable dans la Littérature Françoise.
C'est à Madame Riccoboni que je m'adressai pour avoir quelques notices préliminaires sur mes Acteurs Italiens. Elle les connoissoit à fond, et elle m'en fit un détail que je trouvai par la suite très-juste, et digne de son honnêteté et de sa sincérité.
Suite du Chapitre précédent. - Quelques détails sur les Acteurs Italiens de Paris. - Mon premier voyage à Fontainebleau. - Quelques mots sur la Cour. - Signature de la paix entre la France et l'Angleterre. - Les Italiens donnent sur le Théâtre de Fontainebleau l'Enfant d'Arlequin perdu et retrouvé. - Cette Piece déplaît à la Cour. - Danger des Pieces à canevas. - Mes Projets contrariés.
Monsieur Charles Bertinazzi dit Carlin, qui est le diminutif de Charles en Italien, étoit un homme estimable par ses mœurs, célebre dans l'emploi d'Arlequin, et jouissoit d'une réputation qui le mettoit au pair de Dominique et de Thomassin en France, et de Sacchi en Italie; la nature l'avoit doué de graces inimitables; sa figure, ses gestes, ses mouvemens prévenoient en sa faveur; son jeu et son talent le faisoient admirer sur la scene autant qu'il étoit aimé dans la société.
Carlin étoit le favori du Public; il avoit su si bien gagner la bienveillance du Parterre, qu'il lui parloit avec une aisance et avec une familiarité qu'aucun autre Acteur n'auroit pu se permettre. Devoit-on haranguer le Public? y avoit-il des excuses à faire? C'étoit lui qui en étoit chargé, et ses annonces ordinaires étoient des entretiens agréables entre l'Acteur et les Spectateurs.
Mademoiselle Camille étoit une excellente Soubrette, bien assortie à l'Arlequin dont je viens de parler; pleine d'esprit et de sentiment, elle soutenoit le comique avec une vivacité charmante, et jouoit les situations touchantes avec ame et avec intelligence; elle étoit sur la scene ce qu'elle étoit dans son particulier, toujours gaie, toujours égale, toujours intéressante, ayant l'esprit orné, et les qualités du cceur excellentes.
M. Collalto étoit un des meilleurs Acteurs d'Italie; c'étoit le Pantalon pour lequel j'avois beaucoup travaillé chez moi, et dont j'ai beaucoup parlé dans la deuxieme Partie de mes Mémoires.
Cet homme qui étoit Comédien dans l'aine, avoit l'art de faire parler son masque, mais c'étoit à visage découvert qu'il brilloit encore davantage: il avoit joué en Italie une de mes Pieces, intitulée les deux Jumeaux Vénitiens, dont l'un étoit balourd et l'autre spirituel; il y donna à ce sujet une tournure nouvelle, et il ajouta un troisieme Jumeau brusque, emporté; il rendit les trois différens caracteres en perfection; il fut extrêmement goûté et applaudi, et je me fis un vrai plaisir de lui abandonner tout le mérite de l'imagination.
M. Ciavarelli jouoit sous le nom de Scapin les rôles de nos Briguelles Italiens, c'étoit un excellent pantomime et d'une exécution très-exacte. M. Rubini remplissoit par interim l'emploi du Docteur de la Comédie Italienne.
J'ai parlé de ces cinq personnages avant d'entrer dans les détails des Amoureux et des Amoureuses, parce que c'étoit là la base de la Comédie Italienne à Paris.
M. Zanuzzi étoit le premier Amoureux; je le connoissois depuis long-tems; il étoit considéré en Italie, on l'appelloit par sobriquet Vitalbino, diminutif de Vitalba, Comédien Italien très-célebre, et dont j'ai fait une mention honorable dans la premiere Partie de mes Mémoires.
C'étoit M. Balletti qui le secondoit; cet Acteur, fils d'un pere Italien et d'une mere Françoise, possédoit également les deux langues, et en connoissoit le génie; des accidens fâcheux avoient affoibli son esprit et altéré sa santé, mais on reconnoissoit toujours dans son jeu l'école de Silvia qui l'avoit mis au monde, et de Lélio et de Flaminia qui avoient contribué à son éducation.
Madame Savi, premiere Actrice, et Madame Piccinelli qui étoit la seconde, n'avoient pas de dispositions heureuses pour la Comédie, mais elles étoient jeunes, et l'une par sa bonne volonté, et l'autre par l'agrément de son chant, pouvoient parvenir avec le tems à se rendre utiles; la premiere mourut quelque tems après, et la derniere quitta le Théâtre comique pour reparoître sur celui de l'Opéra en Italie.
Je voyois les jours d'Opéra-Comique une affluence de monde étonnante, et les jours des Italiens la Salle vuide; cela ne m'effrayoit pas; mes chers compatriotes ne donnoient que des Pieces usées, des Pieces à canevas du mauvais genre, de ce genre que j'avois réformé en Italie. Je donnerai, me disois-je à moi-même, je donnerai des caracteres, du sentiment, de la marche, de la conduite, du style.
Je faisois part de mes idées à mes Comédiens. Les uns m'encourageoient à suivre mon plan, les autres ne me demandoient que des farces: les premiers étoient les Amoureux qui desiroient des Pieces écrites; les derniers c'étoient les Acteurs comiques, qui, habitués à ne rien apprendre par cœur, avoient l'ambition de briller sans se donner la peine d'étudier; je me proposai d'attendre avant que de commencer. Je demandai quatre mois de tems pour examiner le goût du Public, pour m'instruire dans la maniere de plaire à Paris, et je ne fis pendant ce tems-là que voir, que courir, que me promener, que jouir.
Paris est un monde. Tout y est en grand; beaucoup de mal, et beaucoup de bien. Allez aux Spectacles, aux promenades, aux endroits de plaisirs, tout est plein. Allez aux Eglises, il y a foule par-tout. Dans une ville de huit cens mille ames, il faut de toute nécessité qu'il y ait plus de bonnes gens et plus de vicieux que par-tout ailleurs, on n'a qu'à choisir. Le débauché trouvera facilement de quoi satisfaire ses passions, et l'homme de bien se verra encouragé dans l'exercice de ses vertus.
Je n'étois ni assez heureux pour me placer dans la classe de ces derniers, ni assez malheureux pour me laisser entrainer dans l'inconduite. Je continuai à Paris ma maniere de vivre ordinaire, aimant les plaisirs honnêtes, et faisant cas des personnes qui sont faites pour édifier.
Mais plus j'allois en avant, plus je me trouvois confondu dans les rangs, dans les Classes, dans les manieres de vivre, dans les différentes façons de penser. Je ne savois plus ce que j'étois, ce que je voulois, ce que j'allois devenir. Le tourbillon m'avoit absolument absorbé; je voyois le bessoin que j'avois de revenir à moi-même et je n'en trouvois pas, ou pour mieux dire, je n'en cherchois pas les moyens.
Heureusement pour moi la Cour alloit à Fontainebleau. Les Comédiens devoient s'y rendre pour y donner leurs représentations. Je les suivis de près avec ma petite famille, et je retrouvai, dans ce séjour délicieux, le repos, la tranquillité que j'avois sacrifiés aux amusemens de la Capitale.
Je voyois tous les jours la Famille Royale, les Princes du Sang, les Grands du Royaume, les Ministres François, les Ministres Etrangers. Tout le monde se rassembloit au Château, on alloit aux levers, aux diners dans les appartemens, on suivoit la Cour à la Messe, à la chasse, aux Spectacles sans embarras, sans gêne, sans confusion.
Fontainebleau n'est ni grand, ni riche, ni décoré; mais sa position est agréable. La forêt offre des points de vue rustiques admirables, et le Château Royal, fort vaste et fort commode, est un monument précieux d'ancienne architecture, très-riche et très-bien conservé.
C'est dans ce Château de plaisance, et dans celui de Compiegne, qu'on termine pour l'ordinaire les grandes affaires de l'Etat, et ce fut à Fontainebleau que, dans l'année 1762, dont je parle actuellement, la paix fut signée entre l'Angleterre et la France.
Les Italiens donnerent, dans le courant de ce voyage, l'Enfant d'Arlequin perdu et retrouvé. Cette Piece qui avoit eu beaucoup de succès à Paris, n'en eut aucun à Fontainebleau. Elle étoit à canevas; les Comédiens y avoient mêlé des plaisanteries du Cocu imaginaire; cela déplut à la Cour, et la Piece tomba.
Voilà l'inconvénient des Comédies à sujet. L'Acteur qui joue de sa tête, parle quelquefois à tort et à travers, gâte une scene et fait tomber une Piece. Je n'étois pas attaché à cet Ouvrage; au contraire, j'en ai assez dit dans la premiere Partie de ces Mémoires, pour prouver le peu de cas que j'en faisois; mais j'étois fâché de voir tomber à la Cour la premiere Piece que l'on y donnoit de moi.
Cet évenement fâcheux me prouvoit encore davantage la nécessité de donner des Pieces dialoguées. Je revins à Paris avec une volonté ferme et vigoureuse; mais je n'avois pas affaire à mes Comédiens d'Italie, je n'étois pas le maître ici comme je l'étois chez moi.
Mon retour à Paris. - Mes observations et mes projets. - Mon logement sur le Palais-Royal. - L'Amour Paternel , ma premiere Comédie. - Petit extrait de cette Piece. - Son peu de succès. - Pieces données à la Comédie Italienne pendant le cours de deux années. - Nouvelles observations sur l'Opéra-Comique. - Quelques mots sur la Comédie Françoise.
De retour à Paris, je regardai d'un autre œil cette Ville immense, sa population, ses amusemens et ses dangers; j'avois eu le tems de la réflexion, j'avois compris que la confusion que j'y avois éprouvée, n'étoit pas un défaut du physique, ni du moral du pays; je décidai de bonne foi que la curiosité et l'impatience avoient été les causes de mon étourdissement, et qu'on pouvoit jouir et s'amuser à Paris sans se fatiguer, et sans sacrifier son tems et sa tranquillité; j'avois fait en arrivant trop de connoissances à la fois; je me proposai de les conserver, mais d'en profiter sobrement; je destinai mes matinées au travail, et le reste du jour à la société.
J'avois loué un appartement sur le Palais-Royal; mon cabinet donnoit sur ce jardin qui n'avoit pas la forme et les agrémens qu'il a aujourd'hui, mais qui offroit à la vue des beautés que quelques-uns ne cessent de regretter.
J'avois beau être occupé, je ne pouvois me passer de donner de tems en tems un coup-d'œil à cette allée délicieuse qui rassembloit à toute heure tant d'objets différens.
Je voyois sous mes fenêtres les déjeûners du Café de Foi, où des gens de tout étage venoient se reposer et se rafraîchir.
J'avois devant moi ce fameux marronnier que l'on appelloit l'Arbre de Cracovie, autour duquel les Nouvellistes se rassembloient, débitant leurs nouvelles, traçant sur le sable avec leurs cannes des tranchées, des camps, des positions militaires, et partageant l'Europe à leur gré.
Ces distractions volontaires m'étoient utiles quelquefois; mon esprit se reposoit agréablement, et je revenois au travail avec plus de vigueur et plus de gaieté.
Il s'agissoit de mon début; je devois paroitre sur la Scene Françoise avec une nouveauté qui répondit à l'opinion que ce Public avoit conçue de moi; les avis de mes Comédiens étoient toujours partagés; les uns persistoient en faveur des Pieces écrites, les autres pour les canevas: on tint une assemblée sur mon compte: j'y étois présent, je fis sentir l'indécence de présenter un Auteur sans dialogue; il fut arrêté que je commencerois par une Piece dialoguée.
J'étois content, mais je voyois de loin que les Acteurs qui avoient perdu l'habitude d'apprendre leurs rôles m'auroient sans malice et sans mauvaise volonté mal servi; je me vis contraint à borner mes idées, et à me contenir dans la médiocrité du sujet pour ne pas hasarder un ouvrage qui demanderoit plus d'exactitude dans l'exécution, me flattant que je les amenerois peu-à-peu à cette réforme à laquelle j'avois conduit mes Acteurs d'Italie.
Je composai donc une Comédie en trois actes intitulée l'Amour Paternel, ou la Suivante reconnoissante.
Pantalon a deux filles qu'il aime tendrement; il leur a donné l'éducation la mieux soignée; Clarice a fait des progrès en belles-lettres, et Angélique est devenue bonne Musicienne; le pere s'est épuisé pour ses enfans, et la mort de son frere qui lui fournissoit les moyens d'entretenir honorablement sa famille, le met hors d'état de la soutenir.
Camille, qui est à son aise, et qui avoit été Femme-de-chambre des deux filles de Pantalon, prête tous les secours possibles à son ancien maître et à ses anciennes maîtresses, et parvient à les rendre heureuses; voilà un petit Extrait qui vaut peut-être mieux que la Piece; elle n'eut que quatre représentations.
Je voulois partir sur-le-champ, mais pouvois-je quitter Paris qui m'avoit enchaîné? J'avois un engagement pour deux ans, j'étois tenté d'y rester: la plupart des Comédiens Italiens ne me demandoient que des canevas; le Public s'y étoit accoutumé, la Cour les souffroit; pourquoi aurois-je refusé de m'y conformer? Allons, dis-je, faisons des canevas, s'ils en veulent; tout sacrifice me paroît doux, toute peine me paroît supportable pour le plaisir de rester deux ans à Paris.
On ne peut pas dire cependant que les amusemens m'aient empêché de remplir mon devoir; je donnai dans l'espace de ces deux années vingt-quatre Pieces dont les titres et les succès bons ou mauvais se trouvent dans l'Almanach des Spectacles.
Huit de ces Pieces resterent au Théâtre, et me coûterent plus de peine que si je les eusse écrites en entier; je ne pouvois plaire qu'à force de situations intéressantes, et d'un comique préparé avec art, et à l'abri des fantaisies des Acteurs; je réussis plus que je ne croyois: mais quel que fût le succès de mes-Pieces, je n'allois gueres les voir, j'aimois la bonne Comédie, et j'allois au Théâtre François pour m'amuser et pour m'instruire.
J'avois mes entrées à ce Spectacle; on m'avoit fait l'honneur de me les offrir à mon arrivée à Paris; c'étoit d'autant plus flatteur pour moi, que personne n'auroit cru que je parviendrois un jour à entrer dans le Catalogue de leurs Auteurs.
Je trouvai ce Spectacle de la nation également bien monté pour le tragique et pour le comique. Les Parisiens me parloient avec enthousiasme des Acteurs célebres qui n'étoient plus; on disoit que la nature avoit cassé les moules de ces grands Comédiens; on se trompoit. La nature fait le moule et le modele et l'original tout à la fois, et elle les renouvelle à son gré. C'est l'ordinaire de tous les tems: on regrette toujours le passé, on se plaint du présent; c'est dans la nature.
Pouvoit-on desirer deux Actrices plus accomplies que Mademoiselle Duménil et Mademoiselle Clairon? L'une représentoit la nature dans la plus grande vérité, l'autre avoit poussé l'art de la déclamation au point de la perfection.
Pouvoit-on moins estimer, moins admirer dans la Comédie la noblesse et la finesse du jeu de Madame Préville, et la naïveté charmante de Mademoiselle d'Oligny?
Cette derniere a rendu un grand service aux femmes de son état. Elle leur a prouvé que les simples profits du Spectacle peuvent assurer en France une retraite agréable et décente.
M. Le Kain étoit un homme prodigieux; il avoit contre lui sa figure, sa taille, sa voix. L'art l'avoit rendu sublime, et M. Brisard jouissoit de tous les avantages de son personnel, et du mérite de son talent.
M. Molé jouoit alors les Amoureux. On a beau faire des comparaisons, on a beau remuer les cendres des anciens Acteurs, je ne crois pas qu'il y en eût un dans ce genre plus brillant, plus agréable que lui. Noble dans la passion, vif dans la gaieté, original dans les rôles chargés; c'étoit un Prothée toujours beau, toujours vrai, toujours surprenant.
A l'égard de M. Préville, je vis d'abord que tout le monde lui rendoit justice; je n'entendis pas faire de comparaisons sur son compte, aussi est-ce un Acteur qui n'a imité personne, et que personne ne pourra jamais imiter. Notre siecle a produit trois grands Comédiens presqu'en même-tems: Garrik, en Angleterre, Préville, en France, Sacchi, en Italie. Le premier a été conduit au lieu de sa sépulture par des Ducs et Pairs. Le second est comblé d'honneur et de récompenses. Le troisieme, tout célebre qu'il est, ne finira pas sa carriere dans l'opulence.
Je vais à la Comédie Françoise pour la première fois. - Je vois le Misantrope. - Quelques mots sur cet Ouvrage et sur les Acteurs. - Le Pere de Famille de M. Diderot. - Anecdotes qui regardent cet Auteur et moi. - Les Dominiqueaux, Société Littéraire.
La premiere fois que j'allai à la Comédie Françoise, on y donnoit le Misantrope, et c'étoit M. Grandval qui jouoit le rôle d'Alceste.
Cet Acteur très-habile, très-aimé, très-estimé du Public, avoit fini son tems, s'étoit retiré avec pension; au bout de quelques années l'envie lui prit de remonter sur le Théâtre, et c'étoit ce jour-là qu'il reparoissoit sur la scene.
Il fut extrêmement applaudi à sa premiere entrée; on voyoit le cas que le Public faisoit de lui, mais à un certain âge, spiritus promptus est, caro autem infirma: il ne resta pas long-tems à la Comédie, et c'est par cette raison que je n'ai pas parlé de lui dans le chapitre précédent.
Quant à moi je le trouvois excellent, et je le préférois à bien d'autres à cause de sa belle voix; mon oreille ne s'étoit pas encore familiarisée avec le langage François; je perdois beaucoup dans les sociétés et encore plus au Théâtre.
Heureusement je connoissois le Misantrope; c'étoit la Piece que j'estimois le plus parmi les Ouvrages de Moliere, Piece d'une perfection sans égale qui, indépendamment de la régularité de sa marche et de ses beautés de détail, avoit le mérite de l'invention et de la nouveauté des caracteres.
Les Auteurs comiques, anciens et modernes, avoient mis jusqu'alors sur la scene les vices et le défauts de l'humanité en général; Moliere fut le premier qui osât jouer les mœurs et les ridicules de son siecle et de son pays.
Je vis avec un plaisir infini représenter à Paris cette Comédie que j'avois tant lue et tant admirée chez moi; je n'entendois pas tout ce que les Comédiens débitoient, et ceux encore moins qui brilloient par une volubilité que je voyois applaudir, et qui étoit fort gênante pour moi, mais j'en comprenois assez pour admirer la justesse, la noblesse et la chaleur du jeu de ces Acteurs incomparables.
Ah! me disois-je alors à moi-même, si je pouvois voir une de mes Pieces jouée par des pareils sujets; la meilleure de mes Pieces ne vaut pas la derniere de Moliere, mais le zele et l'activité des François la feroient valoir bien plus qu'elle n'a valu chez moi.
C'est ici l'école de la déclamation: rien n'y est forcé ni dans le geste, ni dans l'expression; les pas, les bras, les regards, les scenes muettes sont étudiées, mais l'art cache l'étude sous l'apparence du naturel.
Je sortis du Théâtre enchanté; je souhaitois de deux choses l'une, ou de parvenir à donner une de mes Pieces aux François, ou de voir mes compatriotes en état de les imiter: quelle étoit la plus difficile à voir réaliser? il n'y avoit que le tems qui pût décider ce probleme.
En attendant je ne quittois pas les François; ils avoient donné l'année précédente le Père de Famille de M. Diderot. Comédie nouvelle qui avoit eu du succès. On disoit communément à Paris, que c'étoit une imitation de la Piece que j'avois composée sous ce titre, et qui étoit imprimée.
J'allai la voir, et je n'y reconnus aucune ressemblance avec la mienne. C'étoit à tort que le Public accusoit de plagiat ce Poëte Philosophe, cet Auteur estimable, et c'étoit une feuille de l'Année Littéraire qui avoit donné lieu à cette supposition.
M. Diderot avoit donné quelques années auparavant une Comédie intitulée le Fils Naturel; M. Fréron en avoit parlé dans son Ouvrage Périodique; il avoit trouvé que la Piece Françoise avoit beaucoup de rapport avec le Vrai Ami de M. Goldoni; il avoit transcrit les scenes Françoises à côté des scenes Italiennes. Les unes et les autres paroissoient couler de la même source, et le journaliste avoit dit en finissant cet article, que l'Auteur du Fils Naturel promettoit un Père de Famille, que Goldoni en avoit donné un, et qu'on verroit si le hasard les feroit rencontrer de même.
M. Diderot n'avoit pas besoin d'aller chercher au-delà des monts des sujets de Comédie, pour se délasser de ses occupations scientifiques. Il donna au bout de trois ans un Pere de Famille qui n'avoit aucune analogie avec le mien.
Mon Protagoniste étoit un homme doux, sage, prudent, dont le caractere et la conduite peuvent servir d'instruction et d'exemple. Celui de M. Diderot étoit, au contraire, un homme dur, un pere sévere qui ne pardonnoit rien, qui donnoit sa malédiction à son fils... C'est un de ces êtres malheureux qui existent dans la nature, mais je n'aurois jamais osé l'exposer sur la scene.
Je rendis justice à M. Diderot, je tâchai de désabuser ceux qui croyoient son Pere de Famille puisé dans le mien; mais je ne disois rien sur le Fils Naturel. L'auteur étoit fâché contre M. Freron et contre moi; il vouloit faire éclater son courroux, il vouloit le faire tomber sur l'un ou sur l'autre, et me donna la préférence. Il fit imprimer un Discours sur la Poésie Dramatique, dans lequel il me traite un peu durement.
Charles Goldoni, dit-il, a écrit en Italien une Comédie, ou plutôt une Farce en trois Actes... Et dans un autre endroit: Charles Goïdoni a composé une soixantaine de Farces... On voit bien que M. Diderot, d'après la considération qu'il avoit pour moi et pour mes Ouvrages, m'appelloit Charles Goldoni, comme on appelle Pierre le Roux dans Rose e Colas. C'est le seul Ecrivain François qui ne m'ait pas honoré de sa bienveillance.
J'étois fâché de voir un homme du plus grand mérite indisposé contre moi. Je fis mon possible pour me rapprocher de lui; mon intention n'étoit pas de me plaindre, mais je voulois le convaincre que je ne méritois pas son indignation. Je tâchai de m'introduire dans des maisons où il alloit habituellement; je n'eus jamais le bonheur de le rencontrer. Enfin, ennuyé d'attendre, je forçai sa porte.
J'entre un jour chez M. Diderot, escorté par M. Duni, qui étoit du nombre de ses amis; nous sommes annoncés, nous sommes reçus; le Musicien Italien me présente comme un homme de Lettres de son pays, qui desiroit faire connoissance avec les Athlètes de la Littérature Françoise.
M. Diderot s'efforce envain de cacher l'embarras dans lequel mon introducteur l'avoit jetté. Il ne peut pas cependant se refuser à la politesse et aux égards de la société.
On parle de choses et d'autres; la conversation tombe sur les Ouvrages Dramatiques. M. Diderot a la bonne foi de me dire que quelques-unes de mes Pieces lui avoient causé beaucoup de chagrin; j'ai le courage de lui répondre, que je m'en étois apperçu. Vous savez, Monsieur, me dit-il, ce que c'est qu'un homme blessé dans la partie la plus délicate. Oui, Monsieur, lui dis-je, je le sais; je vous entends, mais je n'ai rien à me reprocher. Allons, allons, dit M. Duni, en nous interrompant: ce sont des tracasseries littéraires, qui ne doivent pas tirer à conséquence; suivez l'un et l'autre le conseil du Tasse:
Ogni trista memoria omai si taccia;
E pongansi in obblio le andate cose.
"Qu'on ne rappelle pas des souvenirs fâcheux, et que tout ce qui s'est passé soit enseveli dans l'oubli."
M. Diderot, qui entendoit assez l'Italien, semble souscrire de bonne grace à l'avis du Poëte Italien; nous finissons notre entretien par des honnêtetés, par des amitiés réciproques, et nous partons M. Duni et moi très-contents l'un et l'autre.
J'ai été toute ma vie au-devant de ceux qui avoient des raisons bonnes ou mauvaises pour m'éviter, et quand je parvenois à gagner l'estime d'un homme mal prévenu sur mon compte, je regardois ce jour-là comme un jour de triomphe pour moi.
En sortant de chez M. Diderot, je pris congé de mon ami Duni, et j'allai me rendre à une assemblée littéraire à laquelle j'étois associé, et où je devois dîner ce jour-là.
Cette société n'étoit pas nombreuse, nous n'étions que neuf. M. de la Place, qui faisoit le Mercure de France; M. de la Garde, qui travailloit dans le même Ouvrage pour la partie des Spectacles; M. Saurin, de l'Académie Françoise; M. Louis, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Chirurgie; M. l'Abbé de la Porte , Auteur de plusieurs Ouvrages de Littérature; M. Crébillon fils; M. Favart et M. Jouen. Ce dernier ne brilloit pas par l'esprit, mais il se distinguoit par la délicatesse de sa table.
Chaque membre de la société recevoit à son tour chez lui ses confreres, et leur donnoit à diner, et comme les séances se tenoient les dimanches, on les appelloit des Dominicales, et nous étions des Dominicaux.
Il n'y avoit parmi nous d'autres statuts que ceux de la bonne société, mais nous étions convenus que les femmes n'entreroient pas dans nos assemblées; en connoissoit leur charmes, et on craignoit les douces distractions que cause le beau-sexe.
On tenoit un jour la Dominicale à l'Hôtel de Madame la Marquise de Pompadour, dont M. de la Garde étoit Secrétaire. Nous allions nous mettre à table; une voiture entre dans la cour; on y voit une femme; on la reconnoît: c'étoit une Actrice de l'Opéra, la plus estimée par son talent, la plus brillante par son esprit, la plus aimable dans la société.
Deux de nos confreres descendent et lui donnent le bras; elle monte, elle nous demande à diner en riant, en plaisantant; pouvoit-on lui refuser un couvert? Chacun lui auroit donné le sien, et je n'aurois pas été le dernier.
Cette Demoiselle étoit faite pour plaire, pour enchanter; dans le courant du repas elle demande une place dans la confrérie; elle arrange sa peroraison d'une maniere si neuve et si singuliere, qu'elle est reçue avec acclamation.
Au dessert, on regarde à la pendule, il étoit quatre heures et demie. Notre nouvelle associée ne jouoit pas ce jour- là; mais elle vouloit aller à l'Opéra, et les confreres étoient presque tous disposés à la suivre. Il n'y avoit que moi qui ne marquois pas la même disposition.
Ah! Monsieur l'Italien, dit la belle en riant, vous n'aimez donc pas la musique Françoise? Je ne la connois pas trop, lui dis-je, je n'ai pas encore été à l'Opéra; mais on chante par-tout, et je n'entends que des airs qui me font mal au cœur. Voyons, reprend-elle, voyons si je ne pourrois pas gagner quelque chose sur vous, en faveur de notre musique; elle chante, je me sens ravi, pénétré, enchanté. Quelle charmante voix! pas forte, mais juste, touchante, délicieuse; j'étois en extase. Venez, me dit-elle, embrassez-moi, et venez avec nous à l'Opéra. Je l'embrasse, et je vais à l'Opéra.
La premiere fois que je vais à l'Opéra François. - Mon attachement pour l'ensemble de ce Spectacle. - Trait d'imprudence de ma part. - Castor et Pollux me raccommode avec l'Opéra François. - Quelques mots sur Rameau, sur Gluk, sur Piccini et Sacchini.
Me voilà enfin à ce Spectacle que plusieurs personnes auroient voulu que je visse le premier, et que je n'aurois pas vu peut-être de sitôt sans l'occasion qui m'y avoit amené.
L'Actrice qui venoit d'être reçue dans notre société, monta dans sa loge avec trois de nos confreres, et je pris place avec deux autres à l'amphithéâtre; cet endroit qui occupe une partie de la salle de Spectacle en France, est en face du Théâtre, coupé en demi-cercle, et élevé en gradins bien garnis et très-commodes; c'est la position la plus heureuse pour tout voir et pour bien entendre; j'étois content de ma place, et je plaignois le parterre qui étoit debout, qui étoit serré, et qui n'avoit pas tort de s'impatienter.
Voilà l'Orchestre qui part; je trouve l'accord et l'ensemble des instrumens d'un mérite supérieur et d'une exécution très-exacte; mais l'ouverture me paroît froide, languissante; ce n'étoit pas de Rameau, j'en étois sûr; j'avois entendu de ses ouvertures et de ses airs de ballets en Italie.
L'action commence; tout bien placé que je suis, je n'entends pas un mot; patience, j'attendois les airs dont la musique m'auroit au moins amusé. Les Danseurs paroissent; je crois l'acte fini, pas un air; j'en parle à mon voisin, il se moque de moi, et m'assure qu'il y en avoit eu six dans les différentes scenes que j'avois entendues.
Comment, dis-je, je ne suis pas sourd; les instrumens ont toujours accompagné les voix; tantôt un peu plus fort, tantôt un peu plus lentement, mais j'ai tout pris pour du récitatif.
Regardez, regardez, me dit-il, voyez Vestris, voyez le Danseur le plus beau, le mieux fait, le plus habile de l'Europe.
Effectivement je vois, dans une danse champêtre, ce Berger de l'Arno l'emporter sur les Bergers de la Seine; mais deux minutes après trois personnages chantent tous les trois à la fois; c'étoit un trio que je confondis peut-être de même avec le récitatif; et le premier acte finit.
Comme il n'y a rien dans les entr'actes des Opéras François, on ne tarda pas à commencer le deuxieme acte; même musique, même ennui: j'abandonne tout-à-fait le drame et ses accompagnemens, je m'arrête à examiner, à admirer l'ensemble de ce Spectacle, et je le trouve surprenant; je vois les premiers Danseurs, les premieres Danseuses d'une perfection étonnante, et leur suite très-nombreuse et très-élégante; la musique des chœurs me paroît plus agréable que celle du drame; j'y reconnois les Psaumes de Corelli, de Biffi, de Clari.
Les décorations superbes, les machines bien ordonnées, parfaitement exécutées; des habits très-riches, beaucoup de monde sur la scene.
Tout étoit beau, tout étoit grand, tout étoit magnifique, hors la musique; il n'y avoit qu'à la fin du drame une espece de chaconne, chantée par une Actrice qui n'étoit pas du nombre des personnages du drame, et qui étoit secondée par la musique des chœurs et par des pas de danse; cet agrément inattendu auroit pu égayer la Piece, mais c'étoit un hymne plutôt qu'une ariette.
On baisse la toile; tous ceux qui me connoissent me demandent comment j'ai trouvé l'Opéra; la réponse part de mes levres comme un éclair: c'est le paradis des yeux, c'est l'enfer des oreilles.
Cette répartie insolente, inconsidérée, fait rire les uns, fait grincer les dents à d'autres; deux Messieurs de la Chapelle du Roi la trouvent excellente. L'auteur de la Musique n'étoit pas loin de ma place, il m'avoit peut-être entendu, j'étois au désespoir; c'étoit un brave homme... Requiescat in pace.
Je vis quelques jours après Castor et Pollux: ce drame parfaitement bien écrit, supérieurement décoré, me raccommoda un peu avec l'Opéra François, et je reconnus la différence qu'il y avoit entre la musique de M. Rameau et celle qui m'avoit déplu.
J'étois fort lié avec ce célebre Compositeur, et j'avois la plus haute considération pour sa science et pour son talent; mais il faut être vrai; Rameau s'étoit distingué, et avoit produit une heureuse révolution en France pour la musique instrumentale, mais il n'avoit pas fait des changemens essentiels dans la musique vocale.
On croyoit que la langue Françoise n'étoit pas faite pour se prêter au nouveau goût que l'on vouloit introduire dans le chant: Jean-Jacques Rousseau le croyoit comme les autres, et fut étonné lorsqu'il crut voir le contraire dans la musique du Chevalier Gluck.
Mais ce savant Musicien Allemand n'avoit fait qu'effleurer le goût récent de la musique Italienne, et il étoit réservé à M. Piccini et à M. Sacchini de perfectionner cette réforme, que les François semblent tous les jours goûter davantage.
Je me suis étendu dans cette petite digression sans m'en appercevoir.
Je ne suis pas Musicien, mais j'aime la musique de passion; si un air me touche, s'il m'amuse, je l'écoute avec délice, je n'examine pas si la musique est Françoise ou Italienne; je crois même qu'il n'y en a qu'une.
L'incendie de l'Opéra. - Le Concert Spirituel. - Les deux années de mon engagement à Paris touchent à leur fin. - Mon indécision. - L'Amhassadeur de Venise veut me rapprocher de ma Patrie. - Mort de ce Ministre. -Heureux événement pour moi. - Je suis employé au service de Mesdames de France. - Je cours risque de perdre la vue. - Mes défauts. - Mes ridicules dans la société.
Aurois-je pu me douter, lorsque j'assistai à la représentation de Castor et Pollux, que ces planches et ces coulisses qui avoient résisté aux flammes infernales de cet Opéra, seroient réduites en cendre avant la fin du mois?
C'est cependant ce qui est arrivé: une chandelle oubliée causa la destruction de la Salle du Palais-Royal, et l'Opéra, en attendant la construction d'un nouveau bâtiment, fut transporté au Château des Tuileries où est actuellement le Concert Spirituel.
Voici l'occasion de parler de ce Spectacle pieux, consacré aux louanges de Dieu, et qui n'est ouvert que les jours où les autres sont fermés.
C'est un Concert composé de tout ce qu'il y a de mieux en voix et en instrumens; on y chante des Psaumes, des Hymnes, des Oratorios: on y exécute des Symphonies, des Concertos, et on y fait venir des Musiciens les plus célebres de l'Europe.
Les Chanteurs étrangers dérogent pour ainsi dire à la premiere institution de ce Concert qui ne faisoit usage autrefois que de la langue Latine, mais la prononciation Françoise est si différente de celle des autres nations, que l'Etranger le plus habile et le plus agréable se rendroit ridicule à Paris, s'il s'exposoit à chanter un Motet Latin.
C'est donc de l'Italien que les Etrangers chantent: car il paroit que les autres nations n'ont pas une musique particuliere, et la liberté qu'on leur accorde de changer de langage, entraîne celle de changer les sujets de leur chant, de maniere qu'au milieu des Cantiques Spirituels on entend les Cantatilles, et ce ne sont pas celles qui font le moins de plaisir.
Il n'y a pas en Italie un Concert public, monté comme celui de Paris; nous avons à Venise les quatre Hôpitaux de Filles dont j'ai rendu compte dans la premiere Partie de ces Mémoires: il y a à Naples les Conservatoires qui sont des Ecoles de Musique vocale et instrumentale; les Peres de l'Oratoire donnent des Oratorios dans leurs Congrégations, et on trouve par-tout des Concerts de Professeurs ou d'Amateurs; mais tous ces établissemens n'offrent pas la magnificence de celui de Paris.
Je rends compte des agrémens de cette Ville pour ceux qui ne la connoissent pas; mes Mémoires pourroient être destinés à servir d'enveloppes, mais je les écris comme s'ils devoient être lus dans les quatre parties du monde.
Je connoissois tous les jours de mieux en mieux le mérite de cette Ville; je m'y attachois toujours davantage, et les deux années de mom engagement touchoient à leur fin; et je regardois comme indispensable la nécessité de changer de Ciel.
L'Ambassadeur de Portugal m'avoit fait travailler pour sa Cour: il m'avoit fait présent de mille écus pour un petit Ouvrage qui avoit réussi à Lisbonne; j'avois lieu d'espérer que ma personne n'auroit pas été refusée dans un pays où les Spectacles dans ce tems-là fleurissoient, et les talens étoient récompensés.
D'un autre côté le Chevalier Tiepolo, Ambassadeur de Venise, ne cessoit de m'encourager à rentrer dans le sein de ma Patrie qui me chérissoit, qui me desiroit; il étoit à la fin de son Ambassade, il m'y auroit reconduit lui-même; il m'auroit soutenu, protégé, mais il étoit sérieuseinent malade; il fit son entrée de congé accablé de douleurs et de peines; il alla à Geneve pour consulter le fameux Tronchin; c'est-là où il finit ses jours, au grand regret de sa République et de la Cour de France qui t'estimoient également.
Pendant l'état d'indécision où j'étois, une heureuse étoile vint à mon secours; je fis la connoissance de Mademoiselle Sylvestre, Lectrice de feue Madame la Dauphine, mere du Roi Louis XVI; cette Demoiselle, fille du premier Peintre du Roi Auguste de Pologne et Electeur de Saxe, avoit été employée à Dresde pour l'éducation de son auguste Maîtresse, et jouissoit en France auprès d'elle du crédit que ses talens et sa conduite lui avoient mérité.
Mademoiselle Sylvestre qui savoit bien l'Italien, qui connoissoit mes Ouvrages, et qui étoit foncierement bonne, serviable, obligeante, eut la bonté de s'intéresser à moi: je lui avois parlé de mon attachement pour Paris, et du regret avec lequel je me voyois forcé de l'abandonner; elle se chargea de parler de moi à la Cour, où je n'étois pas inconnu, et huit jours après elle me fit partir pour Versailles; je m'y rends immédiatement, je descends aux petites écuries du Roi, où Mademoiselle Sylvestre vivoit en societé avec ses parens, tous employés au service de la Famille Royale.
Après l'accueil le plus gracieux, le plus aimable, le plus sincere, voici le résultat de notre premiere conversation, et voici une affaire très-importante pour moi entamée et terminée dans cette heureuse journée.
Madame la Dauphine me connoissoit; elle avoit vu jouer mes Pieces à Dresde; elle se les faisoit lire, et sa lectrice ne manquoit pas de les embellir, et d'y mêler de tems en tems quelques propos en faveur de l'Auteur; elle réussit si bien auprès de sa Maîtresse, que cette Princesse lui promit de m'honorer de sa protection, et de m'attacher à la Cour.
Madame la Dauphine auroit voulu m'employer peut-être auprès de ses enfans, mais ils étoient trop jeunes pour s'occuper d'une langue étrangere; Mesdames de France, filles de Louis XV, avoient appris les principes de la langue Italienne de M. Hardion, Bibliothécaire du Roi à Versailles; elles avoient du goût pour la littérature Italienne; Madame la Dauphine profita de cette circonstance heureuse, et m'envoya chez Madame la Duchesse de Narbonne qu'elle avoit prévenue en ma faveur, pour que cette Dame me présentât à Madame Adélaïde de France, dont elle étoit alors Dame d'atours, et actuellement Dame d'honneur.
J'avois eu l'honneur de connoître Madame la Duchesse de Narbonne à la Cour de Parme; elle me reçut avec bonté, me présenta le même jour à son auguste Maîtresse, et je fus installé sur-le-champ au service de Mesdames de Francee.
Aucun traitement ne me fut proposé. Je n'en demandai aucun; trop glorieux d'un emploi si honorable, et très-sûr des bontés de mes Augustes écolieres, je partis content; je fis part de mon aventure à ma femme qui en connut le prix aussi bien que moi; je pris congé de la Comédie Italienne, qui n'étoit pas fâchée peut-être de se débarrasser de moi, et je reçus de bon cœur les complimens de tous ceux qui s'intéressoient à moi.
Celui qui connoissoit mieux que personne à quoi cet heureux événement pouvoit me conduire, étoit M. le Chevalier Gradenigo, Ambassadeur de Venise, qui avoit succédé à M. Tiepolo; cet illustre Patricien étoit l'ami intime de M. le Duc de Choiseul; il me recommanda à ce Ministre qui avoit les deux départernens les plus considérables, celui des affaires étrangeres et celui de la guerre, et étoit à juste titre l'homme le plus accrédité à la Cour de France, et le plus considéré dans l'Europe.
Avec un emploi si honorable et avec des protections si fortes, j'aurois dû faire une fortune brillante en France; c'est ma faute si je n'en ai qu'une modique; j'étois à la Cour, et je n'étois pas courtisan.
Ce fut Madame Adélaïde qui m'occupa la premiere pour l'exercice de la langue Italienne. Je n'avois pas encore de logement à Versailles; elle m'envoyoit chercher avec une chaise de poste, et ce fut dans une de ces voitures que je manquai de perdre la vue.
J'avois la folie de lire en marchant; c'étoit les Lettres de la Montagne de Jean-Jacques Rousseau qui m'intéressoient dans ce moment-là.
Je perds un jour tout-d'un-coup l'usage de mes yeux; le livre me tombe des mains, je n'y vois pas assez pour le ramasser; je me crois perdu.
Il me restoit cependant assez de faculté visuelle pour distinguer la lumiere: je descends de ma chaise, je monte à l'appartement, j'entre déconcerté, agité, dans le cabinet de Madame: la Princesse s'apperçoit de mon trouble; elle a la bonté de m'en demander la cause: je n'ose pas lui dire mon état; je me flatte de pouvoir tant bien que mal remplir mon devoir; je trouve le tabouret à sa place, je m'assieds comme à l'ordinaire; je reconnois le livre que je devois lire, je l'ouvre; oh, ciel! je ne vois que du blanc; je suis forcé d'avouer mon malheur.
Il n'est pas possible de peindre la bonté, la sensibilité, la compassion de cette grande Princesse; elle fait chercher dans sa chambre des eaux salutaires pour la vue; elle permet que je bassine mes yeux; elle fait arranger les rideaux de maniere qu'il n'y reste qu'un petit jour pour distinguer les objets, ma vue revient petit à petit, j'y vois peu, mais j'y vois assez; ce ne furent pas les eaux qui firent le miracle, mais les bontés de Madame qui donnerent de la force à mon esprit et à mes sens.
Je reprends le livre, je me vois en état de lire; mais Madame ne le veut pas. Elle me renvoie, elle me recornmande à son Médecin; en peu de jours mon œil du côté droit reprend sa vigueur ordinaire, mais l'autre je l'ai perdu pour toujours.
Je suis borgne, c'est une petite incommodité qui ne me gêne pas infiniment, et qui ne paroît pas extérieurement, mais il y a des cas, où elle ajoute à mes défauts et à mes ridicules. C'est, par exemple, à une table de jeu que je me rends incommode à la société; il faut que la lumiere soit placée de mon bon côté; s'il y a une Dame de la partie qui soit dans le même cas, elle n'ose pas l'avouer, mais elle trouve ma prétention ridicule. Au brelan on place les bougies au milieu de la table, je n'y vois pas. Au wisch on change de partenerre, au treset on change de compagnon, il faut que j'apporte le flambeau avec moi. Indépendamment du défaut de mes yeux, j'en ai encore des plus singuliers: je crains la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Il me faut des écrans qui me garantissent du feu, et une fenêtre ouverte le soir m'enrhume dans les plus fortes chaleurs.
Je ne sais pas comment des Darnes que j'ai l'honneur de connoître, peuvent me souffrir et me faire tirer une carte pour être de leur partie; c'est qu'elles sont bonnes, c'est qu'elles sont honnêtes, c'est que je joue à tous les jeux, que je ne refuse aucune partie, que le gros jeu ne m'épouvante pas, que le petit jeu ne m'amuse pas moins, que je ne suis pas mauvais joueur, et que, sauf mes défauts, je suis le bon diable de la société.
Mon logement au Château de Versailles. - Petit voyage de la Cour à Marly. - Quelques observations sur cet endroit charmant. - Le grand voyage de la Cour à Compiegne. - Quelques mots sur cette ville et sur les Camps de cette année- là. - Mort de l'Infant Don Philippe, Duc de Parme. - Mon voyage a Chantilly.
Au bout de six mois de service, j'eus mon logement au Château de Versailles; on me donna l'appartement qui étoit destiné pour l'accoucheur de Madame la Dauphine, dont cette Princesse pouvoit disposer, vu le mauvais état de la santé de Monsieur le Dauphin.
Il y eut dans le mois de Mai de la même année 1765 un petit voyage à Marly; je suivis Mesdames, et je jouis de ce séjour délicieux.
Après avoir vu le jardin des Tuileries et le parc de Versailles, je croyois que rien dans ce genre n'auroit pu me surprendre; mais la position et les agrémens du jardin de Marly me firent une telle impression, que j'aurois donné la préférence à cet endroit enchanteur, si le souvenir de l'étendue et de la richesse des autres n'eût pas réglé mes comparaisons: ceux qui ont vu ce château, son jardin, son parterre immense, ses compartimens, ses desseins, ses jets-d'eau et ses cascades, doivent me rendre justice; et les descriptions exactes que nous en avons, viennent à l'appui de mon jugement.
Mais ce qui augmente les plaisirs et les agrémens de cette partie de campagne, c'est le sallon du jeu; tout le monde connu peut y entrer, et il y a des travées pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas pénétrer dans le cercle.
Je préférai une place dans les travées pour voir la premiere fois l'arrivée du Roi et de sa suite dans ce sallon; c'est un coup d'œil frappant; le Roi entre suivi de la Reine, des Princes, des Princesses, et de tout son cortege, et prend sa place à la grande table, environnée de tout ce qu'il y a de plus grand dans le Royaume. La Reine faisoit ce jour- là sa partie au cavagnol; Madame la Dauphine et Mesdames de France tenoient diffèrentes tables de jeu. On m'apperçoit à l'endroit où j'étois; on me fait dire de descendre, et je me vois confondu dans la foule des Seigneurs, des Ducs, des Ministres, des Magistrats. On jouoit au lansquenet à la table du Roi, où chacun tenoit la main à son tour: on disoit que Louis XV étoit heureux au jeu; j'attendis que ce fût lui qui tint la banque; je donnai six fouis à jouer pour mon compte en faveur de la banque, et je gagnai.
Le Roi part; la famille Royale le suit. Le monde reste; on joue alors comme on veut, tant qu'on veut; il y eut une Dame qui resta un jour et deux nuits à la même table, faisant venir du chocolat et des biscuit pour nourrir en même tems son individu et sa passion.
Malgré les plaisirs qui faisoient le but principal de cette agréable partie de campagne, j'avois tous les jours mes heures réglées pour travailler avec Mesdames; je me trouvai un jour sur le passage d'une de mes augustes Ecolieres qui alloit se mettre à table, elle me regarde, et me dit: à tantôt.
Tantosto, en Italien, veut dire immédiatement. Je crois que la Princesse veut prendre sa leçon à la sortie de son diner; je reste et j'attends aussi patiemment que l'appétit me le permettoit, et enfin à quatre heures du soir la premiere femme-de-chambre me fait entrer.
La Princesse, en ouvrant son livre, me fait la question qu'elle avoit l'habitude de me faire presque tous les jours; elle me demande où j'avois dîné ce jour-là. Aucune part, Madame, lui dis-je. - Comment, dit-elle, vous n'avez pas dîné? - Non, Madame. - Etes-vous malade? - Non, Madame. - Pourquoi donc n'avez-vous pas diné? Parce que Madame m'avoit fait l'honneur de me dire, a tantôt. - Ce mot prononcé à deux heures ne veut-il pas dire au moins à quatre heures de l'après- midi? - Cela se peut, Madame, mais ce même terme signifie, en Italien, tout-à-l'heure, immédiatement. Voilà la Princesse qui rit, qui ferme son livre, et m'envoie diner.
Il y a des termes François et des termes Italiens qui se ressemblent, et dont l'acception est tout-à-fait différente; je donnois encore dans des qui pro quo, et je puis dire que le peu de françois que je sais, je l'ai acquis pendant trois années de mon emploi au service de Mesdames; elles lisoient les Poëtes et les Prosateurs Italiens: je bégayois une mauvaise traduction en François; elles la répétoient avec grace, avec élégance, et le Maître apprenoit plus qu'il ne pouvoit enseigner.
De retour à Versailles, la santé de Monseigneur le Dauphin paroissoit aller beaucoup mieux: il aimoit la musique, et Madame la Dauphine en faisoit chez elle pour l'amuser.
Je composai une Cantate Italienne; je fis faire la musique par un Compositeur Italien, et je la présentai a cette Princesse, qui, en l'acceptant, m'ordonna avec bonté d'aller en entendre l'exécution après son souper dans sa chambre.
J'appris dans cette occasion une étiquette de Cour que je ne connoissois pas: j'entre dans l'appartement sur les dix heures du soir, je me présente à la porte du cabinet des nobles; l'Huissier ne m'empêche pas d'y entrer: Monseigneur le Dauphin et Madame la Dauphine étoient à table; je me range pour les voir souper; une Dame de service vient à moi, et me demande, si j'avois mes entrées du soir. Je ne sais pas, Madame, lui dis-je, quelle est la différence entre les entrées du jour et celles du soir; c'est la Princesse elle-même qui m'a ordonné de venir dans sa chambre après son souper. Je suis venu trop tôt, peut-être, je ne savois pas l'étiquette... Monsieur, reprit la Dame, il n'en est pas pour vous, vous pouvez rester; j'avoue que mon amour-propre n'a pas été dans cette occasion mal satisfait.
Je reste. Le Prince et la Princesse rentrés, on me fait appeller, et ma Cantate est exécutée. Madame la Dauphine touchoit du clavecin, Madame Adélaïde accompagnoit avec le violon, et c'étoit Mademoiselle Hardy (aujourd'hui Madame de la Brusse) qui chantoit. La musique fit plaisir, et l'on fit à l'Auteur des paroles des complimens que je reçus très-modestement. Je voulois sortir, Monsieur le Dauphin eut la bonté de me faire rester; il chanta lui même, et j'eus le bonheur de l'entendre. Mais que chanta-t-il? Un air pathétique tiré d'un Oratorio intitulé le Pélerin au Sépulcre .
Ce Prince dépérissoit tous les jours; mais il avoit du courage, et l'envie de tranquilliser la Cour sur son état, le faisoit souffrir en secret, et lui donnoit des forces en public.
Le Roi alloit régulierement tous les ans passer six semaines en été à Compiegne, et autant en automne à Fontainebleau. On appelle ces parties de campagne les grands voyages, parce que tous les Départemens et tous les Bureaux des Ministres y vont, et les grand Officiers de la Couronne et les Ministres Etrangers s'y rendent aussi.
On les fit l'un et l'autre dans cette année 1765, après le petit voyage de Marly; et celui de Compiegne a été un des plus magnifiques et des plus brillans.
On fit venir plusieurs Régimens François et Etrangers au service de la Couronne de France. Chacun à son tour, et dans différentes journées, formoit des Camps dans les environs de la ville. Ils faisoient l'exercice à feu avec les évolutions que la Tactique sait proportionner à l'emplacement, et l'émulation et la présence du Souverain rendoit encore l'exécution plus exacte.
Les revues étoient encore plus intéressantes par le cortege du Roi. Ce Monarque, monté sur un superbe cheval, étoit suivi par une cohorte très-nombreuse de Cavaliers richement ornés. La Reine, la Dauphine, Mesdames paroissoient dans des voitures de la plus grande magnificence. Les Princesses du Sang et les Dames de la Cour augmentoient la pompe de cette suite éclatante, et l'affluence du peuple qui arrivoit de tous les côtés, mettoit le comble à la grandeur du Spectacle.
M. le Dauphin, Colonel du Régiment des Dragons Dauphin, commanda lui-même la revue particuliere de son Régiment, la veille du jour qu'il devoit paroître devant le Roi.
Après l'exercice très-long et très-fatiguant dont j'avois été témoin, et dans lequel M. le Dauphin avoit fait des efforts qui me faisoient trembler, je revins au Château dans une voiture de la Cour, et je me mis tout seul dans l'embrâsure d'une porte pour voir rentrer ce Prince chez lui. Il arrive, il me voit; il me fixe avec une espece de fierté guerriere, Regardez-moi, paroissoit-il dire, je suis fort, je suis robuste, je me porte bien; c'étoit un esprit vigoureux qui animoit un corps languissant.
Dans cette même année, et pendant ce voyage, un courier de Parme apporta la triste nouvelle de la mort de l'Infant Don Philippe, mon Protecteur et mon Maître. La Cour de France prit le deuil pour trois mois; je le portai bien plus long- tems, et je le porte encore dans mon cœur.
Ce n'étoit pas l'intérêt qui excitoit mes regrets, je connoissois la bonté de l'Infant son fils, j'étois sûr qu'il m'auroit continué sa protection et sa bienveillance; mais je pleurois la perte d'un Prince bon, sage, juste, équitable; les Parmesans auroient été encore plus à plaindre, si leur Duc regnant n'eût pas réparé leur perte, en suivant les traces et les vertus de son pere. Je me rappelle avoir parlé de ce Prince avec les mêmes sentimens dans la deuxième Partie de mes Mémoires; qu'on ne trouve pas cette répétition inutile; on n'en dit jamais trop quand il s'agit de faire honneur à la vérité.
Je vis quelques jours après, à Compiegne, M. le Comte d'Argental, Ministre Plénipotentiaire de la Cour de Parme à Paris; il m'assura que ma pension me seroit continuée, et il la fit même transporter pour ma plus grande commodité sur le trésor de Parme à Paris.
C'est la moindre des obligations que j'aie à M. d'Argental, à cet ami de Voltaire, très-aimable, très-instruit, qui m'a toujours favorisé, protégé, chez lequel il y eut toujours un couvert pour moi a sa table, et une place à ce charmant Spectacle qu'il donne de tems en tems dans son petit Théâtre de société, où j'admirai les Ouvrages et le jeu de M. le Chevalier de Florian, et les talens et les graces de Madame de Vimeux.
Le voyage de Compiegne avoit commencé avec une apparence de gaieté; mais il alloit finir avec une tristesse réelle. La santé de M. le Dauphin alloit de mal en pis; il croyoit que l'exercice lui auroit fait du bien, au contraire la fatigue l'avoit épuisé.
J'avois perdu un Protecteur, et je me voyois à la veille d'en perdre un autre; j'étois triste, et je ne trouvois rien dans l'endroit où j'étois qui pût m'égayer. La Forêt de Compiegne est superbe; mais je la trouvois trop peignée, trop uniforme et trop éloignée de la ville.
Je ne manquois pas de sociétés; mais tout le monde étoit triste comme moi; je craignois moi-même pour ma santé; le foyer de mon ancienne mélancolie alloit se rallumer: je cherchois quelque distraction agréable, j'en trouvai une charmante à Chantilly.
Je pris cette route pour retourner à Versailles; je jouis pendant deux jours de ce Château délicieux, appartenant au Prince de Condé. Que de beautés! que de richesses! quelle position heureuse! quelle abondance d'eau! Je n'y ai pas perdu mon tems, j'ai tout vu, j'ai tout examiné, les jardins, les écuries, les appartemens, les tableaux, le cabinet d'histoire naturelle.
Cette immense collection de ce qu'il y a de plus rare dans les trois regnes de la nature, est l'ouvrage de M. Valmont de Bornare, et c'est ce Naturaliste célebre qui en est le Directeur et le Démonstrateur.
Je partis de Chantilly très-content; mon ame se trouva soulagée, et je revins à Versailles en état de remplir mes devoirs à la Cour.
Voyage de Fontainebleau. - Quelques mots sur le Château et sur la ville. -Mort du Dauphin. - Le Duc de Berry prend le titre de Dauphin. - Mon retour à Versailles. - Triste compliment à mon arrivée. - Mort de Madame la Dauphine, celle du Roi de Pologne et celle de la Reine de France sa fille. - Ma position douloureuse. - Présent de Mesdames. - Mon état fixé. - Propos des Parisiens sur Versailles.
La Cour s'étoit à peine rendue à Versailles, qu'on commençoit à parler du voyage de Fontainebleau; il étoit fixé Pour le 4 Octobre, mais l'état de M. le Dauphin le rendoit incertain.
Ce Prince aimable, complaisant, étoit au désespoir que le Roi fût privé d'un plaisir, et que les habitans de Fontainebleau perdissent les profits que la présence de la Cour et l'affluence des étrangers pouvoient leur procurer, de maniere que tout malade et tout souffrant qu'il étoit, quand il s'agissoit de Fontainebleau, il s'efforçoit d'être gai, et faisoit semblant de se bien porter.
Je n'en étois pas la dupe, et bien du monde pensoit comme moi; cependant le voyage fut décidé et exécuté: il seroit injuste et déraisonnable de croire que le Roi et la famille Royale fussent moins intéressés que les autres à la santé et à la tranquillité de ce Prince qui faisoit leurs délices et leur bonheur; mais il est dans la nature que ceux qui sont les plus intéressés à la conservation d'un objet, voyent moins les dangers, et se flattent de contribuer à la santé du malade par le changement d'air et par des amusemens.
Nous partîmes donc pour ce Château de plaisance au commencement d'Octobre: la position du pays, et les agrémens qu'on y trouve, rendirent pendant quelques jours ce voyage charmant.
Les Spectacles de Paris venoient y représenter à leur tour, et les Auteurs y donnoient de préférence leurs nouveautés.
Il y avoit Spectacle quatre fois par semaine; et on y entroit moyennant des billets que le Capitaine des Gardes en exercice avoit droit de donner.
Je me présentai un jour avec un de ces billets à la porte d'entrée; elle n'étoit pas encore ouverte: j'étois un des premiers; je me flattois avec raison d'entrer avec plus de facilité, et d'être dans le cas de choisir ma place: il n'est pas possible d'être plus pressé, plus foulé que je le fus en entrant, et arrivé à la salle, je la trouve remplie de monde, et je suis forcé de m'asseoir sur la derniere banquette.
Tout ce monde n'étoit pas entré par la porte où l'on présentoit les billets: je n'en voulus pas savoir davantage, je pris un autre parti, et je m'en trouvai bien; j'avois de bonnes connoissances dans le corps diplomatique: on me permettoit d'entrer à la suite des Ministres étrangers; j'étois bien placé, et je voyois le Spectacle à mon aise.
Le Chevalier Gradenigo, Ambassadeur de Venise, avoit toujours des bontés pour moi; c'est par son moyen que j'eus l'honneur de faire la connoissance de S. E. Monsieur l'Estevenon de Berkenrod, Ambassadeur de Hollande, qui m'a toujours honoré de sa protection, et c'étoit dans ce corps respectable que je passois très-agréablement une bonne partie de mon tems.
Nous voilà donc dans la gaieté, dans les plaisirs, dans les amusemens; mais tout change de face à la moitié du voyage; Monseigneur le Dauphin ne peut plus soutenir avec indifférence le feu qui le mine intérieurement; le courage lui devient inutile, les forces l'abandonnent; il est alité; tout le monde tombe dans la consternation; la maladie fait des progrès effrayans; la Faculté n'a plus de ressources; on a recours aux prieres: Monseigneur de Luynes, Archevêque de Sens, et maintenant Cardinal, va tous les jours en procession, suivi d'un monde infini, à la Chapelle de la Vierge qui est au bout de la Ville; on fait le vœu d'y élever un temple, si l'intercession de la Mere de Dieu rend la santé au Prince moribond; il étoit écrit dans les décrets de la Providence qu'il n'acheveroit pas sa carriere; il mourut à Fontainebleau vers la fin de Décembre.
J'étois au Château dans ce moment fatal; la perte étoit grande, la désolation générale. Quelques minutes après j'entends crier tout le long des appartemens, Monsieur le Dauphin, Messieurs; je reste interdit, je ne sais ce que c'est, je ne sais où je suis: c'étoit le Duc de Berry, le fils aîné du défunt, qui devenu l'héritier présomptif de la Couronne, venoit, mouillé de ses larmes, consoler le peuple affligé.
Ce voyage qui devoit finir à la moitié de Novembre, avoit été prolongé jusqu'à la fin de l'année; tout le monde étoit pressé de partir; je l'étois aussi; mais je cédai la place à ceux dont le service étoit plus nécessaire, et je partis le dernier. L'année étoit des plus mauvaises; il avoit tombé beaucoup de neige; les chemins étoient glacés; les chevaux ne pouvoient se tenir sur leurs pieds: j'employai deux jours et une nuit dans cette route que l'on peut faire en sept heures de tems.
Arrivé à Versailles, je suis visité sur-le-champ par un valet du Concierge du Château, qui, de la part de son Maître, me demande la clef de mon appartement; Monsieur le Dauphin étant décédé, l'accoucheur de Madame la Dauphine étoit censé supprimé; cette Princesse n'avoit plus le droit d'en disposer; je ne devois plus en jouir, et on l'avoit destiné apparemment pour quelqu'un qui valoit mieux que moi.
Je crus ne devoir pas dialoguer avec l'homme qui me parloit; je le renvoyai, en lui disant que j'avois besoin de me reposer. Je fis mes réflexions pendant la nuit; je vis que dans la circonstance où la Cour étoit, il n'étoit pas décent que j'allasse porter des plaintes, ni demander protection. Je louai tout bonnement un logement dans la ville, et je rendis la clef de l'appartement.
Il n'étoit plus question d'Italien chez Mesdames; cependant je n'osois pas m'éloigner de Versailles; mes finances alloient mal; j'avois eu une gratification de cent louis sur le Trésor Royal, mais c'étoit pour une fois; j'avois besoin de tout, et je n'osois rien demander.
Je voyois de tems en tems mes augustes Ecolieres; elles me regardoient avec bonté; mais je ne travaillois plus avec elles; je ne savois comment m'y prendre pour leur faire concevoir mon état, et ces Princesses étoient trop affligées pour penser à moi. Mes revenus d'Italie arrivoient lentement; mon ami Sciugliaga m'avança cent sequins, et j'attendois patiemment que le trouble cédât la place à la sérénité.
Mais la tristesse alla fort loin, et les malheurs se succéderent l'un à l'autre. Madame la Dauphine succomba à sa douleur, et fut enterrée dans le même tombeau que son Epoux. La mort du Roi de Pologne, Pere de la Reine de France, arriva quelque tems après, et celle de son auguste Fille mit le comble à l'affliction publique.
Pouvois-je approcher de Mesdames, et leur parler de moi? Non. Et quand je l'aurois pu, je ne l'aurois pas fait; je respectois trop leur douleur, et j'avois trop de confiance en leurs bontés, pour ne pas souffrir en silence. Je savois mesurer mes desirs et mes forces, et hors les cent sequins que je devois a un ami, je ne devois rien à personne.
Enfin les sombres nuages commençoient à se dissiper. Tous les deuils étoient cessés, et la Cour reprenoit peu-à-peu cette aménité qu'elle avoit perdue. Mesdames eurent la bonté de me faire appeller: je reçus un présent de cent louis dans une boite d'or ciselée, et il fut question de m'assurer un état.
Mesdames demanderent pour moi le titre et les émolumens d'Instituteur d'Italien des Enfans de France. Le Ministre de Paris et de la Cour y trouva des difficultés. Ce seroit, disoit-il, un nouvel emploi à la Cour, et une nouvelle charge pour l'Etat. Il y avoit mille choses que j'aurois pu demander; je ne demandai rien; je continuai à servir, à attendre et à espérer. Ce fut au bout de trois ans que mes augustes Protectrices me procurerent un traitement annuel.
Elles envoyerent chercher le Ministre. Il ne s'agit pas, lui dirent-elles, de créer un nouvel emploi pour un homme qui devroit servir, il s'agit de récompenser un homme qui a servi; elles demanderent pour moi six mille livres par an. Le Ministre trouva que c'étoit trop. Je crois, dit-il, que M. Goldoni sera content de quatre mille francs d'appointemens. Mesdames le prirent au mot, et l'affaire fut faite sur-le-champ.
J'étois content; j'allai remercier Mesdames, elles étoient encore plus contentes que moi; elles eurent la bonté de m'assurer que, d'une maniere ou de l'autre, j'aurois eu pour Ecoliers leurs Neveux et leurs Nieces, et que le traitement que je venois d'obtenir, n'étoit que le commencement des bienfaits dont elles espéroient me faire jouir. Si je n'ai pas profité de cette faveur, c'est ma faute; je ne savois pas demander; j'étois à la Cour, et je n'étois pas courtisan.
La premiere fois que mon ordonnance me fut payée, on ne me donna au Trésor Royal que 3600 liv., on me retint 400 liv. pour le vingtieme. Si j'avois parlé, j'étois dans le cas, peut-être, de l'exemption de cet impôt; je ne dis mot; je suis resté là, toujours là.
Mon état n'étoit pas bien considérable, mais il faut se rendre justice. Qu'avois-je fait pour le mériter? J'avois quitté l'Italie pour venir en France. La Comédie Italienne ne me convenoit pas, je n'avois qu'à retourner chez moi. Je suis attaché à la Nation Françoise; trois ans d'un service doux, honorable, agréable, me procurerent l'agrément d'y rester; ne dois-je pas me croire heureux? Ne dois-je pas me trouver content?
D'ailleurs, Mesdames m'avoient dit: vous aurez pour Ecoliers nos Neveux. Il y avoit trois Princes et deux Princesses. Que de perspectives heureuses! que d'espérances fondées! N'étoit-ce pas assez pour mon ambition? Pourquoi aurois-je brigué des emplois, des charges, des commissions, qui de droit auroient mieux convenus à un national qu'à un étranger? Je n'ai jamais demandé de graces pour moi ni pour mon neveu, que dans le cas où un Italien pouvoit être préférable à un François.
Aussi-tôt que mon traitement fut reglé, Mesdames cesserent de s'occuper de la Langue Italienne, et donnerent à d'autres études les heures qu'elles m'avoient destinées.
J'étois maître alors d'aller par-tout; j'avois envie d'aller rétablir mon séjour à Paris; mais je m'amusois assez bien à Versailles, et j'y restai encore quelque tems. On dit communément à Paris que la vie de Versailles est fort triste, qu'on s'y ennuye, et que les particuliers ne savent que devenir. Je puis prouver le contraire; ceux qui se déplaisent dans leur état, doivent s'ennuyer par-tout. Ceux qui y trouvent de l'agrément sont aussi bien à Versailles que par-tout ailleurs, et ceux qui n'ont rien à faire, trouvent à employer leurs matinées utilement ou agréablement, au Château, dans les Bureaux, dans le Parc, et trouvent partout des objets intéressans, et des plaisirs variés.
C'est dans l'après-midi qu'on cherche les amusemens de la société, et il y en a, proportion gardée, aussi bien à Versailles qu'à Paris. On y trouve des parties de jeu, des concerts, de la littérature, avec cette différence, qu'à Paris on manque bien souvent les sociétés que l'on cherche, à cause de la distance des lieux; et à Versailles on les a sous la main, et les pauvres piétons n'y sont pas dans la dure nécessité de rester chez eux, ou de se ruiner en voitures.
On dit que les Dames employées au service de la Cour ne parlent que de leurs Princesses, et que les Commis des Bureaux ne s'entretiennent que de leurs départemens. Cela peut être. Tractant fabrilia fabri, de tauris tractat arator . Mais je sais que je m'y suis bien amusé, et sans les Spectacles qui ne brillent qu'à Paris, j'aurois fixé, peut-être, mon séjour à Versailles.
Je regrette les amis que j'y ai laissés, que j'aime toujours, et que j'aimerai toute ma vie. J'aurois envie de les nommer, pour leur donner une preuve de mon souvenir, de mon estime et de ma reconnoissance, mais ils sont en trop grand nombre, et j'aurois l'air de vouloir me parer de tous ces noms respectables, pour en tirer vanité.
Mon retour à Paris. - Nouvelle Société Littéraire. - Difficulté des traductions. - Quelques-unes de mes Pieces traduites en François. - Théâtre d'un inconnu. Traduction de mon Avocat Vénitien. - Celle de mon Valet de deux Maîtres. - Choix des meilleures Pieces Italiennes. - Quelques mots sur cet Ouvrage. - Dialogue entre un Monsieur, une Dame et moi.
Je revins m'établir à Paris, mais je gardai un pied à terre à Versailles: j'étois intéressé à faire ma cour à mes augustes Protectrices, et à voir si la langue et la littérature Italiennes ne gagneroient pas quelques partisans parmi les jeunes Princes et les jeunes Princesses.
L'étude des langues étrangeres n'est pas comprise à la Cour de France dans les classes nécessaires à l'éducation: c'est un amusement que l'on accorde à celui qui le demande, et qui est dans le cas d'en profiter: il n'y avoit qu'un des trois Princes qui paroissoit disposé à apprendre l'Italien; M. l'Abbé de Landonviller, de l'Académie Françoise, fut chargé de ce soin. Il employa sa Maniere d'apprendre les Langues, imprimée en 1768; il y réussit à merveille, et le Prince fit des progrès admirables.
J'étois sans emploi et sans occupation; pendant mes trois années de service à la Cour je n'avois rien fait, et je cherchois l'occasion d'employer mon tems utilement: M. de la Place et M. Favart, deux membres de notre ancienne Dominicale, me proposerent une nouvelle société littéraire; c'étoit un pique-nique à l'épée de bois, vis-à- vis les Galeries du Louvre; on s'y rassembloit une fois par semaine, on y étoit bien servi, la compagnie étoit aimable, et nos conversations fort utiles.
Voici les noms des convives: M. de la Place, M. Coquelet de Chaussepierre, M. de Veselle, M. Laujon, M. Louis, M. Dorat, M. Colardeau, M. du Doyez, M. Barthe, M. Vernet, et moi.
Au bout de quelque tems M. le Comte de Coigny voulut bien honorer nos dîners de sa présence, et augmenter l'agrément de nos entretiens; mais nos assemblées ne durerent pas long-tems: on ne pouvoit introduire personne sans l'aveu général: un des associés s'avisa d'y amener un de ses amis qui ne plaisoit pas à tout le monde: c'étoit un homme de mérite, mais il étoit Auteur d'une feuille périodique; il avoit déplu à quelqu'un de la société, et le pique-nique finit comme la Dominicale.
J'en étois fâché, car il m'étoit utile de vivre avec des personnes qui savoient parfaitement leur langue; j'aspirois dèsolors à faire quelque chose en François: je voulois prouver à ceux qui ne connoissoient pas l'Italien, que j'occupois une place parmi les Auteurs dramatiques, et je concevois qu'il falloit tâcher de réussir ou ne pas s'en mêler.
J'essayai de traduire quelques scenes de mon Théâtre: mais les traductions n'ont jamais été de mon goût, et le travail me paroissoit même dégoûtant sans l'agrément de l'imagination.
Plusieurs personnes étoient venues me demander mon aveu pour traduire mes Comédies sous mes yeux, d'après mes avis, et avec la condition de partager le profit: depuis mon arrivée en France jusqu'à présent, il ne s'est pas passé une seule année sans qu'un ou deux ou plusieurs traducteurs ne soient venus me faire la même proposition: en arrivant même à Paris, j'en trouvai un qui avoit le privilege exclusif de me traduire, et venoit de publier quelques-unes de ses traductions: je tâchai de les dégoûter tous également d'une entreprise, dont ils ne connoissoient pas les difficultés.
Le Théâtre d'un inconnu, vol. in-12, chez Duchesne, 1765, contient trois Pieces: la premiere a pour titre la Suivante Généreuse, Comédie en cinq actes en vers, imitée de la Serva Amorosa de Goldoni; la seconde n'est qu'une traduction littérale de la même Piece en prose.
La troisieme et derniere porte le titre des Mécontens, qui est le même que j'avois donné à ma Piece Italienne I malcontenti, dont j'ai rendu compte dans la deuxieme Partie de mes Mémoires: je ne sais si un François pourroit lire ces traductions d'un bout à l'autre.
Il y a une Epitre à la tête de ce volume, adressée à une Dame qui en savoit beaucoup plus que l'Auteur inconnu; elle s'amusa à traduire mon Avocat Vénitien, et elle réussit mieux que les autres dans ce travail difficile et pénible; mais elle ne fit imprimer que les deux premiers actes de sa traduction, et cet Ouvrage imparfait n'auroit pas vu le jour, si le mari, jaloux de la gloire de sa femme, ne l'eût pas, malgré elle, envoyé à la presse.
J'ai vu une traduction de mon Valet de deux Maîtres assez bien faite; un jeune homme qui connoissoit suffisamment la langue Italienne, avoit rendu le texte avec exactitude; mais point de chaleur, point de vis comica, et les plaisanteries Italiennes devenoient des platitudes en François.
Il parut en 1783 un livre intitulé Choix des meilleures Pieces du Théâtre Italien moderne, traduit en François, avec des dissertations et des notes, imprimé chez Morin, à la Vérité.
L'Auteur se méfia lui-même de son entreprise; car c'étoit un Ouvrage qui devoit avoir une longue étendue, et il n'a pas mis sur le frontispice Tome premier.
Il avance dans son Discours préliminaire que les Auteurs dramatiques Italiens sont en état aujourd'hui de lutter contre les Auteurs François, chose très-difficile à prouver; il présente une dissertation sur les Spectacles, d'un Auteur moderne Italien qui n'a fait que copier les anciens, et commence le choix de ses traductions par une de mes Pieces.
Cette préférence me fait beaucoup d'honneur, mais je suis forcé de dire ici ce que j'ai dit au Traducteur lui-même; il a mal choisi, car si on devoit me juger Par cette Piece, on ne pourroit pas concevoir une idée avantageuse de moi.
C'est par la Donna di Garbo que le Traducteur prétend me placer parmi les rivaux des François en Italie, et c'est précisément une de mes Pieces les plus foibles dont le fond sent furieusement le merveilleux de l'ancien Théâtre Italien; c'est une de mes Pieces où l'on trouve le moins de correction, le moins de vraisemblance; une Piece enfin qui avoit eu beaucoup de succès en Italie, mais qui ne faisoit que fronder le mauvais goût, et annoncer la réforme que j'avois projettée.
L'Auteur du Choix des Pieces Italiennes s'est d'abord trompé dans la traduction du titre: ce n'est la docte intrigante, ni la femme accorte, comme on lit dans sa traduction; una donna di garbo est en Italien une brave femme, et c'est sous ce titre que je l'ai présentée, et que j'en ai rendu compte dans la deuxieme Partie de ces Mémoires.
Il est vrai que l'Actrice principale de cette Piece est intrigante et adroite; mais elle paroît aux yeux des personnages de la Comédie une brave femme, et c'est d'après cette apparence que, par une espece d'ironie, je lui ai donné le titre de brave femme.
J'aurois pardonné au Traducteur, s'il avoit annoncé que ses deux titres corrigeoient le mien, et j'aurois mieux aimé qu'il se donnât plus de liberté dans sa traduction pour la rendre plus lisible et plus supportable en François; mais ayant rendu le texte mot pour mot, il est tombé dans l'inconvénient d'une diction triviale et insipide.
Cet Ouvrage n'a pas eu de suite; il ne pouvoit pas en avoir; on ne peut faire connoître le génie de la littérature étrangere que par les pensées, par les images, par l'érudition; mais il faut rapprocher les phrases et le style du goût de la nation pour laquelle on veut traduire.
Les leçons que je pouvois donner aux autres, je les appliquois à moi-même: il ne faut pas traduire, il faut créer, il faut imaginer, il faut inventer: je n'étois pas encore en état de hasarder une Piece en François, mais je pouvois essayer, tâtonner; je cherchois des sujets qui pussent me fournir quelque nouveauté, et j'ai cru un jour l'avoir trouvé, et je me suis trompé; j'étois invité à dîner chez une Dame très-aimable, mais dont le ménage étoit mystérieux: j'y vais à deux heures, et je la trouve auprès du feu avec un Monsieur à cheveux longs, qui n'étoit ni Conseiller au Parlement, ni au Châtelet, ni à la Cour des Aides, ni à la Chambre des Comptes, ni Maître de Requêtes, ni Avocat, ni Procureur.
Madame me présente à Monsieur par mon nom; Monsieur fait semblant de vouloir se lever; je le prie de ne pas se déranger: il reste sans difficulté sur la bergere qu'il occupoit.
Je vais rendre compte de notre conversation, et pour éviter le dit-il, le dit-elle, je vais établir un petit dialogue entre Monsieur, Madame et moi.
MADAME. Monsieur, vous devez connoître M. Goldoni de réputation.
MONSIEUR. N'est-ce pas un Auteur Italien?
MADAME. Oui, Monsieur, c'est le Moliere de l'Italie. (Il faut pardonner l'exagération à une femme honnête et polie).
MONSIEUR. C'est singulier: est-ce que Monsieur s'appelle Moliere aussi?
MADAME (en riant). Ne vous ai-je pas dit qu'il s'appelloit Monsieur Goldoni?
MONSIEUR. Eh bien, Madame, y a-t-il de quoi rire? L'Auteur François ne s'appelloit-il pas Poquelin de Moliere, pourquoi un Italien ne pourroit-il pas s'appeller Goldoni de Moliere? (En se retournant vers moi). Madame a de l'esprit, mais elle est femme, elle veut toujours avoir raison; mais je la corrigerai.
MADAME (d'un ton brusque). Allons, allons, taisez-vous.
MONSIEUR (à Madame). Vous êtes aimable, admirable, divine. (En se retournant vers moi). Monsieur, vous êtes Auteur, vous êtes Italien, vous devez connoître une Piece Italienne... Une Piece que je vais vous nommer. C'est... C'est... J'ai oublié le titre... Mais c'est égal. Il y a dans cette Comédie un Pantalon... Il y a... un Arlequin... Il y a un Docteur, un Briguelle. Vous devez savoir ce que c'est.
MOI. Si Monsieur n'a pas d'autres renseignemens à me donner...
MADAME. Messieurs, nous sommes servis; allons dîner. (Monsieur offre son bras à Madame, elle prend le mien).
MONSIEUR. Vous me refusez, Madame; je ne vous adore pas moins. (Nous nous mettons à table. Monsieur se place à côté de Madame, et s'empare de la grande cuiller).
MONSIEUR. Comment, Madame, vous donnez de la soupe au pain à un Italien?
MADAME. Que falloit-il donner à votre avis?
MONSIEUR (en servant la soupe). Du maccaroni, du maccaroni. Les Italiens ne mangent que du maccaroni.
MADAME. Vous êtes singulier, Monsieur de la Clo...
MONSIEUR (à Madame). Paix.
MADAME (un peu fâchée). Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur? Vous êtes bien grossier aujourd'hui.
MONSIEUR. Paix, ma belle; paix, mon adorable.
MOI. Est-ce que je ne pourrois pas savoir le nom de celui avec qui j'ai l'honneur de dîner?
MONSIEUR (à moi). C'est inutile, Monsieur; je suis ici incognito.
MADAME. Qu'appellez-vous incognito, Monsieur de la Cloche?... Vous n'êtes ici ni à l'auberge, ni dans un mauvais lieu. On vient chez moi honnêtement comme par-tout ailleurs, et j'espere bien que ce sera la derniere fois que vous y mettrez les pieds.
Cette femme qui étoit très-décente et très-sensible, mais qui avoit malheureusement quelque chose à se reprocher, se crut offensée par le propos du jeune étourdi; elle fond en larmes; elle se trouve mal. Sa femme-de-chambre vient à son secours; elle la ramene dans l'appartement. Monsieur veut la suivre, on lui ferme la porte au nez.
Je quitte la table; il faisoit froid, je vais me chauffer dans le sallon. Monsieur, piqué à son tour, se promenoit en long et en large, se jettant tantôt sur l'ottomanne, tantôt sur les fauteuils et sur les bergeres; c'étoit un meurtre de le voir gâter avec sa chevelure des meubles très-élégans. Je ne savois quel parti prendre; je n'avois pas dîné; j'adresse la parole à Monsieur pour savoir s'il comptoit rester ou partir. Vous êtes bien heureux, me dit-il, vous autres Italiens, vos femmes sont vos esclaves; nous les gâtons ici, nous avons tort de les flatter, de les ménager.
Monsieur, lui dis-je, les femmes sont respectées en Italie comme en France, sur-tout quand elles sont aimables comme celle-ci. - Elle est fâchée. - J'en suis pénétré; je suis au désespoir. - Ce n'est rien, ce n'est rien, reprend-il, vous la verrez bientôt revenir.
Il va à la porte de la chambre, il frappe, il crie; la porte s'ouvre, c'est la femme-de-chambre. Ma maîtresse, dit- elle, est couchée, elle ne verra plus personne aujourd'hui; elle referme la porte, et blesse la main du Robin qui vouloit entrer.
Il peste, il menace, puis se tournant vers moi: allons, dit-il, allons dîner quelque part. J'en avois besoin autant que lui; nous sortons ensemble, nous traversons le Palais-Royal. Monsieur voit deux grisettes se promener dans les bosquets; il veut les suivre, il m'engage d'aller avec lui; je refuse; il les suit tout seul; il me plante-là, et je vais dîner chez le Suisse, bien content d'en être débarrassé.
Je ne manquai pas de placer cet original sur mes tablettes, non pas pour l'exposer sur la scene; mais pour remplir quelque vuide dans la conversation.
Conversation du lendemain avec la Dame du Chapitre précédent. - Les Amours de Zelinde et Lindor, la Jalousie de Lindor, les Inquiétudes de Zelinde; les Amans timides; le Bon et le mauvais Génie, Piece à machines, en cinq Actes. - Son histoire. - Son extrait. - Son succès.
J'envoyai voir le lendemain comment se portoit la Dame chez laquelle je n'avois pas dîné: elle se portoit bien, et me fit prier d'aller la voir; j'y fus le même jour; elle me fit des excuses sur ce qui s'étoit passé la veille, et je la trouvai fort contente de s'être débarrassée d'un homme qui lui déplaisoit; c'étoit un Provençal, qui prétendoit avoir des droits sur une personne qui étoit née dans un fief de son illustre famille.
Comme cette Dame étoit d'une Province méridionale de la France, elle avoit beaucoup de facilité pour la prononciation Italienne, et aimoit passionnément cette langue.
Notre conversation tomba sur le Théâtre de la Comédie Italienne de Paris; elle étoit fâchée que je l'eusse quitté, et me rappella quelques-unes de mes Pieces à canevas, qui lui avoient fait grand plaisir.
Elle me parla entr'autres de trois Pieces qui effectivement avoient eu du succès: Les Amours d'Arlequin et de Camille, la jalousie d'Arlequin et les Inquietudes de Camille. Trois Pieces qui étoient la suite l'une de l'autre, et qui formoient une espece de Roman comique, partagé en trois parties, dont chacune renfermoit un sujet isolé et achevé.
Cette Dame qui avoit de l'esprit, de l'intelligence et du goût, me fit voir que j'avois tort de perdre trois Pieces qui auroient pu me faire beaucoup d'honneur, si elles étoient dialoguées; je l'écoutai, je la remerciai, et je profitai de ses avis.
On me demandoit des Comédies en Italie; j'écrivis en totalité les trois canevas ci-dessus; mais comme dans la troupe qui devoit les jouer, il n'y avoit pas un Arlequin du mérite de Carlin, ni de celui de Sacchi, j'ennoblis le sujet; je remplaçai l'Arlequin et la Soubrette par deux personnes d'un moyen état, réduites à servir par des circonstances malheureuses, et j'intitulai ces trois Pieces les Amours de Zelinde et Lindor; la jalousie de Lindor, et les Inquiétudes de Zelinde.
Ces trois Comédies n'eurent pas à Venise un succès éclatant; mais elles furent assez bien reçues du Public éclairé, plus content de la composition que de l'exécution: je ne connoissois pas les Acteurs qui devoient les jouer; on avoit fait la distribution des rôles comme l'on avoit pu, et il n'y a pas en Italie les doubles et les triples comme à Paris pour adapter les caracteres à ceux qui sont le mieux en état de les soutenir.
Même aventure arriva à une autre Piece que j'envoyai dans le même pays et dans la même année; c'étoit en Italien Gli Amanti timidi o l'imbroglio de' due ritratti: les Amans timides ou l'équivoque des deux portraits.
Cette Comédie en deux Actes, qui, sous le titre du Portrait d'Arlequin, avoit fait beaucoup de plaisir à la Comédie Italienne à Paris, ne réussit pas de même là Venise.
Voilà quatre Pieces qui avoient plu en France et qui avoient mal réussi en Italie: elles étoient pourtant de l'Auteur qui avoit eu le bonheur de plaire pendant long-tems dans son pays; mais cet Auteur étoit en France, et ses Ouvrages commençoient à se sentir des influences du climat; le génie étoit le même, mais le style et la tournure étoient changés.
J'étois fâché de ne pouvoir pas contenter mes compatriotes qui m'aimoient toujours, et qui ne cessoient pas de jouer mes Pieces anciennes, et de m'en demander de nouvelles.
Je savois que depuis mon départ les troupes de Venise avoient souffert des changemens qui avoient altéré ce zele, cette méthode qu'on avoit suivi sous mes yeux, et que le succès d'une Piece de caractere ou à sentiment n'étoit plus aussi sûr qu'il étoit de mon tems; j'imaginai d'envoyer une Piece dans un genre qui n'étoit pas tout-à-fait le mien, et je réussis on ne peut davantage.
Dans le courant des deux années de mon engagement avec les Comédiens Italiens, j'avois présenté à leur assemblée une Piece à spectacle qui avoit pour titre Le bon et le mauvais Génie.
On ne trouva rien à redire sur ce sujet qui étoit à la fois moral, critique et divertissant; mais on se récria contre les décorations qui étoient nécessaires, et qui auroient coûté cent écus en Italie, et mille écus peut-être à Paris.
L'Opéra-Comique croyoit la dépense inutile pour les Italiens, et ceux-ci qui partageoient avec les autres, n'étoient pas fâchés de l'épargne.
On lit dans l'Almanach des Spectacles de Paris, à l'article Le bon et le mauvais Génie, Piece à spectacle en cinq Actes non représentée: je ne sais par quel hasard une Comédie qui n'avoit pas même été reçue, se trouve dans ce Catalogue; c'est apparemment une galanterie du Rédacteur de cet Almanach qui a voulu, pour me faire honneur, annoncer les vingt-trois Pieces que j'avois composées pour les Italiens en deux années de tems.
Je savois que la Féerie avoit repris à Venise son ancien crédit, et je crus Le bon et le mauvais Génie un sujet encore plus adapté au goût de l'Italie qu'à celui de la France.
J'hésitai long-tems cependant avant que de me déterminer à l'envoyer; je me faisois conscience de flatter le mauvais goût dans le pays où j'avois beaucoup travaillé pour en établir un bon; mais le peu de succès de mes dernieres Pieces m'avoit donné du chagrin, je voulois plaire encore une fois à mes compatriotes, je cédai à la tentation et je profitai de la circonstance.
Cette Comédie d'ailleurs ne donnoit pas dans les extravagances des anciennes Pieces à machines: il n'y avoit de merveilleux que les deux Génies qui faisoient passer les Acteurs en très-peu d'instans d'une région à l'autre; tout le reste étoit dans la nature; en voici un extrait fort succint, mais suffisant pour en faire connoître l'intention et la marche.
Arlequin et Coralline ouvrent la scene: ils viennent de se marier ensemble; ils sont très-heureux, très-contens; le bon Génie paroit; c'est lui qui a fait consentir l'oncle de Coralline a ce mariage, c'est lui qui leur a fait accorder en dot le bois qu'ils habitent dans le pays Bergamasque: il les exhorte à être sages, honnêtes et modérés dans leurs desirs; il les assure en tout tems de sa protection, de son assistance, et les quitte.
Le mauvais génie paroit à son tour; il trouve les deux mariés malheureux, il les plaint, il leur trace le tableau des plaisirs du monde; il les gagne, il leur fournit de l'argent, il les engage à aller à Paris, il fait venir une voiture; Arlequin et Coralline montent dedans; les voilà partis, et le premier acte finit. Au deuxieme acte, on voit les deux Epoux à Paris; ils en sont enchantés, mais Coralline est jolie, les François sont galans, et Arlequin est jaloux.
Ils quittent la France; le troisième acte se passe à Londres. Le sérieux des Anglois leur déplait, la populace les effraye, le brouillard les incommode, ils quittent Londres pour aller à Venise.
C'est dans cette Ville que se passe le quatrieme acte.
Arlequin débute mal; il veut monter dans une gondole, il tombe dans le canal, et court le risque de se noyer. Coralline se plait à l'usage du masque, à la liberté des femmes dans ce pays-là. Arlequin de son côté y prend du goût aussi; il aime le jeu; dans le tems où je composai cette Piece les jeux n'étoient pas défendus à Venise, et la Redoute n'étoit pas supprimée; Arlequin joue, il perd son argent, il est au désespoir; Coralline en a encore assez pour partir; mais fatigués, ennuyés de courir le monde, Coralline et Arlequin prennent le parti de revenir chez eux, de se contenter de leur premier état, et de renoncer aux plaisirs dangereux.
Les voilà au dernier acte dans leur bois, très-contens d'y être revenus, et se proposant bien de ne plus le quitter; le seul desir qui leur reste, est celui de revoir le bon Génie; ils l'appellent, mais au lieu du bon c'est le mauvais Génie qui paroît, qui tâche de les séduire de nouveau, en leur offrant de l'argent; les bonnes gens le refusent, le méprisent; l'esprit malin est obligé de quitter prise, et s'en va.
C'est alors que le bon Génie reparoit; il embrasse ses protégés, il les amene au temple de la félicité, et c'est par cette décoration que la Piece finit.
Il y a dans les actes deuxieme, troisieme et quatrieme assez de mouvement et d'intrigue, de petits tableaux et de légeres critiques.
Le fond du sujet de la Piece est le combat des passions; dans le premier acte, c'est le vice qui l'emporte, dans le dernier, c'est la vertu qui triomphe.
Cette Piece eut à Venise le plus grand succès; elle soutint toute seule le Théâtre de Saint Jean-Chrisostôme, pendant trente ou quarante jours de suite; elle avoit fait l'ouverture du carnaval, et elle en fit la clôture.
Mon neveu Professeur de Langue Italienne à l'Ecole Royale Militaire, et quelque tems après, Secrétaire-Interprete au Bureau de la Corse. - Départ de M. Gradenigo, Ambassadeur de Venise, - Suppression des entrées publiques des Ambassadeurs Ordinaires. - M. le Chevalier Mocenigo, nouvel Ambassadeur de Venise.
Je m'amusois à Paris en parcourant les beautés de la Ville, et en donnant tous les jours quelques heures à mon cabinet, mais ce qui m'occupoit plus sérieusement, c'étoit mon neveu.
Je l'avois amené en France avec moi, sachant combien les voyages sont utiles à l'éducation, quand on donne à un jeune homme les moyens d'apprendre, et que l'on veille sur sa conduite.
Je ne pensois pas, en arrivant à Paris, que j'y fixerois ma demeure; mais ayant décidé d'y rester, il falloit tâcher d'y donner un état au fils de mon frere, que j'aimois comme mon propre enfant; il étoit honnête et docile, il avoit fait ses études à Venise; il étoit susceptible de quelque bon emploi; je n'étois pas assez riche pour lui acheter une charge, et je voulois éviter, s'il étoit possible, le désagrément de lutter les emplois de grace contre les François.
Il y avoit à l'Ecole Royale Militaire un Professeur de Langue Italienne; M. Conti qui occupoit cette place, étoit mon ami; il desiroit de se retirer, mais on n'accordoit la pension de retraite qu'au bout de vingt années de service, et M. Conti n'étoit pas dans le cas de la demander; l'emploi étoit bon; c'étoit un bel état pour un jeune homme; j'aurois bien desiré que mon neveu pût l'obtenir, mais il y avoit des difficultés à surmonter.
J'implorai la protection de Madame Adélaïde de France; cette Princesse me recommanda à M. le Duc de Choiseul; en quinze jours de tems M. Conti eut la pension, et mon neveu la place.
C'est par cette occasion que le vis a mon aise, et a plusieurs reprises, ces deux établissemens dignes de la magnificence des Monarques François, l'Ecole Royale Militaire et l'Hôtel des Invalides, le berceau et le tombeau des défenseurs de la Patrie.
On éleve dans le premier la noblesse qui se destine au métier des armes, et on soulage dans le second l'âge, le service et les suites malheureuses de la guerre; les arts, les sciences, l'éducation la plus utile forment les hommes dans l'un; les soins, le repos, les commodités de la vie les récompensent dans l'autre; la fondation de ce dernier monument est du regne de Louis XIV; celle de l'autre est du regne de Louis XV.
L'Hôtel des Invalides est décoré d'un temple magnifique qui tiendroit à Rome une place honorable; et les quatre grands réfectoires des Soldats sont aussi curieux à voir que les cuisines où l'on prépare les alimens pour ces bonnes gens.
C'étoit un plaisir pour moi d'aller passer quelques jours dans ces deux Maisons Royales, qui se touchent de près, et dont je connoissois les Gouverneurs et les principaux employés; mais au bout de vingt-deux mois que mon neveu y fut placé, on fit des changemens considérables à l'Ecole Royale Militaire; on envoya les classes des humanités au College de la Fléche, et on supprima tout-à-fait celle de la Langue Italienne; ce ne fut pas la faute du Professeur; au contraire il fut récompensé, on lui donna six cens francs de pension.
Quelqu'un m'assura que M. le Duc de Choiseul étoit prévenu de ces changemens projettés lorsqu'il y plaça mon neveu, et que ce n'étoit que pour nous procurer ce petit bénéfice qu'il nous avoit accordé un emploi qui ne devoit pas subsister.
Ce Ministre, en me regardant comme un protégé de Mesdames, avoit beaucoup de bonté pour moi; il me fit l'honneur de me dire lorsque j'allai chez lui pour le remercier: voilà les affaires de votre neveu en bon train, comment vont les vôtres? Je lui dis que je jouissois d'un traitement de 3600 liv. de rente; il se mit à rire: ce n'est pas avoir un état, me dit-il; il vous faut bien autre chose; on aura soin de vous; cependant je n'ai rien eu davantage, c'est ma faute peut-être; mais je reviens à mon refrain: j'étois à la Cour, et je n'étois pas courtisan.
Mon neveu, qui étoit sans occupation, travailloit avec moi en attendant que le sort le pourvût de quelqu'autre emploi; la maxime que j'avois adoptée, et que je lui avois inspirée de ne pas le chercher dans la foule des concurrens, rendoit la réussite plus difficile.
J'étois lié à Versailles avec M. Genet, chef et Directeur du Bureau des Interpretes, auquel il avoit donné une forme nouvelle et une consistance solide, et dont il étoit devenu le premier Commis.
Ce pere de famille respectable, qui partageoit son tems entre les affaires de son état et l'éducation de ses enfans, se souvenant d'un petit service que j'avois eu le bonheur de lui rendre, saisit l'occasion de m'en récompenser.
Depuis que la France avoit fait l'acquisition de la Corse, on avoit établi à Versailles un Bureau pour toutes les affaires en général de cette Isle; il falloit un Interprete qui sût bien les deux langues; le premier Commis s'adressa à Monsieur Genet pour en avoir un; mon digne ami se souvint de moi, il proposa mon neveu, qui fut accepté et installé sans difficulté.
Ce jeune homme paroissoit destiné à rencontrer partout des réformes et des suppressions. Le Bureau de la Corse fut démembré quelque temps après: les affaires de Finance furent données au Contrôleur Général, et l'administration civile passa au Bureau de la Guerre.
C'est-là où l'interprete est resté: on a annexé cette inspection au Bureau de M. Campi, premier Commis pour les affaires contentieuses. Mon neveu tâche de s'y rendre utile: il a le bonheur de ne pas déplaire à ses Supérieurs, et il a des preuves de leur bonté: si mon voyage en France ne m'avoit produit que l'établissement de cet enfant chéri, je m'applaudirois toujours de l'avoir entrepris.
J'étois attaché à la France par inclination; je le devins encore plus par reconnoissance; M. le Chevalier Gradenigo, Ambassadeur de Venise, tout intéressé qu'il étoit à me faire goûter les propositions de ses compatriotes, trouva juste ma résistance et se chargea de me justifier vis-à-vis ses amis et mes protecteurs.
Ce Ministre touchoit à la fin de sa Commission; la période des Ambassades de la République est fixée à quatre années. M. Gradenigo étoit aimé de la Cour et du Ministere François; on auroit desiré qu'il restât davantage; le Roi étoit disposé à le redemander; le Ministre alloit expédier un courier.L'Ambassadeur, pénétré de respect et de reconnoissance, ne pouvoit pas y consentir; les loix de la République sont immuables; le successeur étoit en route, M. Gradenigo devoit partir, et les préparatifs de son audience de congé étoient bien avancés.
M. le Duc de Choiseul, Ministre des Affaires Étrangeres, voyoit que cette cérémonie étoit coûteuse, gênante, et, tout-à-fait inutile; le Roi pensoit de même. M. Gradenigo fut armé Chevalier par Sa Majesté sans la pompe ordinaire, et fit ses visites à la Famille Royale et aux Princes du Sang en particulier.
C'est l'époque de la suppression des Audiences publiques pour les Ambassadeurs ordinaires.
Cet Ambassadeur fut relevé par M. le Chevalier Sébastien Mocenigo, qui venoit d'Espagne où la République de Venise l'avoit envoyé pour sa premiere Ambassade; il étoit d'une illustre famille, très-ancienne et très-riche; il avoit de l'esprit, de l'intelligence, il étoit aimable, bon Musicien, avec une voix charmante. Mais... Il essuya des désagrémens qu'il n'avoit peut-être pas mérités.
Ma correspondance avec les Entrepreneurs de l'Opéra à Londres. - Victorine, Opéra-Comique. - Le Roi à la Chasse, autre Opéra-Comique pour Venise. - Quelques détails sur les Acteurs et sur les Auteurs de l'Opéra-Comique de Paris. - Projet d'une petite Piece en deux Actes.
On me demandoit à Londres; c'est le seul pays qui puisse disputer en Europe la primauté à Paris: j'aurois été bien aise de le voir; mais j'entendois parler de grands mariages à Versailles; j'avois assisté à tous les convois de la Cour, je voulois m'y trouver dans le tems des réjouissances.
D'ailleurs ce n'étoit pas le Roi d'Angleterre qui me demandoit, c'étoit les Directeurs de l'Opéra qui vouloient m'attacher à leur Spectacle.
Je tâchai cependant de tirer parti de l'opinion avantageuse qu'ils avoient de moi; je donnai de bonnes raisons pour faire agréer mes excuses, et je leur offris mes services sans l'obligation de quitter la France.
Mes propositions furent acceptées; on me demanda un Opéra-Comique nouveau, et on me chargea de raccommoder tous les vieux Drames, qu'ils avoient choisis pour le courant de l'année.
On ne parla pas de la récompense, je n'en fis pas mention non plus, je travaillai; les Anglois furent contens de moi; je fus très-satisfait de leur honnêteté.
Cette correspondance eut lieu pendant plusieurs années; elle ne cessa que lorsque les Directeurs céderent à d'autres leur entreprise, et je reçus à cette occasion une marque bien certaine de leur satisfaction, car ils me payerent un Opéra dont ils n'étoient plus dans le cas de se servir; cette direction étoit entre les mains de femmes, et les femmes sont aimables par-tout.
L'Ouvrage le plus agréable et le mieux soigné que je leur envoyai, étoit à mon avis un Opéra-Comique, intitulé Victorine; j'en reçus de Londres des complimens et des remerciemens sans fin. M. Piccini, chargé de la musique de cet Ouvrage, écrivit de Naples, qu'il n'avoit jamais lu de Drame-Comique qui lui eût fait autant de plaisir, mais le succès ne répondit pas à la prévention des Directeurs, ni à la mienne.
Il faut bien des beautés réunies pour faire réussir une Piece, et le plus petit inconvénient peut la faire tomber.
Je fus plus heureux à Venise où j'avois envoyé presqu'en même tems un Opéra-Comique, sous le titre du Roi à la Chasse: le sujet de cette Piece étoit le même que celui du Roi et le Fermier de M. Sedaine, et de la Partie de Chasse d'Henri IV de M. Collé.
Les Ouvrages de ces deux Auteurs François paroissoient avoir imité le Roi et le Meunier, Comédie Angloise de Mansfield, mais la source véritable de tous ces sujets se trouve dans l'Alcaïde de Zalamea, Comédie Espagnole de Calderon.
Dans la Piece de l'Auteur Espagnol il y a beaucoup d'intrigue: une Fille violée, un Pere vengé, un Officier étranglé, et l'Alcaïde est juge et partie, et bourreau en même tems.
Dans celle de l'Auteur Anglois on trouve de la philosophie, de la politique, de la critique, mais trop de simplicité et très-peu de jeu.
L'Auteur de la Partie de Chasse d'Henri IV en a fait un Ouvrage très-sage et très-intéressant; il suffit qu'il y soit question de ce bon Roi, pour qu'il plaise aux François, et soit approuvé de tout le monde.
M. Sedaine y a mis plus d'action, plus de gaieté: je vis le Roi et le Fermier à sa première représentation, j'en fus extrêmement content, et je le voyois avec douleur prêt à tomber, il se releva peu-à-peu, on lui rendit justice; il eut un nombre infini de représentations, et on le voit encore avec plaisir.
Il faut dire aussi que M. Sedaine a été bien secondé par le Musicien; je ne me vante pas d'être connoisseur, mais mon oreille est mon guide.
Je trouve la musique de M. Monsigny expressive, harmonieuse, agréable: ses motifs, ses accompagnemens, ses modulations m'enchantent, et si j'avois eu des dispositions pour composer des Opéras-Comiques en François, ce Musicien auroit été un de ceux à qui je me serois adressé.
Mais je n'y conçois rien; j'ai fait quarante ou cinquante Opéras-Comiques pour l'Italie, j'en ai fait pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour le Portugal, et je ne saurois en faire un pour Paris.
Tantôt je vois à ce Spectacle des Drames sérieux, des Drames larmoyans porter le titre de Comédie, et les Acteurs pleurer en chantant et sanglotter en mesure; tantôt des Pieces affichées sous le titre de Parades, et qui le seroient effectivement sans le prestige de la musique et le jeu charmant des Acteurs.
Tantôt je vois aller aux nues des bagatelles qui ne promettoient rien, tantôt tomber des Pieces bien faites, parce que le sujet n'est pas assez triste pour faire pleurer, ou n'est pas assez gai pour faire rire.
Quels sont les préceptes de l'Opéra-Comique? Quelles sont ses règles? Il n'y en a point; c'est par routine que l'on travaille, je le sais par expérience, on doit me croire, experto crede Roberto.
Me dira-t-on que les Opéras-Comiques Italiens ne sont que des farces indignes d'être mises en comparaison avec les poëmes de ce nom en France? Que ceux qui entendent la Langue Italienne se donnent la peine de parcourir les six volumes qui renferment la collection de mes Ouvrages en ce genre, et l'on verra peut-être que le fond et le style ne sont pas si méprisables.
Ce ne sont pas des Drames bien faits; ils ne peuvent pas l'être: je ne me suis jamais avisé d'en faire par goût, par choix; je n'y ai travaillé que par complaisance, et quelquefois par intérêt. Quand on a un talent, il faut en tirer parti; un Peintre en histoire ne refusera pas de peindre un magot, s'il en est bien payé.
Malgré cette espèce d'aversion que j'ai pour l'Opéra-Comique, j'avoue que ceux de la Comédie Italienne de Paris me font un plaisir infini.
Je reconnois la supériorité des Auteurs François dans ce genre comme dans tous les autres. M. Marmontel, M. Laujon, M. Favart, M. Sedaine, M. d'Hell ont donné à l'Opéra-Comique toute la perfection dont il étoit susceptible.
Messieurs Philidor, Monsigny, Duni, Grétry, Martini, Deséides, les ont ornés d'excellente musique, et M. Piccini a dernierement donné de nouvelles preuves de la supériorité de ses talens sur des paroles de M. son fils.
Les acteurs augmentent tous les jours en nombre, en zele et en mérite; M. Clairval est toujours le même: c'est un Acteur immortel; Madame Trial a remplacé avec tous les agrémens possibles Madame la Ruette: Mademoiselle Colombe et Mademoiselle Adeline sa sœur, l'une par sa belle voix, l'autre par la finesse de son jeu, font honneur à l'Italie où elles ont eu la naissance; Madame du Gazon, fait les délices de ce Spectacle; Mademoiselle Desbrosses marche à grands pas sur ces traces; et Mademoiselle Renaud âgée de quinze ans vient, par la perfection de son chant et par ses graces naturelles, d'enrichir ce Spectacle, et annonce des dispositions pour l'action qui ne peuvent se développer qu'avec le tems.
J'ai assisté il y a un an au début de Mademoiselle Rinaldi; elle a été beaucoup applaudie; le Journal de Paris en a dit le lendemain tout le bien possible; elle a été reçue aux appointemens, et depuis son début, on ne l'a pas vue paroitre une seule fois sur la scène; la quantité de débutantes reçues en pourroit être la cause, mais il est à espérer que Mademoiselle Rinaldi remplira à son tour un des emplois de la Comédie, et qu'on rendra justice à ses talens, à ses mœurs et à sa conduite.
Le Théâtre Italien est aussi heureux en Acteurs qu'en Auteurs, et les uns et les autres sont bien traités et bien récompensés: les Poëtes et les Musiciens jouissent du droit du neuvieme de la recette pour une Piece en cinq Actes ou en trois; du douzieme pour une Piece en deux Actes, et du dix-huitieme pour une Piece en un Acte. De plus, on a fondé à la Comédie Italienne deux pensions annuelles, une pour l'Auteur des paroles, l'autre pour l'Auteur de la musique qui ont le plus mérité.
Il y a à ce Spectacle un autre agrément considérable pour les Auteurs; c'est qu'ils ne perdent jamais leurs droits sur leurs Pieces; ils jouissent toujours du partage statué; ils donnent des billets gratis à chaque représentation de leurs Ouvrages, et les Pieces qui n'ont pas été refusées du Public, sont placées dans le Répertoire de la semaine, de maniere qu'elles ne tombent jamais.
Vu ces avantages, j'ai été tenté plus d'une fois de céder aux sollicitations de quelques Musiciens qui me demandoient souvent, très-souvent, et presque tous les jours, quelque Ouvrage pour l'Opéra-Comique; après avoir vu, revu, et bien examiné, je croyois pouvoir saisir la routine qui étoit nécessaire pour plaire aux François, et j'essayai de composer une petite Piece en deux Actes, intitulée la Bouillotte.
Ce mot ne se trouve dans aucun Dictionnaire; mais il est très-connu à Paris: c'est un jeu de cartes, c'est un brelan à cinq, dont les tours ne sont ni fixes, ni marqués. Celui qui perd sa cave, sort, et est remplacé par un autre; il y a ordinairement dans ces parties de Bouillotte trois ou quatre personnes qui ne jouent pas d'abord, qui attendent la sortie des malheureux pour entrer en jeu, et les uns et les autres sortent successivement. Ce mouvement perpétuel, et la quantité de monde intéressé à la même partie, causent une espece de bouillonnement qui a fourni le nom de Bouillotte. Vous verrez dans le Chapitre suivant quelle étoit la Piece que j'avois imaginée.
Extrait de la Bouillotte. - Raisons qui m'ont empêché de la donner.
Voici le sujet de la Piece. Madame de la Biche est la femme d'un Négociant, elle est riche, elle est volontaire et joueuse dans l'ame. Isabelle sa fille déteste le jeu; mais faute de joueurs, elle fait quelquefois la partie de sa mere, et profite de l'occasion pour voir un jeune homme qui est de la société de Madame, et pour lequel Isabelle nourrit une passion innocente.
Madame de la Biche reçoit beaucoup de monde chez elle; les uns y vont pour jouer, les autres pour faire leur cour à la Demoiselle; mais il faut que, bon gré, malgré, tout le monde joue. Madame ne sait que faire de gens qui bâillent et qui font bâiller.
Il y a des joueurs de toute espece: le beau joueur, le mauvais joueur, le joueur noble, le joueur serré, et le flegmatique qui emporte l'argent de tout le monde.
Quand Isabelle n'est pas de la partie, sa mere la fait assepir auprès d'elle; mais si elle perd, c'est la fille qui lui porte malheur, et la renvoie.
Le jeune homme amoureux tâche alors de perdre bien vite son argent, il cede sa place, va rejoindre la Demoiselle à la cheminée, et la mere échauffée au jeu ne prend pas garde à ceux qui s'échauffent autrement.
Les événemens du jeu fournissent des sujets variés pour placer des airs; pendant qu'on mêle, on cause et on chante; la Demoiselle et le jeune homme ont des situations intéressantes pour chanter, et le jeu va son train sans ennuyer les Spectateurs.
Enfin, on vient annoncer à Madame qu'elle est servie. Tout le monde se leve pour aller souper; les propos de jeu d'un côté, les tendres expressions de l'autre, font sortir tout le monde en chantant, et le premier Acte finit.
C'est M. de la Biche qui ouvre le deuxieme Acte. Il est de retour de sa terre; il fait appeller Catherine , et lui demande compte du train dont il s'est apperçu en rentrant chez lui: la vieille femme, attachée depuis longtems à cette maison, instruit son Maitre de l'inconduite de Madame, et du danger de la Demoiselle.
M. de la Biche est très-piqué contre sa femme, a qui il avoit défendu le gros jeu, et tremble sur le compte de sa fille. Un voisin arrive: c'est l'oncle de l'amoureux d'Isabelle; il en fait la demande au pere au nom de son neveu. M. de la Biche trouve le parti convenable, il promet de donner sa fille au neveu de son ami et son voisin; ils entendent la société qui revient, ils sortent pour terminer l'aiffaire entamée.
Les joueurs rentrent, et la partie recommence. Madame de la Biche se cave au plus fort; le flegmatique met de plus devant lui un rouleau de cinquante louis; la brelandiere ne s'effraye pas; on donne les cartes; elle ouvre le jeu; l'autre tient, et lui fait va-tout. Madame qui a un brelan d'as, ne recule pas, elle tombe sur un brelan quarré, elle perd, elle en est furieuse.
Le mari arrive. Ah! dit-elle, en le regardant, je ne m'étonne pas si j'ai perdu, voilà mon guignon, et elle sort.
Les uns la plaignent, les autres en rient. Monsieur de la Biche interroge sa fille sur son inclination; elle l'avoue de bonne foi; il parle au jeune homme, il fait entrer l'oncle, et le mariage est conclu.
La joueuse en est informée; elle revient, et elle a de son mari pour toute consolation l'alternative de quitter le jeu pour toujours, ou d'aller vivre avec ses parens.
Elle accepte le dernier parti, et prie sa société d'aller le lendemain faire sa partie dans sa maison paternélle. La passion du jeu et les extravagances des joueurs forment le sujet de la finale.
Voilà le canevas de la Piece que j'avois imaginée. Pourquoi ne l'ai-je pas achevée?
Tant qu'il ne s'agissoit que du dialogue, je me tirois d'affaire assez bien, et je me croyois en état de hasarder ma prose sur un Théâtre où le Public avoit de l'indulgence pour les Etrangers.
Mais il falloit des airs dans un Opéra-Comique, et il falloit faire de la bonne Poésie pour avoir de la bonne musique. Je connoissois la mécanique des vers François; j'avois surmonté toutes les difficultés que doit y rencontrer une oreille étrangere; et je m'étois proposé de bons modeles à imiter. J'essayai, je travaillai; je fis des couplets, des quatrins, des airs entiers, et après toutes les peines que je m'étois données, je vis que ma muse habillée à la Françoise n'avoit pas cette verve, cette grace, cette facilité qu'un Auteur acquiert dans sa jeunesse, et perfectionne dans sa virilité. Je sus me rendre justice, je laissai là mon ouvrage, et je renonçai pour toujours aux charmes de la Poésie Françoise.
J'aurois pu confier mon sujet à quelqu'un qui se seroit chargé, peut-être, de la versification; mais à qui aurois-je dû m'adresser? Un Auteur du premier ordre auroit changé mon plan, et un Auteur médiocre me l'auroit gâté.
D'ailleurs c'étoit une bagatelle, dont je ne faisois pas grand cas, et je l'avois oubliée sans peine et sans regret. C'est à l'occasion des recherches que je fais actuellement pour mes Mémoires, que fouillant dans mes paperasses, je l'ai retrouvée; et faisant part à mes Lecteurs de toutes mes productions, je crois ne devoir pas leur cacher cette espece d'avorton.
Si quelqu'un de mes Lecteurs trouve ce petit sujet digne de son attention, je le laisse le maître d'en faire ce qu'il voudra; et s'il a la bonté de me consulter, je lui dirai de bonne foi mon avis, au risque même de lui déplaire, ce qui m'est arrivé plusieurs fois en pareilles circonstances.
Gardez-vous, mes amis, de ces jeunes gens, de ces Auteurs médiocres qui viennent vous consulter; ce ne sont pas des conseils qu'ils vous demandent, ce sont des complimens, des applaudissemens. Vous n'avez qu'à essayer de les corriger, vous verrez comme ils soutiennent leur opinion, quel coloris ils savent donner à leurs fautes; et si vous insistez, vous finissez par être un sot.
Mariage du Dauphin. - Ouverture du grand Théâtre de la Cour. - Observations sur ce monument. - Foule de Poëtes à cette occasion. - Le Bourru Bienfaisant, Comédie en trois Actes, en prose. - Son succès. - Justice rendue aux Acteurs qui l'ont exécutée.
J'ai annoncé dans le Chapitre treizième, qu'on préparoit de grands mariages a la Cour; je parlois de l'année 1770, et ce fut dans ces jours heureux, que l'Archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette de Lorraine, vint, en qualité de Dauphine, combler ce Royaume de joie, de gloire et d'espérance.
Elle gagna par les qualités de son ame et de son esprit l'estime du Roi, le cœur de son époux, l'amitié de la Famille Royale, et mérita l'admiration du Public par sa bienfaisance.
Cette vertu qui est devenue, de nos jours, la passion dominante des François, semble avoir excité l'émulation dans les ames sensibles d'après l'exemple de cette auguste Princesse.
Ces nôces furent célébrées avec une pompe digne du petit-fils du Monarque françois et de la fille de l'Impératrice de l'Allemagne.
J'ai vu le temple richement décoré; le coup d'œil imposant du Banquet royal, le Bal dans la galerie, les parties de jeu dans les appartemens.
Des illuminations par-tout; un feu d'artifice de la plus grande beauté. Torré, Artificier Italien, porta à cette occasion l'art pyrotechnique au dernier degré de sa perfection.
L'on fit en même tems l'ouverture du nouveau Théâtre de la Cour; c'est un riche monument dont l'architecture offre plus de majesté que de commodité pour les Spectateurs; il faut le voir lorsqu'on y donne des Bals parés, ou des Bals masqués. On arrange le théâtre dans ces occasions avec la même décoration et les mêmes ornemens que la salle; on voit alors un sallon immense enrichi de colonnes, de glaces et de dorures, qui prouvent la grandeur du Souverain qui l'a ordonné, et le goût de l'artiste qui l'a exécuté.
Parmi les réjouissances de cet auguste mariage les Poëtes François faisoient retentir la Cour et la Ville de leurs chants: ma muse avoit envie de se réveiller; je tâchai de la satisfaire, je fis des vers italiens, mais je n'osai pas les faire imprimer.
Dans le nombre infini des compositions qui paroissoient tous les jours, il y en avoit d'excellentes, et il y en avoit qu'on ne lisoit pas. Je ne voulois pas augmenter le nombre de ces dernieres, je présentai mes vers en manuscrit; Madame la Dauphine les reçut avec bonté, et me fit comprendre en très-bon italien que je ne lui étois pas inconnu.
Il semble que l'heureuse étoile qui répandoit pour lors ses influences sur ce Royaume, m'ait inspiré du zele, de l'ambition, du courage. Je conçus le projet de composer une Comédie françoise, et j'eus la témérité de la destiner au Théâtre François.
Le mot de témérité n'est pas trop fort, c'en est une vraiement, que de voir un étranger arrivé en France à l'âge de cinquante-trois ans avec des connoissances confuses et superficielles de cette langue, oser au bout de neuf ans composer une Piece pour le premier Spectacle de la Nation.
Vous devez vous appercevoir que c'est du Bourru Bienfaisant dont je vais parler, Piece fortunée qui a couronné mes travaux, et a mis le sceau à ma réputation.
Elle a été donnée pour la première fois à Paris le 4 Novembre 1771, et le lendemain à Fontainebleau; elle eut le même succès à la Cour et à la Ville. J'eus une gratification du Roi, de 150 louis, le droit d'Auteur me valut beaucoup à Paris, mon Libraire me traita fort honnêtement, je me vis comblé d'honneur, de plaisir, de joie; je dis la vérité, je ne cache rien; la fausse modestie me paroit aussi odieuse que la vanité.
Je ne donnerai pas l'extrait d'une Comédie que l'on joue par-tout, qui est entre les mains de tout le monde. Mais je ne puis pas me dispenser de donner ici une marque de reconnoissance aux Acteurs qui ont infiniment contribué à la réussite de mon ouvrage.
Il n'est pas possible de rendre le rôle de Bourru Bienraisant avec plus de vérité que M. Préville l'a rendu. Cet Acteur inimitable, foncierement gai, d'une physionomie riante, sut si bien surmonter la contrainte de son naturel et l'habitude de son jeu, qu'on voyoit dans ses regards et dans ses mouvemens l'âpreté du caractere et la bonté du cœur du Protagoniste.
M. Bellecour avoit moins de peine à soutenir le caractere de Dorval qui étoit aussi flegmatique que l'Acteur lui-même; mais il y mettoit toute l'intelligence et toute la finesse qui étoient nécessaires pour le faire valoir, et faisoit un contraste admirable avec la vivacité de Géronte.
Le rôle de Dalancour n'étoit pas assez considérable pour l'emploi et pour le talent supérieur de Monsieur Molé; il le joua par complaisance, et le céda quelques jours après; mais au décès de Monsieur Bellecour, il prit le rôle de Dorval, et le rendit à la perfection. J'estimois beaucoup Monsieur Molé, mais j'avoue de bonne foi qu'il m'a surpris dans cette occasion; je l'avois vu surpasser tous les autres dans les caractères brillans, dans les passions vigoureuses, dans les situations intéressantes; j'étois tout étonné de le voir prendre le ton, le geste, le sang froid d'un personnage aussi opposé à son naturel et à son goût; voilà l'homme, voilà le bon Comédien!
Le rôle de Madame Dalancour, rempli par Madame Préville, étoit nouveau sur la scene, et pas aisé à soutenir, mais il n'y avoit rien de difficile pour une Actrice de son mérite. Elle jouoit également bien dans ses différentes positions la Coquette, l'innocente et la Femme sensée.
Mademoiselle Doligny donna dans cette Piece de nouvelles preuves de son talent, de son zele et de sa précision: on ne pouvoit rendre avec plus de vérité et plus de graces la jeune Amoureuse décente et timide. Madame Bellecour, avec son enjouement naturel et la finesse de son jeu, donna tout l'agrément possible au rôle de la Gouvernante, et M. Feuilli fit si bien valoir le petit rôle de Valet, qu'il n'eut pas moins de part que les autres Acteurs aux applaudissemens du Public.
Tous les Comédiens étoient attachés à cette Piece dès sa première lecture; la réception et l'exclusion des Pieces se fait à la Comédie Françoise par des billets secrets, signés par ceux qui composent l'assemblée. Tous ces billets n'étoient ce jour-là que des éloges pour moi et pour mon ouvrage; les suffrages du Public ont prouvé depuis que les Comédiens avoient jugé avec connoissance; et que s'il reçoivent quelquefois de mauvaises Pieces, c'est par des causes étrangeres qui les font agir contre leur sentiment intérieur.
Observations qui regardent le Bourru Bienfaisant. - Conversation avec Jean Jacques Rousseau sur le même sujet.
Mon Bourru Bienfaisant ne pouvoit être plus heureux qu'il l'a été; j'avois eu le bonheur de retrouver dans la nature un caractere qui étoit nouveau pour le Théâtre, un caractere qu'on rencontre par-tout, et qui cependant avoit échappé à la vigilance des Auteurs anciens et modernes.
Ils ont cru peut-être qu'un homme brusque, étant incommode à la société, seroit dégoûtant sur la scene; en le regardant de cette maniere, ils ont bien fait de ne pas l'employer dans leurs Ouvrages, et je m'en serois gardé moi-même, si d'autres vues ne m'eussent pas fait espérer d'en tirer parti.
C'est la bienfaisance qui fait l'objet principal de ma Piece, et c'est la vivacité du Bienfaisant qui fournit le comique inséparable de la Comédie.
La bienfaisance est une vertu de l'ame; la brusquerie n'est qu'un défaut du tempérament; l'une et l'autre sont compatibles dans le même sujet; c'est d'après ces principes que j'ai formé mon plan, et c'est la sensibilité qui a rendu mon Bourru supportable.
A la premiere représentation de ma Comédie, je m'étois caché, comme j'avois toujours fait en Italie, derriere la toile qui ferme la décoration; je ne voyois rien, mais j'entendois mes Acteurs, et les applaudissemens du Public; je me promenois en long et en large pendant la durée du Spectacle, forçant mes pas dans les situations de vivacité, les ralentissant dans les instans d'intérêt, de passion, content de mes Acteurs, et faisant l'écho des applaudissemens du Public.
La Piece finie, j'entends des battemens de mains, et des cris qui ne finissoient pas. M. Dauberval arrive, c'étoit lui qui devoit me conduire à Fontainebleau. Je crois qu'il me cherche pour me faire partir: point du tout: venez, Monsieur, me dit-il, il faut vous montrer. - Me montrer! A qui? - Au Public, qui vous demande. - Non, mon ami; partons bien vite, je ne pourrois pas soutenir... Voilà M. Le Kain et M. Brizard qui me prennent par les bras, et me traÎnent sur le Théâtre.
J'avois vu des Auteurs soutenir avec courage une pareille cérémonie; je n'y étois pas accoutumé; on n'appelle pas les Poëtes en Italie sur la scene pour les complimenter; je ne concevois pas comment un homme pouvoit dire tacitement aux Spectateurs: me voilà, Messieurs, applaudissez-moi.
Après avoir soutenu pendant quelques secondes la position pour moi la plus singuliere et la plus gênante, je rentre enfin, je traverse le foyer pour aller gagner le carrosse qui m'attendoit; je rencontre beaucoup de monde qui venoit me chercher; je ne reconnois personne, je descends avec mon guide; j'entre dans la voiture, ma femme et mon neveu y étoient déjà montés; le succès de ma Piece les faisoit pleurer de joie, et l'histoire de mon apparition sur le Théâtre les fait éclater de rire.
J'étois fatigué, j'avois besoin de me reposer, j'avois besoin de dormir: mon ame étoit contente, mon esprit tranquille; j'aurois passé une nuit heureuse dans mon lit: mais, dans une voiture, je fermois l'œil, et le cabotage me reveilloit à chaque instant; enfin, en sommeillant, en causant, en bâillant, j'arrive à Fontainebleau; je dors, je dîne, je me promene, et je vais voir ma Piece au Château, toujours derriere la toile.
J'ai parlé de son succès à la Cour dans le Chapitre précédent. Il n'étoit pas alors permis d'applaudir chez le Roi, mais on s'appercevoit par des mouvemens naturels et permis, de l'effet que la Piece faisoit sur les Spectateurs.
Le lendemain, M. le Maréchal de Duras me fit l'honneur de me présenter au Roi particulierement dans son cabinet. Sa Majesté et toute la Famille Royale me donnerent des marques de leur bonté ordinaire.
Je revins à Paris pour la deuxieme représentation de ma Piece. Il y eut ce jour-là quelques mouvemens qui indiquoient de la mauvaise humeur dans le parterre: j'étois à ma place ordinaire; M. Feuilli vint me dire: ne soyez pas inquiet; c'est de la cabale. Comment, dis-je? Il n'y en a pas eu à la premiere représentation: les jaloux ne vous craignoient pas, dit le Comédien; ils se moquoient d'un étranger qui vouloit donner une Piece en François, et la cabale n'étoit pas préparée; mais vous n'avez rien à redouter, ajouta-t-il, le coup est porté, votre succès est assuré.
Effectivement la Piece alla de mieux en mieux jusqu'à la douzieme représentation, et nous ne la retirâmes, les Comédiens et moi, que pour la faire reparoître dans une saison plus avantageuse.
Personne ne dit du mal du Bourru Bienfaisant, mais plusieurs propos se sont tenus sur son compte; les uns croyoient que c'étoit une Piece de mon Théâtre Italien; d'autres pensoient que je l'avois écrite ici en Italien et traduite en François. La collection de mes Œuvres pouvoit convaincre les premiers du contraire, et je vais désabuser les derniers, s'il en reste encore.
Je n'ai pas seulement composé ma Piece en François, mais je pensois à la maniere Françoise quand je l'ai imaginée; elle porte l'empreinte de son origine dans les pensées, dans les images, dans les mœurs, dans le style.
On en a fait deux différentes traductions en Italie; elles ne sont pas mal faites, mais elles n'approchent pas de l'original; j'ai essayé moi-même pour m'amuser d'en traduire quelques scenes: je sentis la peine du travail et la difficulté de réussir; il y a des phrases, il y a des mots de convention qui perdent tout leur sel dans la traduction.
Voyez, par exemple, dans la scene XVII du deuxieme acte, le mot de jeune homme, prononcé par Angélique; il n'y a pas dans la Langue Italienne le mot équivalent. Il giovine est trop bas, trop au-dessous de l'état d'Angélique. Il giovinetto seroit trop coquet pour une fille honnête et timide; il faudroit pour le traduire employer une périphrase; la périphrase donneroit trop de clarté au sens suspendu, et gâteroit la scene.
Les caracteres de M. et Madame Dalancour sont imaginés et son traités avec une délicatesse qu'on ne connoît qu'en France: de tout mon Ouvrage, ce sont ces deux personnages qui me flattent davantage. Une femme qui ruine son mari sans pouvoir s'en douter, un mari qui trompe sa femme par attachement, ce sont des êtres qui existent, et qui ne sont pas rares dans les familles; je les ai employés comme épisodes, et j'aurois pu en faire des sujets principaux qui auroient été aussi neufs peut-être que le Bourru Bienfaisant.
J'ai donc écrit, j'ai donc imaginé cette Piece en François, mais je n'ai pas été assez hardi de la produire, sans consulter des personnes qui pouvoient me corriger et m'instruire; et j'ai profité même de leurs avis.
C'étoit à-peu-près dans ce tems-là que M. Rousseau de Geneve étoit de retour à Paris; chacun s'empressoit de le voir, et il n'étoit pas visible pour tout le monde; je ne le connoissois que de réputation; j'avois envie d'avoir un entretien avec lui, et j'aurois été bien aise de faire voir ma Piece à un homme qui connoissoit si bien la Langue et la Littérature Françoises.
Il falloit le prévenir pour être sûr d'être bien reçu; je prends le parti de lui écrire, je lui marque le desir que j'avois de faire connoissance avec lui; il me répond très-poliment qu'il ne sortoit pas, qu'il n'alloit aucune part, mais que si je voulois me donner la peine de monter quatre escaliers, rue Plâtriere, à l'Hôtel Plâtriere, je lui ferois le plus grand plaisir; j'accepte son invitation, et quelques jours après je m'y rends.
Je vais rendre compte de mon entretien avec le Citoyen de Geneve. Le résultat de notre conversation n'est pas bien intéressant; il n'y est question de ma Piece qu'en passant, et sans conséquence; mais j'ai saisi cette occasion pour parler de cet homme extraordinaire qui avoit des talens supérieurs, des préjugés et des foiblesses incroyables.
Je monte au quatrieme étage à l'Hôtel indiqué; je frappe, on ouvre; je vois une femme qui n'est ni jeune, ni jolie, ni prévenante.
Je demande si M. Rousseau est chez lui; il y est, et il n'y est pas, dit cette femme, que je crois tout au plus sa gouvernante, et elle me demande mon nom. Je me nomme. Monsieur, dit-elle, en vous attendoit, et je vais vous annoncer à mon mari.
J'entre un instant après; je vois l'Auteur d'Emile copiant de la Musique; j'en étois prévenu, et je frémissois en silence; il me reçoit d'une maniere franche, amicale; il se leve et me dit, tenant un cahier à la main: voyez si personne copie de la musique comme moi: je défie qu'une partition sorte de la presse aussi belle et aussi exacte qu'elle sort de chez moi: allons nous chauffer, continua-t-il, et nous ne fîmes qu'un pas pour nous approcher de la cheminée.
Il n'y avoit pas de feu, il demande une bûche, et c'est Madame Rousseau qui l'apporte; je me leve, je me range, j'offre ma chaise à Madame; ne vous gênez pas, dit le mari, ma femme a ses occupations.
J'avois le cœur navré; voir l'homme de Lettres faire le copiste; voir sa femme faire la servante, c'étoit un spectacle désolant pour mes yeux, et je ne pouvois pas cacher mon étonnement ni ma peine: je ne disois rien. L'homme qui n'est pas sot, s'apperçoit qu'il se passe quelque chose dans mon esprit; il me fait des questions, je suis forcé de lui avouer la cause de mon silence et de mon étourdissement.
Comment, dit-il, vous me plaignez, parce que je m'occupe à copier? Vous croyez que je ferois mieux de composer des livres pour des gens qui ne savent pas lire, et pour fournir des articles à des journalistes méchans? Vous êtes dans l'erreur, j'aime la musique de passion; je copie des originaux excellens; cela me donne de quoi vivre, cela m'amuse, et en voilà assez pour moi. Mais vous, continua-t-il, que faites-vous, vous-même? Vous êtes venu à Paris pour travailler pour les Comédiens Italiens; ce sont des paresseux; ils ne veulent pas de vos Pieces; allez-vous-en, retournez chez vous; je sais qu'on vous desire, qu'on vous attend...
Monsieur, lui dis-je, en l'interrompant, vous avez raison, j'aurois dû quitter Paris d'après l'insouciance des Comédiens Italiens; mais d'autres vues m'y ont arrêté. Je viens de composer une Piece en François... - Vous avez composé une Piece en François, reprend-il, avec un air étonné, que voulez-vous en faire? - La donner au Théâtre. - A quel Théâtre? - A la Comédie Françoise. - Vous m'avez reproché que je perdois mon tems; c'est bien vous qui le perdez sans aucun fruit. - Ma Piece est reçue. - Est-il possible? Je ne m'étonne pas; les Comédiens n'ont pas le sens commun; ils reçoivent et ils refusent à tort et à travers; elle est reçue, peut-être, mais elle ne sera pas jouée, et tant pis pour vous si on la joue. - Comment pouvez-vous juger une Piece que vous ne connoissez pas? - Je connois le goût des Italiens et celui des François, il y a trop de distance de l'un à l'autre; et avec votre permission, on ne commence pas à votre âge à écrire et à composer dans une Langue étrangere. - Vos réflexions sont justes, Monsieur, mais on peut surmonter les difficultés.
J'ai confié mon Ouvrage à des gens d'esprit, à des connoisseurs, et ils en paroissent contens. - On vous flatte, on vous trompe, vous en serez la dupe. Faites-moi voir votre Piece; je suis franc, je suis vrai, je vous dirai la vérité.
Ç'étoit-là où je voulois l'amener, non pas pour le consulter, mais pour voir s'il persisteroit encore après la lecture de ma Piece dans le peu de confiance qu'il avoit en moi. Le manuscrit étoit entre les mains du Copiste de la Comédie Françoise; je promis à Monsieur Rousseau qu'il le verroit aussi-tôt qu'il me seroit remis, et mon intention étoit de lui tenir parole. On verra dans le Chapitre suivant quelle fut la raison qui m'en à détourné.
Suite du Chapitre précédent. - Anecdotes qui regardent Jean Jacques Rousseau. - Quelques réflexions sur le même sujet.
Il parut, il y a trois ans, un livre intitulé les Confessions de J.J. Rousseau, Citoyen de Geneve: ce sont des anecdotes de sa vie écrites par lui-même. Il ne se ménage pas dans cet ouvrage; il y avance même des singularités sur son compte, qui pourroient lui faire du tort si sa célébrité ne le mettoit au dessus de la critique.
Mais j'en connois une qui lui arriva dans les dernières années de sa vie, qui ne se trouve pas dans ses Confessions; l'Auteur l'a peut-être oubliée, ou n'a pas eu le tems de la placer avec les autres, puisque son livre est posthume. Cette anecdote ne me regarde pas particulièrement, mais j'en fais mention, parce que ce fut la cause qui m'empêcha de communiquer à M. Rousseau mon Bourru Bienfaisant.
Ce savant étranger avoit des amis, et beaucoup d'admirateurs à Paris. M*** étoit du nombre des uns et des autres; il l'aimoit, il l'estimoit, et le plaignoit en même tems, connoissant aussi bien sa détresse que ses talens.
M*** proposa au Littérateur Génevois un appartement tout meublé, très-joli, très-commode, près du Jardin des Tuileries, et pour ne pas blesser la délicatesse de son ami, il lui offrit ce logement pour le même prix qu'il payoit à son hôtel garni. M. Rousseau s'apperçut de l'intention de cet homme généreux, il le refusa brusquement, et cria tout haut, qu'il ne vouloit pas être trompé.
M***, qui étoit Philosophe aussi, mais qui étant François, savoit allier la politesse à la philosophie, ne se fâcha pas du refus; il connoissoit l'homme et lui pardonnoit ses foiblesses, il ne cessa pas de le voir, et montoit paisiblement à un quatrieme étage pour s'entretenir avec lui.
Il avoit entendu parler des Confessions de J. J., il avoit envie de les voir en totalité, ou en partie, et ayant lui-même, dans son porte-feuille, des caracteres du siecle qu'il avoit composés à la maniere de Théophraste et de La Bruyere, il proposa à son ami la lecture réciproque de ces deux ouvrages.
M. Rousseau accepta la proposition, mais à condition que M*** accepteroit un souper frugal à l'hôtel Plâtriere; celui-ci fit voir qu'ils seroient plus commodément chez lui; c'est égal, dit l'autre, il faut que ce soit chez moi, ou nous ne lirons pas; tout au plus, ajouta-t-il, je vous permets d'apporter une bouteille de votre vin, car on m'en donne de très- mauvais où je suis logé.
Le François docile s'accommode à tout; mais malheureusement il étoit trop honnête, trop poli, il envoye une corbeille avec six bouteilles d'excellent vin, et six bouteilles de Malaga. Cette surprise rend le Génevois de mauvaise humeur. Le François arrive, il s'en apperçoit, il en demande l'explication. Nous ne boirons pas, dit l'homme fâché, douze bouteilles de vin à nous deux, j'en ai tiré une de votre corbeille, et c'est bien assez pour un petit souper; renvoyez le reste sur le champ, ou vous ne souperez pas chez moi.
La menace n'étoit pas effrayante, mais c'étoit la lecture qui intéressoit le convive; son domestique étoit là, il lui fait remporter la corbeille; Rousseau est content, et c'est lui qui lit le premier.
Le renvoi du vin leur avoit fait perdre du tems; la lecture est interrompue par Madame Rousseau, qui avoit besoin de la table pour mettre le couvert; on auroit pu lire sans table, mais le souper fut servi dans le même instant: une poularde, une salade, et voilà tout.
Le souper fini, c'est à M*** à faire la lecture; il lit un chapitre, c'est fort bien, il est applaudi; il en lit un second, M. Rousseau se leve, il se promene d'un air très-piqué, très-fâché. Interrogé sur le motif de sa colere, on ne vient pas, dit-il, chez les honnêtes gens pour les insulter.Comment! dit l'autre, de quoi vous plaignez-vous? Vous n'avez pas affaire à un sot, reprend le Philosophe, c'est mon portrait que vous avez tracé avec un coloris chargé, avec des traits satyriques, c'est affreux, c'est indigne!...
Tout doucement, dit le François, je vous aime, je vous estime, vous me connoissez; c'est un homme dûr, fâcheux, acariâtre que j'ai voulu peindre... on en rencontre si souvent dans la société. Oui, oui, reprend M. Rousseau, je sais que je passe pour tel dans l'esprit des ignorans; je les plains, et je les méprise; mais je ne souffrirai pas qu'un homme comme vous, qu'un ami... vrai ou faux, vienne se moquer de moi.
M*** eut beau faire, eut beau dire, il ne put rien gagner; la tête de l'autre étoit mal montée, ils finirent par se brouiller sérieusement, et il y eut par la suite des lettres piquantes de part et d'autre.
J'étois lié avec le Littérateur François; je le vis le lendemain de sa brouille avec M. Rousseau, dans une société où nous nous rencontrions souvent; il nous fit part de ce qui venoit de lui arriver; les uns rioient, d'autres faisoient des réflexions; je fis les miennes. Rousseau étoit bourru, il l'avoit avoué lui-même dans sa dispute avec son ami; il n'avoit qu'à se donner la bienfaisance, il auroit dit que c'étoit lui-même que le voulois jouer dans le Bourru Bienfaisant; je me gardai bien de m'exposer à essuyer sa mauvaise humeur, et je ne le vis plus.
Cet homme étoit né avec des dispositions très-heureuses, il en a donné des preuves, mais il étoit de la Religion P. R., il a fait des ouvrages qui n'étoient pas orthodoxes; il a été obligé de quitter la France qu'il avoit adoptée pour sa patrie; c'est ce désastre qui l'a rendu chagrin. Il croyoit les hommes injustes; il les méprisoit, et ce mépris ne pouvoit pas tourner à son avantage.
Que d'offres généreuses, que de protections n'a-t-il pas refusées? Son grabat lui étoit devenu plus cher qu'un palais; les uns voyoient de la grandeur d'ame dans sa fierté, d'autres n'y voyoient que de l'orgueil; soit d'une maniere, soit de l'autre, il étoit à plaindre; ses foiblesses ne faisoient de tort à personne, et ses talens l'avoient rendu respectable. Il est mort en Philosophe, comme il avoit vécu, et la République des Lettres doit savoir bon gré à l'homme généreux qui a honoré ses cendres.
Mariage de Monsieur, Frere du Roi. - Le Pàrc de Versailles. - Prise d'habit de Madame Louise aux Carmelites de Saint-Denis.
Dans le mois de Mai de l'Année 1771, on célébra à Versailles le Mariage du Comte de Provence, Petit-fils de Louis XV et Frere du Dauphin, avec Marie-Louise de Savoye, Fille ainée du Roi de Sardaigne.
Cet événement redoubla la joie des François; ce Prince étoit cher à l'Etat, et se rendoit encore plus intéressant par ses vertus et ses talens, et la Princesse faisoit par son esprit et par ses connoissances, les délices de son époux.
Le Comte de Provence ne s'appelle aujourd'hui que Monsieur, et son Epouse Madame; ce sont les titres qu'on donne en France au premier Frere et à la Belle-sœur du Roi; les trois quarts du monde doivent le savoir; j'instruis les Etrangers qui pourroient l'ignorer.
Les réjouissances à l'occasion de ce Mariage furent de la même magnificence que celles de l'année précédente; j'avois passé mon tems dans les appartemens aux noces du Dauphin, je jouis des jardins à celle-ci.
Le Parc de Versailles est délicieux par lui-même; je n'en ai pas encore fait mention, c'est ici l'occasion d'en parler. Son étendue est immense, ses compartimens variés, on y voit de tous les côtés une profusion de marbres précieux, des statues originales des célebres Artistes modernes, et des copies très-exactes d'après les antiques les plus estimés; on y rencontre par-tout des allées peignées et décorées, qui cachent des recoins rustiques et ombragés; on y voit des bassins richement ornés, des parterres agréablement dessinés, des fontaines superbes et des jets d'eau d'une élévation surprenante.
L'orangerie est un chef-d'œuvre de l'art, et la quantité et la grosseur de ses arbres est merveilleuse, vu la contrariété du climat à la nature des orangers; mais ce qui fait la beauté et la richesse principale de ces jardins enchanteurs, ce sont les bosquets.
Ces especes de salles ou de cabinets ne sont pas ouverts pour tout le monde; on les voit en suivant la Cour dans les jours solemnels, ou à l'arrivée de quelques illustres Etrangers. Ils sont fermés le reste du tems; il y a des personnes a qui, par grace, on en confie la clef; j'étois assez heureux pour en avoir une, et je pouvois les parcourir à mon aise, et en faire jouir mes amis.
Les bosquets sont au nombre de douze: la Salle du Bal, la Girandole, la Colonnade, les Dômes, l'Encelade, l'Obélisque, l'Etoile, le Théâtre d'eau, les Bains d'Apollon, les trois Fontaines, l'Arc de triomphe et le Labyrinthe. Ce dernier a été supprimé au commencement de ce regne, et on y a substitué un jardin à l'Anglaise.
On trouve dans ces bosquets des chefs-d'œuvre en sculpture, en architecture; les deux bosquets les plus remarcables sont les Bains d'Apollon et la Colonnade. On voit dans le premier un groupe de sept figures de marbre blanc, unique par sa grandeur et par sa perfection; et on admire dans l'autre un péristyle de forme circulaire, composé de trente- deux colonnes de différens marbres choisis.
Tous ces bosquets étoient ouverts les jours des nôces dont je viens de parier; on dansoit dans celui de la Salle du Bal, dans celui de la Colonnade et dans la Salle des Maronniers. On avoit disposé dans d'autres des divertissemens pour amuser le Public, et on y avoit fait venir les petits Spectacles de Paris.
Les Etrangers qui ne connoissent pas cette Capitale, seront curieux de savoir, peut-être, de quelle nature sont ces petits Spectacles que je viens d'annoncer; je les satisferai dans le Chapitre suivant, et je finirai celui-ci par un trait héroïque qui doit intéresser la Religion et l'Humanité.
Dans cette même année 1771, et au milieu des fêtes et des réjouissances de la Cour, Madame Louise, fille du Roi Louis XV, quitta le monde, alla s'enfermer pour toute sa vie dans un cloître, et choisit l'ordre le plus humble et le plus austere.
C'est aux Carmelites de Saint-Denis, que cette pieuse Princesse prit l'habit de Sainte-Thérese; elle ne craignoit pas que le séjour Royal l'empêchât d'exercer sa piété et ses vertus, mais la corruption de notre siecle avoit besoin d'un exemple imposant pour ramener les ames timides à la voie de la perfection, et Dieu choisit une Princesse du Sang des Bourbons pour les encourager.
Les petits Spectacles de Paris. - Les Boulevarts, les Foires, les Promenades de cette Capitale et des Environs.
On appelle à Paris les Petits Spectacles ceux qui suivent les différentes Foires de cette Ville, et jouent pendant le reste de l'année sur les Boulevarts.
Je n'entrerai pas dans le détail de leur origine; je dirai comment je les ai trouvés en arrivant à Paris, et je parlerai de leurs progrès depuis mon arrivée.
La Salle de Nicolet tenoit alors la premiere place aux Foires et sur le Boulevart du Temple: c'étoit des Danseurs de cordes brévetés du Roi, qui, après leurs exercices, donnoient de petites Pieces dialoguées.
Les Boulevarts étoient ma promenade favorite; je les regardois comme une ressource agréable et salutaire dans une Ville très-vaste, très-peuplée, dont les rues ne sont pas larges, et où la hauteur des bâtimens empêche la jouissance de l'air.
Ce sont des bastions très-étendus qui environnent la Ville: quatre rangées de gros arbres forment un vaste chemin au milieu pour les voitures, et deux allées latérales pour les gens à pied; on y découvre la campagne, on y jouit des points de vue agréables et variés des environs de Paris, et on s'amuse en même tems des divertissemens que l'on y trouve rassemblés.
Une foule de monde infini, une quantité de voitures étonnante, de petits Marchands qui s'élancent parmi les roues et les chevaux, avec toutes especes de marchandises; des chaises sur des trottoirs pour les personnes qui aiment à voir, et pour celles qui se rangent pour être vues; des Cafés bien décorés avec un orchestre, et des voix Italiennes et Françoises, des Pâtissiers, des Traiteurs, des Restaurateurs, des Marionnettes, des Voltigeurs, des Braillards qui annoncent des Géans, des Nains, des Bêtes féroces, des Monstres marins, des Figures de cire, des Automates, des Ventriloques; le Cabinet de Comus, savant Physicien et Mathématicien aussi surprenant qu'agréable.
Je vis un jour à la porte de la Salle de Nicolet, que l'on y donnoit, pour troisieme Piece, Coriolan, Tragédie en un acte; cette affiche me parut si extraordinaire, que j'entrai sur-le-champ, crainte de manquer de place, et je me trouvai presque seul dans la galerie.
Je vois, quelques minutes après, un jeune homme bien bâti, et assez mal vêtu, s'approcher de moi; le monde commençoit à venir, je le crois Spectateur comme moi, je me range pour lui faire place; c'étoit un Acteur de la Troupe de Nicolet qui devoit jouer le rôle de Coriolan, et n'ayant pas en son pouvoir une épée décente, venoit me prier de vouloir bien lui prêter la mienne.
Ne le connoissant pas, j'hésitai, quelques instans, et je lui fis des questions pour m'assurer s'il étoit attaché à ce Spectacle: je lui demandai si le Coriolan que l'on avoit affiché étoit une Tragédie ou une Parodie; il m'assura que c'étoit un Ouvrage très-sérieux, très-bien fait; il m'en dit assez pour me rassurer; et je lui donnai mon épée, enchanté de la voir briller entre les mains de ce valeureux Capitaine.
J'attendis pendant long-tems et avec beaucoup d'impatience la Piece qui m'avoit attiré à ce Spectacle: les Danseurs de cordes me faisoient frémir; les deux premieres Pieces dialoguées me faisoient dormir; enfin voilà le tour de Coriolan arrivé.
Je vois des Acteurs mal habillés, j'entends des vers mal débités, mais je m'apperçois que l'Ouvrage n'étoit pas sans mérite, et que l'Auteur avoit traité fort adroitement son sujet; il n'y a dans l'histoire de Coriolan qu'un seul instant qui intéresse; c'est lorsque ce Capitaine Romain vient se venger de l'ingratitude de sa Patrie, et se laisse désarmer par les larmes de Volumnia sa mere, et de Véturia sa femme.
Nous avons sept ou huit Tragédies en cinq actes sur ce même sujet, et elles ont presque toutes échoué; il n'y a que M. de la Harpe qui ait su rendre les quatre premiers actes de son Coriolan intéressans et agréables, mais je soutiens toujours que l'Auteur de la Piece en un acte avoit donné a son sujet l'étendue que l'histoire pouvoit lui fournir, et avoit évité le danger de devenir ennuyeux.
Je ne dirai rien de son style, car j'ai plus deviné qu'entendu: les Acteurs de Nicolet n'étoient pas faits pour ce genre de représentations, et ce Spectacle en général étoit encore mal monté; il l'est beaucoup mieux aujourd'hui; les petits Spectacles qui se sont établis depuis, lui ont donné de l'émulation, et ont mis le Directeur dans la nécessité de se pourvoir de meilleurs sujets.
L'Ambigu-Comique fut le premier qui parut sur le Boulevart après Nicolet: ce Spectacle commença par des Marionnettes, qu'on appelloit les Comédiens de Bois; il y avoit un Orchestre assez bien monté qui exécutoit des airs connus, et les Marionnettes faisoient la charge des Acteurs des grands Spectacles qui les avoient chantés.
Cette nouveauté fut extrêmement goûtée et courue, mais elle ne pouvoit aller loin, et le Directeur changea les Comédiens de Bois en petits Comédiens vivans, très-bien instruits dans le jeu et dans la danse; il y eut des Auteurs qui ne dédaignerent pas de composer quelques jolies Pieces analogues aux Acteurs et à la Salle. L'Ambigu-Comique étoit devenu le Spectacle à la mode; je ne sais pas si le Directeur est riche, mais il a eu le tems et les moyens de le devenir.
Quelques années après, un troisieme Spectacle s'ouvrit sur le Boulevart Saint-Martin, sous le titre de Variétés Amusantes; celui-ci, mieux monté en Acteurs, et mieux fourni de Pieces comiques, l'emporta sur les autres, et fut transporté par la suite au Palais-Royal, jouissant toujours du même crédit et du même bonheur.
La Salle des Petits Comédiens, établie dans ce même endroit, n'est pas moins fréquentée; ce sont des enfans qui accompagnent si adroitement avec leurs gestes la voix des hommes et des femmes qui chantent dans la coulisse, que l'on a cru d'abord, et l'on a parié que c'étoit les enfans eux-mêmes qui chantoient.
Les deux derniers Spectacles et quelques autres curiosités que l'on fait voir au Palais-Royal jouissent du privilege de ne pas être forcés de courir les Foires de la Ville; car ces Foires sont soutenues plus pour l'intérêt des Propriétaires du terrein que pour celui du commerce.
Torré, Artificier Italien, est le premier qui ait ouvert un Vaux-Haal d'été sur les Boulevarts; il n'y a pas duré long-tems. On a élevé un bâtiment immense près des Champs-Elysées, sous le titre de Colisée, et les Entrepreneurs s'y sont ruinés. Faire payer l'entrée dans une promenade close, bornée et sans agrémens, dans un pays où il y a tant de promenades publiques, spacieuses, agréables, c'est à mon avis une mauvaise spéculation.
Indépendimment des Tuileries et des Boulevarts, on trouve par-tout ici des promenades sans sortir de la ville.
Le Jardin du Luxembourg est très-ample et très-fréquenté; c'est le rendez-vous des gens sensés, des Religieux, des Philosophes et des bons ménages.
On jouit à l'Arsénal de la vue de la campagne et de la riviere; même vue et même air au Jardin de l'Infante et au Cour la Reine; les Jardins du Temple et de l'Hôtel Soubise sont trés-utiles dans leurs quartiers.
Mais les endroits les plus essentiels où l'on peut s'instruire et s'amuser en même tems, ce sont le Jardin des Plantes et le Cabinet du Roi.
On trouve dans l'un tous les simples les plus rares et le plus utiles; on voit dans l'autre une collection immense d'animaux de toutes especes et de minéraux de différentes régions.
M. le Comte de Buffon, Intendant du Jardin et du Cabinet, s'est rendu célebre par son Histoire Naturelle ; instruit de tous les systemes qui embrassent les trois regnes de la nature, il les a approfondis, il les a éclaircis; il en a donné de nouveaux très-sages, très-satisfaisans, et il a rendu, par la noblesse et par la clarté de son style, cette étude aussi agréable qu'intéressante.
M. le Comte de la Billarderie d'Angeviller, nommé à cet emploi en survivance, donne actuellement des preuves de son mérite et de ses connoissances dans la charge qu'il occupe de Directeur et Ordonnateur Général des Bâtimens du Roi, et des Académies Royales. J'eus l'honneur de le connoître à Versailles, il m'a toujours honoré de ses bontés; je suis bien aise d'avoir trouvé l'occasion de lui marquer ma reconnoissance.
Mais il me reste encore quelques mots à dire sur les Promenades de cette Capitale et de ses Environs. Les Champs- Elisées, par exemple, méritent bien que l'on en fasse mention; c'est un endroit immense, ombragé par des arbres distribués en quinconces, où la foule qui le fréquente, semble avoir dépeuplé la ville. Cependant il y a du monde par-tout; on en trouve en affluence au Bois de Boulogne, au Parc de Saint-Cloud, à Belleville, au Pré Saint-Gervais, et on reconnoît par-tout le goût et la gaieté nationales.
Paris est beau, ses Environs sont délicieux, ses Habitans sont aimables; cependant il y a du monde qui ne s'y plaît pas. On dit que pour en jouir, il faut beaucoup de dépense: cela est faux; personne n'a moins d'argent que moi, et j'en jouis, je m'amuse et je suis content. Il y a des plaisirs pour tous les états: bornez vos desirs, mesurez vos forces, vous serez bien ici, ou vous serez mal par-tout.
L'Avare fastueux, Comédie en cinq Actes. - Son extrait.
Depuis le succès de mon Bourru Bienfaisant, je n'avois rien fait; je disois en badinant que je voulois reposer sur mes lauriers; mais c'étoit la crainte de ne pas réussir une seconde fois comme la premiere, qui m'empêchoit de me rendre aux desirs de mes amis, et de me satisfaire moi-même; je cédai enfin aux sollicitations d'autrui, et à celles de mon amour-propre.
Je jettai les yeux sur l'Avare fastueux: ce caractere est si bien dans la nature, que je n'avois à craindre que la trop grande quantité d'originaux, et je pris mon protagoniste dans la classe des gens parvenus pour éviter le danger de choquer les Grands.
Cette Piece très-peu connue, et que beaucoup de monde voudroit connoître, a essuyé des aventures singulieres: je vais d'abord en exposer le sujet, je parlerai après des anecdotes qui la regardent.
M. de Chateaudor, devenu très-riche, avoit changé de nom comme il avoit changé de fortune; son avarice a contribué à sa richesse, et sa richesse l'a rendu fastueux.
Il est garçon, il craint la dépense qu'entraîne le mariage; mais ayant acheté une charge qui l'ennoblit, il croiroit avoir mal dépensé son argent, s'il n'avoit pas de postérité, et prend le parti de se marier; il hésite sur le choix d'une épouse; la noblesse flatte son orgueil, mais l'intérêt l'emporte, et c'est Dorimene sa sœur qui se charge de le marier.
Elle connoît Madame Araminte qui a cent mille écus à donner en dot à Léonore sa fille; elle les fait venir l'une et l'autre à Paris; elle les loge chez elle au deuxieme étage dans la même maison que son frere.
Sa médiation est heureuse; il semble que les deux partis se conviennent, et c'est la signature du contrat qui fait l'action principale de la Piece.
M. de Chateaudor ouvre la scene; il fait des réflexions qui instruisent le Public de son état et de ses projets, et appelle Frontin son valet-de-chambre, son homme d'affaire et son confident.
Il s'agit de donner un repas: grand étalage de vaisselle, et beaucoup d'économie dans les plats; il fait appeller Dorimene, et Frontin sort.
Le frere et la sœur parlent du mariage en question; Dorimene est bien aise d'avoir réussi dans cette affaire, mais elle craint que Léonore ne soit pas trop contente de son prétendu. Chateaudor badine là-dessus, et fait connoître que ce sont les cent mille écus qui l'intéressent plus que le cœur de la Demoiselle; il annonce à Dorirmene son magnifique dîner, et elle sort.
Frontin entre, et annonce le Tailleur qui vient d'arriver dans son carrosse: l'équipage effraye Chateaudor; mais j'aurai, dit-il, de beaux habits, on m'en fera compliment; il faut pouvoir nommer l'homme qui les aura faits.
Le Tailleur paroît; Chateaudor demande quatre habits de drap avec des broderies très-riches, mais appliquées de maniere à pouvoir les détacher, et propose au Tailleur de les lui rendre au bout de huit jours, et de lui payer la somme dont ils seront convenus: l'homme à voiture dédaigne ce marché; l'Avare envoye chercher son petit Tailleur ordinaire, et le premier Acte finit.
Dorimene ouvre le deuxieme Acte avec Léonore; elle l'a éloignée de sa mere pour la questionner sur son inclination; la Demoiselle voudroit se cacher, mais Dorimene s'y prend si adroitement, que Léonore est forcée d'avouer qu'elle a le cœur prévenu.
Araminte arrive; elle se plaint de sa fille, qui est devenue d'une tristesse insupportable; elle la gronde, et lui donne des leçons sur le nouvel état qu'elle va prendre.
M. de Chateaudor entre, un écrain à la main, et suivi par un Bijoutier; il fait voir à Madame Araminte les diamans, et la consulte; elle s'y connoît, elle en a eu dans son commerce; elle les trouve très-beaux, très-bien assortis, mais elle juge que le prix doit en être excessif, et le conseille de ne pas faire la folie de les acheter; M. de Chateaudor parle bas au Bijoutier, il le prie de lui confier les diamans pour quelques jours; le Bijoutier consent, et s'en va.
Chateaudor présente l'écrain à Léonore; elle le refuse: Araminte condamne la prodigalité de son gendre futur; mais puisque les diamans sont achetés, elle conseille à sa fille d'accepter le cadeau de son prétendu. Chateaudor prie Léonore de paroître avec ces diamans au diner de ce jour; Araminte trouve cette parade ridicule; l'homme fastueux la trouve nécessaire à un repas de trente couverts; cette somptuosité la choque encore davantage; elle croit avoir affaire à un prodigue, et elle craint pour sa fille.
Frontin entre, et donne une lettre à son maître. C'est le Marquis de Courbois qui doit arriver dans la journée à Paris, avec le Vicomte son fils, et lui demande à souper. L'Avare seroit bien aise que le Marquis se trouvât à son festin; mais il est fâché qu'il n'arrive que le soir.
Il fait part aux Dames de l'arrivée du Marquis et de son fils; ce jeune homme est l'amant de Léonore; elle se trouve mal; elle sort avec Dorimene, Araminte les suit, et revient un instant après. Voici une scene que le Lecteur ne sera pas fâché, je crois, de voir en entier.
ARAMINTE et CHATEAUDOR
ARAMINTE. Ce n'est rien, grâce au ciel, ce n'est rien, ma fille se porte bien.
CHATEAUDOR. J'en suis enchanté, Madame, mais il faut toujours ménager la santé de Mademoiselle, il faut suspendre le dîner; j'envoyerai prier mon monde pour ce soir. (à part). Le prétexte est honnête, voilà un repas d'épargné.
ARAMINTE. Et vous aurez trente personnes à votre souper? CHATEAUDOR. Je l'espere, Madame.
ARAMINTE. Permettez-vous que je vous parle à cœur ouvert? Que je vous dise ce que je pense?
CHATEAUDOR. Je vous en prie très-fort, Madame.
ARAMINTE. N'est-ce pas une folie, mon cher ami, mon cher gendre, de donner à dîner ou à souper à trente personnes, dont la moitié, au moins, se moquera de vous?
CHATEAUDOR. Ils se moqueront de moi?
ARAMINTIE. Sans doute. Je ne suis pas avare, il s'en faut de beaucoup; mais je ne puis pas souffrir qu'on jette l'argent mal à propos.
CHATEAUDOR. Mais, Madame, dans un jour comme celui-ci.
ARAMINTE. Sont-ce des parens que vous avez priés?
CHATEAUDOR. Non, Madame, ce sont des connoissances, des gens titrés, des gens de lettres, des gens de robe, des personnes de la premiere distinction.
ARAMINTE. Tant pis, tant pis; c'est de la vanité toute pure. Mon ami, vous ne connoissez pas le prix de l'argent.
CHATEAUDOR (avec étonnement). Moi, Madame?
ARAMINTE. Oui, oui, vous. Votre sœur m'a fait croire que vous étiez économe, et je l'ai cru sur sa parole, autrement je n'aurois jamais accordé ma fille à un homme aussi dépensier que vous.
CHATEAUDOR. Moi dépensier, Madame?...
ARAMINTE. Je m'en suis doutée, quand j'ai su que vous aviez déboursé une somme considérable pour acheter un titre qui ne vous rapporte presque rien.
CHATEAUDOR. Comment, Madame? Est-ce que vous n'en êtes pas flattée? Ce titre n'apportera-t-il pas des avantages réels aux enfans de votre fille?
ARAMINTE. Point du tout. J'aurois mieux aimé vous donner ma fille quand vous n'étiez que Monsieur du Colombier, ancien Bourgeois, qu'à présent que vous êtes Monsieur de Chateaudor, nouveau Gentilhomme.
CHATEAUDOR. Mais, Madame...
ARAMINTE. Oui; vos peres ont bâti, et vous allez détruire.
CHATEAUDOR. Moi, détruire? Vous êtes dans l'erreur...
ARAMINTE. Je gage que sans vous connoître en diamans, et sans consulter personne, vous allez être la dupe de votre Bijoutier.
CHATEAUDOR. Oh! pour ces diamans-là, Madame...
ARAMINTE (en l'interrompant). Oh! pour ces diamans-là... Je vous vois venir; c'est la parure de Madame de Chateaudor... Ma fille, Monsieur, a été élevée dans l'aisance, mais modestement. Nous avons donné abondamment à la bienséance, et rien à la vanité. La parure de ma fille a toujours été la sagesse, et je me flatte qu'elle ne démentira jamais l'éducation que je lui ai donnée.
CHATEAUDOR. Mais, Madame...
ARAMINTE. Mais, Monsieur, je vous demande pardon. Je m'échauffe un peu trop, peut-être; mais je vous vois dans un train de dépense qui me fait trembler. Il s'agit de ma fille, il s'agit de cent mille écus de dot...
CHATEAUDOR (piqué). N'ai-je pas assez de fonds pour les assurer?...
ARAMINTE. Oui, oui, des fonds! on les mange les fonds, vous principalement qui avez la manie d'être magnifique, d'être généreux.
CHATEAUDOR. Mais vous ne me connoissez pas...
ARAMINTE. Si vous étiez différent de ce que vous êtes, j'avois un projet excellent à vous proposer. J'ai vingtecinq mille livres à moi toute seule; je me serois mise en pension chez vous; j'aurois vécu avec ma fille, et nous aurions fait un ménage charmant; mais avec un homme comme vous...
CHATEAUDOR (à part et faché). C'est désespérant. (A Araminte). Vous vous trompez sur mon compte; il y a peu d'hommes qui connoissent l'économie comme moi, et vous verrez par vous-même...
ARAMINTE. Je ne verrai rien. Vous voudriez m'en imposer; mais vous ne réussirez pas. Pour ma fille... Nous verrons... Je l'ai promise... Si elle le veut, soit. Mais ne comptez pas sur moi; je me garderois bien d'avoir à faire à un homme qui jette son argent par les fenêtres. (Elle sort).
CHATEAUDOR (en la suivant). Non, non, Madame, je n'ai pas, grace au ciel, le vice de la prodigalité.
Fin du second Acte.
Le reste au Chapitre suivant.
Suite du Chapitre précédent.
ACTE III
Frontin annonce à son maître un petit Auteur, nommé Jacinte; celui-ci entre, et après avoir parlé d'une Piece de sa façon que les Comédiens avoient refusée, se donne le mérite davoir fait la généalogie de M. de Chateaudor qui est de la famille du Colombier, et que l'Auteur fait descendre de Christophe Colomb; l'imagination ne déplait pas à l'homme fastueux, et l'Auteur est prié à souper, mais comme il s'agit de débourser quelqu'argent, il est renvoyé brusquement.
A la sortie de Jacinte, la Fleur, domestique du Marquis de Courbois, vient annoncer l'arrivée de ses Maitres; le pere et le fils comptent loger chez M. de Chateaudor, et Mademoiselle de Courbois, qui est de la partie, ira loger chez sa tante: Chateaudor n'est pas trop content qu'on vienne lui demander l'hospitalité si cavalierement: il n'en fait pas semblant, et sort pour aller s'informer de l'état de la santé de sa prétendue.
Frontin et la Fleur restent sur la scene; chacun trace le tableau de son Maitre; celui de la Fleur a des ridicules; il parle singulierement, il n'acheve jamais ses phrases; il en dit la moitié, il faut deviner le reste; il a des intercalaires; celui-ci entr'autres, voilà qui est bien; il le fourre par-tout à tort et à travers; la maison n'est pas riche, mais le service y est doux; on y est très-bien.
Frontin se plaint de sa condition; son Maître est avare. La Fleur auroit de bonnes occasions pour le mieux placer; mais depuis le tems, il le croit attaché à son Maître; j'y suis attaché, dit Frontin, mais je n'y suis pas cloué: leur conversation est interrompue par le Marquis et le Vicomte, qui demandent le Maitre de la maison; on va le chercher; le pere et le fils étant seuls, font connoître le motif de leur voyage. Le Vicomte aime Léonore; le Marquis seroit enchanté que ce mariage pût avoir lieu; Chateaudor est leur ami; ils se flattent l'un et l'autre de l'obtenir par sa médiation.
Chateaudor entre; après les cérémonies d'usage, il envoye le Vicomte voir Dorimene sa sœur, et il parle des deux Etrangeres sans les nommer, et sans savoir ce qui se passe entre le jeune homme et la Demoiselle; le Marquis reste avec Chateaudor; je vais écrire la scene qu'ils ont entr'eux pour faire connoître le rôle du Marquis.
CHATEAUDOR, le MARQUIS
LE MARQUIS. Ah ça, avant que... Avez-vous le tems?
CHATEAUDOR. Je suis à vos ordres, Monsieur le Marquis.
LE MARQUIS. Vous êtes mon ami.
CHATEAUDOR. C'est un titre dont je me fais honneur.
LE MARQUIS. Voilà qui est bien; je voudrois vous prier... là... Tout court... Tout bonnement...
CHATEAUDOR (à part). Il est venu pour m'emprunter de l'argent.
LE MARQUIS. Vous connoissez ma maison?...
CHATEAUDOR. Beaucoup, Monsieur.
LE MARQUIS. J'ai deux enfans... Il faut que je pense... La fille est jeune; voilà qui est bien; mais le Vicomte... Vous savez ce que c'est.
CHATEAUDOR. Je comprends à-peti-près que vous pensez sérieusement à l'établissement de vos enfans, et vous faites très- bien; mais à propos d'établissement, je me crois dans le devoir de vous faire part de mon mariage prochain.
LE MARQUIS. Quoi!... Vous allez aussi... Voilà qui est bien; j'en suis ravi.
CHATEAUDOR. Aujourd'hui nous signerons le contrat, et c'est un bonheur pour moi que Monsieur le Marquis...
LE MARQUIS. C'est à merveille, mais... en même tems ... si vous vouliez m'obliger...
CHATEAUDOR. Je me félicite d'avoir fait une bonne affaire, mais si vous saviez combien il m'en coûte en meubles, en chevaux, en voitures; je suis épuisé.
LE MARQUIS. Voilà qui est bien.
CHATEAUDOR. Pas trop bien.
LE MARQUIS. Ecoutez... vous êtes lié avec Madame Araminte.
CHATEAUDOR. Oui, Monsieur; elle est ici actuellement, et vous la verrez vous-même. Celle-là, par exemple, celle-là est une femme qui est riche, et qui pourroit bien faire votre affaire.
LE MARQUIS. C'est précisément pour cela... Si vous vouliez lui parler pour moi et pour le Vicomte...
CHATEAUDOR. Je le ferai avec plaisir.
LE MARQUIS. Mais je voudrois que cela... Aussi-tôt dit, aussi-tôt fait...
CHATEAUDOR. Je vais voir Madame Araminte, et je lui parlerai sur-le-champ.
LE MARQUIS. Et croyez-vous que... Voilà qui est bien?
CHATEAUDOR. Je crois que Madame Araminte se prêtera à vos desirs, pour vous d'abord qui le méritez à tous égards, et pour moi aussi qui vais devenir son gendre.
LE MARQUIS. Quoi! son... Comment?
CHATEAUDOR. Oui, Monsieur; c'est sa fille que je vais épouser.
LE MARQUIS. Ah! voilà qui... Est-ce bien vrai?
CHATEAUDOR. Mais d'où vient votre étonnement? Trouveriez-vous à redire à mon mariage?
LE MARQUIS. Point... C'est que mon fils... (A part). Ah! comme il s'est... Ah! quelle étourderie!...
CHATEAUDOR. Croyez-vous que Madame Araminte, en déboursant la dot de sa fille, n'ait pas d'argent à vous prêter?
LE MARQUIS (piqué). A me prêter? A me prêter?
CHATEAUDOR. Je vais lui parler...
LE MARQUIS. Point du tout.
CHATEAUDOR. Vous ne voulez pas que je lui parle?
LE MARQUIS. Point... Point... Voilà qui est bien, point.
CHATEAUDOR. Monsieur, je vous demande pardon, je ne vous entends pas. Voilà votre appartement; j'ai des affaires, il faut que je sorte. Je suis votre très-humble serviteur. (A part). Je n'ai rien vu de si ridicule. (Il sort)
LE MARQUIS. Peste soit!... Il ne sait ce qu'il dit.
Fin du troisieme Acte.
A la premiere scene du quatrieme Acte, le Vicomte se plaint de l'engagement de Léonore; à la troisieme, Chateaudor se plaint à son tour des mauvaises façons de sa prétendue et de sa mere. Il a envie de s'en défaire, il a vu Mademoiselle de Courbois, il en est enchanté; mais il regrette les cent mille écus de Madame Araminte.
Il se passe une scene entre le Marquis et Chateaudor, où l'homme fastueux fait étalage de ses richesses, et se vante d'avoir fait un présent à sa prétendue de cent mille francs de diamans. Le Marquis en est étonné; il sort en répétant à plusieurs reprises: cent mille francs de diamans! voilà qui est bien.
Chateaudor se flatte de pouvoir épouser Mademoiselle de Courbois, sans perdre les cent mille écus de Madame Araminte; il en fait part à sa sœur; voici son projet. Je ferai en sorte, dit-il, que Madame Araminte donne sa fille au Vicomte, avec cent mille écus, et que le Marquis me donne en même-tems sa fille en mariage avec le même argent. De cette maniere le pere satisfait son fils, il marie sa fille sans bourse délier, et tout le monde est content. (Il sort).
Dorimene intéressée également à son frere et à son amie, voudroit bien que ce projet, tout extraordinaire q'il paroît, pût réussir. Léonore paroît; le Vicomte aussi; la scene est intéressante, et elle est coupée par Madame Araminte qui fait partir sa fille, sous le prétexte d'aller parler à la Marchande de Modes qui l'attend. Léonore sort avec Dorimene.
Araminte restée seule avec le Vicomte, lui parle avec sa franchise ordinaire; elle connoît son inclination pour Léonore, elle a beaucoup de considération pour lui, elle lui donneroit sa fille avec plaisir, et son engagement avec Chateaudor ne l'en empêcheroit pas; mais les affaires de la maison de Courbois sont en mauvais état, son dérangement est connu.
Le Vicomte voit qu'elle n'a pas tort. Il avoue cependant que son pere lui cédant la direction des affaires, il se flatteroit d'y mettre de l'ordre et de l'économie, de pouvoir continuer son chemin dans le service, que faute de moyens il étoit forcé de quitter.
Araminte est touchée de l'état du jeune homme dont elle connoît le mérite et la probité; vous n'êtes pas dans le cas, lui dit-elle, de vous marier. Soyez libre, et laissez ma fille en liberté de suivre sa destinée; mais si vous agréez les preuves de mon amitié, je vous offre la somme nécessaire pour acheter un Régiment; je ne vous demande d'autres assurances que votre billet d'honneur.
Le Vicomte dit, pénétré de reconnoissance, et si je meurs, Madame? Si vous mourez, reprend Madame Araminte, eh bien, si vous mourez, je perdrai mon argent, peut-être, mais tout ne sera pas perdu; il me restera le plaisir d'avoir obligé un honnête homme.
Ils vont ensemble chez Madame Dorimene, et le Vicomte appelle la Fleur pour en faire prévenir son pere en cas qu'il le cherche.
Le Marquis entre, il demande son carrosse, et est furieux contre son cocher. La Fleur excuse le cocher; celui de Chateaudor lui a refusé la paille pour ses chevaux. Le Marquis ne peut pas le croire, Chateaudor n'est pas un avare. La Fleur soutient le contraire, et raconte à son Maitre tout ce que Frontin lui avoit confié. Le Marquis rappelle les cent mille francs de diamans; la Fleur découvre le mystere de ces diamans empruntés.
Comment, dit le Marquis, un avare caché, un homme faux; c'est... Voilà qui est bien, l'homme du monde le plus misérable. Ma fille?... Il ne l'aura pas. Cent mille Francs de diamans et point de paille! (Il sort).
Au cinquieme Acte la nuit commence. Chateaudor fait allumer les lustres et les girandoles.
Frontin appelle la Fleur pour se faire aider. Celui-ci s'y prête avec plaisir, et se flatte de faire bonne chere ce jour- là. Frontin ne lui promet pas grando chose. Au moins une bouteille de vin, dit la Fleur: ce n'est pas sûr, répond l'autre. Mon Maitre a des boules de papier dans sa poche, il les tire à mesure que les bouteilles paroissent sur la table, il sait à la fin du repas combien on en a servi, et il est très-difficile d'en escamoter.
Chateaudor reparoit, mais d'un air furieux. Tout le monde le méprise, il est refusé de tous les côtés. Il fait sortir la Fleur, et ordonne à Frontin d'éteindre les bougies. Frontin obéit à regret, et c'est Chateaudor lui-même, qui, avec son mouchoir, éteint la derniere bougie, et on reste dans l'obscurité.
Chateaudor veut sortir, il entend du monde qui entre, et se tient caché; c'est la Fleur qui est étonné de voir que l'on a éteint les bougies. Il se rencontre avec Frontin; ils se reconnoissent; ils causent; Chateaudor est témoin de tout ce que l'on dit sur son compte: cela fournit matiere à plusieurs scenes comiques, dont le détail seroit trop long; mais en voici une que je trouve à propos de transcrire:
Madame ARAMINTE, le MARQUIS, en se rencontrant.
ARAMINTE. ...Ah! bonjour, Monsieur le Marquis.
LF MARQUIS. Bonjour, Madame... J'avois justement... Voilà qui est bien, j'en suis ravi... Avez-vous vu mon fils?... Vous a- t-il parlé?
ARAMINTE. Votre fils, ma fille, Madame Dorimene ne font que m'étourdir... Je suis d'une humeur... Je n'en puis plus.
LE MARQUIS. Est-ce que vous en seriez fachée?... Vous me connoissez. Je ne suis pas... Je n'ai pas... Mais pour des terres... Courbois... Sept-fontaines... Basecôteau... Verdurier... Voilà qui est bien, Madame... Deux millions, Madame.
ARAMINTE. A quoi bon vos millions, vos terres? Feu mon mari avec rien a fait des millions, et vous avec des raillions vous n'avez rien. C'est que mon mari avoit de l'ordre, c'est qu'il avoit une femme qui savoit conduire un ménage; mais vous, Monsieur le Marquis, soit dit entre nous, tout va de travers chez vous.
LE MARQUIS. Il est vrai que feue Madame de Courbois n'étoit pas... Elle aimoit un peu... La pauvre femme! ... Et elle perdoit gros... Moi tantôt d'un côté, voilà qui est bien, tantôt de l'autre... Je l'avoue, je ne me connois pas ... Mais mon fils... Il s'y connoît lui... Un jour, un jour ... nos terres...
ARAMINTE. Ah! si vos terres étoient entre mes mains, ce jour, ce jour... ne tarderoit pas à arriver.
LE MARQUIS. Prenez-les, Madame... Ma foi, voilà qui est bien, prenez-les.
ARAMINTE. Croyez-vous, Monsieur, qu'une femme comme moi soit faite pour être votre intendante?
LE MARQUIS. Point du tout. Est-ce que nous ne pourrions pas... Je ne suis pas vieux moi... Vous êtes encore... Voilà qui est bien.
ARAMINTE. Vous vous moquez de moi, Monsieur le Marquis.
LE MARQUIS. Pardonnez moi... Ce que je dis... est toujours... là... bien... Voilà qui est bien.
ARAMINTE. Je n'ai pas envie de me remarier; mais en tout cas, je ne le ferois que pour le bien de ma fille.
LE MARQUIS. Oui, oui. Tout... maîtresse de tout... Carte blanche, Madame, carte blanche.
ARAMINTE (avec intérêt). Carte blanche, Monsieur?...
LE MARQUIS. Oui, parole d'honneur... Carte blanche.
Le Vicomte survient, il est instruit de ce dont il s'agit, il ajoute ses prieres à celles de son pere pour qu'Araminte se charge de la direction de leurs affaires, en qualité de Madame la Marquise de Courbois; elle hésite toujours. Léonore arrive, elle se jette aux genoux de sa mere, et la fait accepter.
Madame Dorimene apprend ce qui vient de se passer; elle est bien aise que Léonore soit heureuse, mais elle trouve mauvais que cet arrangement soit fait sans en faire part à son frere.
Il auroit eu ma fille, dit Madame Araminte, s'il n'eût pas été si fastueux.
Il auroit eu la mienne, dit le Marquis, s'il n'étoit pas un avare.
L'Avare fastueux entre. Il est instruit de tout, et prend son parti en brave. Le souper est fait, il ne faut pas le perdre; les convives se rassemblent, il ne veut pas qu'ils se moquent de lui, il les fait entrer; il leur annonce qu'il les a priés pour fêter le mariage de Monsieur le Vicomte de Courbois; ils n'en sont pas les dupes, les domestiques ont parlé; les vices de Chateaudor sont découverts, il est détesté à cause de son avarice, et méprise a cause de son faste.
Fin de la Piece.
Suite des deux Chapitres précédens. Anecdotes qui regardent l'Avare fastueux.
La premiere personne à qui je fis voir ma Piece quand je la crus en état de paroitre, ce fut M. Préville; je lui avois destiné le rôle du Marquis, j'étois bien aise d'avoir son avis sur ce personnage, et sur la totalité de ma Comédie.
Il me parut content de l'un et de l'autre; je lui fis observer la difficulté de rendre au naturel le rôle dont il alloit se charger; je connois, me dit-il, cette belle nature-là.
D'après l'encouragement de cet Acteur estimable, je fis faire la lecture de la Piece à l'assemblée de la Comédie Françoise; elle eut des billets pour et contre, et elle fut reçue à correction; je n'étois pas accoutumé à cette espece de réception; mais allons, me dis-je à moi-même, point d'orgueil, point d'entêtement; je retranche quelque chose, j'en ajoute quelqu'autre, je corrige, je polis, j'embellis mon ouvrage; on en fait une seconde lecture, la Piece est reçue et on la met sur le répertoire pour le voyage de Fontainebleau.
C'étoit une des premieres qu'on devoit jouer sur le Théâtre de la Cour. M. Préville tombe malade en arrivant; il reste pendant un mois dans son lit, il va mieux vers la fin du voyage, et on destine l'Avare fastueux pour la veille du départ du Roi.
Tous les Ministres, tous les Etrangers, tous les Bureaux étoient partis; les Comédiens étoient fatigués, ils n'avoient pas grande envie d'étudier, encore moins de répéter. Je voyois la position critique de ma Piece; je demande très- modestement s'il étoit possible d'en suspendre la représentation; il n'y en avoit pas d'autres sur le répertoire, on me fit croire qu'on ne pouvoit pas s'en dispenser.
Je vais à la premiere représentation; je me mets à la place ordinaire au fond du Théâtre derriere la toile; il y avoit si peu de monde qu'on ne pouvoit pas s'appercevoir des effets bons ou mauvais de la Piece, et elle finit sans aucun signe d'approbation ni de réprobation; je rentre chez moi, je ne vois personne; tout le monde fait ses paquets, je fais les miens; tout le monde part, et je pars aussi.
J'eus le tems en route de faire mes réflexions; le froid glacial avec lequel on avoit écouté mon ouvrage, pouvoit provenir du vuide de la Salle et de la circonstance du moment; mais je vis que quelques Acteurs s'étoient trompés dans l'exécution.
Madame Drouin, excellente Actrice pour les rôles de charge, joua celui d'Araminte en mere noble; c'est ma faute, mon Lecteur doit se souvenir de cette scene, où Madame Araminte exerce un acte de générosité vis-à-vis du Vicomte; l'Actrice partant de là, s'est imaginé que son rôle devoit être grave et sérieux.
L'honnêteté, la bienfaisance, la générosité même peuvent se rencontrer dans tous les rangs; une femme des Halles fait une belle action, elle n'en est pas moins une harengere; Madame Araminte en fait une à proportion de ses facultés, elle n'est pas moins une mere difficile, une amie pétulante; elle pouvoit être intéressante par occasion, et comique par caractère.
M. Bellecour joua l'Avare fastueux comme le glorieux; bien dans les situations du faste, et très-gêné dans celle de l'avarice; c'est encore ma faute, j'aurois dû donner ce rôle à un Acteur qui jouât les rôles à manteau et les rôles chargés.
A l'égard de M. Préville, je n'ai rien à dire, son rôle étoit d'une difficulté extraordinaire, il n'avoit pas eu le tems de se familiariser avec ces phrases coupées qui demandoient beaucoup de finesse pour faire comprendre ce que l'Acteur n'achevoit pas de prononcer. C'est ma grande faute, j'aurois dû faire des remontrances, et employer mes protections pour que ma Piece ne fût pas donnée à Fontainebleau; ainsi, faisant la récapitulation de mes torts, j'écrivis aux Comédiens en arrivant à Paris, et je retirai ma Piece sur-le-champ.
Mes amis desiroient avec impatience de voir l'Avare fastueux sur la scene à Paris; ils furent tous fâchés en apprenant que je l'avois retirée; on me grondoit, on m'en vouloit, on me tourmentoit pour que j'en permisse la représentation; et on me rappelloit, pour m'encourager, combien de Pieces tombées à la premiere représentation, s'étoient relevées depuis. Ils n'avoient pas tort, peut-être; j'aurois suivi leurs conseils, et j'aurois satisfait leurs desirs, si les Comédiens m'eussent fait connoître qu'ils avoient envie de la rejouer, mais apparemment ils en étoient dégoûtés autant que moi; elle étoit née sous une mauvaise étoile, il falloit en craindre les influences, il falloit la condamner à l'oubli, et ma rigueur alla si loin, que je la refusai à des personnes qui me la demandoient pour la lire.
Je ne pus cependant pas résister à la demande d'un des plus grands Seigneurs du Royaume, dont les prieres sont des ordres; j'allai lui faire hommage de ma Comédie; une Dame se chargea de la lecture. Elle s'en acquitta avec cette facilité et cette grâce qui lui sont naturelles; mais à la premiere entrée du Marquis, elle fut surprise par la singularité du rôle dont elle n'étoit pas prévenue.
M*** s'empara de l'original, lut cette scene, et toutes les autres de ce même personnage, avec une aisance et une telle précision, qu'on l'auroit pris pour l'Auteur de l'ouvrage; j'avoue que je ne pus retenir ma joie et mon admiration.
La lecture finie, tout le monde me parut content; j'étois dans la maison de la bonté, de l'honnêteté, je ne pouvois m'attendre qu'à des complimens.
Mariage de M. le Comte d'Artois, Frere du Roi. Arrivée à Paris du Chevalier Jean Mocenigo, nouvel Ambassadeur de Venise. - Ses bontés pour moi. - Son heureuse négociation pour l'abolition du droit d'aubaine entre la Cour de France et sa République- Mes attentions pour les Italiens - Nouvelle Edition de Métastase. - Graveurs Italiens qui s'y sont distingués.
0n célébra à Versailles, dans le mois de Novembre de l'année 1773, le mariage de M. le Comte d'Artois, Frere de Louis XVI, avec Marie-Thérese de Savoie, Fille du Roi de Sardaigne, et sœur de Madame.
Les Fêtes, à cette occasion, furent ordonnées et exécutées avec la pompe et la magnificence ordinaires.
Autant la saison étoit contraire aux Spectacles champêtres du Parc, autant les appartemens étoient brillans par les salles de bals et de jeu multipliées, et par la quantité d'étrangers qui venoient de toutes parts pour assister à ces nôces et passer l'hiver à Paris.
Ce fut à-peu-près dans ce tems-là, que le Chevalier Jean Mocenigo, Ambassadeur de Venise, vint relever le Chevalier Sébastien Mocenigo son frere cadet, qui terminoit ses quatre années d'Ambassade.
Ce nouveau Ministre de la République étoit un de mes anciens Protecteurs; il m'avoit donné des preuves essentielles de sa bienveillance; il m'avoit logé chez lui pendant long-tems avec ma famille; il protégea, avec les Balbi, les Querini, les Valier, les Berengan, les Barbarigo, ma premiere édition de Florence, et en facilita l'entrée dans la ville de Venise, malgré la guerre barbare que me faisoient les Libraires.
Voici une nouvelle marque de sa bonté pour moi; à l'occasion de son mariage avec la niece du Doge Loredan, il m'écrivit ce billet: le Doge Sérénissime m'a permis d'inviter à la nôce quelques-uns de mes amis: vous êtes du nombre, je vous prie d'y venir, vous y trouverez votre couvert.
Je n'y manquai pas. Il y avoit une table de cent couverts dans la salle appellée des Banquets, il y en avoit une autre de vingt quatre, dont le neveu du Doge faisoit les honneurs; j'étois de cette derniere; mais au second service tout le monde quitta sa place, et nous allâmes tous dans la grande salle, faisant le tour de cette piece immense, nous arrêtant derriere les uns et les autres, et jouissant, moi en mon particulier, des honnêtetés que l'on prodiguoit à un Auteur qui avoit le bonheur de plaire.
M. le Chevalier Jean Mocenigo rendit, pendant le cours de son Ambassade, un service essentiel à sa Nation. Il négocia avec la Cour de France l'abolition réciproque du droit d'aubaine, et il y réussit.
J'appris cet événement avec beaucoup de satisfaction; je n'y étois pas intéressé pour moi-même, car je n'ai rien à laisser, après ma mort, à mes héritiers, mais je jouissois pour les Vénitiens qui ont des affaires en France.
J'ai toujours regardé mes compatriotes avec amitié. Ils ont toujours été les bienvenus chez moi; j'ai été trompé plus d'une fois, il est vrai, mais les méchans ne m'ont jamais dégoûté du plaisir de me rendre utile; je me flatte qu'aucun Italien n'est jamais parti mécontent de moi.
Enchanté d'être en France, j'aime à converser de tems en tems avec les gens de ma nation, ou avec des François qui possedent la Langue Italienne.
L'endroit où j'en rencontre le plus souvent, est chez Madame du Boccage: il n'y a pas d'étranger qui, soutenu par ses qualités ou par ses talens, ne s'empresse en arrivant à Paris de lui faire sa cour; ce fut chez cette Dame que je fis une découverte très-agréable, et très-intéressante pour moi.
Un jour que je devois y diner, Madame la Comtesse Bianchetti, niece de madame du Boccage, me présenta à une Dame que j'aurois du connoître, et que je ne reconnoissois pas; je fus étonné de m'entendre saluer en très-bon Vénitien par une personne qui jusqu'à ce momente là avoit parlé parfaitement François.
C'étoit la femme de M. de la Borde, Administrateur Général des Domaines du Roi, et sœur de M. le Blond , qui a succédé à son pere dans le consulat de France à Venise. J'avois connu cette Dame dans sa premiere jeunesse; elle étoit la cadette des trois sœurs qu'on appelloit les trois beautés de Venise.
Après le dialecte Toscan et le Vénitien, c'est le Génois qui m'amuse plus que les autres. Dieu (disent les Italiens) avoit assigné à chaque nation son langage; il avoit oublié les Génois; ils en composerent un à leur fantaisie, qui sent encore la confusion des langues de la Tour de Babel; mais c'est celui de ma femme, et je l'entends et je le parle assez bien.
J'avois occasion autrefois de le parler fréquemment avec un Génois de mes amis, que des circonstances ont éloigné de Paris; je n'ai plus le plaisir de m'entretenir avec lui, mais j'ai celui de dîner très-souvent chez son épouse.
On trouve chez elle une petite société charmante; M. Valmont de Bornare le Naturaliste, qui ne refuse pas d'instruire et d'amuser en même tems 1es convives si on le questionne sur l'étendue de ses connoissances; M. Coqueley de Chaussepierre, Avocat au Parlement, qui met toujours de l'agrément et de la gaieté ans les propos sérieux aussi bien que dans les propos galans, et quelques autres personnes aussi aimables que respectables.
On cause à table, on passe en revue les nouvelles du jour, les Spectacles, les Découvertes, les Projets, les Événrmens, chacun dit son mot; et s'il s'éleve quelque discussion, la Maîtresse de la maison, pleine d'esprit et de connoissances, fait les frais de la conciliation.
Si mes Mémoires ont le bonheur de traverser les mers, mon ami*** verra que je ne l'ai pas oublié; d'ailleurs je rends justice à la vérité, et rien ne me flatte davantage que l'occasion de parler de mes amis, que j'aime bien, que j'aime constamment, soit Italiens, soit François.
La nation Françoise m'est aussi chere aujourd'hui que la mienne, et c'est un délice de plus pour moi quand je rencontre des François qui parlent l'Italien; j'en citerai quelques-uns qui, à ma connoissance, le parlent et l'écrivent mieux que les autres. Madame Pothouin, veuve depuis peu de M. Pothouin célebre Avocat au Parlement de Paris, femme aussi aimable, aussi respectable par son esprit et ses talens, que son époux l'étoit par sa science et sa probité.
Sans avoir été en Italie, ayant commencé l'étude de la langue Italienne fort tard et ne l'ayant suivie que pendant deux ans, Madame Pothouin est en état de soutenir de longues conversations avec les Italiens en y employant les meilleurs termes, les phrases les mieux composées et les tournures les plus usitées.
M. le Président Tacher ajoute à ses connoissances très-étendues et au goût de la Littérature Françoise, celui de la Langue et de la Littérature Italienne.
Pendant qu'il occupoit la place très-importante et très-laborieuse d'Intendant des Isles du Vent de l'Amérique, il trouvoit le tems de m'écrire, et notre correspondance étoit toujours en langue Italienne.
Il tâtonnoit alors dans le dialecte Toscan, et se trompoit rarement. Après son retour de l'Amérique, il fit un voyage en Italie; ce n'est plus un François qui imite les Italiens, il semble dans ses conversations et dans ses lettres, appartenir à ces deux nations.
Madame la Baronne de Bordic a beaucoup de goût et beaucoup de facilité pour la langue Italienne; j'eus l'honneur de la voir et de faire sa connoissance à Paris, dont elle fit les délices pendant quelques mois; estimée pour ses qualités, admirée pour son esprit, chérie pour le charme de ses vers, elle y étoit adorée.
Madame de Bordic fait à Nimes sa résidence; je regrette la privation de sa société, mais sa correspondance me dédommage, et les lettres dont elle m'honore de tems en tems, prouvent l'étude qu'elle a fait de notre Langue et de nos Auteurs.
M. Cousin, Avocat du Roi au Bailliage de Caux, en est aussi un grand amateur; je n'ai jamais eu l'honneur de le voir, mais il m'a fait celui de m'écrire de Dieppe, où il fait sa demeure, toujours en Italien, et quelquefois même dans le dialecte Vénitien.
Notre Littérature Italienne est très-goûtée en France, nos livres y sont bien reçus et bien payés; les Bibliotheques de Paris en sont garnies. Feu M. Floncele en avoit une de seize mille volumes, tous en Langue Italienne. Monsieur Molini, Libraire Italien dans cette Capitale, en fait un commerce considérable.
La quantité d'exemplaires de mes Comédies qu'on a débitée dans ce pays-ci est prodigieuse, et l'empressement avec lequel on a souscrit à la nouvelle édition des Œuvres de Metastasio, l'est encore davantage.
Cette superbe Edition conduite et exécutée par les soins de M. Pezzana, est décorée de tous les agrémens de la Typographie. Elle est belle et elle est chere; l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il y a des gravures précieuses; on y admire entr'autres un Polipheme de Bartolozzi, et dans plusieurs estampes l'excellence du crayon et du burin de M. Martini. C'est un de meilleurs Eleves de M. le Bas; c'est un Parmesan très-honnête, très-sage, très-instruit, c'est un Artiste qui fait honneur à la Nation Italienne. Il est à Paris; il y a fixé sa demeure comme moi: il a bien fait.
Mort de Louis XV. - Avénement au Trône de Louis XVI. -- Naissance du Duc d'Angouleme. - Maladie de Mesdames de France. - Leur convalescnce à Choisi. - Mariage de Madame Clotilde, sœur du Roi. - Mes services auprès de cette Princesse et auprès de Madame Elisabeth. - Nouveaux bienfaits du Foi à mon égard.
A la joie que les mariages de trois Princes avoient répandue dans le Royaume, succéda la plus sombre tristesse. Louis XV tomba malade; la petite vérole ne tarda pas à se déclarer; elle étoit des plus malignes, des plus compliquées; ce Roi fort vigoureux, bien constitué, succomba à la violence de ce fléau de l'humanité.
Quelle affliction pour la France qui lui avoit conféré le titre de Bien-Aimé, quelle désolation pour sa Famille qui l'adoroit, quelle perte pour ses anciens serviteurs qui lui étoient attachés plus par sentiment que par devoir!
C'étoit le Roi le plus clément, le pere le plus tendre, le Maitre le plus doux; il avoit les qualités du cœur excellentes, et celles de l'esprit très-heureuses.
Mais essuyez vos larmes, ô François! La Providence lui a donné un successeur dont les vertus feront votre bonheur: vous avez qualifié plusieurs de vos Rois par des titres et des surnoms qui sont passés à la postérité; quelle sera l'épithete honorable que vous choisirez pour Louis XVI?
La bonté, la justice, la clémence, la bienfaisance sont des devoirs pour tous ceux que Dieu a destinés à gouverner les hommes; c'est d'après ses qualités personnelles qu'il faut choisir: ses mœurs, sa conduite, son zele pour le bien public, pour la paix, pour la tranquillité de l'Europe; sa religion, sa modération, la probité qu'il exige, l'exemple qu'il en donne... Voilà des vertus rares, des vertus essentielles bien plus utiles à l'Etat que l'esprit de conquêtes; voilà des sources inépuisables d'éloges et de monumens immortels.
Ce n'est pas à l'âge de trente-trois ans que la voix publique décerne les honneurs et les titres à un Souverain qui aspire à la gloire de les mériter, mais je suis trop vieux pour attendre; je le nomme, en attendant, dans mon cœur Louis le Sage.
Hélas! que de vicissitudes dans l'humanité; je suis forcé de rappeller ici un nouveau sujet de crainte et de douleur. Les trois filles de Louis XV qui n'avoient pas quitté le lit de leur pere pendant le cours de sa maladie, furent affectées des mêmes symptomes, et coururent le même danger.
Ces Princesses étoient trop intéressantes pour ne pas allarmer tout le monde sur leur état; Dieu nous les préserva; Dieu arracha des bras de la mort cet exemple héroïque de l'amour filial.
Mesdames allerent passer le tems de leur convalescence à Choisi. Je n'avois pas moins souffert que les autres dans cette circonstance effrayante, j'allai à leur suite respirer l'air salutaire de cet endroit délicieux.
J'étois un jour au dîner des Princesses et des Dames de leur Compagnie; il n'y avoit d'hommes à cette table que le Prince de Condé; Madame Adélaïde me fit l'honneur de me nommer à ce Prince du Sang qui me regarda avec bonté; je l'accostai respectueusement; il me parla de mon Bourru Bienfaisant: je savois qu'il l'avoit joué à Chantilly, et qu'il avoit rendu le rôle de Géronte en perfection; je saisis cette occasion pour lui faire mes complimens et mes remerciemens.
De retour à Paris, j'entendis parler d'un mariage projetté entre Midame Clotilde, sœur du Roi de France, et le Prince de Piémont, héritier présomptif de la Couronne de Sardaigne.
Cette nouvelle étoit pour moi intéressante; j'allai à Versailles pour en être mieux informé; le projet étoit vrai, mais on en faisoit mystere, et ce ne fut que sept mois avant le mariage que j'eus l'ordre de me rendre chez la Princesse pour lui donner quelqu'instruction sur la Langue Italienne.
J'obéis; mais que pouvoit-elle apprendre en sept mois de tems? je me serois bien gardé de la faire passer par la voie commune; elle connoissoit bien sa Grammaire Françoise; je ne lui fis apprendre que les verbes auxiliaires de la Grammaire Italienne; je la faisois beaucoup lire; les remarques et les courtes digressions que j'entre, mêlois à la lecture, valoient mieux, à mon avis, que la longue et ennuyeuse kyrielle des regles et des difficultés scholastiques.
Mes lectures tendoient à un but encore plus intéressant; je lui faisois connoître les Auteurs classiques Italiens par leurs noms, par quelques-unes de leurs anecdotes, et par les titres de leurs Ouvrages; et je tâchois de l'instruire des mœurs et des usages Italiens.
Cette Princesse très-douce, très-complaisante, avoit une facilité prodigieuse pour apprendre et une mémoire très- heureuse; j'y allois tous les jours, et elle faisoit des progrès admirables; mais nos conférences étoient souvent interrompues par des Bijoutiers, par des Joailliers, par des Peintres, par des Marchands; j'entrois quelquefois dans sa chambre pour être témoin du choix des étoffes, du prix des bijoux, et de la ressemblance des portraits.
Je tâchois de tirer parti de ces mêmes inconvéniens; je lui faisois répéter en Italien les noms des choses qu'elle avoit vues, qu'on avoit marchandées pour elle, et qu'on avoit achetées ou refusées.
Nous eûmes d'autres distractions; un voyage à Reims pour le Sacre du Roi, et la naissance de Monsieur le Duc d'Angoulême: ce Prince, fils de Monsieur le Comte d'Artois, étant le premier fruit des trois mariages des Enfans de France, devoit être intéressant pour l'Etat, et les réjouissances furent proportionnées à la joie publique.
Mon auguste Ecoliere, malgré tous ces intervalles, savoit mettre à profit son tems; elle prononçoit l'Italien assez bien, elle le lisoit encore mieux; elle étoit en état de lire et de comprendre les épithalames que les Poëtes Piémontois devoient lui avoir destinés.
Son mariage fut célébré par procuration vers la fin du mois d'Août de l'année 1775, dans la Chapelle de Versailles; il y eut des fêtes superbes, des réjouissances magnifiques: la Princesse partit adorée, regrettée: tous ceux qui l'avoient servie, qui l'avoient approchée, eurent des marques de sa bonté: il n'est pas extraordinaire que dans cette foule il y eut quelqu'un d'oublié; c'est un coup de malheur que cet oubli soit tombé sur moi.
A l'égard de mes services et de mes dépenses, je n'avois rien demandé et je n'avois rien reçu, mais j'étois bien persuadé que je n'aurois rien perdu; je me tenois tranquille et ne disois mot.
Des personnes, qui s'intéressoient à moi, impatientées de mon silence, firent des démarches pour savoir à quoi je devois m'en tenir: ils avoient plus d'esprit que moi, et leur médiation me fut très-utile.
On croyoit à la Cour que ma pension de 3600 livres m'obligeoit au service de toute la Famille Royale; on ne savoit pas que c'étoit une récompense pour avoir enseigné l'Italien à Mesdames, et ceux qui étoient chargés des dépenses pour Madame de Piémont, furent convaincus que je devois être récompensé; mais les affaires qui regardoient cette Princesse étoient terminées; je n'avois qu'à attendre; on devoit m'employer pour Madame Elisabeth, autre sœur du Roi; c'étoit à cette occasion que je devois réserver mes demandes.
J'attendis long-tems, et je gardai toujours mon appartement à Versailles; le jour enfin arriva, j'eus ordre de me rendre chez Madame Elisabeth.
Cette jeune Princesse, vive, gaie, aimable, étoit plus dans l'âge de s'amuser que de s'occuper; j'avois assisté à des leçons de Latin qu'on lui donnoit, et je m'étois apperçu qu'elle avoit beaucoup de dispositions pour apprendre, mais qu'elle n'aimoit pas à s'appesantir sur des difficultés vétilleuses.
Je suivis à-peu-près la méthode que j'avois adoptée pour Madame la Princesse de Piémont; je ne la tourmentai pas avec des déclinaisons et des conjugaisons qui l'auroient ennuyée; elle vouloit faire de son occupation un amusement, et je tâchai de rendre mes leçons des conversations, agréables.
On faisoit lecture de mes Comédies; dans les scenes a deux personnages, c'étoit la Princesse et sa Dame d'honneur qui lisoient et traduisoient chacune son rôle; s'il y avoit trois personnages, c'étoit une Dame de compagnie qui se chargeoit du troisieme, et je rendois les autres, s'il y en avoit davantage.
Cet exercice étoit utile et amusant; mais peut-on se flatter que la jeunesse s'amuse pendant long-tems de la même chose? Nous passâmes de la prose aux vers; Métastase occupa mon auguste Ecoliere pendant quelque tems; je ne cherchois qu'à la contenter, et elle le mérithit bien; c'étoit le service le plus doux, le plus agréable du monde.
Mais je vieillissois; l'air de Versailles ne m'étoit pas favorable; les vents qui y dominent et qui soufflent presque perpétuellement attaquoient mes nerfs, réveilloient mes anciennes vapeurs et me causoient des palpitations, je fus forcé de quitter la Cour, et de me retirer a Paris, où l'on respire un air moins vif et plus analogue à mon tempérament.
Mon neveu, quoiqu'employé au Bureau de la Guerre, pouvoit me remplacer; il l'avoit fait auprès de Mesdames et j'étois sûr des bontés de Madame Elisabeth. C'étoit-là le moment d'arranger mes affaires, et je ne m'oubliai pas dans cette circonstance.
Je présentai un Mémoire au Roi; il fut protégé par Mesdames; la Reine elle-même eut la bonté de s'intéresser à moi, le Roi eut celle de m'accorder 6000 livres de gratification extraordinaire, et un traitement de 1200 livres annuelles sur la tête de mon neveu.
Mes amis, vous qui m'avez tant reproché ma retenue, ma patience, voyez si j'ai eu tort d'attendre tout des bontés du Roi; voyez ses nouveaux bienfaits; trouvez-vous la récompense modique? Qu'ai-je fait pour en mériter une plus considérable?
Départ du Chevalier Jean Mocenigo, Ambassadeur de Venise. - C'est le Chevalier Zeno qui le remplace. Défense des jeux de hasard à Parts. - Quelques mots sur un nouveau Livre, intitulé de la Passion du Jeu. - Quelques réflexions sur les jeux du Commerce.
Tout ce que je viens de dire dans le Chapitre précédent, n'est pas de la même année: la continuation des matieres m'engage quelquefois à déranger l'ordre chronologique, mais je ne tarde pas à y revenir, et me voilà à l'année 1776.
C'est dans cette année que Madame la Comtesse d'Artois accoucha d'une Princesse à qui le Roi donna sur-le-champ le titre de Mademoiselle.
Le Chevalier Jean Mocenigo, Ambassadeur de Venise, termina à cette époque la quatrieme année de son ambassade, et fut remplacé par le Chevalier Zeno.
Ce Patricien de Venise venoit d'Espagne, où les jeux étoient permis; il les trouva encore plus généralement établis dans cette Capitale; on jouoit chez les Grands Seigneurs, on jouoit chez quelques Ministres Etrangers. Le jeu étoit la passion dominante de M. Zeno; il voyoit beaucoup de monde chez lui; on y étoit traité grandement, et en y jouoit de même.
Mais ç'étoit précisément dans ce tems-là que le Gouvernement François commençoit à ouvrir les yeux sur cette tolérance dangereuse qui perdoit la jeunesse et ruinoit des familles entieres; les jeux de hasard furent défendus; quelques Ministres Etrangers prétendoient jouir des privileges du corps diplomatique, et cette résistance fit un mauvais effet.
Il parut presqu'en même tems un livre intitulé de la Passion du Jeu, par M. du Saulx. C'est un Traité complet qui embrasse la morale, la police et la politique; c'est un livre classique qui manquoit à la collection des Ouvrages utiles à la Société, et je ne doute pas qu'il n'ait contribué à la suppression des jeux dangereux.
M. du Saulx ne laisse pas de fronder, quoique légerement, les jeux qu'on appelle de Commerce ou de Société; il n'entend pas les proscrire, mais il conseille de les modérer.
Les petits jeux paroissent devenus nécessaires; on ne peut pas passer une soirée sans rien faire; après la nouvelle du jour, après la critique de son prochain et même de ses amis, de toute nécessité il faut jouer.
C'est un amusement honnête, une occupation agréable, mais tout le monde ne s'y amuse pas de la même maniere; cela dépend de la différence des tempéramens; il y a des personnes très-douces, très-polies, très-agréables qui changent de ton, de caractere, et même de physionomie à une table de jeu.
Un homme généreux devient furieux quelquefois pour une perte modique; ce n'est pas pour la perte de l'argent, dit- il, c'est par amour-propre; cela peut être: mais je joue aussi, et je suis de bonne-foi; j'aime mieux gagner six francs que de les perdre: je marque exactement ma perte et mon gain, et je suis bien aise, quand à la fin du mois j'ai quelques écus de profit.
Ce n'est pas l'amour-propre qui me flatte dans ce moment-là, c'est qu'un louis de plus ou un louis de moins dans ma petite bourse, fait une petite différence qui me cause un petit plaisir ou un petit chagrin; je parle de moi; personne ne peut prendre sur son compte ce que je dis et ce que je pense.
La charge la plus pénible pour une Maîtresse de maison est celle d'arranger les parties pour que l'amour-propre des uns ne choque pas l'amour-propre des autres.
Mais indépendamment des caracteres qu'on doit raisonnablement pardonner, il y a encore plus à craindre les effets de l'antipathie qui se développe au jeu plus que par-tout ailleurs: qu'un joueur aime mieux perdre avec une jolie femme qu'avec moi, cela est tout simple; mais que ce même joueur me prenne en grippe plus qu'un autre, je me râcherois, si j'étois capable de me fâcher; cependant cela arrive tous les jours, l'homme prudent fait semblant de ne pas s'en appercevoir.
Les Maîtresses des maisons doivent se mettre au fait des sympathies et des antipathies de leurs Sociétés; elles doivent connaÎtre leurs joueurs, et les assortir.
Je demande pardon aux Dames qui doivent en savoir beaucoup plus que moi; mais j'ai un autre avertissement à leur donner. Il ne faut pas qu'elles commencent par faire leur partie, et qu'elles laissent les autres s'arranger comme ils peuvent; cela est arrivé plus d'une fois sous mes yeux, et j'ai été témoin des plaintes de ceux qui se croyoient mal placés.
Le Lotto est un jeu fort commode pour éviter ces inconvéniens; on rassemble beaucoup de personnes à la même table; la femme qui en fait les honneurs s'y trouve et tout le monde est content; mais c'est aussi à mon avis le jeu le plus insipide, le plus ennuyeux qu'on ait jamais imaginé; c'est le hasard qui domine dans tous les jeux, mais quand j'ai des cartes en main, je fais au moins quelque chose, et au Lotto je ne fais rien; si je gagne aux autres jeux, je puis me flatter d'y avoir contribué par mes combinaisons; si je perds, je me flatte encore d'avoir évité de mauvais coups qu'un autre auroit essuyé; mon amour-propre est en quelque façon satisfait, mais dans ce vilain jeu de boules, je suis toujours le patient.
On a imaginé le Lotto Dauphin; c'est encore pis, car il faut déterminer les numéros, et j'ai le chagrin d'avoir mal choisi; j'entends autour de moi demander des ternes, des quaternes, des quines; je n'ai que des extraits et quelques ambes, je deviens mauvais joueur sans le savoir; j'en veux à ceux qui gagnent, parce que le gain des autres doit nécessairement augmenter ma perte, et mon amour-propre en est piqué, l'intérêt de ma bourse ne l'est pas moine, et l'ennui s'en mêle, et c'est un mauvais présent pour moi que de me faire l'honneur de me présenter un tableau.
J'en fais la confidence à mon Lecteur; je me garderois bien de le dire dans les Sociétés où je suis trop heureux d'être admis; et si les aimables et respectables personnes que j'ai l'honneur de fréquenter jettent par hasard un coup- d'œil sur ces Mémoires, elles me pardonneront, j'espere, en faveur de ma sincérité.
Les Renards, Opéra-Comique, en trois Actes. - Arrivée des Acteurs de l'Opéra-Comique Italien à Paris, pour jouer sur le Théâtre de l'Opéra.
Dans l'année 1777, on me demanda un nouvel Opéra-Comique pour Venise; je m'étois proposé de ne plus en faire, mais croyant que le même ouvrage me seroit utile à Paris, je consentis de satisfaire mes amis, et je composai une Piece qui pouvoit plaire également à l'une et à l'autre Nation; son titre étoit i Volponi (les Renards). C'étoient des gens de Cour, jaloux d'un étranger; on lui faisoit beaucoup de politesse pouramuser, et on tramoit des cabales pour le ruiner. Il y avoit de l'intérêt, de l'intrigue et de la gaieté, et il en résultoit une leçon de morale.
Il étoit question alors de faire venir à Paris les Acteurs de l'Opéra-Comique Italien, que nous appellons i Bouffi, et qu'on appelle ici les Bouffons; ce mot seroit insultant en Italie, il ne l'est pas en France; ce n'est qu'une mauvaise traduction.
La musique de la Bonne-Fille de M. Piccini, celle de la Colonie de M. Sacchini, et les progrès que le goût du chant Italien faisoit tous les jours à Paris, déterminerent les Directeurs de l'Opéra à faire venir ce Spectacle étranger, qui donna ses représentations sur le grand Théâtre de cette Ville.
Ce projet me flatta infiniment, et j'eus la témérité de me croire nécessaire à son exécution; personne ne connoissoit l'Opéra-Comique Italien mieux que moi; je savois que depuis quelques années on ne donnoit plus en Italie que des farces dont la musique étoit excellente, et la poésie détestable.
Je voyois de loin ce qu'il falloit faire pour rendre ce Spectacle agréable pour Paris; il falloit faire de nouvelles paroles; il falloit composer de nouveaux Drames dans le goût François.
J'avois fait plus d'une fois cette opération pour Londres, j'étois sûr de mon fait; personne ne pouvoit mieux que moi se rendre utile dans une pareille occasion.
Je savois, par expérience, combien ce travail étoit difficile et pénible, mais je m'y serois livré, avec un plaisir infini pour le bien de la chose, et pour l'honneur de ma Nation.
D'ailleurs, il y avoit à parier que l'Opéra de Paris, en faisant venir des Acteurs étrangers, ne se contenteroit pas de leur vieille musique, et en feroit faire de nouvelle par M. Piccini qui étoit ici, ou par M. Sacchini qui étoit à Londres.
Je tenois mon Opéra-Comique tout prêt, et j'étois presque sûr qu'on m'en auroit ordonné d'autres, car je ne croyois pas de la dignité du premier Spectacle de la Nation, d'entretenir le Public pendant long-tems avec de la musique qu'on avoit chantée dans les concerts et dans les sociétés de Paris.
J'attendois donc qu'on vint me parler, qu'on vint me consulter, m'engager... Hélas! personne ne m'en dit mot.
Les Acteurs Italiens arriverent à Paris; j'en connoissois quelques-uns, je n'ai pas été les voir, je n'ai pas été à leur début. Il y en avoit de bons et de médiocres; leur musique étoit excellente; mais ce Spectacle tomba, comme je l'avois prévu, à cause des Drames qui étoient faits pour déplaire en France et pour déshonorer l'Italie.
Mon amour-propre auroit dû être flatté, voyant ma prédiction vérifiée, mais au contraire, j'étois vraiment affligé. Je n'aimois pas trop l'Opéra-Comique; j'aurois été enchanté d'entendre de la Musique Italienne, exécutée sur des paroles Italiennes, mais il falloit des paroles qu'on pût lire avec plaisir, et qu'on pût traduire en François sans rougir.
Ces mauvais Opéras paroissoient en Public traduits et imprimés. La meilleure traduction étoit la moins supportable; plus les Traducteurs s'efforçoient de rendre le texte fidèlement, plus ils faisoient connoître les platitudes des originaux.
Je croyois que cette Troupe Italienne s'en iroit au bout de l'an; mais apparemment elle étoit engagée pour deux, et elle y resta l'année suivante. Ce fut dans cette seconde année qu'on me fit l'honneur de venir chez moi, en m'apportant un de ces mauvais Drames à raccommoder; c'étoit trop tard; le mal étoit fait: ce genre de Spectacle étoit décrié. J'aurois pu le soutenir dans son début, je crus ne pouvoir pas le relever après la crise qu'il avoit essuyée.
Il faut encore dire que j'étois piqué d'avoir été oublié au moment nécessaire. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé depuis long-tems un chagrin pareil à celui-là. Les uns disoient, pour me consoler, que les Directeurs de l'Opéra croyoient l'emploi qu'ils auroient pu m'offrir au-dessous de moi; Messieurs les Directeurs ne savoient pas de quoi il s'agissoit; s'ils eussent eu la bonté de me consulter, ils auroient vu qu'il leur falloit un Auteur, et non pas un ravaudeur.
D'autres me disoient (sans fondement, peut-être) qu'on craignoit que Goldoni ne fût trop cher.
J'aurois travaillé pour l'honneur, si on avoit su me prendre; j'aurois été cher, si on m'avoit marchandé; mais mon travail les auroit bien dédommagés; j'ose dire que ce Spectacle existeroit encore à Paris.
Naissance du Duc de Berry, fils de M. le Comte d'Artois. - Naissance de Marie-Thérese-Charlotte de France, Madame, Fille du Roi. - Quelques mots sur la derniere Guerre, sur la Marine et sur les Finances. - Roland, Opéra-Musique de M. Piccini. - Ce Chapitre est interrompu par une indisposition à laquelle je suis sujet. - Singularité de cette incommodité. - Conduite sage de mon Médecin, et soulagement que j'en ai obtenu.
Au mois de janvier de l'année 1778, il y eut des réjouissances à la Cour et à la Ville pour la naissance du Duc de Berry, fils de Monsieur le Comte d'Artois.
Mais quelle fut la joie des François, lorsqu'on déclara dans la même année la grossesse de la Reine! Elle accoucha, dans le mois de Décembre, d'une Princesse qui fut nommée sur-le-champ Marie-Thérese-Charlotte de France; avec le titre de Madame, Fille du Roi.
Ce premier fruit du Mariage du Roi fut regardé comme le Précurseur du Dauphin, qu'on attendoit avec impatience, et qui vint au bout de trois ans exaucer les vœux des François.
Les Fêtes à cette occasion et à celle de la convalescence de la Reine, furent proportionnées aux circonstances du tems; la France êtoit engagée dans une guerre qu'elle n'avoit pas provoquée, mais qu'il falloit soutenir pour l'honneur de la Nation.
Je n'entrerai pas dans le détail de la rupture entre les Anglois Britanniques, et ceux de l'Amérique Septentrionale; ces derniers qui étoient les plus foibles, eurent recours à Louis XVI, et ce Monarque s'intéressant pour la paix, s'attira la guerre.
Ce Royaume, tout riche qu'il est, ne paroissoit pas alors en état de la supporter; la Marine avoit été négligée, ses Finances étoient dérangées; mais les ressources de la France sont inépuisables. Pendant que l'on faisoit des négociations pour rapprocher les Américains de leur mere Patrie, on vit sortir des Ports de Brest et de Toulon des flottes si considérables, qu'elles furent en état de tenir tête aux forces de l'Angleterre.
Cette guerre dura pendant cinq ans, et la paix fut signée à Versailles en 1783; c'est l'époque d'une nouvelle puissance, dans l'Amérique Septentrionale. Les anciens sujets de la Grande Bretagne devenus libres, reconnus tels par le monde entier, peuvent devenir formidables; se souviendront-ils toujours de leurs bons amis les François?
Au milieu du bruit des armes on ne s'amusoit pas moins à Paris; c'est dans cette année que M. Piccini donna à l'Opéra son premier ouvrage.
La Reine, protectrice des Beaux-Arts et des Artistes célebres, avoit fait venir M. Piccini en France, l'avoit fait pourvoir d'un traitement de la Cour, et il étoit libre dé travailler pour les Spectacles de Paris.
Ce Compositeur Italien nouvellement arrivé n'étoit pas encore en état de choisir ses Poèmes, M. Marmontel prit soin de lui en fournir.
Il mit l'Opéra de Roland de Quinaut en trois Actes avec quelques changemens. M. Piccini fit valoir sa science et son goût. Mais les François qui s'intéressent aux Drames autant qu'à la musique, ne peuvent pas souffrir que les Auteurs modernes touchent aux chefs-d'œuvre des Auteurs anciens.
Il y avoit d'ailleurs une guerre ouverte à Paris entre les partisans de M. Gluck et ceux de M. Piccini , et ces deux partis étoient combattus par les amateurs de la Musique Françoise...
Hélas! une violente palpitation me prend dans ce moment-ci... c'est chez-moi une incommodité habituelle; je ne puis continuer...
Je reprends le Chapitre que j'ai quitté hier. Ma palpitation a été plus véhémente et a duré plus long-tems cette fois-ci qu'à l'ordinaire, elle m'a attaqué à quatre heures du soir, et n'a cessé qu'à deux heures du matin.
Cette palpitation n'est pas périodique; elle me surprend plusieurs fois dans l'année, dans toutes les saisons, dans tous les tems, tantôt à jeun, tantôt à mon dîner, tantôt après, rarement la nuit; mais voici ce qu'il y a de plus singulier dans ses symptomes.
Je sens, quand elle veut m'attaquer, un mouvement dans les entrailles, mon pouls s'élève et marche d'une violence effrayante, mes muscles sont en convulsions et mon cœur oppressé.
Je sens, quand elle veut cesser, un choc dans la tête, et mon pouls revient tout d'un coup dans son état naturel; il n'y a pas de gradation dans ses accès, il n'y en a pas dans sa cessation; c'est un Phénomène inconcevable, qui ne peut s'expliquer que par la comparaison des syncopes.
Habitué à cette incommodité plus inquiétante que douloureuse, j'avois appris à la soutenir sans crainte, et cherchant les moyens de me dissiper, je continuois mon dîner, si elle m'attaquoit à table; je faisois ma partie, si elle me surprenoit dans la société; personne ne s'appercevoit de mon état, et comme il faut vivre à mon age avec ses ennemis, je ne cherchois pas les moyens d'en guérir, crainte de tomber dans le gouffre de Scylla pour éviter celui de Carybde.
Mais une palpitation que j'eus il y a quatre ans, de trente-six heures sans discontinuer, me parut sérieuse, et j'eus recours à mon Médecin. M. Guilbert de Préval, Docteur-Régent de la Faculté de Paris, me la fit cesser sur-le-champ, et sans rien hasarder qui pût déranger l'économie animale de mon individu, il ne fit par la suite qu'en retarder les accès et en diminuer la durée.
Ce Médecin m'avoit guéri radicalement de deux dartres qui étoient fort incommodes, et qui commençoient à devenir dangereuses. Il n'en est résulté aucun inconvénient; je me suis toujours bien porté depuis, et c'est avec son eau fondante qu'il conduisit cette cure à sa perfection.
M. Prêval s'est fait des ennemis dans le Corps de la Faculté; on dit qu'il existe une loi parmi eux, qu'aucun Membre de leur Société ne puisse débiter des remedes nouveaux, sans les communiquer à ses Confreres. M. Préval ne l'a pas fait, il a craint, peut-être, que son remede ne devînt inutile comme bien d'autres, s'il étoit entre les mains de tout le monde; il le débite chez lui. Le pauvre y trouve son soulagement, et le riche n'est pas écorché. Heureux l'homme, dit-on, qui trouve son ami dans son Médecin. M. Préval est l'ami de tous ses malades, puisqu'il est celui de l'humanité.
Le Sallon des Tableaux. - Quelques mots sur les Académies et les Sociétés Royales de Paris. - Le Licée. - Le Musée de la rue Dauphine. - Arrivée dans cette Ville de M. de Voltaire. - Sa mort.
J'ai parlé des Spectacles de Paris; je n'ai encore rien dit du Sallon du Louvre, qui vraiment en est un pour les connoisseurs, et pour ceux qui ont du goût pour les chefs-d'œuvre.
Les Peintres et les Sculpteurs de l'Académie Royale y exposent tous les deux ans les Ouvrages qu'ils ont produits pendant cet espace; la quantité prodigieuse de tableaux que l'on y voit, prouve la fécondité des Artistes; et l'affluence de monde que l'on y rencontre pendant un mois, prouve le goût ou du moins la curiosité du Public.
Ce Sallon est de la plus grande utilité pour les progrès des arts: l'homme qui travaille pour un particulier, ne cherche qu'à lui plaire; mais ceux qui exposent leurs Ouvrages, doivent tâcher de plaire à tout le monde.
Lorsque le Catalogue des Tableaux et des Statues est en vente, les critiques paroissent presque en même tems; il semble que les Ecrivains aient suivi les Artistes dans leurs atteliers; les feuilles périodiques en parlent décemment, mais les envieux les condamnent, et les méchans les déchirent.
Le Public éclairé ne s'en rapporte pas aux opinions d'autrui; chacun a sa façon de voir; les uns trouvent bon ce que d'autres ont trouvé mauvais, et il en résulte plus de bien que de mal; les grands hommes sont connus, et les médiocres gagnent des Partisans.
Le riche veut avoir dans son cabinet un tableau du Peintre qui s'est distingué: l'amateur qui est moins fortuné, se contente de la médiocrité; il y a des gens qui font travailler les Peintres et les Sculpteurs pour que l'on imprime dans le Catalogue: ce tableau est fait pour Monsieur un tel; ce buste a été sculpté pour Madame une telle; il y en a qui font faire leurs portraits pour le plaisir de faire paroître leurs figures au Sallon.
Celui de l'année 1779 dont je parle actuellement, étoit le deuxieme que j'avois vu depuis mon arrivée en France: je ne suis pas grand amateur de tableaux, encore moins connoisseur; j'en parle ici par occasion, et sans y mettre du mien, j'en parle comme un homme qui a pris à tâche de parler de tout, et je vais de la même maniere dire quelques mots en passant des autres Académies Royales, et de quelques autres établissemens qui font honneur à la France.
L'Académie Françoise est la premiere par l'époque de sa fondation, et elle à conservé toujours son rang; son institution a été très-utile pour fixer la langue de cette nation, et son dictionnaire est le code qu'il faut consulter. Les quarante fauteuils de cette assemblée respectable sont aujourd'hui des places de récompense; les hommes qui se sont distingués dans les sciences ou dans la littérature, sont admis au concours, et le même siege est accordé indistinctement au Duc et Pair, et au particulier qui n'a d'autres titres que son talent et ses mœurs.
Le Récipiendaire fait son entrée dans une séance publique; il prononce son discours de remerciement; le Président en charge lui répond au nom de sa Compagnie; l'un et l'autre font valoir leurs talens; ce sont des Pieces qui ordinairement font honneur au corps et aux membres de l'Académie.
Il est des hommes assez mal avisés pour dire que cette société n'est utile à rien; ce que je viens de dire, prouve bien le contraire; elle décerne la Couronne au mérite, et encourage les talens à la mériter.
C'est dans l'Académie des Sciences où l'on travaille pour l'utilité; c'est dans celle des Belles-Lettres où l'on s'occupe de l'érudition.
Si une découverte se fait dans la Capitale ou dans la Province, c'est l'Académie des Sciences qui en juge; si elle la rejette, il n'en est plus question; si elle l'approuve, l'Auteur en profite, et le Public est sûr de n'être pas trompé.
Les Mémoires qui sortent de cette Académie forment un monument précieux pour la société en général: ses membres sont en correspondance avec les Savans de l'Europe, et les lumieres qui paroissent dans un hémisphere, se répandent utilement dans l'autre.
Autant cette Académie est utile aux besoins et aux commodités de la vie, autant celle de Belles-Lettres est utile pour les agrémens de l'esprit; les Beaux-Arts y sont cultivés, les anciens monumens illustrés, les inscriptions déchiffrées, les points de critique éclairés.
M. Bartoli, né à Padoue, et Antiquaire du Roi de Sardaigne, est un des membres de la Société dont je viens de parler. Cet homme estimable par l'étendue de son érudition et de ses connoissances, a fixé son séjour en France, mais ne laisse pas de s'occuper de l'honneur de sa Patrie, et d'illustrer la Littérature Italienne.
L'Académie Royale de Chirurgie est encore plus utile que les autres: il y a long-tems que les François excellent dans cet art nécessaire à l'humanité; c'est dans cette Société que les bons éleves se forment sous des maîtres très-habiles et très-éclairés. Ses Mémoires périodiques sont connus, sont traduits, sont étudiés par-tout; on y voit des découvertes intéressantes, soit pour les maladies, soit pour les remedes; on y trouve d'heureuses inventions pour les instrumens, et de nouvelles méthodes qui simplifient les opérations.
On a élevé sous la fin du dernier regne un bâtiment très-vaste et très-commode pour l'Ecole de Chirurgie; c'est un édifice qui décore la Ville, et fait honneur à l'Architecte qui en a formé le plan, et qui a présidé à son exécution.
L'Architecture est érigée aussi en Académie Royale; cet art plus utile que ceux de la Peinture et de la Sculpture, n'a pas fait en France les progrès admirables des deux autres. La galerie et le péristyle du Louvre sont des anciens monumens qui n'ont pas été imités par les Artistes modernes: le Temple des Invalides est le seul qui approche la beauté et la magnificence de ceux d'Italie.
On ne fait que bâtir actuellement à Paris: les nouvelles rues que l'on a percées, et les nouveaux bâtimens que l'on a élevés depuis vingt ans, formeroient une ville très-considérable en Province.
On voit quelques changemens dans les plans et dans le goût des Architectes modernes; quant à l'intérieur des maisons, il ne laisse rien à desirer, toutes les commodités s'y trouvent; mais pour l'extérieur, c'est encore loin de la maniere de Palladio et de Sansovino; il faut espérer que ces Artistes parviendront à la perfection aussi bien que les Peintres et les Sculpteurs leurs compatriotes: en attendant, je suis très-content d'avoir vu de mon tems supprimer les mansardes.
Tout se perfectionne de jour en jour à Paris; il y a de l'encouragement pour tous les talens; il y en a même pour les Etrangers.
L'Académie des Belles-Lettres proposa en 1785 une médaille d'or de 500 liv. tournoises pour celui qui démontreroit d'une maniere satisfaisante quel étoit le commerce des Romains depuis la premiere guerre punique jusqu'à l'avénement au Trône de Constantin.
Cette Société Littéraire ne trouvant aucun Ouvrage dans la premiere année qui méritât son approbation, elle remit le prix double pour l'année suivante, et ce fut à M. François Mengotti à qui les deux médailles furent adjugées.
Ce jeune Vénitien remplit son objet avec tant de science, d'érudition et de précision, que sa dissertation fut admise au concours, et fut couronnée.
Une Ecole Royale et gratuite de Dessein a été fondée, il n'y a pas long-tems, où les jeunes gens qui se destinent à des travaux mécaniques peuvent s'instruire dans les connoissances qui leur sont nécessaires; ils apprennent dans cette Ecole à manier le crayon, et il se développe quelquefois dans l'ouvrier un génie supérieur qui le fait devenir artiste.
Il y a aussi une Société Royale d'Agriculture, et un Bureau Académique d'Ecriture. Tous les secours possibles y sont rassemblés: voilà des ressources pour l'industrie, voilà une grande richesse pour l'Etat.
On a établi en 1776 une Société Royale de Médecine, composée de Médecins de la Cour, d'une partie de ceux de la Faculté, et d'autres Médecins étrangers: cette Société tient ses assemblées particulieres et publiques, et n'a rien de commun avec le Corps des Docteurs-Régens, et encore moins avec l'Université de Paris.
Cette Université qualifiée du titre de Fille aînée du Roi, tient par son ancienneté et par ses fonctions le premier rang dans les établissemens du Royaume; c'est elle qui fournit les sujets à l'Eglise et à l'Etat pour remplir les places les plus distinguées.
Ce sont quatre facultés qui la composent: savoir, celle de Théologie, celle de Droit, celle de Médecine et celle des Arts.
Ces quatre Corps exercent leurs fonctions séparément, et dans des endroits différens, mais ils se rassemblent tous quand les circonstances l'exigent au College de Louis le Grand, où l'Université tient ses séances et son Tribunal; et c'est là où les Colleges envoyent leurs Boursiers et leurs Eleves pour recevoir le prix de leurs talens.
Les Colleges et les Pensions sont innombrables à Paris; les jeunes gens en sortent quelquefois sans avoir rien acquis du côté des sciences, ni du côté des mœurs. Est-ce la faute de l'éducation? Je ne le crois pas. Celui qui a mal réussi dans une Communauté, seroit encore pis s'il avoit été élevé chez lui. Les mauvais caracteres sont les mêmes partout, avec cette différence, que sous la discipline d'un Directeur, ils sont forcés de se contraindre, et les meres les gâtent dans leurs maisons.
Parmi ces établissemens utiles, le Licée, situé près du Palais-Royal, tient une place honorable. Ce n'est pas le Gouvernement qui l'a ordonné, c'est une Société de Citoyens respectables qui en ont fait la fondation, qui l'entretiennent, et qui, pour un abonnement fort modique, offrent la commodité au Public de s'instruire dans les Sciences et dans les Beaux-Arts.
Il y a aussi le Musée, rue de l'Observance, aux Cordeliers, présidé par M. le Marquis de Gouffier, où des Associés se rassemblent, et dont les séances sont très-utiles et très-agréables.
C'est dans une de ces Assemblées que j'ai vu et admiré M. Talassi, de la ville de Ferrare: c'est un de ces talens surprenans, qui, sur tel sujet qu'on lui propose, débitent à l'impromptu et en chantant, cent vers ou cent couplets, sans jamais manquer ni à la rime, ni à la raison.
Les Poëtes Improvvisatori ne sont pas rares en Italie; mais il en est de bons et de mauvais, et de tous ceux qui sont venus à Paris de mon tems, M. Talassi est certainement le meilleur.
Je finirai ce Chapitre par un événement qui doit intéresser les Gens de Lettres, et qui a coûté beaucoup de regrets à la France et à l'Europe entiere.
C'est vers la fin de l'année 1778, que Monsieur de Voltaire vint revoir sa patrie; il y fut reçu avec acclamation; tout le monde vouloit le voir. Heureux ceux qui pouvoient lui parler.
Je fus de ce nombre; je lui avois trop d'obligations pour ne pas me presser d'aller lui rendre mes hommages, et lui marquer ma reconnoissance. On connoît sa lettre au Marquis d'Albergati, Sénateur de Bologne. Voltaire étoit l'homme du siecle, je n'eus pas de peine à acquérir sous ses auspices une réputation en France.
Je ne ferai pas l'éloge de cet homme célebre. Il est trop connu et trop généralement estimé. Son génie aussi fécond qu'instructif et brillant, embrassoit toutes les classes de la Science et de la Littérature, avec un style original qu'il savoit approprier aux différentes matieres, donnant de la noblesse à la gaieté, et de l'agrément au sérieux.
M. de Voltaire fit les délices de Paris pendant quelques mois; mais il avoit une maladie habituelle qu'il auroit pu soutenir long-tems, peut-être, dans la tranquillité de son paisible séjour de Ferney, mais qui ne fit qu'augmenter dans le tourbillon de Paris, et qui, au grand regret de ses amis, de ses concitoyens et de ses admirateurs, coupa le fil de ses jours. Hélas! le dulcis amor patriae l'avoit séduit, et la philosophie avoit cédé à la nature.
Le genre Italien supprimé à la Comédie Italienne. - Quelques mots sur la Femme jalouse et sur son Auteur. - Arrivée en France du Chevalier Dolfino, Ambassadeur de Venise.
Il arriva, dans l'année 1780, une catastrophe fâcheuse pour les Comédiens mes compatriotes. Ils avoient reçu dans leur Société l'Opéra-Comique, et les nouveaux camarades chasserent les anciens.
Mais il faut être vrai. Les Italiens se négligeoient un peu; la Comédie chantante faisoit tout; la Comédie parlante ne faisoit rien. Elle étoit réduite à jouer les mardis et les vendredis, que l'on appelle à ce Spectacle les mauvais jours; et si elle étoit admise à paroître dans les beaux jours, c'étoit pour remplir le vuide entre les deux Pièces qui intéressoient le Public.
Quelques-uns de ces Acteurs Italiens voyant de loin le sort qui les menaçoit, se cotiserent pour me faire travailler. Je m'y prêtai avec plaisir, avec zele; je composai six Pieces, trois grandes et trois petites; ils en étoient contens, il les avoient payées; ils n'eurent pas le tems apparemment de les étudier, de les jouer; pas une ne parut sur la scene.
La Comédie Italienne fut supprimée; les Acteurs reçus furent renvoyés avec des pensions proportionnées à la part dont ils jouissoient. Ceux qui n'avoient pas fini leur tems, furent dédommagés, les gagistes furent récompensés; on ne conserva du genre Italien que M. Carlin, en récompense de ses quarante années de service, et parce que le personnage d'Arlequin pouvoit être utile dans des Pieces Françoises.
M. Carlin n'étoit pas seulement utile, mais il étoit devenu nécessaire; il ne falloit pas perdre les nouvelles Pieces de M. le Chevalier de Florian. Ce jeune Auteur avoit l'art de placer supérieurement ce personnage grotesque.
Il n'est permis qu'à ce masque de débiter des balourdises saillantes; c'est un être imaginaire, inventé par les Italiens, et adopté par les François, lequel a le droit exclusif d'allier la naïveté à la finesse, et personne n'a su mieux rendre ce caractere amphibie, que M. de Florian.
Mais il a fait plus; il a donné du sentiment, de la passion, de la morale à ses Pieces, et les a rendues intéressantes. Les deux Billets, le Bon Ménage, les deux Jumeaux de Bergame, le Bon Pere, sont de petits chefs- d'œuvre. Il les a composés pour lui-même; personne ne les rendit mieux que lui dans la société, et M. Carlin étoit le seul qui pouvoit les faire connoître au Public.
On avoit fait venir d'Italie M. Corali pour doubler M. Carlin. Ce nouvel Acteur n'étoit pas sans mérite; mais la comparaison est rarement favorable au dernier arrivé. M. Corali cependant ne fut pas renvoyé, il se rendit utile à l'Opéra-Comique, et fut gardé aux mêmes appointemens dont il jouissoit auparavant.
M. Camerani qui jouoit les rôles de Scapin dans la Comédie supprimée, eut sa retraite et sa pension comme ses camarades; mais il fut reçu quelques jours après comme Acteur, et avec le titre de Semainier perpétuel de la Troupe.
Cet homme très-actif, plein d'intelligence et de probité, chargé des commissions épineuses, sait si bien concilier les intérêts de la société et ceux des particuliers, qu'il est l'intermédiaire des querelles, l'arbitre des reconciliations, et l'ami de tout le monde.
L'Opéra-Comique, dégagé de la Comédie Italienne, ne pouvoit pas fournir lui tout seul deux ou trois Pieces par jour dans le courant de l'année.
Il y avoit autrefois sur ce Théâtre une Comédie Françoise qui faisoit corps avec les Italiens. Ceux-ci l'avoient renvoyée; l'Opéra-Comique la fit revenir. Elle est assez bien composée, il y a des Acteurs excellens qui seroient très- utiles au Théâtre François; ils ont donné des Pieces charmantes, je ne parlerai que de la Femme Jalouse et de son Auteur.
Cette Piece, en cinq Actes et en vers, est, à mon avis, un Ouvrage achevé; le sujet qui paroît usé, y est traité d'une maniere qui le rend nouveau. L'Auteur eut l'esprit de rendre raisonnable une jalousie mal fondée; la femme est intéressante par ses craintes motivées, et le mari l'est aussi par la délicatesse de son secret. Tous les caracteres de la Piece sont vrais, les épisodes bien adaptés, les équivoques et les surprises bien ménagées, la catastrophe naturelle et satisfaisante; le style noble, comique et correct, les vers harmonieux sans affectation. Je ne donnerai pas l'extrait d'une Piece qui est imprimée; je ne fais qu'énoncer les raisons qui me la font regarder comme une comédie très-bien faite.
Je vais par sauts et par bonds dans mes Mémoires; je passe hardiment de la Comédie à un sujet très-sérieux et très- noble.
Le Chevalier Dolfino, Ambassadeur de Venise, vint dans cette même année 1780 relever le Chevalier Zeno son prédécesseur.
Ce nouveau Ministre, d'une famille très-ancienne et très-riche, s'annonça d'une maniere qui répondoit à son rang, et faisoit honneur à sa Nation; mais il essuya des coups douloureux qui lui mirent l'amertume dans le cœur, et tout robuste qu'il étoit, il fut contraint de céder à son affliction.
Il avoit amené avec lui ses deux enfans: un fils qu'il élevoit sous ses yeux, et une fille qu'il avoit confiée aux Dames Religieuses de Panthemont.
L'un et l'autre promettoient beaucoup, ils faisoient les délices d'un pere tendre, qui, pour cultiver leur esprit et leurs talens, leur avoit procuré les avantages de l'éducation Françoise.
La fille tomba malade et mourut. Le fils qui restoit pour la consolation du pere, mourut aussi. Voilà le pere désolé; il alla à Venise pour mêler ses larmes avec celles de la mere affligée; il revint dans la tristesse. M. Dolfino n'étoit plus le même, on le voyoit peu; je le voyois rarement, j'étois aussi pénétré de douleur; le pere et le fils avoient tant de bonté, tant d'amitié pour moi, pouvois-je m'empêcher de pleurer?
Nouvel incendie de l'Opéra. - Naissance du Dauphin. - Réjouissances à cette occasion. - Une Salle d'Opéra bâtie sur les Boùlevarts. - Mariage de ma nièce en Italie. - Eloge d'un livre et de son Auteur. - Quelques mots sur la famille d'un de mes amis.
La Salle de l'Opéra qui avoit été réduite en cendres en 1763, subit le même sort le 16 juin 1781, à la sortie du Spectacle.
La flamme des lumieres latérales du Théâtre avoit entamé une toile des décorations; un des deux Ouvriers qui devoient se trouver aux deux bouts, n'étoit pas à sa place; l'autre coupa la corde de son côté; la toile qui étoit roulée tomba perpendiculairement; le feu monta rapidement, il gagna la charpente d'en-haut; en trois quarts d'heure, l'intérieur de la Salle fut embrasé.
J'avois dîné ce jour-là chez M. le Comte de Miromesnil, frere du Garde-des-Sceaux et Chancelier en survivance, faisant les fonctions de la Charge: les cris du peuple, et le son des cloches nous avertirent de ce désastre; nous vîmes une pluie de feu tomber sur le toit de la Bibliotheque du Roi; on trembloit pour ce monument précieux, on craignoit pour l'Hôtel où nous étions et pour tout le quartier.
M. le Comte de Miromesnil envoyoit à chaque instant au Palais-Royal, il ordonnoit, il présidoit lui-même aux précautions qu'il croyoit nécessaires pour le bien public et pour celui des particuliers; il étoit en cette occasion ce qu'il est toujours pour les affaires et pour les personnes qui l'intéressent. Il n'y a pas d'homme plus actif, il n'y a pas d'ami plus chaud, de protecteur plus zélé que lui.
L'Opéra ne trouva pas cette fois-ci à se placer aussi commodément qu'il le fut à l'occasion de l'incendie précédent; la Salle des Tuileries étoit toujours occupée par la Comédie Françoise, et les Acteurs chantans furent obligés de donner leurs représentations sur le petit Théâtre des Menus-Plaisirs du Roi, en attendant que l'on bâtit une nouvelle Salle.
Il y avoit différens projets pour ce nouveau bâtiment; tantôt c'étoit au Palais-Royal qu'on devoit le reconstruire, tantôt c'étoit au Carousel, tantôt dans l'emplacement des Halles et tantôt ailleurs.
Tous les jours il y avoit un projet nouveaul qu'on disoit sûr, qu'on disoit arrêté, qu'on prétendoit avoir été signé, et qui n'existoit pas.
Cependant il falloit bien s'y résoudre; ce bâtiment étoit nécessaire pour l'ornement de la Ville et pour l'amusement du Public, et une circonstance heureuse pour la France en rendoit la construction plus pressante. La Reine étoit enceinte; l'Opéra ne devoit pas manquer de figurer à l'occasion des réjouissances: on remit à un autre tems l'idée d'un bâtiment magnifique et solide, et on bâtit en attendant dans l'espace de soixante-six jours sur les Boulevarts, une Salle très- jolie, très-commode, très-agréable, qui existe encore, et qui existera encore long-tems.
Ce prodige fut exécuté par M. Le Noir, Architecte très-habile, plein d'intelligence et de goût; il a donné à cette Salle une solidité plus que suffisante, et la forme et l'étendue que le local lui permettoit.
On fit l'ouverture de ce Spectacle pour la naissance du Dauphin, et on y donna l'Opéra gratis pour le peuple, en réjouissance de cet heureux événement.
Tout le monde étoit dans la joie; les réjouissances furent proportionnées à la grandeur du sujet; on décora supérieurement l'Hôtel-de-Ville de Paris pour y recevoir le Roi et la Reine; on donna un feu d'artifice dont la charpente étoit merveilleuse, mais le feu manqua.
Ceux qui se distinguerent le plus dans cette occasion, furent les Gardes-du-Corps du Roi.
Ils donnerent un bal dans la grande Salle de Spectacle à Versailles; on en choisit trois dans chacune des quatre Compagnies pour danser, et ce fut un de ces Messieurs qui ouvrit le bal avec la Reine; la Salle étoit richement ornée, parfaitement éclairée, les rafraîchissemens en profusion, et l'ordre d'une exactitude admirable.
Je partageois la joie publique; j'étois, soit par inclination, soit par habitude, soit par reconnoissance, j'étois, dis-je, François comme les nationaux. Une affaire de famille ne tarda pas à me rappeller que j'étois né sous un autre ciel, et un événement agréable qui m'intéressoit particulierement ne fit que redoubler les plaisirs que j'éprouvois à Paris.
J'avois laissé en partant de Venise une niece au Couvent; elle étoit parvenue au bout de vingt ans à l'âge où il falloit qu'elle se décidât pour le monde ou pour le clôtre; je la questionnois de tems en tems dans mes lettres pour savoir son desir et sa vocation; elle n'avoit d'autres volontés que les miennes; je ne desirois que de la satisfaire, et je croyois entrevoir du mystere caché sous le voile de la modestie; je priai un de mes Protecteurs de vouloir bien la sonder finement; voici ce qu'il put en tirer: tant que je serai dans les fers, je ne dirai jamai ma façon de penser. J'augurai par-là qu'elle n'aimoit pas le Couvent: tant mieux, je n'avois que des biens substitués qu'on peut donner en dot, et les Religieuses ne demandent que de l'argent comptant.
J'écrivis une lettre à la Supérieure du Couvent, et le Sénateur que j'avois prié de s'en charger, alla la chercher avec Madame son épouse, et l'emmenerent chez eux: là, elle ne parla pas trop clairement, mais autant que la modestie le lui permettoit; elle ne demandoit point d'être mariée, mais elle ne vouloit plus de Couvent.
Ma niece n'étoit pas faite pour rester long-tems dans une maison Patricienne, on la mit en pension chez des gens très-sages, très-honnêtes. M. Chiaruzzi qui étoit l'Hôte de Mademoiselle Goldoni, se chargea en même tems du soin de mes affaires, et son épouse de celui de la jeune personne. Au bout de deux ans sa femme mourut, et le mari me demanda ma niece en mariage; elle en paroissoit contente, je l'étois on ne peut davantage; nous lui cédâmes, mon neveu et moi, tous nos biens d'Italie, et nous passâmes les actes nécessaires pardevant M. Lormeau, Notaire à Paris: la signature d'un homme de sa probité ne pouvoit être que de bon augure pour les prétendus; effectivement le mariage fut fait, et ils sont très- heureux.
Cet événement m'étoit nécessaire pour ma tranquillité. Je m'étois chargé des deux enfans de mon frere; je voyois mon neveu dans une position assez passable auprès de moi, j'étois bien aise de voir ma niece établie; j'aurois été au comble de ma satisfaction, si j'avois pu assister à ses noces, mais j'étois trop vieux pour entreprendre un voyage de trois cents lieues.
Je me porte bien, Dieu merci, mais j'ai besoin de précautions pour soutenir mes forces et ma santé: je lis tous les jours, et je consulte attentivement le Traité de la Vieillesse de M. Robert, Docteur-Régent de la Faculté de Paris.
Nos Médecins ordinaires nous soignent quand nous sommes malades, et tâchent de nous guérir, mais ils ne s'embarrassent pas de notre régime, quand nous nous portons bien: ce livre m'instruit, me conduit, me corrige, il me fait connoître les degrés de vigueur qui peuvent encore me rester, et la nécessité de les ménager; cet Ouvrage est composé en forme de lettres; quand je le lis, je crois qu'il me parle; à chaque page je me rencontre, je me reconnois: les avis sont salutaires sans être gênans; il n'est pas aussi sévere que l'Ecole de Salerne, et ne conseille pas la régime de Louis Cornaro, qui vécut cent ans malade pour mourir en bonne santé.
M. Robert est un homme très-sage, très-instruit; il est un de ceux qui ont le plus étudié la nature, et qui en connoissent les effcts; je fis sa connoissance chez M. Fagnan, premier Commis du Trésor Royal, nous nous y rencontrions souvent; et Madame Fagnan sa veuve, remplie de talens, de graces et de bon sens, voit toujours avec la même cordialité les amis intimes de son mari.
Le Palais Royal - Sa nouvelle forme et ses agrémens.
Dans la même année 1781, dont je viens de parler, on fit part au Public des changemens projettés au Palais Royal; et on donna le 15 Octobre le premier coup de hache aux arbres de la grande allée.
Que de plaintes dans tout Paris! tout le monde troue voit cette promenade charmante comme elle étoit; tout le monde en faisoit ses délices, on ne pouvoit pas croire, qu'on la rendroit plus agréable, ni plus commode; on craignoit qu'un projet de spéculation ne sacrifiât à l'intérêt du maître l'agrément des particuliers.
Les propriétaires des maisons qui environnoient le jardin, étoient plus allarmés que les autres. Ils étoient menacés d'un nouveau bâtiment, qui alloit les priver de la vue et de l'entrée de cet endroit délicieux; ils se réunirent en corps, ils firent des tentatives pour conserver leurs prétendus droits, les Jurisconsultes les persuadèrent de cesser leurs démarches; le terrein avoit été donné par le Roi à la maison d'Orléans; M. le Duc de Chartres, aujourd'hui Duc d'Orléans et premier Prince du Sang, en avoit la jouissance; les jours et les entrées sur ce jardin n'étoient que de tolérance, et sauf la perte des plaignans, c'étoit pour la plus grande satisfaction du Public que l'on alloit travailler.
Mais ce Public ne s'y fioit pas; on regrettoit cette superbe allée, qui rassembloit, dans les beaux jours, un monde infini, où les beautés de Paris faisoient parade de leurs attraits, où les jeunes gens couroient des risques, et rencontroient des fortunes, où les hommes sensés s'amusoient quelquefois aux dépens des étourdis.
Chaque arbre qui tomboit faisoit une sensation douloureuse dans l'ame des spectateurs; je me rencontrai par hasard à la chûte de l'arbre de Cracovie, de ce beau Marronnier qui rassembloit les nouvellistes autour de lui, qui étoit depuis long-tems le témoin de leurs curiosités, de leurs contestations, et de leurs mensonges; je perçai la foule, j'eus le bonheur de m'emparer d'une branche qui avoit conservé ses feuilles, je l'apportai sur-le-champ dans une maison de ma connoissance; je vis des Dames prêtes à pleurer, je vis des hommes en fureur; tout le monde crioit contre le destructeur; je riois tout bas, j'avois grande confiance dans ses projets, et je ne me suis pas trompé.
Voilà le Palais-Royal renouvellé, rebâti, achevé: on a beau dire, on a beau critiquer; je n'y entre jamais sans un nouveau plaisir; et l'affluence du monde qui le fréquente actuellement, vient à l'appui de mon jugement.
L'enceinte du jardin est rétrécie, dit-on, elle est encore assez vaste pour offrir des allées d'été, des allées d'hiver, et un espace très-considérable au milieu, qui n'est jamais rempli. - Il n'y a pas assez d'air. - Ceux qui ne cherechent que de l'air, doivent préférer les Champs-Elisées; mais ceux qui aiment à rencontrer dans le même endroit la société, le plaisir et la commodité, auront de la peine à se détacher du Palais-Royal.
Des arcades qui garantissent de la pluie et du soleil, des marchands très-achalandés, des Magasins d'étoffe, de bijouterie et tout ce qui peut fournir à la parure, à l'habillement et à la curiosité: des Cafés, des Bains, des Restaurateurs, des Traiteurs, des Hôtels garnis, des établissemens de société, des Spectacles, des Tableaux, des Livres, des Concerts, des Appartemens assez commodes en dedans, très-ornés et trop ornés peut-être en dehors; toujours du monde, des gens d'affaire, des commerçans, des politiques, chacun y trouve à s'occuper utilement, à s'amuser agréablement; autant les goûts sont différens, autant les plaisirs du Palais-Royal sont variés.
Il arrive par fois quelques querelles, quelques tapages. Mais où n'en arrive-t-il pas? la Police y veille comme partout ailleurs; et il y a de plus, des Suisses toujours prêts aux premiers mouvemens.
Des gens de mauvaise humeur trouvent le Palais-Royal indécent; il n'y a rien à craindre pour les personnes décentes; j'ai vu suivre aux Tuileries des femmes très-honnêtes, et les forcer de se retirer, parce qu'elles avoient quelque chose d'extraordinaire dans leur parure, ou dans leur figure; cela n'est jamais arrivé au Palais-Royal, il y a trop de foule pour qu'une personne soit fixée et entourée d'une cohue de curieux ou d'étourdis.
On a soin dans certains jours et dans certains momens de séparer le peuple d'avec le monde comme il faut; s'il s'en mêle quelquefois mal à propos, les cotillons des Bonnes ne salissent pas les robes des Dames parées; c'est en passant, on n'y prend pas garde; c'est un endroit public, un endroit marchand; utile, commode, agréable; vive le Palais-Royal.
La nouvelle Salle de la Comédie Françoise. - Celle de la Comédie Italienne. -Le Magnétisme Animal. - Les ballons. - Les Somnambules. - L'Homme de Lyon qui dévoit marcher sur l'eau à pied sec. - Cette plaisanterie compromet le Journal de Paris. - Ce journal est amplement justifié.
La Comédie Françoise quitta les Tuileries en 1781, pour aller occuper le nouveau Théâtre qu'on lui avoit destiné au Fauxbourg Saint-Germain: ce Bâtiment est isolé; sa façade se présente bien, sur un terrain très-spacieux et très-commode pour les voitures; si, malgré les précautions que l'on a imaginées, le feu venoit à prendre, il n'y a rien à craindre pour le voisinage.
La Salle est vaste, noble et commode; les Comédiens ont introduit une nouveauté dans le Parterre; le Public y est assis, mais paye le double; cela peut produire du bien et du mal pour la recette; les jeunes gens habitués à payer vingt sols, regardent à deux fois les quarante huit, et ceux qui alloient aux places de six francs, trouvent agréable et décent ce siège économique.
Autre observation à faire sur ce changement. C'étoit le Parterre autrefois qui jugeoit les Pieces nouvelles; ce Parterre n'est plus le même, les Acteurs donnoient des billets pour faire réussir leurs ouvrages, les jaloux en donnoient pour les faire tomber; le redoublement du prix doit diminuer les soutiens des uns et la cabale des autres; est-ce un bien? est-ce un mal? je m'en rapporte à la recette des Comédiens; mais elle est si considérable et si assurée par les loges louées à l'année, qu'ils ne peuvent pas s'appercevoir du plus ou du moins de bénéfice.
Les Comédiens Italiens à leur tour, l'année suivante, changerent d'emplacement; ils en avoient plus besoin que les autres; la position de leur ancien Hôtel de Bourgogne étoit très-incommode pour le Public, et encore plus pour les habitans du quartier; j'en étois un, et j'ai couru des risques pour rentrer chez moi, au moment de la défilée des voitures.
Au milieu d'une foule de projets que les Architectes proposoient tous les jours, les Comédiens s'arrêterent à celui de l'Hôtel et Jardin de M. le Duc de Choiseul, dont on alloit faire un nouveau quartier, avec des rues, des maisons, et des établissemens de toute espece.
Les Entrepreneurs de ces Bâtimens donnerent aux Comédiens la Salle construite, ornée, achevée, et sauf les décorations du Théâtre, prête à servir à l'usage des acquéreurs, pour le prix convenu de cent mille écus; les Comédiens signerent le contrat, payerent la somme, et la Salle est à eux.
Ils y firent quelques changemens l'année suivante, pour la commodité du Public; ces changemens lui donnerent un relief considérable; c'est une des belles Salles de Paris, elle est très-agréable, et elle est très-fréquentée.
Voilà les trois grands Spectacles renouvellés presqu'en même-tems, voilà ce que les François voudroient: voir tous les jours; le Public ne s'amuse que de nouveautés; l'une efface l'autre, et dans un grand Pays, elles, se succèdent rapidement.
Quand les nouveautés donnent lieu à contestation, elles durent davantage. Celle, par exemple, du Magnétisme Animal commença en 1777, augmenta de vigueur pendant quelques années, et on en parle encore comme d'un probleme à résoudre, ou comme d'un phénomene à éclaircir.
M. Mesmer, Médecin Allemand, préféra les Parisiens pour leur faire part d'une découverte intéressante pour i'humanité; il s'agit de guérir toute espece de maladies, par le tact; rien de plus agréable que de recouvrer la santé sans le dégoût des médicamens.
Y a-t-il un agent dans ses opérations, ou n'y en a-t-il pas? c'est le secret de l'Auteur de la découverte; il l'a communiqué à une société, qui s'est cotisée à cent louis par tête, jusqu'à la concurrence de cent mille écus, avec la promesse de la discrétion; tout le monde à Paris n'est pas discret; il est à parier que le mystere sera dévoilé; mais s'il n'y a pas d'agent, il n'y a rien à apprendre, si l'effet ne dépend que de la vertu du tact, il faudroit avoir la main heureuse du maître.
M. Deslon faisoit des prodiges avec ses doigts aussi-bien que M. Mesmer; celui-ci cependant ne lui avoit pas confié son secret; M. Mesmer l'a dit lui-même, et l'a fait imprimer. M. Deslon l'avoit donc deviné, et le Médecin François avoit la même aptitude que le Docteur Allemand.
Je connoissois la probité de M. Deslon, et les personnes respectables de ma connoissance qui le voyoient familierement, et qui avoient recours à son magnétisme, m'assurent encore davantage sur des doutes qui pourroient me rester.
Enfin si ce remede n'étoit bon que pour guérir les maladies de l'esprit, il faudroit toujours le conserver pour le soulagement des hommes mélancoliques et des femmes à vapeurs.
Une autre découverte parut presqu'en même tems, et ne fit pas moins de bruit. M. de Montgolfier fut le premier qui lança un Globe dans les airs: ce Globe monta à perte de vue, vola au gré des vents et se soutint jusqu'à l'extinction de la flamme et de la fumée qui l'alimentoient.
Cette premiere expérience donna lieu à d'autres spéculations; M. Charles, Physicien très-savant, employa l'air inflammable; les Globes remplis de ce gas, n'ont pas besoin de la main-d'œuvre pour durer plus longtems, et sont à l'abri de la flamme.
Il y eut des hommes assez courageux pour confier leur vie à des cordes qui soutenoient une espece de bateau, et étoient attachées à ce Ballon fragile, sujet à des dangers évidens et à des événemens qu'il n'est pas possible de prévoir.
M. le Marquis d'Arlande et M. Pilastre de Rosier firent le premier essai, d'après la méthode de M. de Montgolfier; et M. Charles, peu de tems après, vola lui-même à l'aide de son air inflammable.
Je ne pus les voir sans frémir; d'ailleurs à quoi bon ce risque, ce courage? Si on est obligé de voler au gré du vent, si on ne peut pas parvenir à se diriger, la découverte sera toujours admirable; mais sans l'utilité, elle ne sera jamais qu'un jeu.
On a tant parlé, on a tant écrit sur cette matiere, que je puis me dispenser d'en dire davantage, d'autant plus que je n'ai nulle connoissance en Physique expérimentale.
Je finirai cet Article en déplorant le sort funeste de M. Pilastre de Rosier, qui a été la victime de son dernier voyage aérostatique, et en souhaitant du courage et du bonheur à M. Blanchard, qui est l'Aréostate le plus constant et le plus intrépide.
La fureur des découvertes s'étoit si violemment emparé de l'esprit des Parisiens, qu'ils allerent en chercher dans la classe des prestiges; on a imaginé des somnambules qui parlent sensément et à propos avec les personnes éveillées, en leur attribuant la faculté de deviner le passé et de prévoir l'avenir.
Cette illusion ne fit pas beaucoup de progrès; mais il y en eut une autre presqu'en même-tems, qui en imposa à tout Paris.
Une Lettre datée de Lyon annonça un homme qui avoit trouvé le moyen de marcher sur l'eau à pied sec, et se proposoit de venir en faire l'expérience dans la Capitale. Il demandoit une souscription pour le dédommager de ses frais et de sa peine; la souscription fut remplie sur-le-champ, et le jour fut fixé pour le voir traverser la Seine. Cet homme ne parut point le jour indiqué, on trouva des prétextes pour prolonger la farce; et on découvrit enfin qu'un plaisant Lyonnois s'etoit amusé de la crédulité des habitans de Paris. Son intention n'étoit pas apparemment d'insulter une ville de huit cens mille ames; il faut croire qu'il a donné de bonnes raisons pour faire passer la plaisanterie, puisque rien de fâcheux ne lui est arrivé.
Ce qui engagea les Parisiens à prêter croyance à cette invention, ce fut le Journal de Paris qui l'annonça comme une vérité constatée par des expériences. Les Auteurs de cette Feuille Périodique furent trompés eux-mêmes, et se justifierent amplement en faisant imprimer les lettres qui leur en avoient imposé, avec les noms de ceux qui les avoient écrites et adressées à leurs Bureaux.
Trois ans après, vint à Paris un Etranger qui, effectivement, et à la vue d'un peuple infini, traversa la riviere à pied sec.
Cet homme fit un mystere des moyens qu'il avoit employés dans son expérience. Il eut grand soin de cacher la chaussure dont il s'étoit servi dans sa traversée; il vouloit apparemment vendre cher son secret; mais le peu d'utilité qu'on pouvoit en tirer, n'en méritoit pas la peine. C'étoit, sans doute, des especes de scaphes, ou des scaphandres appliqués aux deux pieds.
On trouve dans toutes les rivieres des bacs ou des bateaux pour les traverser. Il est rare qu'on ait besoin de secours extraordinaire pour passer l'eau; et en ce cas, on ne pourroit pas toujours avoir sur soi ces machines qui ne peuvent pas être ni légeres, ni commodes à porter.
Cette expérience a cependant fourni une nouvelle justification aux Auteurs du Journal de Paris, qui avoient vu de loin la possibilité de la découverte.
Les Feuilles Périodiques de Paris. - Quelques Ouvrages dont la continuation n'a pas d'époques fixées.
Le Journal dont je viens de parler, me rappelle à la mémoire cette quantité immense de Feuilles qui se débitent tous les jours à Paris.
L'homme du monde le plus curieux et le plus désœuvré n'en pourroit pas lire la totalité, en y employant même tout son tems; je parlerai de celles que je connois davantage.
La Gazette de France qui paroit deux fois par semaine, ne donne pas les nouvelles les plus fraîches, mais les plus sûres: l'article de Versailles est intéressant à cause des nominations et des présentations; c'est un texte sûr et perpétuel pour les titres, pour les dignités et pour les charges.
Le Courier de l'Europe est une Gazette Angloise traduite en François; elle donne des détails très-étendus des débats et des harangues des Parlementaires, et ne traite pas mieux le parti des Royalistes que celui de l'opposition. Cette feuille a été très-courue et très-intéressante pendant la derniere guerre et elle entretient toujours la curiosité du Public sur les démarches du Gouvernement Britannique.
Les Gazettes de Hollande, celles d'Allemagne et quelques-unes d'Italie, qui s'impriment en France, sont utiles pour confronter les nouvelles; les Gazettiers s'empressent d'en donner; ils n'ont pas le tems de les vérifier; ils se trompent quelquefois, et la nécessité de se dédire leur fournit des articles pour remplir les feuilles successives.
Le Mercure de France, que l'on appelloit autrefois le Mercure Galant, a changé l'ordre de sa distribution; au lieu d'un volume par mois, on en débite une partie tous les Samedis; c'est une Société de Gens-de-Lettres qui s'en occupe; il embrasse les Arts, les Sciences, la Littérature, les Spectacles, les Nouvelles Politiques, et il a toujours conservé l'ancien usage des Enigmes et des Logogriphes, dont il donne l'explication dans le volume qui suit.
Tout le monde doit connoître les Enigmes, et il peut y avoir des personnes qui ne connoissent pas les Logogriphes; car je ne les connoissois pas en Italie. Voici l'explication qu'on en trouve dans le Dictionnaire de Trévoux.
Logogriphe, sorte de symbole en paroles énigmatiques; il consiste en quelque allusion équivoque, ou mutilation de mots, qui fait que le sens littéral différe de la chose signifiée, en sorte qu'il tient le milieu entre le rébus et la vraie Enigme ou l'Emblême.
Ce ne sont pas ces bagatelles qui soutiennent la réputation et le débit du Mercure; mais si on les avoit supprimées, il y auroit peut-être moins d'abonnés; aussi-tôt que ce livre paroit, les Curieux s'empressent de voir s'ils ont deviné les Enigmes et les Logogriphes du volume précèdent; ils tombent immédiatement après sur les Pieces nouvelles de ce même genre; ils les étudient, ils passent des journées entieres dans cette occupation, qui devient pour eux sérieuse et piquante.
Une Dame de ma connoissance qui avoit le don de deviner très-souvent au premier coup-d'œil, trouve un jour une Enigme diabolique qui la met au désespoir; elle devine enfin ou croit avoir deviné; elle est couchée, elle sonne, elle se leve, elle écrit, elle envoye faire part à ses amis de sa découverte; on trouve le lendemain qu'elle s'est trompée: je ne puis pas peindre l'état de désolation dans lequel je l'ai vue.
L'Année Littéraire est aussi une Feuille Périodique qui paroit tous les mois, et dont Monsieur Fréron étoit l'Auteur à mon arrivée à Paris; c'étoit un homme très-instruit, et très-sensé; personne ne faisoit l'Extrait d'un livre, ou d'une Piece de Théâtre, mieux que lui; il étoit méchant quelquefois, mais c'étoit la faute du métier.
Ce qui rendoit ce journal plus piquant, c'étoit la guerre qu'il avoit déclarée au Philosophe de Ferney; l'homme célebre eut la foiblesse de s'en facher; Fréron étoit sa bête noire; il le fourroit par-tout, il le chargeoit de sarcasmes, de ridicules, et cela fournissoit au journaliste de nouveaux matériaux pour remplir ses Feuilles et pour amuser le Public; cet Ouvrage Périodique est passé entre les mains d'un homme de mérite dont la plume est heureuse, et le jugement estimable.
Le Journal des Savans n'est pas fait pour tout le monde; il répond bien à son titre; mais en général on aime mieux s'amuser que s'instruire.
La Gazette des Tribunaux est utile aux Gens de Robe et aux Plaideurs, et le Journal d'Agriculture intéresse les Cultivateurs, mais ils sont très-bien faits l'un et l'autre, et ils trouvent assez de Lecteurs pour récompenser la peine de leurs Auteurs.
Une Feuille Périodique qui a été très-heureuse, et qu'on lit encore avec un certain plaisir, c'est celle qui paroît chaque mois sous le titre de Bibliotheque de Romans.
Un François, aussi noble que riche, possede une Bibliotheque à Paris, que j'ose croire la plus ample et la mieux assortie de toutes celles des particuliers de l'Europe.
Son Catalogue est immense; mais ce qui ne paroît pas croyable, et que j'ai vu de mes propres yeux, c'est qu'à chaque article on trouve en marge une note de la main du possesseur de ce recueil précieux; cela prouve que ce n'est pas le faste, mais le goût et la connoissance qui y ont présidé.
Parmi ses collections les plus rares et les plus complettes, on y trouve celle des Anciens Romans: c'est le tableau le plus fidelle des mœurs, des usages et des caracteres de tous les siecles; des Gens de Lettres protégés et encouragés par le savant et généreux Bibliophile, donnerent sous sa direction des Extraits très-curieux, très-intéressans; ces Ecrivains furent forcés au bout de quelque tems et par des raisons particulieres de puiser ailleurs; ce journal ne laisse pas cependant d'être intéressant, et ne manque pas d'Abonnés et de Lecteurs.
Mais il sort de la même Bibliothèque actuellement un nouveau Recueil qui n'est pas moins utile et pas moinsintéressant: c'est une espece d'Histoire Universelle de la Littérature de toutes les Nations policées; et c'est M. Content Dorville qui en est l'Auteur.
Le Journal de Littérature mérite certainement d'être lu. Il est très-bien écrit, et ses critiques sont très- bien faites.
Je ne parle point du Journal de Bouillon, ni des Affiches de Province, ni de bien d'autres, parce qu'on ne peut pas tout lire et tout connoître, et je finirai cet article par les deux Feuilles qui paroissent tous les jours, l'une sous le titre de Journal de Paris, l'autre sous celui de Journal de France ou de Petites Affiches.
L'objet principal de la derniere est d'annoncer les meubles et les immeubles qui sont à vendre ou à louer; les charges dont les possesseurs voudroient se défaire, les demandes des particuliers, les effets perdus ou retrouvés, les nouveautés que l'on trouve chez les Marchands; les ouvrages des Artistes, et tout ce qui regarde l'utilité et la commodité du Public. On y a ajouté depuis quelques années des Notices littéraires; on y trouve des Extraits bien faits, des Critiques judicieuses, et des Observations très-sensées.
Le Journal de Paris n'est pas moins utile et intéressant; il donne tous les jours les nouvelles les plus fraîches et les plus assurées: il rend compte des projets et des découvertes, des discussions en tous genres.
Les traits de valeur, de vertu, de bienfaisance, trouvent place dans ce Journal; on s'adresse à lui pour faire part au Public des Ouvrages d'esprit, et des travaux méchaniques des particuliers; les Auteurs de la Feuille ne manquent pas dans leurs expositions de donner du relief au mérite, et d'indiquer très-modestement les endroits qui auroient besoin d'éclaircissement ou de correction.
Le Public se plaint quelquefois que le Journal de Paris n'est pas assez riche de nouveautés; mais peut-il y en avoir tous les jours? et, d'ailleurs, peut-on tout dire, tout écrire, tout imprimer?
On y trouve l'article des Spectacles qui ne manque jamais, et qui pourroit tout seul contenter une grande partie des Curieux et d'Abonnés; le Journal de France s'en est emparé aussi, mais il n'y a pas de mal de voir les Ouvrages dramatiques criblés par deux Auteurs différens.
Le lendemain de la nouvelle représentation d'une Piece, vous en voyez dans ces deux Journaux l'exposition, le succès et la critique; quelquefois les journaux sont d'accord, quelquefois ils different dans leurs avis: il en est un plus sévere; l'autre est beaucoup plus indulgent; je ne les nommerai pas: le Public les connoît.
Ces expositions, ces critiques, sont des leçons très-utiles pour les jeunes Auteurs; d'autres Feuilles donnent au bout de quelques tems des extraits et des remarques sur les mêmes Pieces; mais les secours tardifs sont inutiles; la promptitude des journaux dont je viens de parler éclaire les Auteurs sur-le-champ, et une Piece tombée à la premiere représentation, se releve quelquefois à la deuxieme, et fait autant de plaisir qu'elle avoit causé de dégoût.
C'est le Public, me dira-t-on, peut-être, qui indique l'endroit qui le choque ou qui l'ennuie; mais les Auteurs et les Comédiens peuvent-ils démêler au juste la cause de la mauvaise humeur de l'assemblée?
Ce sont les Auteurs des Journaux qui, d'après leur propre jugement, et d'après celui des Spectateurs qu'ils ont eu le tems d'examiner attentivement et de Sang-froid, rendent compte des bons et des mauvais effets, et donnent des avis salutaires.
Voilà ma façon de penser sur l'utilité de ces Ouvrages Périodiques que j'estime beaucoup, mais pour lesquels je ne voudrois pas pour tout l'or du monde me voir occupé. Il n'y a rien de si dur que d'être obligé de travailler bon gré, malgré, tous les jours. On a beau se partager la besogne entre plusieurs Ecrivains, les engagemens avec le Public sont terribles, et la difficulté de plaire à tout le monde est désespérante.
Il y a des Ouvrages, qui, sans être périodiques, ont une continuation arbitraire. Telle est, par exemple, la Vie des Hommes Illustres, ou le Plutarque François de M. Turpin. Ses éloges sont puisés dans l'histoire; mais on admire dans cet Auteur estimable l'art de rapprocher les faits, sans ennuyer le Lecteur, et son style noble et vigoureux qui fait relever le mérite, sans prodiguer l'encens.
M. Rêtif de la Bretonne est aussi un Auteur d'une fécondité sans égale; ses Contemporaines entr'autres sont connues de tout le monde, et se lisent toujours avec satisfaction; il a tracé des tableaux de toute espece; s'il a peint d'après nature, il a beaucoup vu, s'il a travaillé d'imagination, il a beaucoup deviné.
Ce seroit ici l'occasion de parler du Tableau de Paris de M. Mercier; mais je l'avoue, je me trouve à cet égard fort embarrassé; car j'estime l'Auteur, et je suis piqué contre son Ouvrage.
Il ne trouve rien de beau, rien de bon, rien de supportable à Paris; qui prouve trop ne prouve rien; M. Mercier avoit fait pleurer le Public à la représentation de ses drames; il a voulu l'égayer à la lecture de son livre.
Observations sur quelques établissemens dans Paris.
Depuis vingt-cinq ans que le suis à Paris, je dois le connoître, et comme je ne suis pas né dans un désert, je dois savoir l'apprécier; j'ai parlé de ses beautés, je vais parcourir à la hâte ses commodités, ses agrémens et sa Police.
La Ville est gardée par huit-cents soixante-seize hommes d'Infanterie, et cent onze de Cavalerie, que l'on appelle le Guet à pied et le Guet à cheval; on en trouve des Corps-de-Garde par-tout, on les rencontre en patrouille à toute heure, ils prêtent main-forte à la justice, et ils arrêtent et amenent les hommes arrêtés chez le Commissaire du quartier.
Ce ne sont pas cependant des Sbires, mais des Gardes montés sur le pied Militaire, et commandés par des Officiers qui ont occupé des grades respectables dans les Troupes du Roi.
Cinquante Commissaires, distribués dans la Capitale, reçoivent les plaintes des particuliers et les rapports des dés nonciateurs; ils dressent des Procès-verbaux sur-le-champ, et renvoyent les accusés aux Juges compétens; ces Officiers subalternes sont très-utiles pour vérifier les faits dans le premier instant, et pour éviter la peine et la dépense dans les cas de moindre importance.
Le Lieutenant-Général de Police est le Magistrat qui veille sur l'exécution des ordonnances à la sûreté et à la tranquillité du Public; il a quatre Secrétaires et vingt Inspecteurs sous ses ordres; chacun a son département à remplir, et rien n'échappe à leur vigilance.
Sans ces soins, sans ces précautions, l'on perdroit le fruit de tant d'établissemens utiles et commodes, dont on jouit à Paris; celui des voitures publiques en est un; on se plaint des mauvais Fiacres, et l'on a raison; les Fermiers viennent d'en donner une certaine quantité de meilleurs, mais les plus délabrés valent toujours mieux que rien; je suis dans la classe des piétons; je les trouve délicieux quand j'en ai besoin.
Il y a des Chaises à Porteurs, et des Brouëttes: ces petites voitures coûtent beaucoup moins que les autres; mais pour en sentir le bénéfice, il faut être seul: si vous êtes quatre, vous avez meilleur marché dans un Fiacre.
Ce qu'il y a de plus à craindre dans les voitures de place, ce sont les Cochers; il semble qu'on les choisisse parmi les hommes les plus malpropres et les plus grossiers; on n'entend parler que de leurs impertinences, et sans la rigueur de la Police, on ne pourroit pas y tenir.
Je puis me vanter cependant de n'avoir jamais eu de dispute avec eux; je sais qu'ils sont avides, je tâche de les prévenir, et quelques sols de plus les contentent.
Mais je fais encore mieux; les François sont dans l'habitude de les gourmander, de les tutoyer, et ces gens sans éducation ne risquent rien à renchérir sur la mauvaise opinion que l'on a de leur état; je leur parle avec honnêteté, avec douceur, et je suis bien servi.
La Petite Poste de Paris est aussi un établissement bien imaginé, et très-bien conduit; on peut écrire et recevoir la réponse dans le même jour; cela est très-utile pour le commerce, pour les affaires, pour les complimens, pour les invitations.
Ce sont, dans ce dernier genre, les billets que je reçois le plus souvent par la Petite Poste, et je trouve fort commode de pouvoir accepter ou refuser sur-le-champ, sans aller moi-même, et sans envoyer; j'accepte presque toujours les dîners; j'évite tant que je peux les soupers, et je ne refuse jamais les parties de jeu.
Mais ce qui mérite plus d'attention, c'est l'établissement des Pompes Publiques, pour remédier aux incendies; il y a dix-sept Corps-de-Gardes-Pompiers, et autant de Dépôts de Pompes et de Voitures d'eau.
Au premier avertissement, les Pompiers sont toujours prêts à partir; leur activité, leur zele, leur courage sont admirables; je les ai vus moi-même s'élancer dans les flammes, s'exposer aux dangers les plus évidens, et tout cela sans autre intérêt que celui de remplir les devoirs de leur état, car il n'est pas possible de leur faire accepter la plus petite marque de reconnoissance.
Ce Corps respectable n'a pas besoin de Police; M. Moret, Directeur Général des Pompes du Roi, a su leur inspirer le courage et l'honneur.
On trouve des Bureaux à Paris pour tous les métiers et pour tous les emplois du bas Peuple; un Garçon Perruquier s'adresse à son Bureau, pour retrouver un Maitre; un Tailleur s'adresse au sien, pour avoir un Garçon; les Domestiques en font autant, pour se procurer une condition, et les Nourrices, pour se pourvoir de nourrissons.
Ce dernier Bureau mérite plus d'attention que les autres, car il s'agit de confier les enfans à des femmes inconnues qui emportent les nouveaux nés à la campagne; aussi la Police y a mis de l'ordre, et prend soin de l'exécution; les Nourrices viennent à Paris avec des certificats de leurs Curés, et le chef du Bureau répond de l'enfant.
Malgré toutes ces précautions, il peut arriver que le pere et la mere reçoivent un enfant nourri, qui n'est pas le leur; les meres qui nourrissent leurs enfans obéissent à la loi de la nature, et évitent les inconvéniens; ce soin maternel est heureusement devenu à la mode; les femmes qui étoient autrefois trop délicates pour le soutenir, sont devenues vigoureuses: il est à souhaiter que cette mode ne soit pas éphémere, comme les autres.
Je n'oublierai pas le Bureau Royal de Correspondance nationale et étrangere; il se charge de toutes les affaires actives et passives; il a des correspondans, ou il en trouve, dans les quatre parties de l'univers; cinq cens mille livres déposées chez un Notaire, garantissent votre confiance; et l'intelligence du Directeur vous assure de la meilleure réussite possible.
Je finirai l'article des établissemens publics par celui des machines à feu pour donner de l'eau en abondance dans toutes les rues et dans toutes les maisons de Paris.
Ce projet n'est pas neuf, c'est depuis long-tems qu'il a été imaginé et exécuté à Londres avec le plus grand succès.
La Ville de Paris voyoit la nécessité de l'imiter; elle écouta un Anglois, et lui accorda le privilege exclusif qu'il demandoit.
Une Compagnie de Citoyens François remplie de zele et de patriotisme, et animée par l'intelligence des sieurs Perier Freres, prit à tâche de revendiquer l'honneur de sa Nation; les Associés, autorisés par le Gouvernement, acheterent à grand frais le privilege, et ils entreprirent ce grand ouvrage, le plus essentiel et le plus utile pour la Capitale.
L'exécution est très-avancée; les premieres machines élevées à Chaillot ont bien réussi; les sieurs Perier, Mécaniciens très-célebres, très-versés principalement dans la Pyrotechnie et dans l'Hydrostatique, ont bien répondu dans ce premier essai à la réputation qui les avoit annoncés, et la Compagnie soutient toujours la dépense avec courage, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés, et les critiques qu'elle a essuyées.
Il ne faut pas se scandaliser si les meilleurs projets possibles éprouvent des contrariétés: tous les hommes ne les regardent pas du même œil; il peut y avoir des jaloux, des envieux, des plaisans; mais ces personnes-là ne méritent pas d'attention, c'est dans la classe des honnêtes gens, des gens bien intentionnés qu'on trouve des mécontens.
Un projet qui intéresse tous les individus d'une grande ville, donne lieu a un chacun d'en examiner l'utilité publique et particuliere; celui qui n'en est pas satisfait, peut louer l'intention et condamner les moyens; il dit son avis, il le fait imprimer; on répond, les esprits s'échauffent.
Quelque chose de pareil est arrivée à l'égard de l'établissement en question; la dispute de quelques particuliers n'a pas ralenti le zele de la société, ni l'activité des Directeurs. On continue à poser les tuyaux dans les rues.
Les grandes nouveautés ont toujours de la peine à être généralement approuvées. Il est rare même que les premiers auteurs en profitent; mais il semble que celle-ci prend déjà une consistance réelle, et visible. La Compagnie a distribué des actions à des particuliers, et ces actions ont monté prodigieusement.
Le projet est si beau, l'exécution est si heureuse, l'utilité si considérable, la commodité si évidente, qu'il n'est pas possible que la Nation la plus éclairée de la terre se refuse à en reconnoître l'avantage, et à en savoir bon gré au zele patriotique de ses Concitoyens.
Mort de Madame Sophie de France. - Projet d'un nouveau Journal. - Aventure d'un Américain et d'une femme Napolitaine.
Je touche à la fin de mes Mémoires, et je soutiens avec courage la peine d'un travail qui commence à me fatiguer; mais un événement funeste dont je suis au moment de parler, me fait sentir le désagrément de la charge que je me suis imposée.
C'est dans l'année 1783, que Madame Sophie de France cessa de vivre; quelle perte pour la Cour! quelle affliction pour ses tendres sœurs! Ses vertus la rendoient respectable, sa douceur inspiroit l'amour et la confiance; son ame bienfaisante prévenoit l'indigence, et son esprit faisoit des efforts inutiles pour se cacher sous le voile de la piété et de la modestie; cette Princesse a été pleurée, a été regrettée de tous ceux qui avoient l'honneur de l'approcher; je n'en ai pas moins été pénétré que les autres; je trouvois quelque consolation chez Madame Tacher, et chez Madame la Marquise de Chabert sa fille; nous étions affligés par la même cause; la conversation de ces Dames me faisoit ressouvenir de ma perte, et leurs bontés pour moi soulageoient ma douleur.
Ce n'est pas cependant la mort de mes protecteurs, de mes amis, ni de mes parens dont je me sens, par mon naturel, le plus vivement pénétré: je suis né sensible; le moindre mal, le moindre inconvénient qui leur arrivent, m'affecte, me désole, et je regarde la mort de sang-froid, comme le tribut de la nature dont la raison doit nous consoler.
D'où vient donc que la perte de mon auguste Ecoliere m'afflige encore aujourd'hui comme le premier jour? Dans la justice que je rends au mérite, pourroit-on me soupçonner d'amour-propre ou de vanité? Hélas! mes amis, faites-moi la grace de croire que c'est plutôt de la reconnoissance.
En parcourant mes tablettes, je trouve le plan d'un journal de mon imagination; ce projet doit paroitre contradictoire à l'aversion que j'ai marquée dans le Chapitre XXXIII, pour l'assiduité qu'exige un ouvrage périodique; mais ce n'étoit pas moi qui aurois dû m'en charger.
Un jeune homme, François d'origine et habitant de l'Amérique, avoit été envoyé par ses parens dans cette Capitale pour y faire ses études: il étoit bien avancé, il avoit profité des moyens de s'instruire plus que des occasions de s'amuser; mais il avoit tant souffert dans sa traversée, et il craignoit tant la mer, qu'il ne vouloit plus s'y exposer.
En attendant le consentement de sa famille pour rester en France, il cherchoit de l'occupation: il venoit chez moi; il avoit appris assez bien la Langue Italienne, il vouloit traduire mes Œuvres en François; je lui en fis voir les difficultés. Il étoit raisonnable, il y renonça; mais il aimoit la Littérature, et il vouloit tirer parti de l'Italien qu'il avoit appris. J'ai formé pour le contenter le projet d'une Feuille Périodique, et en voici le titre et le plan.
"Journal de Correspondance Italienne et Françoise.
"Un Italien établi depuis quelque tems à Paris est en correspondance de lettres avec plusieurs personnes de son pays. Ces lettres roulent sur toutes les matieres susceptibles de remarques, d'observations, de critique. L'histoire, les sciences, les arts, les découvertes, les projets, la typographie, les spectacles, la musique, les loix, la police, les mœurs, les usages, les caracteres nationaux, les fetes publiques, les cérémonies, les nouvelles, les anecdotes, tout y est mis à contribution. Mais le contenu de ces lettres doit toujours, par des rapports mutuels, intéresser à la fois le pays d'où elles partent, et celui où elles sont adressées.
"Sort-il un livre, un drame, un poëme, un ouvrage quelconque d'une des deux Nations, on en fait part à l'autre. L'on s'envoie des extraits, des analyses, des comparaisons; les matieres sujettes à discussions ou à déclaration ne resteront pas sans réponse, et on ne manquera pas d'y insérer des discours, des harangues, des dissertations, et tout ce qui pourra contribuer à intéresser les Lecteurs.
"Seroit-ce une entreprise téméraire que de proposer un nouveau Journal à Paris?
"Les Auteurs qui viennent d'entreprendre celui-ci, se flattent que non, vu que chaque Journal a ses partisans, et que le leur pourroît en acquérir comme un autre. La Littérature Françoise fait depuis long-tems les délices de l'Italie; il semble que les Italiens soient reconnoissans envers les François d'avoir soutenu et embelli le grand ceuvre de la renaissance des Lettres pour lequel ils avoient travaillé les premiers.
"Mais il paroît aussi que les François remontent de tems en tems à la source, et se plaisent à converser avec les grands Maîtres du bon siecle de la Littérature Italienne.
"Cette Langue est en vogue en France plus que jamais. Le goût de la nouvelle musique y a beaucoup contribué; les Bibliotheques à Paris abondent en Livres Italiens, on les lit, on les goûte, on les traduit, et les voyages des François en Italie sont devenus plus fréquens.
"Tant d'objets paroissent justes, raisonnables et engageans; si les Auteurs de ce journal se trompent, ce ne sera pas la faute du projet, mais de l'exécution. Cependant les personnes qui doivent s'en occuper, ne manqueront pas de matériaux intéressans, de notices sûres, de correspondances bien établies, de zele pour le Public et d'attention pour leur propre intérêt. Car on a beau dire, je me sacrifie pour l'honneur, pour le bien de la société, l'homme riche ne travaille gueres, et celui qui ne l'est pas ne s'oublie point, etc."
Mon jeune homme, enchanté du programme, avoit trouvé quatre associés qui l'auroient secondé. Je leur avois procuré des connoissances à Rome, à Naples, à Florence, à Bologne, à Milan, à Venise, et on attendoit d'avoir apprêté assez de matiere pour le travail de six mois, avant que de publier le Prospectus.
Dans ces entrefaites, une femme Napolitaine vint à Paris. C'étoit une Actrice de l'Opéra-Comique Italien; elle venoit de Londres, où le Directeur qui l'avoit engagée, avoit fait banqueroute, et elle venoit chercher des ressources en France. Elle n'étoit ni jeune, ni jolie; mais elle étoit fine et adroite, et ajoutoit aux artifices ordinaires de son état, celui de l'hypocrisie.
J'eus l'honneur da sa premiere visite; mon Américain la trouva fort aimable; il étoit un peu dévot; la Napolitaine avoit toujours son chapelet à la main. Elle allumoit tous les Samedis une lampe devant l'Image de Notre-Dame-de-Lorette, et pendant que le bon-homme apprenoit à prier Dieu en Italien, il oublioit son travail et ses associés.
J'avois beau lui faire des remontrances, et même des reproches; il étoit amoureux. Tout son chagrin étoit que sa belle étoit mariée, et qu'il ne pouvoit pas l'épouser.
Le Journal alloit mal. Les jeunes gens qui s'y étoient engagés, commençoient à mépriser celui qui étoit chargé de les conduire, et je faisois mon possible pour les encourager; je me flattois de ramener leur chef à la raison; mais le voilà perdu.
Il va un jour chez la sorciere, il la trouve à genoux. Ah venez, mon ami, s'écrie-t-elle en le voyant, prosternez- vous devant la Vierge Marie, remerciez Dieu avec moi, criez au miracle, mon mari est mort.
Elle lui fait voir la lettre qu'elle venoit de recevoir, l'extrait-mortuaire étoit dedans. Bref, ils se marient. La fem me étoit jalouse, elle ne vouloit pas rester à Paris; le mari étoit honteux, il ne se laissoit plus voir. Ils partirent quelques jours après: voilà le journal fini avant que de commencer.
On se plaint des femmes qui enchantent par leurs graces, qui encheînent les hommes par leurs agrémens, qui les ruinent quelquefois par leurs caprices; mais leurs charmes sont connus, et c'est l'homme lui-même qui leur prête les armes pour le soumettre.
Il n'y a que l'hypocrisie qui trompe, et cet artifice est aussi rare en France que l'imbécillité de ceux qui se laissent tromper.
Les femmes sages ont en France plus d'amabilité que par-tout ailleurs, et les femmes adroites y sont moins méprisables.
Didon, Tragédie Lyrique, en trois Actes. - Nouveau genre de Drames sur le Théâtre de l'Opéra de Paris. - Le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro, à la Comédie Françoise. - Quelques mots sur d'autres Auteurs et sur des personnes de ma connoissance.
Dans l'année 1783, on donna à Paris la premiere représentation de l'Opéra de Didon, paroles de M. Marmontel, musique de M. Piccini; c'est à mon avis le chef-d'œuvre de l'un, et le triomphe de l'autre.
Il n'y a pas de Drame musical qui s'approche plus de la véritable Tragédie que celui-ci; M. Marmontel n'a imité personne, il s'est rendu maître de la Fable, et il lui a donné toute la vraisemblance et toute la régularité dont un Opéra est susceptible.
Quelques-uns disent que M. Marmontel a travaillé son Drame d'après Métastase; ils ont tort. Didon a été le premier ouvrage du Poëte Italien; on y reconnoît un génie supérieur, mais on y remarque en même tems les écarts de la jeunesse, et l'Auteur François auroit mal réussi s'il avoit cherché à l'imiter.
M. Piccini, après avoir travaillé sur des Poëmes ingrats, a trouvé celui-ci qui pouvoit faire briller ses talens, et il en a su profiter. Madame Saint-Huberti, aussi bonne Actrice que bonne Musicienne, a supérieurement rendu le rôle de Didon, et cet ouvrage est justement regardé comme un monument précieux de l'Opéra François.
Depuis quelques années ce Spectacle avoit beaucoup perdu de son ancien crédit; il s'est vigoureusement soutenu depuis qu'on a pris le parti de multiplier les nouveautés et d'en varier les représentations.
On donnoit autrefois le même Opéra, bon ou mauvais, pendant trois ou quatre mois, et les Spectateurs diminuoient tous les jours; à présent la Salle est toujours reimplie, on a beaucoup de peine à trouver des Loges à l'année.
Ce qui a aussi beaucoup contribué à l'agrément de ce Spectacle, c'est un nouveau genre de Drames que l'on y a introduit, et qu'on pourroit appeler des Opéras-Comiques décorés. Colinette à la Cour, l'Embarras des richesses, la Caravanne, Panurge dans l'Isle des Lanternes, et bien d'autres, ne sont que des esquisses de Comédies sans intrigue et sans intérêt, et dont le dialogue ne donne pas assez de tems pour en démêler lé sujet; mais de la musique charmante, des ballets de la plus grande beauté, des décorations magnifiques, donnent du mérite à l'ensemble et du plaisir au Public; c'est bien-là le cas de dire, que la sauce vaut mieux que le poisson.
Je n'entends pas porter atteinte au mérite des Auteurs qui ont travaillé dans ces bagatelles; ils se sont conformés à la singularité des ouvrages qu'on leur avoit demandés; ils ont réussi à bien servir les autres parties du Spectacle qui en faisoient l'objet principal, et il paroit que le Public en a été satisfait.
Ce Public que l'on accuse d'être si difficile, si rigide, est par fois très-docile, très-indulgent; vous n'avez qu'à lui présenter les choses pour ce qu'elles sont, sans morgue et sans prétention, il applaudit aux endroits qui l'amusent sans examiner le fond du sujet.
Le Mariage de Figaro a eu le plus grand succès à la Comédie Françoise, parce que l'Auteur avoit fait précéder ce titre par celui de la Folle-Journée.
Personne ne connoît mieux que M. de Beaumarchais les défauts de sa Piece; il a donné des preuves de son talent dans ce genre, et s'il avoit voulu faire de son Figaro une Comédie dans les regles de l'art, il l'auroit faite aussi bien qu'un autre; mais il n'a voulu qu'égayer le Public, et il y a parfaitement réussi.
Le succès de cette Comédie a été extraordinaire en tout. On donne régulierement aux Théâtres-Comiques à Paris deux ou trois Pieces par jour; Figaro remplissoit tout seul le Spectacle; il faisoit courir le Public deux ou trois heures avant le lever de la toile, il le faisoit rester trois quarts d'heure plus tard qu'à l'ordinaire, sans l'ennuyer: le voilà à sa quatrevingt-sixieme représentation, il est toujours frais, toujours applaudi; et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que les mêmes personnes qui le critiquent en sortant du Spectacle, ne cessent pas d'y revenir, et s'amusent de ce qu'elles avoient critiqué.
M. de Beaumarchais avoit donné, quelques années auparavant, une Comédie intitulée le Barbier de Séville, et ce même Espagnol qui portoit le nom de Figaro, fournit le sujet de la Folle-journée.
La premiere de ces deux Pieces a été goûtée, applaudie. L'Auteur venoit d'essuyer un Procès; il avoit défendu sa cause lui-même; ses Plaidoyers étoient gais, plaisaus et bien écrits; on les lisoit parotout, ils faisoient le sujet des conversations; il avoit eu l'adresse d'insérer dans le Barbier de Séville des anecdotes masquées qui rappelloient son procès, et donnoient du ridicule à ses adversaires; tout cela contribua infiniment au succès de la Piece.
Dans celle du Mariage de Figaro, il n'y avoit pas de sarcasme pour des particuliers, mais il y en avoit pour tout le monde; personne cependant ne pouvoit s'en plaindre, les critiques tomboient sur des vices, sur des ridicules, que l'on rencontre parotout; tant pis pour ceux qui s'y reconnoissent.
Les connaisseurs et les amateurs du bon genre faisaient retentir leurs plaintes contre ces ouvrages qui, à leur avis, étaient faits pour dégrader le Théâtre François; ils voyoient une espece de fanatisme qui entraînait leurs compatriotes; et craignaient que la maladie ne devint contagieuse.
L'expérience leur fit voir le contraire. On donna en même tems à la Comédie Françoise des nouveautés qui n'eurent pas moins tout le succès qu'elles pouvaient mériter: Coriolan, par exemple, de M. de la Harpe, le Séducteur, de M. Bievre, les Aveux difficiles et la Fausse Coquette, de M. Vigé: ce dernier Auteur a été même encouragé par le Public; on a trouvé les premiers essais de son talent du meilleur goût, du meilleur ton, du meilleur style; et on a lieu d'espérer en lui un soutien de la bonne Comédie.
Je m'intéresse beaucoup à ce jeune Auteur, parce que j'ai l'honneur de le connaître particulierement: c'est le frère de Madame le Brun de l'Académie Royale de Peinture, et dont les ouvrages font honneur à son sexe, à son pays et à notre siecle; c'est le gendre de M. Riviere, Conseiller et Sécrétaire de légation de la Cour de Saxe; c'est le mari d'une Dame que j'ai vu naître, remplie de vertus et de talens qui prouvent l'éducation d'une mere incomparable, d'une mere de neuf enfans, dont il n'y en a pas un qui ne réponde aux soins de sa vigilance, et ne promette la consolation de ses parens.
J'ai fait cette heureuse connaissance chez Madame Bertinazzi, veuve de M. Carlin; je fréquentais cette maison du vivant du mari, je ne l'ai pas quittée depuis.
On ne peut pas être plus aimable que Madame Carlin: beaucoup d'esprit, beaucoup de gaieté, toujours égale, toujours honnête, toujours prévenante; sa société n'est pas nombreuse, mais bien choisie; ses anciens amis sont toujours les mêmes, elle aime le jeu, et moi aussi; elle est belle joueuse, et je tâche de l'imiter.
Il n'y a que le Reversi qui donne des convulsions aux joueurs les plus flegmatiques. Madame Carlin est fort vive, elle ne peut pas se contenir plus qu'un autre, mais elle met tant de graces dans ses transports, et tant d'agrément dans ses reproches, qu'on peut dire qu'elle est belle dans sa colere.
Traduction d'une de mes Pieces en François. - Sa chute au Théâtre Italien. - Naissance du Duc de Normandie. - Nouvelle maniere d'illuminations. - Quelques observations sur les modes.
Vers la fin de l'année 1784, pendant que je travaillois à la deuxieme partie de mes Mémoires, et que je faisais des extraits de Pieces de mon Théâtre, un de mes amis vint me parler d'une affaire qui étoit on ne peut pas plus analogue au travail dont j'étais occupé.
Un homme de Lettres que je n'ai pas l'honneur de connaître, avait envoyé à M. Courcelle de la Comédie Italienne une de mes Comédies qu'il avait traduite en François; il priait l'Acteur de me la présenter, et de la faire jouer si j'étais content de sa traduction; bien entendu, disoit-il très-honnêtement, que l'honneur et le profit devaient appartenir à l'Auteur.
La Piece en question est intitulée en Italien un Curioso Accidente (une Plaisante Aventure); vous en trouverez l'extrait dans la deuxieme partie de mes Mémoires, avec des notices historiques qui regardent le fond du sujet.
Je trouvai la traduction exacte, le style n'était pas coupé à ma maniere, mais chacun a la sienne; le Traducteur avoit changé le titre en celui de la Dupe de soi-même, je n'en étais pas mécontent; je donnai mon consentement pour qu'elle fût jouée; les Comédiens la reçurent à la lecture avec acclamation; elle fut donnée l'année suivante, et elle tomba net.
Un endroit de la Piece qui avait fait le plus grand plaisir en Italie, révolta le Public à Paris; je connais la délicatesse Françoise, et j'aurais dû le prévoir; mais comme c'était un François qui en avoit fait la traduction, et que les Comédiens l'avoient trouvée charmante, je me suis laissé conduire.
Je me serois peut-être apperçu du danger si j'avois pu assister aux répétitions; mais j'étois malade, et les Comédiens étoient pressés de la faire paroitre.
J'avois donné quelques billets d'Amphithéâtre et de Parterre pour la premiere représentation; personne ne vint chez moi m'en donner des nouvelles, c'étoit mauvais signe; je me couchai cependant sans m'informer de l'événement, et ce fut mon Perruquier qui, les larmes aux yeux, me fit le lendemain le détail de la chute solemnelle de la Piece; je la retirai sur le champ, et comme je me portois beaucoup mieux ce jours-là, je dînai de très-bon appetit.
Accoutumé depuis long-tems aux succès, tantôt bons, tantôt mauvais, je sais rendre justice au Public, sans le sacrifice de ma tranquillité; ce qui me fachoit davantage, c'étoit que personne ne venoit me voir, personne n'envoyoit s'informer de l'état de ma convalescence; j'écrivis à mes amis pour savoir si ma Piece les avoit indignés; au contraire c'étoit par trop d'amitié, par trop de sensibilité qu'ils n'osoient pas faire eclater devant moi leur chagrin; nous nous vîmes enfin, et c'étoit moi qui faisois l'office de consolateur.
Des rejouissances publiques me firent quitter ma Chambre, et me dédommagerent de la maladie et des désagrémens que j'avois essuyés.
La Reine venoit de donner un nouveau Prince à l'Etat; elle accoucha, le 27 Mars 1785, du Duc de Normandie; on fit des illuminations à Paris comme à l'ordinaire, mais il y eut de riches particuliers qui se distinguerent, dans cette occasion, d'une maniere noble et nouvelle; les façades de leurs Hôtels étoient ornées de haut en bas de nouveaux desseins abondamment et artistement éclairés; on ne peut pas voir de décorations plus frappantes, ni plus éclatantes.
Il est à croire que ce nouveau goût sera suivi à Paris, et que chacun, à proportion de ses forces, voudra dorénavant avoir une illumination à la mode.
La mode a toujours été le mobile des François, et ce sont eux qui donnent le ton à l'Europe entiere, soit en Spectacles, soit en décorations, en habillemens, en parure, en bijouterie, en coëffure, en toute espèce d'agrémens; ce sont les François que l'on cherche part-tout à imiter.
A l'entrée de chaque saison, on voit à Venise dans la rue de la Mercerie une figure habillée, que l'on appelle la Poupée de France: c'est le Prototype auquel les femmes doivent se conformer, et toute extravagance est belle d'après cet original; les femmes Vénitiennes n'aiment pas moins le changement que celles de France; les Tailleurs, les Couturieres, les Marchandes de Modes en profitent; et si la France ne fournit pas assez de modes, les Ouvriers de Venise ont l'adresse de donner du changement à la Poupée, et de faire passer leurs inventions pour des idées transalpines.
Quand j'ai donné à Venise ma Comédie intitulée la Manie de la Campagne, j'ai beaucoup parlé d'un habillement de femme qu'on nommoit le Mariage: c'étoit une robe d'une étoffe toute unie, avec une garniture dé deux rubans de différentes couleurs, et c'étoit la Poupée qui en avoit donné le modele; je demandai, en arrivant en France, si cette mode existoit encore; personne ne la connoissoit, elle n'avoit jamais existé, on la trouvoit même ridicule, et on se moquoit de moi.
J'eus le même désagrément ici en parlant de robes à la Polonnoise, qu'au moment de mon départ les femmes avoient adoptées en Italie, mais douze ans après, je vis les Polonnoises à Paris, comme une nouveauté charmante.
La mode, en fait d'habillemens, a eu, il est vrai, un long interregne en France, mais elle a repris son ancien empire.
Que de changemens en très-peu de tems! des Polonnoises, des Lévites, des Fourreaux, des Robes à l'Angloise, des Chemises, des Pierrots, des Robes à la Turque et des Chapeaux de cent façons; et des Bonnets qu'on ne sauroit définir; et des Coëffures!... des Coëffures!
Cette partie des ajustemens des femmes, si essentielle pour relever leurs graces et leur beauté, étoit arrivée, il y a quelque tems, au point de sa perfection; aujourd'hui, j'en demande pardon aux Dames, elle est insupportable à mes yeux.
Ces cheveux chiffonnés, ces toupets qui tombent sur les sourcils, leur donnent des désavantages qu'elles devroient éviter.
Les femmes ont tort de suivre en fait de Coëffüre la mode générale; chacune devroit consulter son miroir, examiner ses traits, adapter l'arrangement de sa chevelure à l'air de son visage, et conduire la main de son Perruquier.
Mais avant que mes Mémoires sortent de la presse, on verra, peut-être, les Coëffures des femmes, et bien d'autres modes changées; on diminuera la grandeur des Boucles, on rognera les Chapeaux, on donnera plus de noblesse aux habillemens des femmes, et plus d'ampleur aux culottes des hommes.
Quelques mots sur une Procédure réglée à l'extraordinaire. - Le goût des François pour le Vaudeville. Quelques mots sur deux Auteurs estimables. - 0bservation sur la ville de Saint-Germain-en-Laye. - Traits de reconnoissance envers quelques-uns de mes amis. - Ma vie ordinaire. - Mon secret pour m'endormir. - Mon tempérament.
Il y eut une grande affaire à Paris dans cette même année 1785: des Prisonniers d'Etat furent enfermés à la Bastille; le Roi ordonna à son Parlement de les juger, et l'Arrêt fut prononcé le 30 Mai de l'année suivante.
Je ne parlerai pas du fond de ce Procès que personne ne doit ignorer; les Gazettes en ont assez dit, et les Mémoires des Accusés ont été répandus par-tout.
Un Personnage illustre, victime d'une duperie inconcevable, fut déchargé de toute accusation.
Un Etranger, impliqué mal-à-propos dans cette affaire, fut blanchi de même.
Une femme intriguante, méchante, criminelle, fut punie, le nom de son mari contumace fut affiché et flétri.
Un homme qui avoit prêté sa plume aux escroqueries fut banni à perpétuité, et une jeune étourdie, complice sans le savoir, fut mise hors de Cour par commisération de son ignorance.
Cette cause, singulierement compliquée, occupa le Public pendant dix mois; elle faisoit le sujet journalier des cercles et des sociétés de Paris; les personnes qui par leur adhérences y étoient intéressées, vivoient dans l'inquiétude, et les beaux esprits faisoient des couplets.
C'est le ton de la Nation; si les François perdent une bataille, une épigramme les console; si un nouvel impôt les charge, un vaudeville les dedommage; si une affaire sérieuse les occupe, une chansonnette les égaye, et le style le plus simple et le plus naïf est toujours relevé par des traits malins et par des pointes piquantes.
La France est riche en talens: les uns travaillent pour la gloire, les autres s'amusent pour l'agrément de la société.
M. le Comte de Rivarol est un jeune Auteur qui s'est annoncé au Public par un Ouvrage qui lui fait le plus grand honneur, et qui prouve l'étendue de ses connoissances et l'énergie de sa plume.
Tout le monde connoît son Discours sur la préférence de la Langue Françoise, qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin; il vient de traduire le Poëme du Dante, et on a lieu d'espérer en lui un successeur aux Grands- Maitres de la Littérature.
Voici un Poëte qui embrasse les deux genres de Poësie ci-dessus marques. M. Robet est grave et vigoureux dans ses Poëmes, et agréable dans ses contes; c'est un Auteur qui n'a imité personne; son style est original, ses vers sont plus énergiques que coulans, ses rimes sont des plus riches, et en même tems des plus difficiles et des plus heureuses; son érudition est immense, et sa logique est aussi claire que vigoureuse.
Ses Ouvrages ne sont pas imprimés; j'en ai entendu débiter par l'Auteur lui-même plusieurs fois, mais pas aussi souvent que je desirerois; car M. Robet partage sa demeure entre la Capitale et Saint-Germain-en-Laye.
L'occasion de nommer cette derniere Ville me fait souvenir que j'avois oublié d'en faire mention dans mes Mémoires.
C'est un séjour royal, à quatre lieues de Paris, dont la Position est des plus heureuses: elle est bâtie sur une élévation qui domine une plaine immense, traversée par les eaux de la Seine; ce qui fait que l'air y est très-salutaire, e la vue délicieuse.
La forêt qui l'approche sans la gêner, est très-vaste, bien coupée, bien peignée, et abondante en bêtes fauves et en gibier; le Château est superbe, dans l'ancien goût; c'est le lieu de la naissance de Louis XIV.
Si ce Monarque avoit eu plus d'attachement pour son pays natal, il auroit épargné tant de millions qu'il a sacrifiés pour dessécher les marais de Versailles, il auroit trouvé le sol moins ingrat, et l'exposition plus heureuse pour l'exécution de ses idées magnifiques.
Saint-Germain est aujourd'hui une retraite agréable pour bien du monde: les uns y vont chercher la tranquillité, les autres l'économie: chacun y trouve la société qui lui convient; si mes affaires ne me retenoient à Paris, j'irois certainement profiter de ce séjour agréable pour le reste de mes jours.
Ce qui m'engageroit encore davantage, ce seroit l'occasion de me rapprocher d'un ami respectable que j'aime tendrement par inclination et par reconnoissance.
M. Huet y fait sa demeure depuis quelques années; je le voyois souvent, quand il étoit à Paris; il n'y a pas d'homme plus aimable; il n'y a pas d'ami plus solide que lui; dans le tems où le Trésor Royal n'étoit pas en regle comme aujourd'hui, M. Huet ne m'a jamais refusé de m'avancer les sommes dont je pouvois avoir besoin; et lorsque le Roi m'accorda la gratification de cent cinquante louis pour mon Bourru Bienfaisant, cet ami généreux m'envoya sur-le-champ trois sacs de 1200 livres, et se chargea de les retirer à la commodité du Caissier des Menus-Plaisirs; ce sont des services qu'on ne peut pas oublier.
Je me félicite de plus en plus d'avoir entrepris cet Ouvrage, pour pouvoir donner des marques de reconnoissance à ceux qui m'ont obligé.
Les Lecteurs de mes Mémoires qui n'ont pas des raisons pour s'intéresser aux personnes que je me fais un honneur et un plaisir de nommer, ne peuvent pas me savoir mauvais gré que je leur fasse connoître des hommes qui méritent d'être connus.
Je n'oublierai pas dans cet article Madame de la Bergerie. M. et Madame Haudry, ses pere et mere, furent de mes premieres connoissances à mon arrivée à Paris; j'étois chez eux comme chez moi; je vis naître leur fille, je la vis croître tous les jours en beauté, en sagesse, en esprit.
Mademoiselle Haudry perdit à la fleur de sa jeunesse son pere, sa mere, son oncle paternel; ces pertes entraînerent celle d'une partie de son bien.
M. de la Bergerie, jeune homme d'une conduite peu commune, avec un esprit solide et un cœur excellent, rendit justice au mérite de la jeune personne, la fit demander en mariage, l'épousa; il prit soin des affaires de sa femme, il la fit rentrer dans les droits de sa terre de Bleneau; c'est un ménage charmant dont je jouis en hiver, et que je regrette en été.
Beaucoup de mes connoissances vont à la campagne dans la belle saison, et je reste à Paris; j'irois bien m'établir pour quelques jours chez les uns et chez les autres de mes amis, mais la petite santé de ma femme m'empêche de m'éloigner.
Elle a eu une maladie considérable cette même année: M. de Longlois, son Médecin, l'a tirée d'affaire; c'est un homme qui, indépendamment de sa science, a l'exactitude et la douceur qui consolent les malades et les tranquillisent; mais les pleurésies laissent toujours des vestiges dangereux, et je n'ose pas la quitter; ma pauvre femme a tant d'attention pour moi, il faut bien que j'en aye pour elle.
Je vais, pour changer d'air, passer quelques journées dans les environs de Paris: tantôt à Belleville, chez Madame Bouchard et Madame Legendre sa fille; maison charmante où l'on trouve les talens réunis, et tous les agrémens possibles de la société.
Tantôt à Passy, chez Madame Alphand ou chez Mademoiselle Desglands, deux aimables voisines dont la douceur de l'une et la vivacité de l'autre sont toujours dans la plus parfaite harmonie, parce que leurs esprits sont raisonnables, et leurs cœurs excellens.
Je vais aussi quelquefois à Clignancour me promener dans le superbe jardin de M. Agironi; ce dernier est un honnête Vénitien privilégié par Lettres-patentes du Roi pour la vente d'une eau médicinale de sa composition: il faut que son remede soit bon; car c'est depuis vingt ans qu'il le débite à Paris, et il lui a produit une fortune considérable.
Pour le reste du tems, je mene ma vie ordinaire à la Ville; je me leve à neuf heures du matin, je déjeûne avec du chocolat de santé: c'est Madame Toutain, rue des Arcis, qui m'en fournit d'excellent; je travaille jusqu'à midi, je me promene jusqu'à deux heures; j'aime la société, je vais la chercher, je dîne en Ville très-souvent, ou chez moi avec la société de ma femme.
Madame et Mademoiselle Farinelli sont de ce nombre: la mere a été une des premieres Actrices de l'Opéra en Italie, la fille enseigne à toucher du forte-piano, et la musique Italienne et Françoise à Paris; elle a beaucoup d'Ecolieres, ses talens et ses mœurs lui font honneur également.
Madame Rinaldi est aussi une de nos compatriotes qui viennent quelquefois nous voir; et M. Rinaldi a bien voulu, par amitié, être le copiste de mon Ouvrage; c'est un Maître de Langue Italienne très-accrédité: il y en a plusieurs dans cette Ville, je les crois tous excellens, mais celui-ci est mon ami, je l'estime beaucoup, et tous ceux à qui je l'ai proposé m'en ont remercié.
Que de disgressions! Que de bavardage!... Pardonnez-moi, Messieurs, ce n'est pas du bavardage: je suis à Paris; j'annonce aux Parisiens des personnes utiles, et je serois bien aise de pouvoir contribuer aux avantages des uns, et à la satisfaction des autres.
Je reviens à mon régime... Direz-vous encore que je pourrois m'en passer? Vous avez raison; mais tout cela est dans ma tête, il faut que cela en sorte peu-à-peu, et je ne vous ferai pas grace d'une virgule.
Après mon dîner, je n'aime ni le travail, ni la promenade; je vais aux Spectacles quelquefois, et le Plus souvent je fais ma partie jusqu'à neuf heures du soir; je rentre toujours avant les dix; je prends deux ou trois diablotins, avec un verre d'eau et de vin, et voilà tout mon souper; je fais la conversation avec ma femme jusqu'à minuit; nous nous couchons maritalement en hiver, et dans deux lits jumeaux dans la même chambre en été; je m'endors bien vite, et je passe les nuits tranquillement.
Il m'arrive quelquefois comme à tout le monde d'avoir la tête occupée par quelque chose capable de retarder mon sommeil; dans ce cas, j'ai un remede sûr pour m'endormir; le voici.
J'avois projetté depuis long-tems de donner un vocabulaire du dialecte Vénitien, et j'en avois même fait part au Public qui l'attend encore; en travaillant à cet Ouvrage ennuyeux, dégoûtant, le vis que je m'endormois; je le plantai-là, et je profitai de sa faculté narcotique.
Toutes les fois que je sens mon esprit agité par quelque cause morale, je prends au hasard un mot de ma langue maternelle, je le traduis en Toscan et en François; je passe en revue de la même maniere les mots qui suivent par ordre alphabétique, je suis sûr d'être endormi à la troisieme ou à la quatrieme version; mon somnifere n'a jamais manqué son coup.
Il n'est pas difficile de démontrer la cause et l'effet de ce phénomene; une idée gênante a besoin d'être remplacée par une idée opposée ou indifférente; l'agitation de l'esprit une fois calmée, les sens se tranquillisent, et le sommeil les assoupit.
Mais ce remede, tout excellent qu'il est, ne pourroit pas être utile à tout le monde; un homme trop vif, trop sensible, n'y réussiroit pas; il faut avoir le tempérament dont la nature m'a favorisé; le moral chez moi est analogue au physique, je ne crains ni le froid ni le chaud, et je ne me laisse ni enflammer par la colere, ni enivrer par la joie.
Arrivée a Paris de M. le Chevalier Cappello, Ambassadeur de Venise. - Quelques mots sur le nouveau Port de Cherbourg - Nouvelle représentation de mon Bourru Bienfaisant à Versailles. - Retraite de quatre Acteurs de la Comédie Françoise. - Pieces jouées sur ce Théâtre dans ces derniers tems. - Autres Pièces jouées à la Comédie Italienne.
En m'approchant de la fin de mes Mémoires, je rencontre de plus en plus des sujets agréables à traiter.
M. le Chevalier Cappello, Ambassadeur de Venise à cette Cour, arriva à Paris dans le mois de Décembre 1785: c'est le septieme Ministre de ma nation que je vois en France.
J'ai vu les autres, je leur ai fait ma cour; ils ont eu tous des bontés pour moi, mais celui-ci m'a fait au premier abord un accueil si gracieux, si tendre, si intéressant, que je me suis senti ravi de joie, de respect, de reconnoissance.
Je n'avois pas eu l'honneur de le connoître à Venise; je connoissois bien la famille Cappello, qui est une des plus anciennes et des plus respectables de la République, mais M. le Chevalier étoit jeune, quand j'ai quitté mon pays; et c'est une raison de plus qui augmente ma surprise, en trouvant dans ce Patricien un de mes plus zélés protecteurs.
Je ne ferai pas son éloge: je connois sa modestie, il ne le souffriroit pas; d'ailleurs, s'il est sage, s'il est juste il s'acquitte des devoirs de l'homme; s'il est grand, honnête, généreux, il remplit les charges de son état, mais les qualités de son cœur ne sont pas communes; il y a peu d'hommes qui s'intéressent à l'humanité indigente comme lui: sa porte n'est pas fermée pour les malheureux; sa personne n'est pas inaccessible pour les mal vêtus, et le titre national suffit pour avoir droit à sa protection: que Son Excellence me pardonne; je n'ai pas pu m'empêcher de donner un petit échantillon de ses vertus, je n'en dirai pas davantage.
Je sors d'un sujet qui me flatte, et j'entre dans un autre qui ne me touche pas moins; j'aime la France, je m'intéresse à la gloire de son Souverain, aux avantages de ses citoyens.
Par-tout où je vais, je n'entends parler que du Port de Cherbourg: il y en avoit un dans cette Ville, qui, par son heureuse situation, offroit des avantages considérables dans cette partie intéressante de l'Océan; mais n'étant ni assez vaste, ni assez profond, il ne pouvoit recevoir que de petits bâtimens, et on va le mettre en état de contenir une armée navale.
Cet ouvrage immense est très-avancé; on a fait des prodiges en trois années de tems; on a surmonté la profondeur de la mer pour élever un terrein susceptible de batteries et de fortifications; et on doit l'étendre des deux côtés pour garantir les vaisseaux de la violence des vents et des flots.
Voilà un ouvrage digne des Romains; Louis XVI ne néglige rien pour la sûreté et pour la tranquillité de ses Etats; il est allé lui-même visiter les travaux, et encourager les travailleurs; il a répandu la joie et la bienfaisance par-tout. Que d'éloges, que d'acclamations, que de bénédictions n'a-t-il pas rapporté?
Je prenois part à la joie publique; mais je n'étois pas insensible à une heureuse nouvelle, qui me regardoit particulierement.
On devoit donner des Spectacles à Versailles, pour des illustres Etrangers qui étoient fêtés par la Cour de France; mon Bourru Bienfaisant étoit du nombre des Pieces que l'on avoit choisies pour cette occasion.
Mon amour-propre en étoit flatté à cause de la circonstance, et parce que M. Préville, qui venoit de se retirer du Théâtre, devoit y jouer.
Cet homme incomparable ne manqua pas de plaire, et même de surprendre, comme à son ordinaire; ma Piece gagna de nouveaux partisans, et moi-même de nouveaux protecteurs.
C'est une grande perte que la Comédie Françoise vient de faire par la retraite de Monsieur et de Madame Préville, et par celle de M. Brisard et de Mademoiselle Fanié: il lui reste cependant de bons Acteurs, d'excellentes Actrices pour conserver cette réputation qu'à juste titre elle a toujours mérité.
Ils ont donné depuis sur ce Théâtre plusieurs Pieces tant comiques que tragiques, dont la plus grande partie a obtenu les applaudissemens du Public.
Je vais rarement au Spectacle, et je ne puis pas parler des Pieces que je ne connois que par relation; mais j'ai vu l'Inconstant de M. Collin; j'ai trouvé la Piece charmante et les Acteurs excellens: M. Mollé, entr'autres, m'a paru toujours nouveau, toujours étonnant: c'est le même jeune homme, vif, agréable, brillant, qu'il étoit il y a vingt ans.
Paroît-il cet Acteur célebre, en jouant l'Inconstant, le même homme qui joue le rôle de Dorval dans le Bourru Bienfaisant? Je crois qu'il réussiroit également dans celui de Géronte.
Les Italiens n'ont pas été moins heureux dans ces derniers tems.
Richard, Cœur de Lyon, a eu le plus grand succès. M. Sedaine, membre de l'Académie Françoise, et M. Gretry se surpasserent l'un et l'autre dans cet Opéra-Comique charmant, et M. Clairval fit valoir encore davantage le mérite du Poëte et celui du Musicien.
Lorsqu'on retira l'Opéra de Richard, il paroissoit difficile d'en trouver un autre qui pût le remplacer avec autant de bonheur. Nina, ou la Folle par amour, fit le miracle; et si le succès de cette Piece ne l'emporta pas sur la précédente, elle l'a au moins égalé.
Cet Ouvrage de M. Marsoiller eut le mérite de faire tolérer sur la scene un être malheureux sans crime et sans reproche, et la musique de M. d'Alerac fut trouvée bonne et analogue au sujet.
Mais Madame du Gazon qui avoit donné tant de preuves de ses talens dans tous les genres, dans tous les caracteres, dans toutes les positions les plus intéressantes, rendit avec tant d'art et avec tant de vérité le rôle extraordinaire de Nina, qu'on a cru voir une nouvelle Actrice, ou, pour mieux dire, on a cru voir la malheureuse créature dont elle représentoit le personnage et imitoit les délires.
Compliment de l'Auteur. - Ses excuses. - Quelques mots sur deux Auteurs Italiens. - Conclusion de l'Ouvrage. Me voilà parvenu à l'année 1787, qui est la quatre-vingtieme de mon âge, à laquelle j'ai borné le cours de mes Mémoires.
Mes quatre-vingts ans sont complets; mon Ouvrage l'est aussi; le Prospectus en a été distribué; les souscriptions ont surpassé mes espérances, et le dessein de mon portrait est achevé.
C'est M. Cochin qui a bien voulu employer son crayon pour décorer mon Ouvrage. Cet homme célebre, Secrétaire et Historiographe de l'Académie Royale de Peinture, et Chevalier de l'Ordre du Roi, n'a pas seulement consenti à mon desir et à mon ambition, mais il m'a prévenu avec l'amitié la plus pure et la générosité la plus obligeante.
Tout est fini, tout est prêt: je vais envoyer mes trois Volumes à la presse et mon portrait au Graveur.
Ce dernier Chapitre ne peut donc pas regarder les évenemens de l'année courante, mais il ne me sera pas inutile pour m'acquitter de quelques devoirs qu'il me reste à remplir.
Je commence par remercier les personnes qui ont eu assez de confiance en moi pour m'honorer de leurs souscriptions.
Je ne parle pas des bontés et des bienfaits du Roi et de la Cour; ce n'est pas ici le lieu d'en parler.
J'ai nommé dans mon Ouvrage quelques-uns de mes amis, quelques-uns même de mes Protecteurs. Je leur demande pardon si j'ai osé le faire sans leur permission; ce n'est pas par vanité: les à-propos m'en ont fourni l'occasion; leurs noms sont tombés sous ma plume; le cœur a saisi l'instant, et la main ne s'y est pas refusée.
Voici, par exemple, une de ces heureuses occasions dont je viens de parler. J'ai été malade ces jours derniers; M. le Comte Alfieri m'a fait l'honneur de venir me voir; je connoissois ses talens, mais sa conversation m'a averti du tort que j'aurois eu, si je l'avois oublié.
C'est un homme de Lettres très-instruit, très-savant, qui excelle principalement dans l'art de Sophocle et d'Euripide, et c'est d'après ces grands modeles qu'il a tracé ses Tragédies.
Elles ont eu deux Editions en Italie; elles doivent être actuellement sous la presse, chez Didot à Paris. Je n'en donnerai pas les détails, puisque tout le monde est à portée de les voir et de les juger.
Dans ces mêmes jours de ma convalescence, M. Caccia, Banquier à Paris, mon compatriote et mon ami, m'envoya un livre qu'on lui avoit adressé d'Italie pour moi.
C'est un Recueil d'Epigrammes et dé Madrigaux François traduits en Italien par M. le Comte Roncali, de la ville de Brescia, dans les Etats de Venise.
Ce Poëte charmant n'a traduit que les pensées; il a dit les mêmes choses en moins de mots, et il a trouvé dans sa Langue des pointes aussi brillantes, aussi saillantes que celles de ses Originaux.
J'eus l'honneur de voir M. Roncali, il y a douze ans à Paris, et il me fait espérer que j'aurai le bonheur de l'y revoir; cela me flatte infiniment; mais, de grace, qu'il se dépêche, car ma carriere est fort avancée, et ce qui est encore pis, je suis extrêmement fatigué.
J'ai entrepris un Ouvrage trop long, trop laborieux pour mon âge, et j'y ai employé trois années, craignant toujours que je n'aurois pas l'agrément de le voir achevé.
Cependant me voilà, Dieu merci, encore en vie, et je me flatte que je verrai mes trois volumes imprimés, distribués, lus... Et s'ils ne sont pas loués, au moins j'espere qu'ils ne seront pas méprisés.
On ne m'accusera pas de vanité ou de présomption, si j'ose espérer quelque lueur de grace pour mes Mémoires, car si j'avois cru devoir déplaire absolument, je ne me serois pas donné tant de peine, et si dans le bien et dans le mal que je dis de moi-même, la balance penche du bon côté, je dois plus à la nature qu'à l'étude.
Toute l'application que j'ai mise dans la construction de mes Pieces, a été celle de ne pas gâter la nature, et tout le soin que j'ai employé dans mes Mémoires, a été de ne dire que la vérité.
La critique de mes Pieces pourroit avoir en vue la correction et la perfection de la Comédie, et la critique de mes Mémoires ne produiroit rien en faveur de la Littérature.
S'il y avoit cependant quelqu'Ecrivain qui voulût s'occuper de moi, rien que pour me donner du chagrin, il perdroit son temps. Je suis né pacifique; j'ai toujours conservé mon sang-froid, à mon âge je lis peu, et je ne lis que des livres amusants.