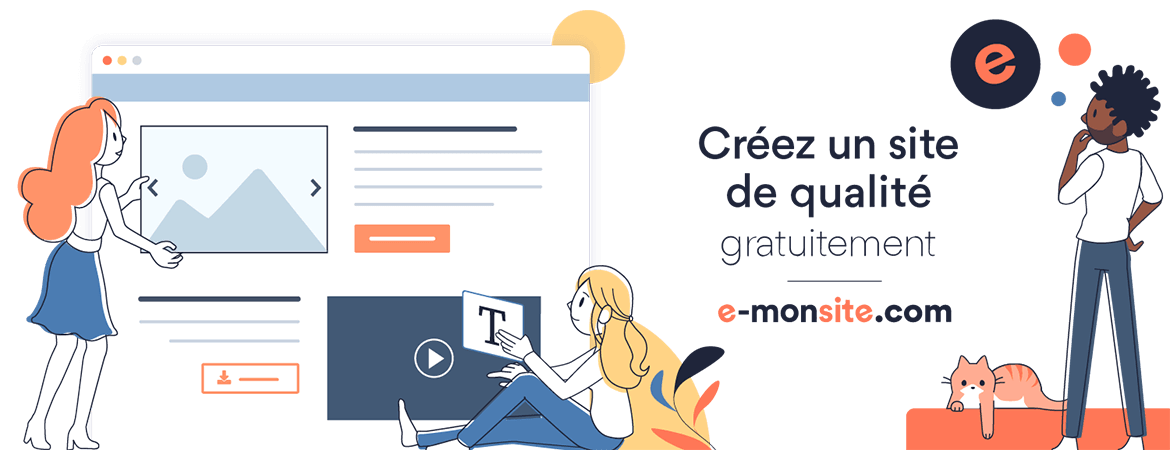- Accueil
- Pages
- Une époque un écrivain un destin
- Gustave Flaubert
Gustave Flaubert
« L’artiste doit s’arranger de façon à faire croire à la postérité qu’il n’a pas vécu »
(à Louise Colet, 27 mars 1852).
1821
Naissance d’un enfant chez les Flaubert, de Rouen : l’aîné, Achille (comme son père, successeur désigné) a déjà huit ans ; deux autres sont morts en bas âge ; le cinquième se présente un 12 décembre à 4 heures du matin. Vivra-t-il ? En attendant de le savoir, on le prénomme Gustave.
« Je suis né à l’hôpital (de Rouen — dont mon père était le chirurgien en chef ; il a laissé un nom illustre dans son art) et j’ai grandi au milieu de toutes les misères humaines — dont un mur me séparait. Tout enfant, j’ai joué dans un amphithéâtre. Voilà pourquoi, peut-être, j’ai les allures à la fois funèbres et cyniques. Je n’aime point la vie et je n’ai point peur de la mort » (à Mlle Leroyer de Chantepie, 30 mars 1857).
« Quels étranges souvenirs j’ai en ce genre ! L’amphithéâtre de l’Hôtel-Dieu donnait sur notre jardin. Que de fois, avec ma sœur, n’avons-nous pas grimpé au treillage et, suspendus entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés ! Le soleil donnait dessus : les mêmes mouches qui voltigeaient sur nous et sur les fleurs allaient s’abattre là, revenaient, bourdonnaient ! [...] Je vois encore mon père levant la tête de dessus sa dissection et nous disant de nous en aller. Autre cadavre aussi, lui. » (à Louise Colet, 7 juillet 1853).
Le père Flaubert a trente-sept ans ; la mère, Justine-Caroline née Fleuriot, vingt-huit : elle descend d’une Cambremer de Croixmare, que la nièce de Flaubert confondra avec l’illustre famille du même nom. Flaubert crut-il au sang bleu du côté maternel ? Bouvard et Pécuchet retrouveront trace de l’ascendance de leur auteur : « L’arbre généalogique de la famille Croixmare occupait seul tout le revers de la porte » (Bouvard et Pécuchet, chap. 4). Voilà pour la famille apparente, celle qui lui fait écrire, à vingt-six ans : « Je ne peux pas m’empêcher de garder une rancune éternelle à ceux qui m’ont mis au monde et qui m’y retiennent, ce qui est pire » (à Louise Colet, 21 janvier 1847).
Quant à la famille réelle, généalogie de l’imaginaire : « Malgré le sang de mes ancêtres (que j’ignore complètement et qui sans doute étaient de fort honnêtes gens ?), je crois qu’il y a en moi du Tartare, et du Scythe, du Bédouin, de la Peau-Rouge. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il y a du moine » (à Louise Colet, 14 décembre 1853). Ce 12 décembre 1821, tout au plus fit-il semblant de naître pour la première fois et de venir au monde, alors qu’il y revenait : « J’ai vécu partout par là [en Grèce], moi, sans doute, dans quelque existence antérieure. — Je suis sûr d’avoir été, sous l’empire romain, directeur de quelque troupe de comédiens ambulants, un de ces drôles qui allaient en Sicile acheter des femmes pour en faire des comédiennes, et qui étaient, tout ensemble, professeur, maquereau et artiste » (à la même, 4 septembre 1852).

1824
Naissance de Caroline, sœur aimée, compagne de jeu, partenaire au théâtre, dans les pièces démarquées du répertoire que Gustave monte sur le billard (table de jeu).
1825
Julie entre au service des Flaubert, comme nourrice, puis domestique. Elle y restera cinquante ans : c’est la mesure du temps provincial : le « demi-siècle de servitude » de Catherine Leroux décorée dans Madame Bovary, le « demi-siècle » de dévouement de Félicité, dans Un cœur simple, hommage à Julie. Elle materne Gustave jusqu’à sa mort : « Je satisfais mes besoins de tendresse en appelant Julie après mon dîner, et je regarde sa vieille robe à damiers noirs qu’a portée maman » (à sa nièce, 18 janvier 1879). Elle survivra trois ans à Flaubert.
1829
Début de l’amitié avec Ernest Chevalier. « Je suis dévoré d’impatience de voir le meilleur de mes amis celui avec lequel je serait toujours amis nous nous aimerons, ami qui sera toujours dans mon cœur. Oui ami depuis la naisance jusqua la mort » (1829-1830 ; sic pour les fautes).

1831
À peine sait-il lire qu’il écrit. « Ami je t’en veirait de mes discours politique et constitutionnel libéraux. [...] Je t’en veirait aussi de mes comédie. Si tu veux nous associers pour écrire moi, j’écrirait des comédie et toi tu écriras tes rèves, et comme il y a une dame qui vient chez papa et qui nous contes toujours de bêtises je les écrirait » (à Ernest Chevalier, vers le premier janvier). La Bêtise, le désir de l’écriture en collaboration sur le double pupitre... Ses premiers écrits conservés : un résumé du règne de Louis XIII (« À maman pour sa fête ») et Trois pages d’un Cahier d’Écolier ou Œuvres choisies de Gustave Flaubert comprenant un « Éloge de Corneille » (« Au mon cher compatriote [...]. Pourquoi es-tu né si ce n’est pour abaisser le genre humain ? »), suivi de « La belle explication de la fameuse constipation » : « La constipation est un resserrement du trou merdarum » (pages publiées par Jean Bruneau, Les débuts littéraires de Gustave Flaubert, éd. Armand Colin, 1962, p. 39-41).
1832
Amitié, théâtre, écriture et lecture mêlés : « Je m’en vais commencé une pièce, qui aura pour titre L’amant avare » (à Ernest Chevalier, 15 janvier) « [...] mais non je ferai des Romans que j’ai dans la tête. qui sont la Belle Andalouse le bal masqué. Cardenio. Dorothée. la mauresque le curieux impertinent le mari prudent » (au même, 4 février). Projets inspirés de Don Quichotte,sur lequel Flaubert prend (déjà) des notes. « Quand je m’analyse, je trouve en moi, encore fraîches et avec toutes leurs influences [...] la place [...] [de] Don Quichotte et de mes songeries d’enfant dans le jardin, à côté de la fenêtre de l’amphithéâtre » (à sa mère, 24 novembre 1850). « Je retrouve toutes mes origines dans le livre que je savais par cœur avant de savoir lire, Don Quichotte » (à Louise Colet, 19 juin 1852). 15 mai 1832 : entrée au Collège Royal de Rouen, en classe de huitième.
1833
Voyages familiaux en Normandie, à Nogent, et tourisme à Versailles, Fontainebleau, Paris : Flaubert retient surtout sa sortie au théâtre. « Louis-Philippe est maintenant avec sa famille dans la ville qui vit naître Corneille. Que les hommes sont bêtes, que le peuple est borné... » (à Ernest Chevalier, 11 septembre).
1834
Vacances à Trouville. Une rencontre avant la rencontre de 1836 : « Se baignait alors une dame, oh une jolie dame [...] le lendemain [...] nous avons appris [...] qu’elle était noyée oui noyée, cher Ernest, en moins d’un quart d’heure » (26 août). Premier « fantôme » de Trouville... Embêtement de l’existence : « Si je n’avais dans la tête et au bout de ma plume une reine de France au quinzième siècle, je serais totalement dégoûté de la vie et il y aurait longtemps qu’une balle m’aurait délivré de cette plaisanterie bouffonne qu’on appelle la vie » (à Ernest Chevalier, 29 août).
1835
L’élève Flaubert lance au Collège un journal manuscrit Art et Progrès dont il est le rédacteur-copiste, avec la collaboration d’Ernest Chevalier. Dans le second numéro (le premier n’a pas été retrouvé) on peut lire un « Voyage en enfer », « Une pensée » (d’amour), des « Nouvelles » et une rubrique « Théâtres ». « Je vous apprendrai que tous les professeurs ont lu mon journal ; dans le prochain numéro, je vous donnerai les détails sur cette affaire ». Il n’en eut pas le loisir : le journal disparut, peut-être supprimé par les autorités du Collège. Il lit et écrit par devoir et pour le plaisir, pliant les exercices scolaires, réunis dans Narrations et discours, 1835-1836, à un tempérament très personnel, vibrant surtout au « frisson historique ». Rencontre de Louis Bouilhet, en cinquième.
1836
Pendant les vacances de l’été 36, rencontre d’Élisa Schlesinger, « Madame Maurice », liée à un éditeur de musique allemand. Elle a vingt-six ans, il en a quinze. Coup de foudre ou coup mythique, comme le prétend Jacques-Louis Douchin dans La vie érotique de Flaubert (éd. Carrère, 1984) ? Qu’importe le degré de réalité ou de sincérité de l’amour, seul compte son pouvoir de cristallisation de l’éternel féminin flaubertien et de dissémination imaginaire dans les écrits autobiographiques et dans les deux Éducations. À Louise Colet : « [...] je n’ai eu qu’une passion véritable. Je te l’ai déjà dit. J’avais à peine 15 ans, ça m’a duré jusqu’à 18. Et quand j’ai revu cette femme-là après plusieurs années j’ai eu du mal à la reconnaître. — Je la vois encore quelquefois mais rarement, et je la considère avec l’étonnement que les émigrés ont dû avoir quand ils sont rentrés dans leur château délabré » (8 octobre 1846). On pense, bien sûr, à la dernière rencontre entre Frédéric et Madame Arnoux. L’année où Flaubert écrit cette lettre à sa maîtresse, 1846, les Schlesinger se sont installés à Bade. En 1872 : « Ma vieille Amie, ma vieille Tendresse, / Je ne peux pas voir votre écriture, sans être remué ! [...] J’aimerais tant à vous recevoir chez moi, à vous faire coucher dans la chambre de ma mère. [...] je suis un Vieux. L’avenir pour moi n’a plus de rêves. Mais les jours d’autrefois se représentent comme baignés dans une vapeur d’or. — Sur ce fond lumineux où de chers fantômes me tendent les bras, la figure qui se détache le plus splendidement, c’est la vôtre ! — Oui, la vôtre. O pauvre Trouville " (5 octobre 1872). Élisa devint folle et finit ses jours à l’asile.
Il écrit cette année-là une dizaine de contes et nouvelles historiques, philosophiques ou fantastiques. La peste à Florence traite de la rivalité entre deux frères.
1837
Les contes de cette année semblent tendus vers les œuvres à venir : Rêve d’Enfer, tentation par Satan, Passion et Vertu, histoire d’une femme adultère qui se suicide par le poison, Quidquid volueris, portrait de l’artiste en homme-singe. Surtout, le jeune Flaubert se voit imprimé pour la première fois, dans le Colibri, revue rouennaise qui publie Bibliomanie (12 février) et Une leçon d’histoire naturelle, genre commis (30 mars), petite physiologie dans le goût de l’époque, deux textes sur la pathologie du livre et de l’écriture qui font partie, surtout le second, du contexte élargi de Bouvard et Pécuchet. Résonne pour la première fois dans la Correspondance le rire du Garçon, création collective (avec, entre autres, Alfred Le Poittevin) qui tient de Gargantua, de Prudhomme et d’Ubu.
1838
Flaubert lit Rabelais et Byron, « les deux seuls qui aient écrit dans l’intention de nuire au genre humain et de lui rire à la face », (à Ernest Chevalier, 13 septembre). Rabelais, à qui il consacre une longue dissertation, restera une grande référence pour Flaubert. Rédige un long drame historique romantique, Loys XI, et, en même temps qu’il lit les Confessions, il écrit des textes autobiographiques, Agonies, pensées sceptiques et Mémoires d’un fou, dédiés au « cher Alfred ».
1839
Smarh, « vieux mystère », entre Rêve d’Enfer et La Tentation, met aux prises Satan et Yuk, le dieu du grotesque. Lecture déterminante de Sade. Achille se marie : « Et avec tout cela je m’ennuie, je m’emmerde » (à Ernest Chevalier, 31 mai). Flaubert est exclu de la classe de philosophie pour avoir, avec d’autres, organisé un chahut et refusé de faire un pensum. « Ne crois pas cependant que je sois irrésolu sur le choix d’un état. Je suis bien décidé à n’en faire aucun. [...] Quant à écrire ? je parierais bien que je ne me ferai jamais imprimer ni représenter. [...] Cependant si jamais je prends une part active au monde ce sera comme penseur et comme démoralisateur » (à Ernest Chevalier, 24 février).
1840
Après son bac, qu’il a préparé seul, Flaubert part pour les Pyrénées et la Corse : il rédige son voyage, en cours de route et au retour. De passage à Marseille, le jeune homme de vingt ans, qui a « simplement perdu son pucelage avec la femme de chambre de sa mère » (Goncourt) baise la tenancière de l’hôtel, Eulalie Foucaud Delanglade. Flaubert ne repassera jamais par là sans faire le pèlerinage : « À Marseille je n’ai pas retrouvé cette excellente tétonnière qui m’y a fait goûter de si doux quarts d’heure » (à Alfred Le Poittevin, 15 avril 1845).
Initiation inscrite dans les fragments des Souvenirs, notes et pensées intimes : « Aujourd’hui samedi, — c’était aussi un samedi, certain jour... dans une chambre comme la mienne, basse et pavée de pavés rouges, à la même heure [...] » « Que fais-je ? que ferais-je jamais ? quel est mon avenir ? Au reste peu importe. [...] visite à Gourgaud [son professeur de lettres] [...] je lui communique mes doutes sur ma vocation littéraire, il me réconforte. [...] » « Aujourd’hui mes idées de grand voyage m’ont repris plus que jamais c’est l’Orient toujours. J’étais né pour y vivre » (Souvenirs, notes et pensées intimes, 1840-1841).
1841
Au physique et au moral, le beau jeune homme commence à ressembler à la silhouette que l’on connaît : « Je deviens colossal, monumental, je suis bœuf, sphinx, butor, éléphant, baleine, tout ce qu’il y a de plus énorme, de plus empâté et de plus lourd » (à Ernest Chevalier, 7 juillet). En novembre, s’inscrit à la Faculté de Droit de Paris. Envie « mystique » de se châtrer : « Je suis resté deux ans entiers sans voir de femme » (à Louise Colet, 27 décembre 1852).
1842
C’est à Gourgaud-Dugazon qu’il fait part de ses doutes, de ses résolutions : « Je fais donc mon Droit, c’est-à-dire que j’ai acheté des livres de Droit et pris des inscriptions. Je m’y mettrai dans quelque temps et compte passer mon examen au mois de juillet. [...] Mais ce qui revient chez moi à chaque minute, ce qui m’ôte la plume des mains si je prends des notes, ce qui me dérobe le livre si je lis, c’est mon vieil amour, c’est la même idée fixe : écrire ! [...] J’ai dans la tête trois romans, trois contes de genres tout différents et demandant une manière toute particulière d’être écrits. C’est assez pour pouvoir me prouver à moi-même si j’ai du talent, oui ou non » (22 janvier). Jean Bruneau pense que ces trois textes pourraient être Les Sept fils du derviche,conte oriental, Bouvard et Pécuchet, sous la forme du Sottisier, et Novembre, « ratatouille sentimentale et amoureuse » à laquelle Flaubert travaille depuis 1840 et qu’il achève le 25 octobre 1842. « Si tu as bien écouté Novembre tu as dû deviner mille choses indisables qui expliquent peut-être ce que je suis. Mais cet âge-là est passé. Cette œuvre a été la clôture de ma jeunesse » (à Louise Colet, 2 décembre 1846). Il s’installe à Paris, s’ennuie fort à l’étude du Droit et, comme antidote, il fait le Garçon, lit Montaigne, fréquente les deux sœurs Collier, Henriette et Gertrude (les petites Anglaises dont il fait la connaissance cet été 1842, à Trouville), les Schlesinger et les Pradier (le sculpteur).
1843
Flaubert commence la première Éducation sentimentale.
Il rencontre Maxime Du Camp. Il rate son examen de deuxième année de Droit. Rencontre Hugo chez les Pradier : « J’ai pris plaisir à le contempler de près ; je l’ai regardé avec étonnement, comme une cassette dans laquelle il y aurait des millions et des diamants royaux [...]. C’était là pourtant l’homme qui m’a le plus fait battre le cœur depuis que je suis né » (à sa sœur, 3 décembre).
1844
Fin de la première existence de Flaubert, en janvier 1844, sur la route de Pont-l’Évêque, au fond d’un cabriolet qu’il conduit : il tombe d’une attaque nerveuse (épileptique). « Ma vie active, passionnée, émue, pleine de soubresauts opposés et de sensations multiples, a fini à 22 ans » (à Louise Colet, 31 août 1846). Les crises se reproduisent, illuminantes : « Dans la période d’une seconde un million de pensées, d’images, de combinaisons de toute sorte qui pétaient à la fois dans ma cervelle comme toutes les fusées allumées d’un feu d’artifice » (à Louise Colet, 6 juillet 1852). La maladie n’a pas que des inconvénients : « Ma maladie aura toujours eu l’avantage qu’on me laisse m’occuper comme je l’entends » (à Emmanuel Vasse de Saint-Ouen, janvier 1845), c’est-à-dire de littérature, et plus de Droit. Crise majeure qui permet de sortir des crises : « Pour moi, je suis vraiment assez bien depuis que j’ai consenti à être toujours mal. [...] J’ai dit à la vie pratique un irrévocable adieu » (à Alfred Le Poittevin, 13 mai 1845). L’achat de Croisset, le 21 mai 1844, arrive à temps pour qu’il s’y retranche.
1845
Flaubert achève la première Éducation sentimentale, continuée après la crise. « Ici, l’auteur passe son habit noir et salue la compagnie. Nuit du 7 janvier 1845, une heure du matin ». Sa sœur se marie, le 3 mars ; Gustave est du voyage de noces, avec la famille au grand complet. Flaubert voyage en écrivant : Provence, Italie, Suisse, mais tout ça ne vaut pas l’Orient. À Gênes, voit La Tentation de saint Antoine, de Breughel : « Il a effacé pour moi toute la galerie où il est » (notes de voyage). Il « m’a fait penser à arranger pour le théâtre La Tentation de saint Antoine. Mais cela demanderait un autre gaillard que moi » (à Alfred Le Poittevin, 13 mai). Au retour, analyse le théâtre de Voltaire, scène par scène : « C’est ennuyeux, mais ça pourra m’être utile plus tard » (au même, juillet). Il pense à son conte oriental, en attendant d’y aller voir. Vit dans un grand état de chasteté.
1846
Mort du père Flaubert, le 15 janvier : « Je n’ai aimé qu’un homme comme ami et qu’un autre c’est mon père » (Souvenirs, notes et pensées intimes, vers 1840). On considère souvent le docteur Larivière de Madame Bovary comme un portrait magnifié du père : « L’apparition d’un dieu n’eût pas causé plus d’émoi. [...] Son regard, plus tranchant que ses bistouris, vous descendait droit dans l’âme et désarticulait tout mensonge » (III, 8). En mars, c’est sa sœur qui meurt, laissant une petite fille, née peu après la mort de son grand-père, et baptisée Caroline comme sa mère : Flaubert se chargera de son éducation ; son père, Émile Hamard, devient fou peu après la mort de sa femme.
« Depuis que mon père et ma sœur sont morts je n’ai plus d’ambition. [...] Je ne sais pas même si jamais on imprimera une ligne de moi » (à Louise Colet, 14 octobre).
Autre perte pour Flaubert : l’ami Alfred Le Poittevin, qui se marie : « Es-tu sûr, ô grand homme, de ne pas finir par devenir bourgeois ? Dans tous mes espoirs d’art je t’unissais. C’est ce côté-là qui me fait souffrir » (31 mai).
Rencontre de Louise Colet chez Pradier, début d’une liaison orageuse et d’une correspondance où l’Amour de l’Art tient plus de place que l’amour : « Je ne suis pas fait pour jouir » (8 août). Louise Colet est une poétesse déjà connue, ce qui n’empêche pas Flaubert, onze ans plus jeune, de critiquer sévèrement ses conceptions esthétiques. Il met au point, contre elle semble-t-il, sa méthode de l’impersonnalité. Avertissement, envoyé de Croisset : « Ne viens jamais ici, il nous serait impossible topographiquement parlant de nous réunir » (14 septembre).
1847
Pendant l’hiver, en guise de récréation, Bouilhet et lui font des scénarios : drames, opéras comiques... Il passe l’été à voyager : « J’ai besoin cependant de prendre un peu l’air, de respirer à poitrine plus ouverte et je pars avec Du Camp nous promener sur les grèves de Bretagne, avec de gros souliers, le sac au dos, à pied » (à Ernest Chevalier, 28 avril). Au retour, Flaubert établit les sommaires d’après les notes communes, et ils s’y mettent : « J’écris tous les chapitres impairs, 1, 3, etc. Max tous les pairs. C’est une œuvre, quoique d’une fidélité fort exacte sous le rapport des descriptions, de pure fantaisie et de digressions » (à Louise Colet, octobre). À la même, cinq ans plus tard, alors qu’il est dans la Bovary : « C’est la première chose que j’aie écrite péniblement (je ne sais où cette difficulté de trouver le mot s’arrêtera ; je ne suis pas un inspiré, tant s’en faut) » (3 avril 1852). Un fragment de Par les champs et par les grèves, intitulé « Les pierres de Carnac et l’archéologie celtique » paraîtra en 1858 : dérision de la science qu’on retrouvera, presque dans les mêmes termes, dans Bouvard.
1848
« L’année 1848 a été la plus belle de ma vie, j’avais une fière gaieté, je vous jure, et un joli tempérament ! » (à Mme Brainne, 1er août 1878). Le siècle se casse en deux. Flaubert vient voir l’émeute, avec Bouilhet, « au point de vue de l’art » (Du Camp). « Je ne sais si la forme nouvelle du gouvernement et l’état social qui en résultera sera favorable à l’Art », écrit-il à Louise Colet (mars). Il rompt avec elle, en août. De Du Camp à Louise : « Du jour où vous l’avez connu vous avez essayé de déranger sa vie » (vers janvier 1847) ; « Gustave n’aime pas le sentiment, il en est las, il en est saoul, comme il dit » (21 février 1847). Le 3 avril, Alfred Le Poittevin meurt, en lisant Spinoza. Douleur et méditations larges de Flaubert. Peu après, il commence à rédiger la (première) Tentation de saint Antoine.
« Mon chien est mort hier. Je m’embête de plus en plus (Rouen — Mercredi 23 nov. 1848. 9 heures du soir) ». (Carnet 3, f. 24).
1849
La Tentation de saint Antoine, commencée en mai 1848, est achevée le 12 septembre. Lecture à Bouilhet et Du Camp, pendant 32 heures. Le verdict est sans appel : « Nous pensons qu’il faut jeter cela au feu et n’en jamais reparler ». Flaubert en restera très affecté : « L’histoire de saint Antoine m’a porté un coup grave, je ne le cache pas » (à Louis Bouilhet, 13 mars 1850). Ses amis lui auraient conseillé une cure de désintoxication en prenant « un sujet terre à terre, un de ces incidents dont la vie bourgeoise est pleine », ce qu’il fera après l’Orient. Il s’y embarque, enfin, le 29 octobre, avec Du Camp : « C’était bien là ce vieil Orient, pays des religions et des vastes costumes » (à sa mère, 5 janvier 1850).
1850
Égypte, Palestine, Rhodes, Asie mineure, Constantinople, Grèce... Pendant que Maxime se livre à ses « rages photographiques, », Flaubert se vautre dans les formes et les couleurs, tente de décrire ce qui défie toute représentation littéraire. Il pense aux œuvres à venir : le Dictionnaire des idées reçues et sa préface, un Don Juan, Anubis, un roman flamand : « Il se prépare en moi quelque chose de nouveau, une seconde manière peut-être ? mais d’ici à quelque temps il faut que j’accouche. Il me tarde de connaître ma mesure » (à sa mère, 14 novembre). Nuit avec Kuchuck-Hânem, danse et baisade : « Quant aux coups, ils ont été bons. Le 3e surtout a été féroce, et le dernier sentimental » (à Louis Bouilhet, 13 mars). Attrape la vérole à Beyrouth. Le 5 août, naissance de son futur « disciple » littéraire, Guy de Maupassant, fils de Laure Le Poittevin, sœur d’Alfred.
1851
Retour par la Grèce et par l’Italie, où sa mère est venue le rejoindre. « Eh bien, oui, j’ai vu l’Orient et je n’en suis pas plus avancé, car j’ai envie d’y retourner » (à Ernest Chevalier, 9 avril). Il réagit très violemment au projet matrimonial de son ami Ernest : « Magistrat, il est réactionnaire ; marié, il sera cocu » (à sa mère, 15 décembre 1850). Il renoue avec Louise Colet, peu de temps avant de se mettre à Madame Bovary : « J’ai commencé hier au soir mon roman. J’entrevois maintenant des difficultés de style qui m’épouvantent » (à Louise Colet, 20 septembre). L’humeur assombrie par le coup d’État du 2 décembre, il s’apprête à fêter son anniversaire : « Vendredi prochain j’aurai 30 ans. [...] Il est présumable que je suis au milieu de ma carrière, comme on dit en haut style. — Quand je pense que j’ai encore trente ans à vivre, j’en suis effrayé » (à Henriette Collier, 8 décembre). Il n’en a plus que vingt-neuf.
Voyage à Londres avec sa mère (fin septembre-début octobre).
1852
Il pioche la Bovary : il achève la première partie en juillet. Les rencontres avec Louise Colet, à Mantes, à Paris, sont subordonnées aux échéances de l’écriture. Très préoccupé par les risques de la paternité : « L’idée de donner le jour à quelqu’un me fait horreur. Je me maudirais si j’étais père » (11 décembre). Se ronge de projets : le Dictionnaire et sa préface, et « grand roman métaphysique, fantastique et gueulard » (à Louise Colet, 8 mai), sans doute la Spirale.Refroissement de l’amitié avec Du Camp, codirecteur de la Revue de Paris, qui lui conseille de se pousser un peu : « Arriver ? — à quoi ? [...] Etre connu n’est pas ma principale affaire. [...] Je vise à mieux, à me plaire [...] Que je crève comme un chien plutôt que de hâter d’une seconde ma phrase qui n’est pas mûre » (à Du Camp, 26 juin).
1853
Travaille à la deuxième partie de la Bovary, tout en pensant à l’après : des préfaces à Ronsard (une Histoire du sentiment poétique en France), à Bouilhet, au Dictionnaire. Abandonne définitivement la tentation autobiographique : il n’écrira pas ses Mémoires. Il envoie une belle lettre hugolienne à Victor Hugo, dont il est, avec Louise Colet, la « boîte aux lettres » clandestine : « Monsieur, vous avez été dans ma vie une obsession charmante, un long amour » (15 juillet). Flaubert devient chauve : ça l’embête beaucoup.
1854
La deuxième partie de la Bovary avance : Louise Colet retarde Flaubert en lui donnant à corriger des vers nuls qu’il commente longuement. Nouvelle rupture : Flaubert n’a pas réussi dans son entreprise de conversion de Louise à la religion de l’Art, et de virilisation de son style : « J’ai toujours essayé (mais il me semble que j’échoue) de faire de toi un hermaphrodite sublime. Je te veux homme jusqu’à la hauteur du ventre (en descendant). Tu m’encombres et me troubles et t’abîmes avec l’élément femelle » (12 avril). Liaison avec l’actrice Béatrix Person.
1855
Toujours dans l’encre de la Bovary, qui tourne au pensum : la troisième et dernière partie est bien avancée à la fin de l’année, mais la petite femme n’a toujours pas « son arsenic dans le ventre » quand Flaubert s’installe à Paris, 42, boulevard du Temple, où il passera quelques mois chaque hiver. Le 6 mars, il envoie en post-scriptum de la rupture un dernier billet à Louise : « J’ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir, hier, dans la soirée, trois fois, chez moi. Je n’y étais pas. [...] le savoir-vivre m’engage à vous prévenir : que je n’y serai jamais ». Sur ce billet, Louise a écrit : « Allée le 5 mars 1855 — lâche, couard et canaille ». La mère de Flaubert a un « mot sublime » qu’il cite à Bouilhet : « La rage des phrases t’a desséché le cœur » (27 juin).
1856
Achèvement de Madame Bovary, en avril : quatre ans et demi de travail, trois mille huit cent trente-et-un feuillets noircis, à une vitesse moyenne de quatre à cinq jours par page imprimée et dix pages de brouillons pour une mise au net. Pour se décrasser de la bêtise bourgeoise, il prépare la Légende de saint Julien (qu’il n’écrira que vingt ans plus tard) et corrige (c’est-à-dire condense) la Tentation : « Je pourrais donc en 1857 fournir du Moderne, du Moyen Âge et de l’Antiquité » (à Louis Bouilhet, 1er juin). Madame Bovary paraît en six livraisons dans la Revue de Paris, d’octobre à décembre, avec des coupures (toute la scène du fiacre) contre lesquels Flaubert proteste publiquement. L’Artiste publie des fragments de la Tentation (décembre 56 - février 57). L’année se termine par des bruits de poursuite judiciaire : « on m’accuse [...] « d’avoir attenté aux bonnes mœurs, et à la religion ». [...] qu’on me laisse exercer tranquillement ma petite littérature » (à Edmond Pagnerre, 31 décembre).
1857
Le procès a lieu le 29 janvier. L’avocat impérial Pinard, moins stupide qu’on ne le dit, incrimine la « couleur sensuelle » du roman et la « beauté de provocation » d’Emma. Maître Sénard, ami de la famille Flaubert, plaide la moralité et l’utilité. Flaubert est acquitté le 7 février, en partie grâce à des appuis en « haut lieu », mais blâmé par les termes du jugement, qui lui rappelle que « la mission de la littérature doit être d’orner et de récréer l’esprit en élevant l’intelligence et en épurant les mœurs ». Le roman, publié en volume au mois d’avril, obtient un important succès de scandale (quinze mille exemplaires en juin) qui agace Flaubert : tout ce tapage est étranger à l’Art. Il restera pour sa vie, et au-delà, l’auteur de Madame Bovary, la référence dont s’autorisent les critiques pour déprécier ses autres livres : « La Bovary m’embête. On me scieavec ce livre-là. Car tout ce que j’ai fait depuis n’existe pas » (à Georges Charpentier, 16 février 1879). Après la bêtise moderne, la barbarie antique : Flaubert se met à un « roman carthaginois », avec une nouvelle méthode d’écriture : il entasse préalablement « bouquins sur bouquins, notes sur notes » (à Ernest Feydeau, 25 mai) pour « ressusciter toute une civilisation sur laquelle on n’a rien ! » (au même, 24(?) novembre).
« Ajoutez ceci pour avoir mon portrait et ma biographie complètes : que j’ai trente-cinq ans, je suis haut de cinq pieds huit pouces, j’ai des épaules de portefaix et une irritabilité nerveuse de petite maîtresse. Je suis célibataire et solitaire » (à Mlle Leroyer de Chantepie, 18 mars).
1858
Vie « mondaine » à Paris, où il se « regarde désormais comme étant convié [aux] festins dominicaux » de la Présidente, Madame Sabatier. Il rencontre un petit clan d’écrivains : les Goncourt, Sainte-Beuve, Baudelaire, Gautier, Renan, Feydeau. Pour confronter le premier chapitre de son roman au terrain et pour se retremper dans l’Orient, Flaubert fait un voyage en Algérie et à Carthage (avril-juin). « Je pars ce soir à cinq heures pour Bizerte, en caravane et à mulet ; à peine si j’ai le temps de prendre des notes » (à Ernest Feydeau, 8 mai). Au retour, il repasse à l’encre ses notes de voyage, et démolit son premier chapitre : « C’était absurde ! impossible ! faux ! » (au même, 20 juin). Il a aligné trois chapitres à la fin de l’année, avec la conscience de plus en plus paralysante de l’impossibilité de la littérature.
1859
Rédaction des chapitres IV et VI de Salammbô : à la fin de l’année, il entre enfin « dans le temple du Moloch » (à Ernest Feydeau, 22 novembre). Seul divertissement : la lecture de Lui,roman à clés de Louise Colet dont il est l’anti-héros.
1860
Salammbô : chapitres VII à X. « Je suis présentement accablé de fatigue ! je porte sur les épaules deux armées entières, 30 mille hommes d’un côté, onze mille de l’autre, sans compter les éléphants avec leurs éléphantarques, les goujats et les bagages ! » (à Amélie Bosquet, 11 ? juillet).
1861
Flaubert s’enferme de plus en plus à Croisset et dans Salammbô : rédige les chapitres XI à XIV : « Je finis maintenant le siège de Carthage, et je vais arriver à la grillade des moutards » (à Jules Duplan, 25 septembre). Entre-temps, il a régalé les Goncourt, invités à Croisset : « Voici le programme : 1º Je commencerai à hurler à 4 heures juste. — Donc venez vers 3 ; 2º À 7 heures, dîner oriental. On vous y servira de la chair humaine, des cervelles de bourgeois et des clitoris de tigresse sautés au beurre de rhinocéros ; 3º Après le café, reprise de la gueulade punique jusqu’à la crevaison des auditeurs. Ça vous va-t-il ? » (début mai).
1862
« J’ai enfin terminé, dimanche dernier, à sept heures du matin, mon roman de Salammb » (à Mlle Leroyer de Chantepie, 24 avril). Cinq ans de travail. Publié le 24 novembre, le livre se vend à mille exemplaires par jour : la mode carthaginoise est lancée. Flaubert répond aux critiques de Sainte-Beuve et de Froehner, portant sur la documentation archéologique. Aussitôt les épreuves corrigées, Flaubert songe à écrire une féerie pour le théâtre : « Je rêvasse une pièce passionnée où le fantastique soit au bout » (à Jules Duplan, 15 juin).
1863
Un article élogieux de George Sand sur Salammb (ils ne furent pas nombreux) marque le début de l’amitié et de la correspondance entre les deux écrivains : la tendresse réciproque triomphe des désaccords esthétiques et politiques. En février, au dîner Magny créé par Sainte-Beuve fin 62, il fait la connaissance de Tourgueneff, le « moscove », le « bon géant », l’un des seuls hommes à l’émouvoir, avec son domestique. Il y rencontre également Taine; le 22 mai, il va pour la première fois chez la Princesse Mathilde, cousine de Napoléon III. Hésite entre deux plans de livres qu’il confectionne simultanément : un roman parisien et l’histoire de deux cloportes (Bouvard et Pécuchet) : « L’Éducation sentimentale en reste là. [...] Bref, ça me dégoûte. Il est fort probable que je vais me rabattre sur Les Deux Cloportes. C’est une vieille idée que j’ai depuis des années et dont il faut peut-être que je me débarrasse ? » (à Jules Duplan, 15 avril). En attendant de se décider, il se récrée avec une « féerie », Le Château des cœurs, à laquelle il travaille pendant l’été avec Bouilhet et d’Osmoy, et qu’il termine seul, à la fin de l’année. Féerie bouffonne, en avance sur Méliès et les surréalistes, où les mots deviennent choses. Flaubert essaiera de la faire jouer pendant les dix ans qui suivent, pour se résigner à la publication, l’année de sa mort.
1864
La nièce de Flaubert, Caroline, se marie le 6 avril à un marchand de bois, Ernest Commanville. « Les époux doivent être demain à Milan. Je viens de passer une semaine peu gaie, mon bonhomme ! » (à Ernest Feydeau, 10 avril). Flaubert se décide pour le roman moderne : il voyage, l’été, pour repérer les sites (Montereau, Nogent), après avoir fait le plan avec Bouilhet. Il se met à la rédaction le 1er septembre : « Me voilà maintenant attelé depuis un mois à un roman de mœurs modernes qui se passera à Paris. Je veux faire l’histoire morale des hommes de ma génération ; « sentimentale » serait plus vrai. C’est un livre d’amour, de passion ; mais de passion telle qu’elle peut exister maintenant, c’est-à-dire inactive » (à Mlle Leroyer de Chantepie, 6 octobre). On voit sa silhouette de géant chez la Princesse Mathilde, aux Tuileries, à Compiègne, au Palais-Royal.
1865
Flaubert achève la première partie de son roman, dont le sujet ne lui plaît guère. Il se rend à Londres, puis à Bade, où séjourne Maxime Du Camp : peut-être y revoit-il Élisa Schlesinger.

1866
En juillet, il retrouve, à Londres, Juliet Herbert, jeune Anglaise qui avait été la gouvernante de la nièce à partir de 1853, et la maîtresse de l’oncle vers 1856. Le 16 août, il vient de recevoir la croix d’honneur... et cependant, il écrit aux Goncourt : « J’ai la tête forte et je consentirai encore à vous saluer ». George Sand fait deux séjours à Croisset, fin août et début novembre. « Mon roman va très mal pour le quart d’heure. [...] Ah ! je les aurai connues, les Affres du Style ! » (à Sand, 27 novembre). Il travaille à la seconde partie, rongé de doute.
1867
Se documente, par lettres et sur le terrain, pour l’Éducation : la Bourse, les faïences, les courses, le menu que l’on servait en 1847 au Café Anglais... « Quelle lourde charrette de moellons à traîner ! » (à George Sand, 12 juin). Va visiter des faïenceries : « J’arrive à l’instant de Creil et de Montataire où j’ai pris des notes sous la pluie pendant 2 heures » (à sa nièce, 13 mai). À Amélie Bosquet : « Il est inutile que je vous ennuie de mes jérémiades ; mais je suis terriblement inquiet de ce livre. Sa conception me paraît vicieuse ? » (22 septembre). Peut-être revoit-il Élisa Schlesinger en mars. Invité à la grande réception des Tuileries, le 10 juin : « Les Souverains désirant me voir comme une des plus splendides curiosités de la France... » (à sa nièce, 7 juin).
1868
Visite à « l’hôpital Sainte-Eugénie pour voir des enfants qui avaient le croup. (C’est abominable et j’en sortais navré. Mais l’art avant tout !) [...] Je me livre aussi à pas mal de courses pour avoir des renseignements sur 48. Et j’ai bien du mal à emboîter mes personnages dans les événements politiques. Les fonds emportent mes premiers plans » (à sa nièce, 9 mars). Excursion à Fontainebleau, pour les besoins du roman. Flaubert travaille à la troisième partie. « J’ai lâché complètement le dîner Magny, où l’on a intercalé des binettes odieuses. Mais tous les mercredis je dîne chez la Princesse, avec les Bichons [les Goncourt] et Théo [Gautier] » (à Jules Duplan, 14 mars). Reçoit à Croisset George Sand en mai et Tourgueneff en novembre.
1869
16 mai 1869 : « Dimanche matin, 5 heures moins 4 minutes. / FINI ! mon vieux ! — Oui, mon bouquin est fini ! [...] Je suis à ma table, depuis hier, 8 heures du matin. — La tête me pète. N’importe ! J’ai un fier poids de moins sur l’estomac » (à Jules Duplan). Cinq ans de travail, deux mille trois cent cinquante cinq feuillets. Lecture publique du roman chez la Princesse : seize heures en quatre séances. Fin mai, Flaubert quitte le boulevard du Temple et s’installe 4, rue Murillo. Aussitôt rentré à Croisset, en juin, il se remet à la Tentation : « J’ai repris une vieille toquade, un livre que j’ai déjà écrit deux fois et que je veux refaire à neuf » (à la Princesse Mathilde, 8 juillet). Le 18 juillet, son vieil ami Louis Bouilhet meurt : Flaubert enterre la meilleure moitié de lui-même : « ma conscience littéraire, mon jugement, ma boussole, mon accoucheur ». Le 13 octobre, c’est au tour de Sainte-Beuve. "J’avais fait L’Éducation sentimentale, en partie pour Sainte-Beuve. Il sera mort sans en connaître une ligne ! Bouilhet n’en a pas entendu les deux derniers chapitres. Voilà nos projets ! L’année 1869 aura été dure pour moi ! — Je vais donc encore me trimbaler dans les cimetières ! » (à sa nièce, 14 octobre).
Le livre paraît le 17 novembre : la critique est très mauvaise. Cinq ans plus tard, Flaubert en a conservé le souvenir : « Le grand succès m’a quitté depuis Salammbô. Ce qui me reste sur le cœur, c’est l’échec de L’Éducation sentimentale. Qu’on n’ait pas compris ce livre-là, voilà ce qui m’étonne » (à Tourgueneff, 2 juillet 1874). Se réconforte en passant les fêtes de Noël à Nohant, chez George Sand.
1870
En hommage à Bouilhet, Flaubert commence à retravailler une pièce trouvée dans les papiers du défunt, Le Sexe faible, s’occupe des répétitions de Mademoiselle Aïssé, écrit une Préface aux « Derniers chansons », datée 20 juin 1870, le jour même de la mort de Jules de Goncourt, trois mois après Jules Duplan.
« [...] j’ai la tête pleine d’enterrements, je suis gorgé de cercueils, comme un vieux cimetière. — La vie solitaire que je mène n’est pas faite pour me distraire, je n’ai plus personne avec qui parler » (à Mme Roger des Genettes, 23 juin).
Travaille à La Tentation, sans y croire : la guerre met le comble au chagrin, surtout quand Croisset est occupé par quarante Prussiens, obligeant Flaubert et sa vieille mère à se réfugier à Rouen.
1871
Flaubert rend visite à la Princesse Mathilde, exilée à Bruxelles, et à Juliet Herbert, en passant par Londres (mars). Après le départ des Prussiens, il retrouve Croisset à peu près intact et déterre ses notes, enfouies par prudence dans une grande boîte. « Pour ne plus songer aux misères publiques et aux miennes, je me suis replongé avec furie dans saint Antoine » (à George Sand, 30 avril). Élisa Schlesinger vient à Croisset en novembre : son mari est mort depuis mai. Flaubert envoie des billets très tendres à une jeune veuve, Léonie Brainne, qui sera l’amie intime des dernières années de sa vie.
1872
Célébration du souvenir de Bouilhet : Flaubert publie dans Le Temps (26 janvier) une cinglante Lettre à la municipalité de Rouen, laquelle a refusé un emplacement pour un buste de Bouilhet ; se remet au scénario du Sexe faible, fait imprimer Mademoiselle Aïssé, qui n’a pas eu de succès sur la scène, et les Dernières chansons, avec sa préface, la seule que Flaubert écrira (20 janvier). À propos des frais d’impressions de ce recueil, Flaubert se « fâche à mort » avec son éditeur Michel Lévy : c’est Charpentier qui prend la suite. La mort réduit encore le cercle autour de Flaubert : sa mère disparaît le 6 avril. « Je me suis aperçu, depuis 15 jours, que ma pauvre bonne femme de maman était l’être que j’ai le plus aimé. C’est comme si l’on m’avait arraché une partie des entrailles » (à George Sand, 16 avril). Croisset revient à Caroline ; Flaubert y conserve son appartement. Le 22 octobre, Gautier meurt, « d’une suffocation trop longue causée par la bêtise moderne » (à sa nièce, 25 octobre). Flaubert se retrouve de plus en plus seul, sur le radeau de la Méduse des naufragés de l’Art. Au milieu de ses chagrins, il achève La Tentation de saint Antoine (1er juillet) dédié « À la mémoire de mon ami Alfred Le Poittevin » : « C’est l’œuvre de toute ma vie » (à Mlle Leroyer de Chantepie, 5 juin). Après un séjour à Luchon, il s’embarque, sans retour, dans une autre œuvre de toute sa vie, Bouvard et Pécuchet : « C’est l’histoire de ces deux bonshommes qui copient, une espèce d’encyclopédie critique en farce » (à Mme Roger des Genettes, 19 août). Il reprend le plan de 1863, le modifie. Dernière lettre (connue) à Élisa Schlesinger (5 octobre) :« Adieu, et toujours à vous ».
1873
Malade en début d’année, Flaubert va se refaire une santé à Nohant avec Tourgueneff (avril). Tout en continuant ses effrayantes lectures pour Bouvard (mille cinq cents livres au total) et ses excursions à la recherche d’un paysage (Brie et Beauce en août), il achève le Sexe faible (fin juillet) auquel il travaille par intermittence depuis 70. Mis « en veine dramatique », il rédige le plan d’« une grande comédie politique » que le directeur du théâtre préfère au Sexe faible(finalement jamais représenté) : « En admettant que Le Candidat soit réussi, jamais aucun gouvernement ne voudra le laisser jouer parce que j’y roule dans la fange tous les partis. Cette considération m’excite. Tel est mon caractère » (à Mme Régnier, juillet-août). Le 29 octobre, mort de Feydeau : « Tant mieux pour lui, du reste » (à Mme Régnier, 30 octobre).
Première lettre à Guy de Maupassant, datée 20 juin 1873.
1874
Le Candidat, représenté le 11 mars, est un four ; résigné au « silence du cabinet », Flaubert retire sa pièce au bout de quatre représentations. L’accueil réservé à La Tentation de saint Antoine, qui paraît le 31 mars, n’est pas fait pour le réconforter. En juin, il fait avec Edmond Laporte un voyage en Normandie : « Je placerai Bouvard et Pécuchet entre la vallée de l’Orne et la vallée d’Auge, sur un plateau stupide » (à sa nièce, 24 juin). Un mois de cure en Suisse, sur ordre médical, pour tenter de se refaire le tempérament, et le samedi 1er août (Flaubert passe souvent aux phrases le premier du mois), malgré la peur, il écrit l’incipit de Bouvard :« Comme il faisait, etc... ».
1875
Flaubert ne va pas fort, au physique et au moral : « Mon affaissement psychique doit tenir à quelque cause cachée ? Je me sens vieux, usé, écœuré de tout. [...] Je n’attends plus rien de la vie qu’une suite de feuilles de papier à barbouiller de noir. Il me semble que je traverse une solitude sans fin, pour aller je ne sais où, et c’est moi qui suis tout à la fois le désert, le voyageur, et le chameau ! » (à George Sand, 27 mars). Là-dessus arrive la ruine de Commanville : pour éviter la faillite, Flaubert vend une ferme à Deauville, quitte son appartement parisien. Il abandonne, définitivement croit-il, la rédaction de Bouvard, trop difficile, au milieu du chapitre III, en pleine médecine. À Concarneau où il séjourne en septembre, pour se reposer, sans « papier ni plumes » par précaution, il trouve tout de même de quoi écrire pour commencer La Légende de saint Julien l’Hospitalier, une « petite bêtise moyenâgeuse » qu’il termine en février 1876.

1876
Flaubert apprend par hasard la mort de Louise Colet (8 mars) : « Cette nouvelle m’émeut de toutes façons. Vous devez me comprendre » (à Jules Troubat, 10 mars). Son souvenir le reporte en arrière, encore plus loin quand il fait un voyage à Pont-l’Évêque et Honfleur pour Un cœur simple (rédigé de février à août) : « Cette excursion m’a abreuvé de tristesse, car forcément j’y ai pris un bain de souvenirs. Suis-je vieux, mon Dieu ! Suis-je vieux ! » (à Mme Roger des Genettes, 20 avril). Comme Sainte-Beuve avant la publication de L’Éducation, la destinatrice meurt trop tôt : George Sand s’éteint le 8 juin. « J’avais commencé Un cœur simple à son intention exclusive, uniquement pour lui plaire. Elle est morte, comme j’étais au milieu de mon œuvre. Il en est ainsi de tous nos rêves » (à Maurice Sand, 29 août 1877). Enchaîne aussitôt avec le troisième conte : « Maintenant que j’en ai fini avec Félicité, Hérodiasse présente et je vois (nettement, comme je vois la Seine) la surface de la mer Morte scintiller au soleil » (à sa nièce, 17 août).
1877
Hérodias est achevé en février : Trois Contes (Moderne, Moyen Age, Antiquité) paraît d’abord en feuilleton avant d’être publié en volume (24 avril). Le livre est bien accueilli. En mars, Flaubert reprend son testament, Bouvard. Pour les besoins des chapitres III et IV, il fait avec Laporte un voyage géologique et archéologique en Basse Normandie (septembre). Se soutient le moral avec des projets pour après : La Bataille des Thermopyles, Monsieur le Préfet.
1878
Histoire, littérature, politique, amour, philosophie pour les chapitres IV à VIII de Bouvard : Flaubert finit l’année « perdu dans la métaphysique et la religion. [...] Il y aurait de quoi me conduire à Charenton si je n’avais pas la tête forte. D’ailleurs, c’est mon but (secret) : ahurir tellement le lecteur qu’il en devienne fou » (à Mme Brainne, nuit de lundi, 30 décembre).
1879
En glissant sur une plaque de verglas, Flaubert se fracture le péroné. À ces ennuis, s’ajoutent les difficultés financières : il est contraint d’accepter, la mort dans l’âme, une pension de trois mille francs par an sans obligation de service, accordée par Jules Ferry. Il se relève juste pour la Saint-Polycarpe, que ses amis lui souhaitent solennellement (27 avril). Depuis plusieurs années, après 70 surtout (mais il le cite déjà dans une lettre à Louise Colet de 53), Flaubert, alias aussi Cruchard, a pris pour pseudonyme le nom de ce saint qui avait coutume de répéter : « Dans quel siècle, mon Dieu, m’avez-vous fait naître ». Bouvard et Pécuchet avance peu : Flaubert se débat dans des matières anti-plastiques : la philosophie (fin du chapitre VIII) et la religion (IX).
1880
Travaille au dernier chapitre du premier volume de Bouvard : l’éducation. Mais son roman, selon son mot, l’achève avant qu’il (Flaubert) ne l’achève. Il lui manque, pense-t-il, encore six mois pour terminer le second volume, presque exclusivement fait de citations. Sa dernière joie littéraire fut peut-être la lecture de Boule de Suif, nouvelle de Maupassant, qu’il a formé à la rude école du style. Alors qu’il se préparait à partir pour Paris, il meurt d’une attaque cérébrale, le 8 mai, laissant sur sa table Bouvard et Pécuchet inachevé, peut-être secrètement inachevable. Il a vécu vingt-et-un mille trois-cent-trente-sept jours, et noirci autant de feuilles de papier. Il voulait être enterré avec ses manuscrits, comme un barbare avec son cheval, mais il n’y avait pas la place pour deux.
publié le chez Michel Lévy frères.
Le cœur du récit est lui-même tiré du roman de Sainte-Beuve, Volupté, qu’Honoré de Balzac avait déjà traité et d’une certaine manière réécrit avec le Lys dans la vallée. Le roman de Flaubert reprend le même sujet selon des règles narratives entièrement neuves, réinventant le roman d'apprentissage pour lui donner une profondeur et une acuité nouvelle. Malgré la critique négative lors de sa parution, il est devenu, depuis Marcel Proust, un livre de référence pour les romanciers du xxe siècle.
L'Éducation sentimentale est le fruit de trois essais de jeunesse de Flaubert. Ainsi de à il produit une première Éducation sentimentale qui succédait à la rédaction de Novembre, achevé le , et à une toute première ébauche de jeunesse intitulée Mémoires d'un fouen 18382. Le roman définitif est rédigé à partir de et achevé le au matin.
L'Éducation sentimentale comporte de nombreux éléments autobiographiques, tels la rencontre de madame Arnoux, inspirée de la rencontre de Flaubert avec Élisa Schlésinger, l'amour de sa vie. Le personnage principal est Frédéric Moreau, jeune provincial de dix-huit ans venant faire ses études à Paris. De 1840 à 1867, celui-ci connaîtra l’amitié indéfectible et la force de la bêtise, l’art, la politique, les révolutions d’un monde qui hésite entre la monarchie, la république et l’empire. Plusieurs femmes (Rosanette, Mme Dambreuse) traversent son existence, mais aucune ne peut se comparer à Marie Arnoux, épouse d’un riche marchand d’art, dont il est éperdument amoureux. C’est au contact de cette passion inactive et des contingences du monde qu’il fera son éducation sentimentale, qui se résumera pour l’essentiel à brûler, peu à peu, ses illusions.
Le personnage de Frédéric, sans doute inspiré à Flaubert par ses propres expériences de jeunesse, est aussi la figure définitive d'une génération nourrie par le courant d'idées romantique le plus large. Ainsi, en même temps que Frédéric exalte la pureté de son amour pour madame Arnoux, celle-ci l'empêche de choisir la moindre situation dans une société, d'abord influencée par la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, puis par la deuxième République et enfin par le Second Empire, et qui mise beaucoup sur la carrière et l'idée de parvenir. Selon Marthe Robert, Frédéric est le « Bâtard moyen », plein de rêves qui le détournent de l'action, en opposition avec le Bâtard de l'époque de Napoléon, où conquérir le pouvoir était à la portée de toute volonté, immortalisé par Balzac avec le personnage de Rastignac.
Les différents personnages que côtoie Frédéric sont eux aussi autant de types d'un genre nouveau, représentant chacun les idées reçues d'un milieu bien défini et agissant en fonction des codes sociologiques stéréotypés. On retrouve ainsi le bourgeois parvenu en Jacques Arnoux, la bourgeoisie d'affaires avec le ménage Dambreuse, le petit bourgeois rêvant de pouvoir dans le personnage de Deslauriers, ami de collège de Frédéric, la courtisane avec Rosanette… Cette diversité permet la peinture de la fin de la Monarchie de Juillet à Paris. Pierre Bourdieu a vu ce roman comme un champ d'expérimentation sociologique. Ce point de vue permet de voir Flaubert comme l'un des phares du réalisme.
Justement parce que Flaubert cherche à pointer les idées toutes faites de chaque milieu, L'Éducation sentimentale est aussi traversé par l'ironie : le narrateur se refuse à intervenir directement, et se borne à chercher la connivence avec le lecteur par de discrètes allusions à un cliché, ou grâce au style indirect libre si souvent analysé. Les opinions des personnages se trouvent ainsi discréditées par leur propre attitude ou par la description objective de ce qu'ils ne voient qu'à travers le filtre de leurs préjugés. Les quelques mots de Frédéric, au terme de la description peu amène du pillage des Tuileries par le peuple en , en offrent un exemple marquant : le narrateur dépeint les ivrognes et les brutes, les blessés s'entassant dans les pièces dévastées. « N'importe, dit Frédéric, moi, je trouve le peuple sublime ». Il ne fait que nier la réalité au profit de ses présupposés romantiques.
Moins connu que Madame Bovary, L'Éducation sentimentale est cependant un roman complet au style pleinement maîtrisé, et où le monde construit méticuleusement est celui qu'il connaît d'expérience. La fresque ainsi créée est à la fois un bilan du romantisme et le tableau précis d'une époque, faisant de Flaubert l'initiateur spirituel du naturalisme. Maupassant et Émile Zola le considèreront d'ailleurs comme leur maître.
Sources: pour en savoir plus Wilkipédia
Gustave Flaubert (1862)
Salammbô, La Tentation de Saint Antoine sont comme l’aboutissement de ce rêve d’Orient qui obséda Gustave Flaubert toute sa vie. Ils sont tout le romantisme de Flaubert et ils le caractérisent. Le romantisme de Flaubert consistait à évoquer de grands paysages ou la documentation avait une part, les souvenirs une autre et le rêve une autre encore et la principale. Il y a des paysages d’Orient antique dans sa correspondance, de très bonne heure, dès 1851 :
« J’ai passé trois fois par Éleusis. Au bord du golfe de Corinthe, j’ai songé avec mélancolie aux créatures antiques qui ont baigné dans ces flots bleus leurs corps et leurs chevelures. Le port de Phalère a la forme d’un cirque. C’est bien là qu’arrivaient les galères à proue chargées de choses merveilleuses, vases et courtisanes. La nature avait tout fait pour ces gens-là, langue, paysage, anatomies et soleils ; jusqu’à la forme des montagnes qui est comme sculptée et a des lignes architecturales plus que partout ailleurs. Avoir choisi Delphes pour y mettre la Pythie est un coup de génie. C’est un paysage à terreurs religieuses, vallée étroite entre deux montagnes presque à pic, le fond plein d’oliviers noirs, les montagnes rouges et vertes, le tout garni de précipices, avec la mer au fond et un horizon de montagnes couvertes de neige. La route de Mégare à Corinthe est incomparable : le sentier taillé à même la montagne, à peine assez large pour que votre cheval y tienne à pic sur la mer, serpente, monte, descend, grimpe et se tord aux flancs de la roche couverte de sapins et de lentisques. D’en bas vous monte aux narines l’odeur de la mer ; elle est sous vous, elle berce ses varechs et bruit à peine ; il y a sur elle, de place en place, de grandes plaques livides comme des morceaux allongés de marbre vert, et derrière le golfe s’en vont à l’infini mille découpures des montagnes oblongues à tournures nonchalantes. En passant devant les roches scirroniennes où se tenait Scirron, brigand tué par Thésée, je me suis rappelé le vers du doux Racine : “Reste impur des brigands dont j’ai purgé la terre.”
Était-ce couenne, l’antiquité de tous ces braves gens-là ! Il n’y a qu’à voir au Parthénon, pouvant, les restes de ce qu’on appelle le type du beau. S’il y a jamais eu au monde quelque chose de plus vigoureux et de plus “nature”, que je sois pendu ! Dans les tablettes de Phidias les veines des chevaux sont indiquées jusqu’au sabot et saillantes comme des cordes. Quant aux ornements étrangers, peintures, colliers en métal, pierres précieuses, etc., c’était prodigué. Ça pouvait être simple, mais en tous cas c’était riche. »
Toute l’inspiration première de Salammbô et même de la Tentation est dans cette page : goût de l’Orient et de l’Orient antique, besoin de l’évoquer et de le faire revivre, sentiment profond de la couleur, du relief et des senteurs, goût des splendeurs et du faste descriptif, goût du mystérieux et de l’horreur sacrée des religions antiques, souci du détail matériel très précis et très accusé et très exact au milieu même de l’éclat et des reluisances, mépris de ceux qui ont simplifié et adouci tout cela, au lieu de le surcharger de couleurs, de « richesses » et d’ornements. L’imagination de Flaubert à la fois comprend l’Orient antique et le refait plus somptueux, plus ruisselant de lumières, plus aveuglant, plus encombré d’un « luxe barbare », comme dit Virgile, que sans doute il n’a été. C’est l’antiquité vue par Lecomte de l’Isle, qui, après tout, peut-être la voit Bien ; mais enfin c’est tout à fait l’antiquité des Romantiques ; c’est Salammbô. Salammbô vivait dans le cerveau de Flaubert dès 1851.
Voyez encore comme il parle du romantisme comme étant son fond même et sa « nature ». Il est vrai que c’est au moment où il écrit Madame Bovary et il n’a jamais de démangeaison romantique plus vive que quand il écrit un livre réaliste ; mais enfin voyez ce qu’il en dit : « Ce qui m’est naturel à moi, c’est le non naturel pour les autres, l’extraordinaire, le fantastique, la hurlade philosophique, mythologique. Saint Antoine ne m’a pas demandé le quart de la tension d’esprit que Bovary me cause ; c’était un déversoir ; je n’ai eu que plaisir à écrire et les dix-huit mois que j’ai passés à en écrire les cinq cents pages ont été les plus profondément voluptueux de ma vie. »
Et il redouble et renchérit en ce sens : « De l’air, de l’air, les grandes tournures, les larges et pleines périodes se déroulant comme des fleuves, la multiplicité des métaphores, les grands éclats du style, tout ce que j’aime enfin !… »
Oui, le romantisme descriptif ; le romantisme non sentimental et élégiaque ; le romantisme non médiéval et néo-chrétien ; mais le romantisme de la couleur et des rythmes ; le romantisme pictural, sculptural et musical ; le romantisme qui, par ces tendances-ci, futtoujours attiré soit vers l’Orient, soit vers l’antiquité comprise à la manière d’Homère ou des Alexandrins et ayant encore ainsi quelque chose d’oriental ; le romantisme qui commence aux Orientales de Victor Hugo et qui se continue par une bonne partie de Théophile Gautier, par une partie considérable de Gérard de Nerval, par la partie essentielle de Lecomte de l’Isle ; le romantisme des « vers spacieux et marmoréens » et des périodes spacieuses et marmoréennes, c’est le romantisme de Flaubert ; et c’est de lui que sont nés Salammbô et la Tentation de Saint Antoine.
« Je suis las des choses laides et des vilains milieux. Je vais pendant quelques années peut-être vivre dans un sujet splendide et loin du monde moderne, dont j’ai plein le dos. Ce que j’entreprends est insensé et n’aura aucun succès dans public. N’importe. Il faut écrire pour soi avant tout. C’est la seule chance de faire beau. » C’est ainsi que le 11 juillet 1858, Flaubert annonçait Salammbô à un de ses amis. Il prédisait juste. Salammbô n’a pleinement satisfait que son auteur. Elle n’a point réussi auprès du grand public. C’est à propos d’elle qu’il faut répéter le mot d’une grande dame du XVIIe siècle à propos de La Pucelle : « C’est beau ; mais c’est ennuyeux. » Un ami de Sainte-Beuve lui disait sur Salammbô : « C’est plus fatigant qu’ennuyeux. » Je saisis mal la nuance. C’est très fatigant et c’est aussi ennuyeux que fatigant. Je ne crois pas qu’un seul lecteur soit de bonne foi s’il dit qu’il a lu Salammbô sans la laisser reposer plusieurs fois un assez long temps, pour se reposer lui-même. « Je veux lire en trois jours l’Iliade d’Homère », disait Ronsard. On peut lire en trois jours Salammbô, mais seulement par ferme propos et gageure, et ce ne sera pas impunément.
La faute en est d’abord à une erreur initiale sur le choix du sujet. Le roman historique, qui n’est pas un genre plus faux qu’un autre, et tous les genres littéraires sont faux, excepté l’élégie très simple et sans ornement, le roman historique n’intéresse qu’autant que l’époque où il est placé nous est assez connue déjà, et qu’autant que les événements qui s’y déroulent engagent une de nos passions et l’émeuvent très fortement.
Il faut que l’époque nous soit assez connue d’avance, parce que si elle ne l’est pas, le roman historique nous instruit trop pour nous émouvoir. Comme il nous révèle un monde ignoré, nous le prenons immédiatement pour un livre d’histoire, et, comme un livre d’histoire, nous l’interrogerons sur les pays, le climat, la topographie, les monuments, les usages, les mœurs et les costumes, et nous le lirons avec l’intérêt que nous apportons à un dictionnaire d’archéologie. C’en est un, certes, mais exclusif de « l’intérêt » proprement dit et contraire à celui-ci, et qui l’empêche de naître. L’enseignement nous divertit de l’émotion, et plus le livre nous instruit, moins il nous passionne. Quand l’émotion veut naître, nous l’écartons comme élément étranger à la curiosité qui nous occupe. Les personnages peuvent être intéressants, mais les détails inconnus complètement de nous et qu’on nous fait connaitre relèguent et repoussent les personnages. Il y a deux manières de nous intéresser ; on en a pris une, soit, mais il ne faut pas compter sur l’autre en même temps. Elles sont contraires. Le plaisir d’être instruit est fort, mais froid. Cette froideur studieuse ne s’accommodera pas de l’émotion romanesque et ne lui permettra pas de se produire. Quand nous connaissons déjà l’essentiel de ce que le roman met sous nos yeux, les détails nouveaux qu’il nous apporte nous amusent et nous occupent sans nous distraire et ils se mêlent notre émotion comme un léger surcroit d’intérêt et comme un ornement de l’ouvrage ; mais ils ne nous empêchent pas de nous livrer au roman lui-même ou au poème. C’est le cas d’Homère pour les Grecs, les Romains et nous ; c’est le cas de Virgile pour les Romains et nous ; c’est le cas des Martyrs pour nous. Ce n’est pas le cas de Salammbô, qui nous révèle un monde sur lequel nous n’avons aucune notion. Dès que nous l’avons ouvert, nous ne songeons qu’à apprendre Carthage ; et Salammbô, Matho et Narr’Havas, en tant que personnages de roman ou de drame, nous sont indifférents.
N’est-il pas vrai que les personnages qui intéressent le plus, pour lesquels, du moins, l’intérêt commence à naître dans Salammbô, sont Spendius et Hannibal enfant ? C’est que nous connaissons les Grecs, un peu, dont Spendius est ici comme le type, et que nous connaissons Hannibal et que ce qu’on nous dit de son enfance mystérieuse et déjà héroïque nous pique d’autant et nous attire. Par ces deux personnages, dont l’un n’est pas le principal et dont l’autre n’est qu’épisodique, le roman rentre dans les conditions nécessaires du roman historique. Par sa constitution générale et son caractère général il en sort.
Je dis encore que le roman historique n’intéresse qu’en tant que les événements qu’il déroule engagent et excitent une de nos passions, soit éternelles, soit contemporaines. La Pharsale, qui est un roman historique, nous intéresse parce qu’elle est la lutte de la liberté qui meurt et du césarisme qui nait. Une Cléopâtre quelconque nous intéressera, parce que la question est de savoir si Rome ou l’Orient prendra ou gardera l’empire du monde. Un Sertorius nous intéressera, parce que la question est de savoir si tel peuple et, par extension, tous les peuples, garderont leur autonomie ou seront absorbés par Rome conquérante. Le duel entre Rome et Carthage, pris à tel ou tel moment, nous passionnerait, parce que la question est de savoir si le génie carthaginois ou le génie romain finira par l’emporter dans le monde. Il faut toujours que, dans le roman historique, des destinées générées du monde et telles que nous puissions nous intéresser pour elles, soient en jeu et très visiblement en jeu devant nos regards.
Dans Salammbô, il est question de la lutte entre Carthage et des mercenaires barbares qui se sont mis à sa solde et qui, trompés par elle, se sont irrités contre elle. Aucun parti ne nous passionne. Que Matho ou Hannon triomphe, il ne nous importe. Férocité barbare, férocité punique, l’une contre l’autre, que celle-ci soit victorieuse ou celle-là, rien ne nous est plus étranger. On se surprend, en lisant Salammbô à s’intéresser à ce dont il n’y est nullement question, c’est-à-dire à Rome. On se surprend à se dire : « Rome à la fin interviendra et ce sera intéressant » ; parce que nous connaissons assez d’histoire pour savoir que la clef des destinées du monde est à Rome, et que, si Rome intervient, le roman rentrerait dans les conditions du roman historique tel que nous le comprenons, tel qu’il faut qu’il soit pour nous prendre.
Il y a un autre moyen de rendre le roman historique intéressant : c’est de le traiter comme un roman ordinaire et de nous satisfaire par la peinture curieuse des sentiments des personnages, et dans ce cas « l’historique » n’est plus que le cadre et le fond du tableau. Les meilleurs romans de Walter Scott sont conçus ainsi et c’est l’âme dé Louis XI qui avant tout nous attire et nous retient dans Quentin Durward. Je ferai remarquer que dans cette manière le roman historique baisse d’un degré, puisqu’il n’est plus qu’un roman d’analyse morale comme un autre, ou à très peu près, et puisque l’intérêt historique n’est plus l’élément principal de ce roman historique. Autant vaudrait tout simplement analyser des âmes du monde contemporain. Mieux vaudrait, parce que, comme pour les âmes contemporaines de la nôtre nous avons le contrôle en nos mains, l’auteur peut nous les peindre dans un détail diligent, pénétrant et curieux, dont nous sommes juges ; tandis que pour les âmes des temps anciens, ce contrôle nous manquant, ce sont les sentiments les plus généraux seulement et dans leur généralité seulement que l’auteur peut nous présenter et nous peindre. Mais enfin c’est une manière encore de traiter le roman historique, et je n’ai pas besoin de faire remarquer que c’est, à peu de chose près, la manière dont nos tragiques et Shakespeare lui-même ont traité la tragédie.
Or, cette manière-là elle-même, Flaubert n’a pas su la prendre. À considérer les choses ainsi, les deux héros du « drame » sont Salammbô et Matho. Or Matho et Salammbô ne sont analysés et pénétrés l’un ni l’autre. Matho est passionnément amoureux et c’est tout. Salammbô est confuse et énigmatique. Flaubert lui-même reconnaît dans sa lettre à Sainte-Beuve qu’il n’a pas pu la connaitre, parce que la femme d’Orient est inaccessible. Alors, quoi donc ? Alors c’est à l’élément historique que nous sommes rejetés et j’ai dit pourquoi il est dans Salammbô d’un faible intérêt pour nous.
Antre manière encore d’exciter l’intérêt, l’attrait du mystérieux. Nous y sommes tous très sensibles, si positivistes que nous croyions être devenus. Une force obscure et détachée dépassant l’homme et ses desseins, et agissant à travers les événements d’une manière inattendue, vaguement logique pourtant, nous impose et nous remplit d’une curiosité mêlée d’inquiétude et d’un commencement d’effroi qui est un « intérêt » au premier chef. Flaubert a cherché cet élément d’émotion. Il a inventé le Zaïmph, le voile sacré, auquel les destinées de Carthage sont attachées comme celle de Troie au Palladium. Rien n’était plus heureux comme ressort poétique. Il a mal manié celui-là. Le Zaïmph devait sans cesse occuper les esprits, ramener à lui notre attention, ne point la laisser s’égarer que par de courts relâches. Il disparaît peu près dans ce poème trop touffu. On le perd de vue, on le revoit, on se dit que c’est à lui qu’il faut songer ; mais on n’y songe point ; et l’auteur n’a pas su faire qu’on y songeât à peu près sans cesse et qu’il fut au moins notre préoccupation subconsciente continuelle.
Et enfin, il faut absolument dans un grand poème un personnage central, très nettement et impérieusement central, pour ainsi dire, et puisque ce n’est pas le Zaïmph, que ce soit un être humain. Dans l’Iliade, quoique composée après coup, c’est Achille, dans l’Odyssée c’est Ulysse, dans l’Énéide c’est Énée, quoique trop pâle, ou plutôt c’est Rome. Dans Salammbô il y a à cet égard erreur absolue. Le personnage principal devait être Salammbô ; et c’est Matho. Le personnage principal devait être Salammbô ; c’est très évident. Quelle est la question ? Une ville qui se défend. Tombera-t-elle ? Il faut la personnifier dans quelqu’un. Si ce n’est pas dans le Zaïmph, que ce soit dans Salammbô. La vierge pieuse, la vierge sacrée, consacrée à la déesse la plus pure de la ville capable de sacrifier ses pudeurs et ses religions personnelles pour la religion de la cité et pour la cité elle-même, voilà évidemment la personnification même de Carthage. Il faut à toute force qu’elle occupe le centre du tableau, et que, invisible ou présente, elle domine toujours tout l’horizon. Or ce qui attire notre regard sans cesse c’est Matho, et non pas même Matho amoureux de Salammbô, ce qui serait une facon de nous ramener à Salammbô elle-même, mais Matho guerroyant, Matho combattant, Matho chef d’armée et chef de peuples. Salammbô, comme le Zaïmph, parait quelquefois, très brillante, très curieusement parée, très mystérieusement attirante, mais elle glisse et rentre dans l’ombre ; son image disparait derrière les masses qui s’entrechoquent et la poudre tournoyante des champs de bataille. C’est ce que Flaubert lui-même a très bien vu et admirablement exprimé par cette critique sur lui-même qui vaut mieux que toutes celles de Sainte-Beuve, pourtant judicieuses : « Le piédestal est trop grand pour la statue. » C’est cela même. Au-dessus des bas-reliefs énormes de cette gigantesque guerre, au-dessus de ce amoncellement et entassement de batailles, de tumultes et de carnages, Salammbô parait comme une figurine. Si le sujet de Salammbô est mal choisi, la composition en est absolument défectueuse.
Et que dire de la monotonie de ces batailles ? Les infinies ressources du style de Flaubert n’ont pas pu en sauver la fatale similitude. À les regarder de près, elles sont toutes très différentes les unes des autres. À les lire bonnement, elles semblent se répéter avec exactitude. « On le voit différent sans l’avoir vu changer » dit d’un nuage Sullyy-Prudhomme. Elles, on les voit changer sans les sentir différentes. C’est que les éléments constitutifs en sont les mêmes ; c’est que les acteurs y sont les mêmes et habillés et armés de la même façon et qu’il ne suffit pas, pour qu’ils paraissent nouveaux, qu’ils fassent des choses un peu différents. Les arrangeurs de l’Iliaden’ont pas pu, eux-mêmes, éviter ce défaut. Encore y ont-ils taché. Encore l’incurable monotonie des batailles entre deux peuples toujours les mêmes est-elle atténuée par des expéditions ou luttes d’un caractère exceptionnel. Ici algarade nocturne de deux audacieux qui vont ravir les chevaux d’un chef ennemi, ici rapt nocturne de Palladium, ici bataille entre un dieu des eaux et le dieu de la flamme. Et néanmoins il y a monotonie belliqueuse dans l’Iliade. Un auteur doit disposer les choses de telle manière qu’il n’y ait dans son poème qu’une bataille, ou qu’il n’y en ait que deux de caractère très différent : bataille sur terre, bataille navale, ajoutez-y un combat singulier ; mais il ne faut jamais que le lecteur soit seulement tenté de se dire : « Il me semble que j’ai déjà lu cela. »
Ce qui reste de Salammbô, c’est les descriptions, dont quelques-unes sont déjà devenues classiques : le lever de l’aurore vu des terrasses d’Hannon : « Mais une barre lumineuse d’éleva du côté de l’Orient », Salammbô et le serpent ; Salammbô à la tente de Matho, scène manquée, du reste, car elle est toute plastique et ce sont les sentiments de Salammbô en cette circonstance décisive qui étaient pour nous intéresser, mais, cependant, d’une beauté de couleur et de dessin incomparable.
Et enfin, comme quand on ne peut pas admirer, il faut encore comprendre, et comme c’est à comprendre ce qu’on n’aime pas que la critique commence, il faut bien se rendre compte que Flaubert, comme tous les grands artistes, n’a écrit que pour se satisfaire et que s’il ne nous satisfait pas dans Salammbô, il n’est aucun de ses livres où il se soit plus complètement satisfait lui-même. Le rêve d’Orient, le goût de la couleur, le goût de l’atroce et du lugubre, le goût complexe de mettre de la précision réaliste dans l’imagination la plus débridée, déchaînée et tempétueuse, tout cela a reçu pleinement satisfaction dans Salammbô. Et surtout, le fond même de Flaubert, l’ardente misanthropie et le pessimisme amer avaient trouvé dans Salammbô le sujet qui s’accommodait à eux au plus juste. Une époque et un lieu où la haine, la soif de vengeance, l’avarice, l’avidité, la cruauté raffinée ou féroce, l’amour à l’état de foliesensuelle, la religion à l’état de férocité monstrueuse, seraient le fond du tableau et tout le tableau, sans une éclaircie ou un coin lumineux et pur ; une époque et un lieu où il n’y eut pas un bon sentiment ou un bon instinct ; une époque et un lieu où l’homme ne fut qu’un animal atroce et brutal, ou rusé et atroce ; c’était évidemment ce qu’avait rêvé Flaubert comme beau sujet, et il faut reconnaître qu’à cet égard il avait bien choisi, et reconnaître encore que son talent a rempli tout son dessein.
[Source : Émile Faguet, Flaubert, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1899]
1881
1874
Livre de George Sand et Gustave Flaubert correspondances 1884