- Accueil
- Catalogue des auteurs classiques
- Marcel Proust
Marcel Proust
________________
Les deux familles de l’enfant ont des origines bien différentes et rien ne laissait prévoir leur rapprochement. Le père de Marcel, Adrien, est issu de la petite bourgeoisie catholique provinciale, il est le fils d’un commerçant qui tenait une épicerie-mercerie à Illiers (Eure-et-Loir). Sa mère, Jeanne Weil, est la fille d’un riche agent de change d’origine juive alsacienne. Il y a donc loin entre les demeures parisiennes spacieuses et cossues de la famille Weil et la modeste maison natale du docteur Proust à Illiers.
On ne sait que peu de choses sur la jeunesse d’Adrien Proust, hormis ses succès scolaires et ses diplômes. Inscrit à la faculté de médecine de Paris, il soutient avec succès sa thèse puis est nommé chef de clinique et, trois ans plus tard, reçu à l’agrégation il obtient le titre de Professeur et connaîtra une grande notoriété dans le milieu médical.
Comme toutes les jeunes filles de la bonne société parisienne, Jeanne Weil a reçu une excellente éducation. Elle parle plusieurs langues, aime la musique et la peinture et, malgré son éducation rigide, possède un certain sens de l’humour qui ressort nettement à la lecture de ses lettres. Lorsqu’elle rencontre Adrien Proust, Jeanne n’a que vingt et un ans. C’est une jeune femme brune, avec un visage très blanc à l’ovale pur. Où a lieu cette rencontre, comment s’est opéré le rapprochement improbable des deux familles ? On n’a que très peu d’informations là-dessus. Il semble que les deux jeunes gens se soient connus à l’occasion du mariage d’un ami commun.
Le 3 septembre 1870, veille de la chute du Second Empire, Adrien Proust épouse Jeanne Weil qui a quinze ans de moins que lui. Le mariage est hâtivement célébré dans une atmosphère lourde, car Napoléon III vient de capituler. La famille Proust n’est pas venue au mariage. Peut-être par crainte de tomber aux mains des Prussiens, ou alors parce qu’il n’était pas prévu de mariage religieux. En effet, sans être pratiquante, Jeanne n’a pas voulu renier la foi de ses pères en se convertissant au catholicisme.
Au cours de ce même mois, le docteur Proust reçoit la Légion d’Honneur des mains de l’Impératrice Eugénie.
Alors que Paris vit les journées dramatiques de la Commune, le docteur Proust est légèrement blessé par une balle perdue en allant prendre son service à l’hôpital de la Charité alors que la capitale est abandonnée aux exactions des Communards. Sa femme, enceinte de Marcel, se remet difficilement de l’émotion éprouvée à cette occasion et il est décidé qu’elle finira sa grossesse dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil située au 96 rue de La Fontaine, dans le quartier d’Auteuil (actuel 16ème arrondissement).
Le bébé qui vient au monde est si faible que son père craint qu’il ne soit pas viable. L’enfant est baptisé à l’église Saint-Louis-d’Antin à Paris. Catéchisme et première communion suivront mais ne laisseront pas chez Marcel d’empreinte religieuse ; ses parents ont toujours évité d’aborder en famille les questions de croyance et l’enfant en gardera une indifférence apparente.
Ambitieux, le Docteur Proust travaille beaucoup. Il cultive de nombreuses relations avec des personnes pouvant être utiles à sa carrière mais sa femme n’apprécie pas la vie mondaine et préfère rester seule avec les enfants. De plus, elle souffre beaucoup des nombreuses infidélités de son mari. C’est un homme majestueux et rempli de son importance.
Adrien Proust
Il semble tout dominer dans la maison, mais en réalité c’est sa femme qui manœuvre avec finesse pour exercer le pouvoir. Pendant les fréquentes absences de son mari, c’est elle qui détient seule l’autorité mais Marcel comprend vite ce que cette autorité comporte de faiblesse. Comment se montrer sévère et inflexible à l’égard d’un enfant à la santé aussi fragile et qui donne des signes d’une intelligence et d’une sensibilité précoces ?
Très tôt, Marcel concentre son amour sur sa mère, avec plus de force encore après la naissance d’un frère cadet, Robert, en 1873, un rival à évincer pour rester l’unique bénéficiaire de l’amour maternel. Les rapports de Marcel avec son jeune frère seront affectueux, mais jamais intimes.
Marcel et Robert
Marcel sera définitivement pour sa mère « mon petit loup » alors que Robert, plus jeune, restera toujours « mon autre loup ». En fait, Marcel n’a jamais accepté son frère, aussi l’a-t-il totalement gommé dans La Recherche.
En 1873, les Proust quittent l’appartement qu’ils occupent rue Roy pour s’installer dans un bel immeuble, au 9 boulevard Malesherbes, dans lequel ils resteront jusqu’en 1900.
A neuf ans, lors d’une promenade dominicale au Bois de Boulogne, Marcel est victime soudaine crise d’asthme d’une extrême violence. Son père assiste impuissant aux efforts épuisants de son fils pour reprendre son souffle et pendant un instant craint le pire. La crise finit heureusement par se calmer, mais l’asthme chronique va s’installer et le jeune garçon, contraint à de fréquents repos, aura tendance à se replier sur lui-même, développant des tendances à l’introspection.
Chaque année, les Proust quittent Paris pour accomplir un pieux pèlerinage familial à Illiers où se trouve la maison de Mme Amiot, la sœur aînée du Docteur Proust.
La maison de Combray
Elle a épousé Jules Amiot marchand drapier, lui a donné trois enfants, puis, son devoir accompli, a décidé de ne plus quitter Illiers, puis sa maison, puis sa chambre, et enfin son lit (modèle de tante Léonie dans Du côté de chez Swann). A noter que le village sera rebaptisé Illiers-Combray en 1971, à l’occasion du centenaire de la naissance de Marcel Proust.
Dans La Recherche, le Narrateur n’emprunte pas seulement ses souvenirs à ses séjours à Illiers, mais également aux vacances passées dans la vaste maison de campagne que possède M. Weil, son grand-oncle maternel, à Auteuil, rue La Fontaine, où Marcel s’installe avec ses parents dès le printemps venu lorsque les crises d’asthme ne le menacent pas trop ; mais bientôt il faudra renoncer à Auteuil pour des séjours avec sa grand-mère, en Normandie, à Dieppe ou à Cabourg, où le climat est plus propice à la santé du jeune Marcel.
Afin de lui éviter les promiscuités vulgaires, Marcel est inscrit au cours Pape-Carpentier où il restera deux ans. Il se lie avec Jacques Bizet, le fils du compositeur, puis il entre, en 1882, au lycée Fontanes, l’un des plus réputés de Paris, qui prendra l’année suivante le nom de Condorcet. De nombreux élèves appartiennent à des familles fortunées où certains membres israélites exercent une forte influence. Les professeurs du lycée ont la réputation d’être peu dogmatiques, ouverts et originaux dans leur manière d’enseigner. Parmi eux, le professeur de sciences naturelles, Georges Colomb, futur créateur du Sapeur Camember et de la famille Fenouillard.
Très irrégulier en raison de sa santé et d’absences dues à des crises d’étouffement répétées, Marcel est cependant inscrit plusieurs fois au tableau d’honneur. Il ne sera jamais un mauvais élève, ni une tête de classe et, s’il excelle en français, il est piètre élève en mathématiques.
Après les heures de lycée ainsi que les jeudis et dimanches après-midi, il va jouer aux Champs-Elysées où il tient sa cour, retrouvant des amis qu’il étonne par sa vivacité d’esprit. Doué d’une surprenante mémoire, il déclame devant ses camarades, charmés mais un peu déconcertés, des vers de ses poètes favoris, Musset, Hugo, Lamartine, Racine, Baudelaire. Aux jeux, il préfère la conversation avec ses camarades auxquels il confie les idées tumultueuses qui emplissent son esprit. Marie Bénardaky, fille d’un diplomate polonais, est sa camarade préférée et Marcel est souvent invité à goûter chez elle, mais les parents de Marcel n’apprécient pas la mère de la fillette qui a mauvaise réputation et il doit cesser de la voir. On notera dans la Recherche une ressemblance évidente entre Mme Bénardaky et ses familiers et Odette et son salon louche.
En raison d’absences particulièrement longues et fréquentes, Marcel redouble sa seconde. En classe de rhétorique (actuelle classe de première), il obtient le prix d’honneur de composition française.
A l’adolescence, il découvre les plaisirs solitaires sans paraître éprouver aucun sentiment de culpabilité. Plusieurs indices et témoignages laissent penser que l’onanisme a été la principale pratique sexuelle de Proust, et ceci tout au long de sa vie ; lui-même sera toujours d’une grande discrétion à ce sujet, aussi bien dans ses écrits privés que publics. Au courant de ces habitudes, son père essaie de l’en détourner en l’envoyant voir des prostituées. Marcel n’hésite pas non plus à s’adresser à son grand-père quand les pulsions sont trop fortes et qu’il n’a plus d’argent : « Me voilà donc comme devant attendant à chaque heure davantage 10 francs pour me vider… mais je n’ose pas redemander sitôt de l’argent à papa… ».
C’est durant son année de rhétorique, 1887-1888, que Marcel ressent ses premières attirances pour les garçons. C’est donc pendant cette période que se sont constituées, simultanément, sa vocation littéraire et sa sensibilité sexuelle.
Inverti, Marcel Proust l’est certainement, mais il ne reconnaîtra jamais ouvertement la vraie nature de ses penchants. Il a toujours été tourmenté par son homosexualité, un état qui était très mal accepté par la société de l’époque et, à plus forte raison, par le milieu bourgeois dont il est issu et qu’il fréquente. Alors qu’il est élève au lycée Condorcet, Marcel adresse une lettre singulière et très significative de son malaise à un ami, dans laquelle il se décrit tel qu’il se voit. « Connaissez-vous M.P. ? Je vous avouerai pour moi qu’il me déplaît un peu, avec ses grands élans perpétuels, son air affairé, ses grandes passions et ses adjectifs. Surtout il me paraît très fou ou très faux. Jugez-en. C’est ce que j’appellerai un homme à déclaration. Au bout de huit jours il vous laisse entendre qu’il a pour vous une affection considérable et sous prétexte d’aimer un camarade comme un père, il l’aime comme une femme. Il va le voir, crie partout sa grande affection, ne le perd pas un instant de vue. Les causeries sont trop peu. Il lui faut le mystère de la régularité des rendez-vous. Il vous écrit des lettres… fiévreuses. Sous couleur de se moquer, de faire des phrases, des pastiches, il vous laisse entendre que vos yeux sont divins et que vos lèvres le tentent. Le fâcheux (…) c’est qu’en quittant B qu’il a choyé, il va cajoler D, qu’il laisse bientôt pour se mettre aux pieds de E et tout de suite après sur les genoux de F. Est-ce une p…, est-ce un fou, est-ce un fumiste, est-ce un imbécile ? »
Au cours de cette année, il se lie avec certains camarades aux noms célèbres, Jacques Bizet, Daniel Halévy, Abel Desjardins, Pierre Lavallée. Marcel déborde pour eux d’une amitié jugée trop vive, trop entière et d’un enthousiasme parfois embarrassant. Si certains d’entre eux se montrent polis, d’autres n’hésitent pas à marquer grossièrement leur désapprobation, allant jusqu’à l’insulter. L’un de ses camarades de classe racontera plus tard sa terreur en voyant Proust venir à lui, prendre sa main, et lui confesser, avec un regard implorant, son « besoin d’une affection totale et tyrannique ». Marcel, exalté, croit un moment trouver en Jacques Bizet l’ami de cœur et peut-être un peu plus mais celui-ci le repousse fermement. Il se tourne alors vers Daniel Halévy, cousin de Jacques Bizet, qui avouera son malaise en présence de cet adolescent languide « aux immenses yeux orientaux » et qui le repousse également.
Pour se remettre de ses échecs, Marcel passe l’été chez son oncle à Auteuil et se réfugie dans la lecture. Plus tard, il confiera à un ami avoir éprouvé alors une passion pour une courtisane célèbre, Laure Hayman, surnommée la « déniaiseuse de jeunes ducs ». Avec l’enthousiasme de la jeunesse, il se croît amoureux et se ruine en fleurs pour elle.
Laure Hayman
C’est à cette époque qu’un camarade de classe l’entraîne dans un bordel situé à deux pas du lycée Condorcet, au 6 rue Boudreau, mais cette séance initiatique le déçoit profondément et provoque chez lui une espèce de dégoût.
Son année de philosophie se fait sous la direction de M. Darlu, professeur remarquable qui aura une influence décisive sur lui. C’est de cette époque que datent ses premières tentatives littéraires. En effet, les élèves du lycée publient « Lundi », une « revue artistique et littéraire » où Marcel apparaît souvent comme membre du comité de la rédaction. Vient ensuite « La Revue de Seconde » qui disparaît après treize numéros. De ses cendres, sort « La revue Verte », écrite sur du papier vert imposé par le professeur de seconde pour ménager les yeux de ses élèves et les siens, mais rien n’a survécu. Plus marquante est « La Revue Lilas » dans laquelle on se plaît à dire que l’essai de Marcel sur les clochers de Martinville a été publié.
Quel est l’aspect physique de Marcel Proust à cette époque ? Son livret militaires donne quelques indications intéressantes.
Livret militaire de Marcel
Fernand Gregh, poète et critique littéraire et le peintre Jacques-Emile Blanche, tous deux témoins de ses débuts dans le monde se rappellent, pour l’un « ses yeux noirs et coulants à la paupière brune qui se baissait comme un beau voile de chair sur un foyer oriental de lumière et de rêve », pour l’autre son extravagante tenue, ses cravates de soie vert d’eau nouées au hasard, ses pantalons tire-bouchonnés, sa redingote flottante… Tous deux s’accordent à louer la grâce avec laquelle il sait se blottir aux pieds des dames qui tiennent salon, les étourdissant par sa culture, ses compliments excessifs et les inquiétant par la maturité et la pénétration de ses jugements.
De son côté, Léon Pierre-Quint nous en fait, dans son « Marcel Proust », une description très imagée à l’âge de 20 ans : « …de larges yeux noirs, brillants, aux paupières lourdes et tombantes un peu sur le côté ; un regard d’une extrême douceur qui s’attache longuement à l’objet qu’il fixe, une voix plus douce encore, un peu essoufflée, un peu traînante, qui frôle l’affectation en l’évitant toujours. De longs cheveux épais, couvrant parfois le front, qui n’auront jamais un fil blanc. Mais c’est aux yeux qu’on revient, immenses yeux cernés de mauve, las, nostalgiques, extrêmement mobiles, qui semblent se déplacer et suivre la pensée secrète de celui qui parle. Un sourire continuel, amusé, accueillant, hésite puis se fixe immobile sur ses lèvres. D’un teint mat, mais alors frais et rosé, il fait penser, malgré sa fine moustache noire, à un grand enfant indolent et trop perspicace ».
Marcel à 20 ans
Puisqu’il ne rencontre que peu de succès auprès de ses condisciples, Proust décide de s’attaquer au monde littéraire et de pénétrer les salons parisiens, très en vogue à cette époque. Introduit dans plusieurs d’entre eux, il entame son ascension mondaine. A Anatole France, l’un des écrivains les plus en vue, il écrit une lettre très adroite, lettre anonyme d’un élève de philosophie qui ne demande pas de réponse mais qui lui permettra quelques mois plus tard de rencontrer le célèbre écrivain par des voies détournées. Grâce à ses amis de Condorcet dont Jacques Baignères et Jacques Bizet, il accède avec gourmandise, aux salons de Mmes Baignères et Strauss. Cette dernière deviendra une de ses plus fidèles amies. C’est chez elle qu’il rencontre Charles Haas. Proust est subjugué par la remarquable ascension sociale du personnage et il s’efforce de découvrir les secrets de cette réussite. Haas est amoureux de la marquise d’Audiffret dont on retrouvera certains traits chez Odette de Crécy. C’est à cette époque que nait la réputation d’homme snob de Marcel Proust qui le poursuivra toute sa vie.
Au cours de l’été 1889, Proust est introduit dans le salon de Mme Arman de Callavet qui le présente à Anatole France dont le physique le déçoit, comme l’aspect physique de Bergotte déçoit le Narrateur dans La Recherche. Le fils de Mme Arman fait son service militaire à Versailles et Marcel a droit aux descriptions détaillées qu’en fait sa mère, ce qui le rend admiratif et envieux aussi. De son propre chef, il rejoint l’armée alors qu’il aurait pu facilement se faire exempter. Les volontaires ne font qu’une année de service au lieu de cinq pour les appelés. Ils servent dans le rang mais sont traités comme des élèves officiers. Le 15 novembre 1889, Marcel incorpore le 76ème régiment d’infanterie à Orléans, il a 18 ans. Sa santé toujours délicate le dispense des longues marches et des corvées et le colonel du régiment veille sur lui avec une bienveillante attention. En raison de ses crises d’asthme qui risquent d’indisposer ses camarades de chambrée durant la nuit, il est autorisé à louer une chambre chez l’habitant. Les conditions de vie du soldat de 2ème classe Proust sont très adoucies par des officiers distingués et humains, parmi lesquels Charles Waleski, descendant de Napoléon 1er (modèle du capitaine Borodino). La jeune recrue s’est trouvé des relations en ville, entre autres le préfet, chez lesquelles il est régulièrement invité à dîner. C’est pendant son service militaire que sa grand-mère maternelle meurt en janvier 1890 d’une crise d’urémie. Marcel, très proche d’elle, en est profondément affecté.
Proust prend plaisir à sa vie militaire. Il fait du cheval, de l’escrime, de la natation, il apprécie le langage bourru employé à l’armée. Sa mère lui écrit tous les jours. Il cherche à comprendre l’univers nouveau dans lequel il est transplanté, il s’intéresse à tout ce qui l’entoure et l’on retrouvera ces préoccupations dans Le Côté de Guermantes, lorsque le Narrateur discute avec son ami Saint-Loup des problèmes de tactique militaire.
Bien qu’en garnison en province, Proust continue de fréquenter le salon de Mme Arman où on le voit apparaître mal fagoté, dans un uniforme bien trop grand pour lui. Lorsqu’il part pour rejoindre la caserne, toujours en retard, Mme Arman lui bourre les poches de gâteaux et de sandwichs qu’il pourra manger dans le train de retour.
Marcel en tenue militaire
A la fin de son service, Marcel s’inscrit au peloton préparatoire au grade de sous-officier dont il sort 63ème sur 64. Il fréquente à nouveau et avec assiduité les salons dont celui de Mme Strauss et fait la connaissance du fils de Mme de Caillavet, Gaston, dont il devient l’ami (un des inspirateurs de Saint-Loup). Il croit tomber amoureux de sa fiancée, Jeanne Pouquet (inspiratrice de Gilberte) et dès lors l’amitié entre les deux garçons va en se refroidissant et leurs relations deviennent plus rares (Gaston et Jeanne auront une fille, Simone, dont Proust s’inspirera pour faire Mlle de Saint-Loup).
Il doit désormais choisir une carrière. Il se sent attiré par la littérature mais son père, brillant professeur, ne peut se satisfaire que son fils accomplisse une activité purement intellectuelle. Marcel s’incline et entre à la Sorbonne, à la faculté de droit et à l’Ecole libre des sciences politiques, ce qui devrait lui permettre de choisir, au bout de trois ans d’études, la magistrature ou la diplomatie. Il suit les cours d’Albert Sorel (qui le juge « pas intelligent » lors de son oral de sortie) et ceux d’Henri Bergson qui vient de faire paraître sa thèse les données immédiates de la conscience et qui a une influence considérable sur la pensée du jeune homme. Il se rapproche davantage encore du philosophe, puisque Bergson devient son cousin par alliance en épousant, en 1891, une parente éloignée de sa mère.
En septembre 1891, Proust visite Cabourg où il se sent envahi pas ses souvenirs d’enfance. Puis il séjourne à Trouville, dans la villa « Les Frémonts » (modèle de La Raspelière avec ses trois vues) de Mme Charlotte Baignières.
Les Frémonts
Il y rencontre la princesse de Sagan (dont il fera la princesse de Luxembourg, amie de Mme de Villeparisis). Il se lie avec le fils du docteur Antoine Blanche, Jacques-Emile, jeune homme médisant et vindicatif, peintre doué destiné à devenir un brillant écrivain. Jacques réalisera le célèbre tableau de Marcel. Au cours de l’année 1892, il a l’occasion de le rencontrer fréquemment dans les salons où il se rend, dont celui de Laure Hayman, la cocotte qu’il a connue avec passion trois ans auparavant, et celui de Mme Aubernon qui possède une maison en Normandie où elle reçoit « ses fidèles », comme la future Mme Verdurin. Jacques Blanche, laisse entendre que la liaison de Proust avec Mme Hayman n’a pas toujours été platonique.
Il faut noter que, contrairement à Odette qui était rejetée par la famille du Narrateur, curieusement Mme Hayman est admise chez les Proust. Plus tard, elle se brouillera quelques temps avec lui pour s’être reconnue dans le personnage d’Odette, mais malgré cet incident, une réelle amitié s’instaurera entre eux deux, entretenue par un abondant échange de courriers.
Marcel suit ses cours à la faculté sans grande conviction, réservant son énergie à la rédaction de ses premiers essais. En 1892, il fonde, dans le salon littéraire de Mme Strauss, une revue, Le Banquet, avec quelques amis qui deviendront tous célèbres : Fernand Gregh, Robert Dreyfus, Daniel Halévy, Robert de Flers, Henri Barbusse. Il participe très activement à la réalisation de la revue en publiant plusieurs nouvelles dans les douze numéros qui paraîtront. Ce qui frappe en parcourant la collection du Banquet, qui connaîtra un certain succès, c’est la curiosité politique, sociale, historique, intellectuelle de ses auteurs.
Marcel connaît une vie amoureuse difficile, car il est très souvent attiré par des jeunes gens qui ne sont pas homosexuels ou alors, lorsque une liaison prend forme, il fait montre de trop d’empressement et d’exigence ce qui fait peur à plus d’un.
En 1893, il fréquente le salon de Mme Lemaire, appelée « la Patronne » à l’instar de Mme Verdurin. Comme cette dernière, elle intervient dans la vie privée de ses amis, leur attribue des surnoms et qualifie d’ « ennuyeux » ceux qui ne font pas partie de son « clan ». Dans ces salons, Proust va faire deux rencontres importantes pour lui. L’une avec Robert de Montesquiou, un peintre aquarelliste célèbre, qui reçoit le Tout Paris dans son hôtel particulier. Marcel a vingt-deux ans, Montesquiou trente-sept, les deux hommes sympathisent aussitôt et deviennent amis. Montesquiou transmet au jeune homme ses goûts artistiques et lui fait connaître de nombreux artistes célèbres. L’autre rencontre est celle d’un jeune vénézuélien de dix-neuf ans, beau et charmeur, Reynaldo Hahn, enfant prodige de la musique.
Les mœurs de Reynaldo ne font pas plus de mystère que celles de Proust. Pendant les quatre semaines qu’ils passent ensemble, les deux jeunes gens vivent une véritable lune de miel (intellectuelle, mais aussi vraisemblablement charnelle) sous l’œil attendri de leur hôtesse. Reynaldo joue pour son ami sa Sonate en ré mineur dont une phrase l’a frappé au point qu’elle deviendra, non seulement « l’air national de leur liaison », mais aussi la fameuse « petite phrase de Vinteuil » qui accompagnera les amours de Swann et d’Odette dans La Recherche.
La liaison amoureuse des deux hommes dure jusqu’en 1896. C’est Reynaldo qui introduit Proust dans le salon littéraire d’Alphonse Daudet, où bien vite il fait la conquête de Mme Daudet. « Je n’ai jamais rencontré un jeune homme aussi bien élevé que ce petit Proust » déclare-t-elle. Proust devient un familier des Daudet. C’est Reynaldo encore qui introduit Proust chez la princesse de Polignac, la marquise de Feydeau de Brou, Mme de Saint-Marceaux et la marquise de Saint-Paul, ces trois dernières fourniront des traits, généralement ridicules, au personnage de Mme de Saint-Euverte.
Au début d’août 1892, Proust échoue à l’oral de son premier examen de droit. Le 14, il part pour Trouville où il retrouve quelques amis parisiens. Les promenades en voiture avec Albertine et ses amis, les aubépines défleuries et les pommiers lourds de fruits appartiennent à cet été.
En 1893, il est enfin reçu à ses examens de droit, au grand soulagement de son père qui le somme désormais de choisir une carrière. En fait, pour Marcel, l’essentiel est d’être autorisé à poursuivre sa vie mondaine. Il doit cependant donner à son père quelques signes de bonne volonté et tente d’être stagiaire chez un avocat, mais l’expérience ne durera que quinze jours. Il émet alors l’idée, aussitôt abandonnée, d’entrer à la Cour des Comptes, puis de préparer le concours des affaires étrangères. Il est entendu que Marcel préparera l’année suivante la licence ès lettres.
Mais il est bien évident que sa priorité consiste à sortir et multiplier les connaissances dans la haute société du Faubourg Saint-Germain, rassemblant ainsi beaucoup de matériaux qui lui seront utiles dans son futur livre. La matinée chez Mme de Villeparisis, le dîner chez la duchesse de Guermantes, puis la soirée de la princesse de Guermantes sont largement inspirés des réceptions auxquelles il participe. La comtesse de Greffulhe, qui est regardée comme la beauté la plus accomplie de la haute société, sera un des modèles d’Oriane de Guermantes. Son mari, Henry, homme de haute taille, aux larges épaules, tyrannique et volage, est le principal modèle du duc de Guermantes. Il en est ainsi pour des dizaines d’autres rencontres qui lui inspireront autant de personnages de la Recherche.
Marcel va avoir une liaison avec Marie Finaly, sœur d’Horace. C’est l’une des très rares occasions où son amour pour une femme est payé de retour. Si cet amour n’a pas de suite, c’est pourtant autour de la figure lointaine, à demi-effacée, de Marie Finaly que se cristallisera le personnage d’Albertine.
L’intense vie mondaine de Proust ne l’empêche pas de terminer les derniers textes qui constitueront Les Plaisirs et les jours, recueil de poèmes en prose et de nouvelles illustrés par Madeleine Lemaire. Ils sont préfacés par Anatole France et publiés chez Calmann-Lévy le 13 juin 1896. Léon Blum, alors auditeur au Conseil d’Etat et futur Président du Conseil, a dû apprécier le livre puisqu’il fait sur Proust une critique d’une grande perspicacité : « J’attends avec beaucoup d’impatience, écrit-il, son prochain livre… Quand on a le talent de style, toute l’aisance de pensée que recèle ce livre trop coquet et trop joli, ce sont là des dons qu’on ne peut laisser perdre. » Malgré la présentation luxueuse du livre, les ventes sont décevantes et l’accueil est loin d’être triomphal. Proust lui-même n’est pas convaincu de la qualité du livre puisqu’il cherchera à en éviter la réimpression pendant la rédaction de La Recherche.
Bientôt, il met un frein à sa boulimie de mondanités, tout d’abord en raison de son état de santé qui s’aggrave et puis par lassitude d’un monde dont il prend la mesure de son aspect féroce et artificiel.
C’est à cette même époque que ses goûts pour l’inversion se confirment. Il multiplie les rencontres avec des homosexuels inconnus ou célèbres, parmi lesquels Oscar Wilde. En 1895, il séjourne un mois avec ce dernier à Belle-Isle-en-Mer puis à Beg-Meil dont il s’inspirera pour la description de Balbec. Même s’il continue à nier son homosexualité, sa mère n’est pas dupe. Au cours de ce séjour à Beg-Meil, il entreprend l’écriture d’un roman d’aventures dans lequel le héros est un jeune homme fragile, naïf et vaniteux, dévoré d’ambition, mais il est conscient du côté artificiel de son roman et de certaines maladresses de sa construction et le livre resté inachevé ne sera publié que longtemps après sa mort, en 1952, sous le titre de Jean Santeuil.
L’affaire Dreyfus éclate en novembre 1897 et Proust prend aussitôt la défense de l’officier soupçonné de trahison. Il organise Le manifeste des cent quatre. Il se trouve souvent dans des situations embarrassantes, car la presque totalité des habitants du Faubourg Saint-Germain qu’il fréquente sont royalistes, nationalistes et catholiques et donc, inévitablement antidreyfusards. Sa mère partage les convictions de son fils alors que son père reste résolument antidreyfusard, ce qui participe à accroître les tensions entre le père et le fils.
Au printemps 1899, Proust fait la connaissance d’un nouvel ami qui jouera un grand rôle dans sa vie, Antoine Bibesco. Il est séduit par cet homme, alors âgé de vingt-huit ans, qui mène une double carrière, de séducteur et de diplomate. Cette passion réciproque n’aura certainement été que platonique et les deux hommes resteront liés jusqu’à la mort de Proust.
Sa passion pour Reynaldo finit par s’émousser et Proust a trouvé chez Lucien Daudet un admirateur plus facilement influençable et surtout plus disponible. Jules Renard décrira Lucien Daudet comme « un beau jeune garçon, frisé, pommadé, peint et poudré, qui parle avec une petite voix de poche de gilet.» Marcel apprécie également le frère aîné de Lucien, Léon, et c’est d’ailleurs en sa compagnie qu’il passe quelques jours à Fontainebleau.
Il continue de fréquenter assidûment les salons littéraires et artistiques des Faubourg Saint-Germain et Saint-Honoré où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation de dilettante mondain. Dans une série d’articles parus de 1900 à 1905, il décrit quelques-uns de ces salons dont celui de la princesse Mathilde dont il s’inspirera pour décrire les soirées de la princesse de Guermantes et de la princesse de Parme. Il se rend également aux soirées chez le comte d’Haussonville, chez la princesse Edmond de Polignac, chez Madeleine Lemaire, salons où il rencontre les artistes les plus illustres tels que Mounet-Sully, Massenet, Saint-Saëns, Réjane, Dumas fils, Anatole France, mais le salon qui le marquera le plus est celui de Mme Strauss-Bizet, un des plus brillants de l’époque. Ces salons sont pour lui de véritables mines d’inspiration. Mme Strauss elle-même l’inspirera pour créer le personnage d’Odette de Crècy. On retrouve la comtesse de Greffhule dans la duchesse de Guermantes, la princesse de Guermantes, mais aussi chez Odette Swann, pour les toilettes. Le mari de la comtesse de Greffulhe.
Son mari, est le principal et presque unique modèle du duc de Guermantes. Charles Haas, que Proust a pourtant peu fréquenté, lui servira de modèle pour un des personnages centraux de La Recherche, Charles Swann.
Durant l’été 1900, la famille Proust s’installe dans un nouvel appartement au 45 rue de Courcelles, rue huppée qui reflète mieux le haut rang professionnel atteint par le docteur Proust.
Marcel continue de mener une vie oisive et facile que ses parents n’’acceptent pas de bon cœur. Certains incidents, telle la vue d’une photo équivoque le montrant en compagnie de son ami Lucien Daudet, déclenchent chez eux une vive colère. De plus, Marcel ne cesse de réclamer de l’argent qu’il dépense aussitôt sans discernement ; plus grave encore, il adopte une liberté totale de mœurs et de mouvement. Sa mère, pourtant sans illusion sur les tendances de son fils, souffre beaucoup de cette attitude. Il se lève si tard qu’il déjeune seul, après sa famille, alors que l’après-midi est déjà bien engagée ; sa mère assiste à ses repas et veille avec amour sur ce fils qu’elle adore, lui pardonnant sa nonchalance et toutes ses fantaisies. Les domestiques ont reçu des instructions pour ne pas le déranger. Son père, parti tôt le matin, ne le voit que rarement.
Madame Proust continue de permettre à son fils de donner de « grands dîners » extrêmement brillants où l’on retrouve Anatole France, la comtesse de Noailles, le prince de Montesquiou et quelques chanteuses ou actrices célèbres. Marcel ne regarde pas à la dépense, les mets servis et la décoration sont assurés par les plus grands professionnels. Ses parents assistent rarement à ces fêtes, sa mère étant très effacée et son père ne comprenant pas le succès de son fils. Il invite également ses amis dans des restaurants chics tels que Larue ou le café Weber. Pour lui, il commande quelques fruits et pour ses amis, tout ce qui peut être le plus cher et hors saison. Son goût pour cette vie décalée ne le quittera jamais. Ainsi, il arrive fréquemment dans les soirées alors que la plupart des invités sont déjà partis. Maladivement frileux et craignant les courants d’air, Marcel s’emmitoufle en toute saison, même par les jours les plus chauds de l’été, d’une lourde pelisse devenue légendaire, qu’il garde durant les repas.
A l’abri du besoin, Marcel ne se soucie guère de trouver un emploi, mais soucieux de son avenir, son père lui obtient, contre son avis, une place à la bibliothèque Mazarine. Peu enthousiaste, Marcel s’absente régulièrement, se déclarant malade, et fait de si brèves apparitions à son travail que l’on finira par mettre fin à son contrat. Il veut se consacrer entièrement à l’écriture. Il a abandonné la rédaction de son roman en cours d’écriture Jean Santeuil pour entamer la traduction de la Bible d’Amiens de l’écrivain et critique d’art anglais, John Ruskin, avec lequel il a beaucoup d’affinités et pour qui il ressent une profonde admiration. Ce long travail de traduction l’amène à entreprendre plusieurs voyages dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande, à Venise.
La mère de Marcel joue un rôle déterminant dans le travail de traduction car Marcel maîtrise mal l’anglais et c’est elle qui se livre à une première traduction, mot à mot, du texte. Il est également aidé dans ce travail par une cousine de son ami Reynaldo Hahn, Marie Nordlinger. Il publie en 1900, dans la revue du Mercure de France : Ruskin à Notre Dame d’Amiens. Sa traduction de La Bible d’Amiens ne paraît qu’en 1904 et celle de Sésame et les Lys qu’en 1906. Le succès n’est toujours pas au rendez-vous.
Soudainement, Proust se déclare fatigué d’avoir consacré tant d’années à Ruskin. « Ce vieillard commence à m’ennuyer. » avoue-t-il à Marie Nordlinger. Pourtant, en mai 1904, il revoit la traduction de la première partie de Sésame et le lys qui paraîtra dans la revue Les Arts et la Vie.
Le père de Proust meurt le 26 novembre 1903. Marcel ne montre pas un immense chagrin. Il ne le dira jamais, mais il n’est pas impossible qu’il ressente une impression de lâche soulagement et de délivrance maintenant qu’il n’a plus à se justifier auprès de ce père qui ne le comprenait pas. Se pose alors le problème de la succession. Angoissé, Proust se voit ruiné. Il se plaint déjà des sacrifices qu’il devra faire en faveur de son frère, alors que celui-ci ne demande rien et se montre particulièrement accommodant. Finalement, il se retrouve à la tête d’une fortune qui lui ôte tout souci d’argent. A la même époque, il renonce aux voyages.
Le seul qu’il entreprend, en dehors de quelques jours à Genève et en Belgique, c’est un court séjour à Venise avec sa mère et Reynaldo Hahn. A partir de 1900, hormis les étés qu’il passe à Trouville et à Cabourg, il ne s’éloigne plus de Paris. Pour conjurer les éventuelles crises d’asthme, il procède avant de sortir à des fumigations. Cependant sa capacité à se livrer à des efforts physiques brusques et brefs dénote une forte vitalité.
La mort de sa mère, en 1905, l’atteint comme un drame terrible aggravé par le remords de n’avoir pas été pour elle le fils qu’elle aurait souhaité et de ne pas lui avoir rendu l’amour qu’elle lui prodiguait. Il éprouve même la tentation de disparaître, non en se tuant, mais en se laissant mourir de faim. Il finit par se résoudre à entrer dans une maison de santé à Boulogne sur Seine (le Boulogne-Billancourt d’aujourd’hui) pour se désintoxiquer de tous les remèdes absorbés de façon anarchique depuis des années et réapprendre à vivre en régulant ses heures de sommeil et de repas. En fait, rempli des préjugés d’un homme qui a trop lu d’ouvrages de médecine, il refuse de se plier aux prescriptions de son médecin et fait tout pour démontrer l’inefficacité de ses méthodes. C’est donc, non guéri, qu’il rentre chez lui en janvier 1906.
A l’occasion de cette retraite de plusieurs mois, l’interruption de son activité littéraire lui a donné l’occasion d’approfondir ses réflexions sur la fuite du temps, et c’est alors qu’il conçoit l’immense projet de faire revivre les jours enfuis dont il a de plus en plus conscience, dans un ouvrage intitulé A la recherche du temps perdu. Peu à peu, son goût de la solitude s’atténue et il rencontre à nouveau quelques amis tout en refusant les invitations. En quête d’un lieu de vacances pour l’été, il hésite tant qu’il doit se rabattre sur Versailles où il s’installe à l’Hôtel des Réservoirs, dans un appartement qu’il décrira comme sinistre, sombre et glacé, qui lui coûte une fortune. Il y reste cependant jusqu’à la fin de l’année, malgré les pollens des arbres, le bruit du tramway et la poussière ; puis il revient à Paris où il loue l’appartement de son oncle, au 102 boulevard Haussmann. Il fait tapisser sa chambre de plaques de liège, et va s’y enfermer pour travailler nuit et jour à son grand œuvre, A la recherche du temps perdu.
La chambre de Proust reconstituée au musée Carnavalet
En 1907, après bien des hésitations, il se rend à Cabourg où il a séjourné enfant avec sa grand-mère puis avec sa mère. Il s’installe au Grand-Hôtel qui vient d’ouvrir ses portes. Là, il retrouve soudain la santé et après être resté alité durant de longs mois, le voici qui se lève, fait des excursions et rencontre de nombreuses relations en villégiature dans les différentes stations de la côte. Il a loué un taxi avec ses trois chauffeurs, Jossien, Odilon Albaret et Agostinelli. Dans des petits carnets, il griffonne pêle-mêle des noms, des adresses, que l’on retrouve dans Du côté de chez Swann. Proust réalise peu à peu qu’il dispose des matériaux qui constitueront son œuvre future, même s’il ne perçoit pas encore l’importance qu’elle prendra.
Sur le plan matériel, il décide de gérer désormais lui-même sa fortune mais se montre, dans ce domaine, d’une rare maladresse. Il retrouve un ami d’enfance, Lionel Hauser, qui est un homme d’une grande intégrité, excellent financier et qui devient son mentor dans la gestion de sa fortune et le restera jusqu’à sa mort. Malheureusement Proust ne suit pas les conseils de Hauser, pas plus que ceux de son médecin et il se retrouve en 1909 gravement malade.
C’est au tout début de janvier 1909 que Proust va faire l’expérience d’un des événements les plus mémorables de sa vie. Alors qu’il est dans sa chambre, frissonnant, Céline insiste pour qu’il prenne une tasse de thé. Il finit par accepter ce breuvage qui lui est peu familier, laisse tomber négligemment un morceau de pain grillé dans sa tasse qu’il porte, tout ramolli à ses lèvres. Il demeure aussitôt immobile, attentif à une saveur qui le renvoie à certains souvenirs, lui faisant alors déclarer :
« Chaque jour, j’attache moins de prix à l’intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n’est qu’en dehors d’elle que l’écrivain peut saisir quelque chose de nos impressions, c’est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même… » Il développe alors la théorie de la mémoire involontaire, c’est-à-dire la résurrection d’une impression jadis ressentie et si bien oubliée qu’on n’aurait jamais pensé qu’elle puisse resurgir. A l’appui de cette théorie, il cite des exemples devenus célèbres : la fameuse madeleine trempée dans la tasse de thé, bien sûr, mais aussi le choc d’une cuillère contre une assiette qui lui rappelle le bruit du marteau contre les roues d’un wagon de chemin de fer, ou bien un pavé de guingois qui le ramène sur une petite place vénitienne.
Proust entreprend de transposer les matériaux réunis dans un ouvrage en chantier, Contre Sainte-Beuve, dont il a commencé la rédaction à la fin de l’automne, en un début de La Recherche qui deviendra Du côté de chez Swann. Comme pour toute son œuvre, Proust ne cesse de reprendre des textes, de les enrichir d’incidentes, telles que le jardin du Pré Catelan, le côté de Méséglise, le Côté de Villebon, qui deviendra le Côté de Guermantes, etc. Il travaille inlassablement certains portraits qui prendront place dans l’œuvre définitive dont il a désormais une vision précise du décor et des acteurs. Par ailleurs, il n’a pas abandonné l’idée de faire éditer Contre Sainte-Beuve. A sa grande déception, le Mercure de France refuse le manuscrit et le livre ne sera publié qu’à titre posthume, en 1954.
Il retourne à Cabourg les étés suivants, mais sa santé se dégrade à nouveau. Il approche de la quarantaine, c’est dire que sa vie est bien avancée puisqu’il mourra à l’âge de cinquante et un ans. Il continue à douter de sa capacité à réaliser une œuvre majeure. Il est conscient de mener une vie désœuvrée qui lui vaut une réputation de dilettantisme et de mondain. Ses crises d’asthme le laissent épuisé, les pertes rapprochées de son père puis de sa mère l’ont profondément affecté. C’est la période la plus sombre de sa vie.
Peut-être conscient de l’inanité de cette vie de loisirs et du gâchis qui en découle, il se remet au travail avec fièvre, un rythme qu’il maintiendra jusqu’à sa mort. Son travail le pousse dans des directions multiples, inspiré par des faits divers, il rédige des articles, des rubriques, des pastiches et prend des notes.
Le fruit de ce travail intense et désordonné va constituer le matériau qui alimentera l’écriture de La Recherche. Durant l’été 1911, Proust s’enferme au Grand Hôtel de Cabourg avec le manuscrit de Combray qui deviendra plus tard Du côté de chez Swann et il commande sous son contrôle, une version dactylographiée. A la fin de 1911, son roman atteint plus de sept cents pages qu’il propose à l’éditeur Fasquelle sous le titre : Les intermittences du cœur, le temps perdu, 1ère partie. Y figure l’actuelle première phrase si célèbre d’A la recherche du temps perdu : « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Ce roman reprend de nombreux passages que l’on retrouvera dans les sept parties qui constitueront La Recherche.
De retour à Paris, il se préoccupe à nouveau de la gestion de sa fortune et de ses éternels problèmes financiers. En plus de Lionel Hauser, il trouve un autre conseiller en la personne d’Albert Nahmias mais, selon son habitude, il n’écoute pas leurs conseils et les pertes s’accumulent et deviennent préoccupantes. Comme un joueur au casino, il est toujours persuadé que la chance va tourner. Bien que préoccupé de voir fondre sa fortune, il gaspille son argent, faisant preuve d’une générosité ostentatoire parfois gênante. Après avoir invité des amis à grands frais dans un restaurant célèbre et onéreux, il est capable de laisser au personnel un pourboire supérieur au montant de l’addition.
La dactylographie de son manuscrit constamment remanié se poursuit. Ce manuscrit est si raturé et embrouillé que c’est son ami, Albert Nahmias, qui tente de mettre de l’ordre dans l’écheveau inextricable de certains passages, mais Proust n’est jamais satisfait et vérifie des quantités de détails apparemment anodins. Ainsi, un soir, à près de minuit, il se fait conduire chez les Caillavet et insiste pour être reçu et voir un court instant leur fille Simone qu’on va réveiller. Proust la regarde quelques secondes puis se retire satisfait. Il voulait simplement vérifier le détail qu’il souhaitait ajouter au portrait du personnage de Gilberte Swann.
Au début de 1912, Le Figaro publie deux passages du manuscrit, dont celui sur les aubépines en fleurs. Fin juin 1912 la dactylographie de Du côté de chez Swann est enfin terminée. D’autres sujets préoccupent Proust : comment publier le nouveau livre ? En combien de volumes ? En combien de parties ? Faut-il découper l’ouvrage ? Quel titre lui donner ? Les stalactites du passé, les reflets du passé, le visiteur du passé, le temps perdu et bien d’autres titres sont cités. Des éditeurs sont approchés, mais l’œuvre ne déclenche pas l’enthousiasme.
Après Fasquelle, ce sont les éditions Gallimard qui refusent le manuscrit sur l’avis d’André Gide qui regrettera amèrement son attitude, et enfin ce sont les éditions Ollendorff. Le directeur de cette maison, M Humblot, fait part de son sentiment à un de ses amis « Je suis peut-être bouché à l’émeri, mais je ne puis comprendre qu’un monsieur puisse employer trente pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil ».
Proust est ulcéré par ce mépris et s’adresse alors à un quatrième éditeur, Bernard Grasset. Comme Gallimard, Grasset est un éditeur qui a créé sa propre maison ; en peu de temps il s’est fait une place dans le monde éditorial grâce à l’originalité et l’efficacité de ses méthodes. Par l’entremise de son ami René Blum, Proust propose le marché suivant : si Grasset accepte de publier les deux volumes à dix mois d’intervalle, il se chargera non seulement des frais d’impression mais également des frais de publicité. Grasset accepte la proposition et engage avec Proust une active correspondance pour régler les détails. Rapidement un projet de contrat est établi, signé le 11 mars 1913. L’édition se fera aux dépens de l’auteur, le livre sera vendu 3,50 francs et l’auteur touchera 1,50 franc par exemplaire vendu.
Les typographes devront sans cesse recomposer une bonne partie du texte pour tenir compte des ajouts et corrections incessants que demande Proust. D’ailleurs, très honnêtement, celui-ci propose à Grasset de lui facturer ce supplément de travail. C’est au cours de ces remaniements qu’il trouve enfin les titres définitifs : Du côté de chez Swann pour le premier volume, Le Côté de Guermantes pour le second, l’ensemble portant le titre général de A la recherche du temps perdu.
Le 26 juillet 1913, Proust part pour Cabourg où, pour une fois, il ne reste que peu de temps puisqu’il retourne précipitamment à Paris une semaine après. La raison de cet aller-retour imprévu est due à la présence boulevard Haussmann, depuis le mois de mai 1913, d’Alfred Agostinelli, le chauffeur de taxi qui l’avait promené quelques années auparavant à travers la Normandie avec son taxi. Maintenant âgé de vingt-cinq ans, et ayant perdu son travail, le jeune homme est venu le voir deux mois plus tôt pour lui demander d’entrer à son service comme chauffeur. Pour ses déplacements, Proust utilise les services d’Odilon Albaret, homme honnête, disponible, ponctuel et discret, aussi n’a-t-il aucune raison de se séparer de lui d’autant plus qu’Albaret s’est marié en mars 1913 avec une jeune fille, Céleste Albaret, qui vient d’un petit hameau de Lozère. Il offre à Agostinelli de continuer la dactylographie de son livre et le jeune homme se retrouve ainsi secrétaire de Proust.
Agostinelli
Il loge boulevard Haussmann avec Anna, sa compagne. Proust éprouve une passion subite et un amour impossible pour le jeune homme, d’autant plus étonnants qu’il le connaît depuis des années. Sur une photo, Agostinelli apparaît comme un bellâtre à moustache, d’une apparence à mi-chemin entre un chanteur italien et un garçon coiffeur. Sa maîtresse est plutôt laide et les Albaret qui la détestent, l’ont surnommée « le pou volant ». Odilon Albaret trouve qu’Agostinelli est « un gentil garçon », un peu fantasque et soucieux de s’élever dans l’échelle sociale. Doué pour la mécanique, il s’intéresse aux progrès de l’aviation et rêve de prendre des leçons de pilotage.
Proust continue de corriger les épreuves avec minutie, au point qu’il ne reste pas une ligne sur vingt du texte original. Résolu à ne rien épargner pour assurer la réussite de son livre, il met son amour-propre de côté pour aider à la promotion de son livre. Mais lorsque le livre est mis en librairie le 14 novembre 1913, bien rares sont les articles de presse annonçant la parution de Du côté de chez Swann.
Cependant, avec l’appui de certains journaux et de plusieurs amis, le livre connaît bientôt un succès d’estime. 1750 exemplaires sont tirés le 8 novembre 1913, suivis de deux autres tirages de 500 exemplaires chacun. Sans enthousiasme, les critiques sont toutefois conscients qu’on a là une œuvre peu ordinaire. Sans être un triomphe, cette opération n’est pas un échec pour Grasset. Marcel Proust et l’éditeur présentent le livre au prix Goncourt où il n’obtiendra pas une seule voix.
Marcel continue à travailler activement sur le deuxième volume qui doit s’intituler Le Côté de Guermantes. De nouveaux personnages apparaissent et Proust modifie profondément la structure du livre. Après de multiples ajouts, il obtient un ensemble cohérent, tellement volumineux qu’il n’est plus envisageable de le publier en un seul volume.
Alors qu’il est absorbé par la sortie de son livre, une bombe éclate boulevard Haussmann. Comme la vieille Françoise annoncera au Narrateur, dans Albertine disparue, le départ subit d’Albertine, la bonne annonce à Proust : « M. Alfred est parti ! ». En effet, Alfred Agostinelli, méridional habitué à une vie au grand air, ne supporte plus d’être enfermé tout au long des jours dans l’obscurité, le silence et l’odeur âcre des fumigations, sous la surveillance jalouse et constante d’un Proust qui, ne pouvant faire de lui son amant, veut vraisemblablement l’empêcher de l’être pour qui que ce soit d’autre, homme ou femme. Alfred est donc parti en ce matin du 1er décembre 1913, emmenant sa peu gracieuse Anna, ce dernier point étant un soulagement pour toute la maison.
Il a pris avec lui toutes ses économies, assez considérables car Proust s’est toujours montré généreux avec lui. Les fugitifs ont gagné Monaco où habite la famille d’Agostinelli. Proust est accablé et désespéré. Toutes ses tentatives pour faire revenir le jeune homme échouent.
Agostinelli sorti de son existence, il faut à Proust recommencer à vivre et à s’occuper de son livre. Certains critiques s’étonnent, à juste titre, du nombre de fautes d’impression qui émaillent le texte dont certaines, fort grossières, n’auraient pas dû échapper, ni à Proust, ni au correcteur de Grasset.
Il faudrait reprendre tout le texte et le réviser. Au-delà de ces erreurs techniques, la critique continue de se montrer réticente. Par ailleurs, Proust aborde un problème qui ne cessera de hanter nombre de ses lecteurs et surtout de ses biographes et exégètes, celui de l’identification du Narrateur, sans âge, sans état et même sans nom, ressemblant à l’auteur comme un frère. Il se défend d’être ce Narrateur en insistant sur son rôle de romancier. De même, plus tard, il n’admettra pas s’être inspiré de tel ami ou de tel personnage pour les portraits de ses romans. Il reconnaîtra seulement avoir emprunté à plusieurs personnes, parfois très dissemblables, des traits de caractères ou de mœurs pour composer un personnage entièrement nouveau.
On commence à parler de Proust et, si les ventes restent modestes elles sont régulières. La N.R.F. manifeste alors le désir d’arracher Proust à son éditeur et lui propose de publier les deux autres volumes d’A la recherche du temps perdu, mais se sentant lié par l’honneur, à défaut de l’être par contrat, Proust répond qu’il acceptera l’offre de la N.R.F. à la double condition que Grasset lui rende sa liberté et qu’il assume les frais d’impression s’il passe à la N.R.F
. Cette deuxième exigence, tout à fait saugrenue, ne peut être acceptée par Bernard Grasset. S’en suivent de nombreux échanges de courriers, Bernard Grasset n’apprécie pas la demande de Proust à qui il finit par dire quant à son choix d’un éditeur : « Décidez dans la plénitude de votre indépendance ». En attendant qu’une décision soit prise, Grasset se débat avec la composition du second volume. Pendant ce temps, Proust continue sa croisade auprès de la critique et de l’opinion pour assurer à la fois la diffusion de son livre et la reconnaissance de son talent.
Il rencontre une fois de plus des difficultés financières, amplifiées par les incessantes demandes d’argent d’Alfred Agostinelli qui, installé sur la côte méditerranéenne, a pu réaliser son rêve en s’inscrivant dans une école de pilotage. Après le choc causé par son départ brutal, Proust s’est réconcilié avec lui et les deux hommes entretiennent une correspondance suivie. Toujours aussi généreux, Proust offre à son ancien secrétaire l’aéroplane de ses rêves d’une valeur de 27000 F (environ 100000 € de 2015). Pour trouver ces fonds, il doit liquider des actions.
Le 30 mai 1914, il apprend que l’avion d’Agostinelli s’est abîmé dans les flots et que son pilote qui ne savait pas nager est mort noyé. Le choc est terrible. Proust va dépenser des sommes importantes pour que l’on retrouve le corps, ce qui sera fait. A la suite de cet accident, la discorde est entrée dans la famille Agostinelli. Elle dépense l’argent sans compter et Proust, peu rancunier et toujours généreux, continue à leur apporter son aide financière.
Cette disparition tragique cause à Proust un chagrin profond et il oubliera tous les côtés négatifs pour ne garder en mémoire que les qualités du disparu, son charme, son intelligence. Face à la douleur, il se réfugie dans le travail et ce triste accident va se révéler source d’inspiration. Ainsi certains épisodes de la vie d’Agostinelli, son existence de captif boulevard Haussann, puis sa mort brutale dans cet accident d’avion contribueront pour une large part à des développements imprévus dans La Prisonnière et dans Albertine disparue.
La guerre éclate début août 1914 et dès la fin du mois les allemands menacent Paris. Odilon Albaret, puis Nicolas Cottin, sont mobilisés et pour ne pas laisser seul Proust et ne pas rester seule elle-même, Céleste Albaret quitte son appartement de Levallois-Perret pour s’installer boulevard Haussmann. Puis Proust recrute un valet de pied, un jeune suédois car tous les jeunes français ont été mobilisés. Début septembre, Proust et ses deux domestiques partent pour Cabourg.
Le voyage est épuisant, puisqu’il leur faut deux jours dans des trains bondés pour atteindre leur destination. L’offensive allemande a été arrêtée sur la Marne et Proust se prépare à rentrer chez lui, d’ailleurs il n’a plus d’argent et puis le Grand Hôtel a été réquisitionné. Durant le voyage de retour et les jours qui suivent, Proust est épuisé par de violentes crises d’asthme. Il obtient de plusieurs médecins des certificats attestant de son inaptitude à prendre du service dans l’armée et il organise alors son existence de civil en guerre. Il réduit son train de vie et se sépare de son maître d’hôtel, ce qui ravit Céleste qui ne l’a jamais aimé. Proust et Céleste règlent alors leur vie, Céleste ne sort plus guère et se dévoue tout entière au service de Proust.
Céleste et son mari Odilon Albaret
Bien vite, elle devient son ange gardien. Venue de sa campagne reculée de Lozère, habituée, comme elle le dira plus tard, « à se coucher avec les poules et à se lever avec les coqs », la voilà qui doit s’accoutumer à ne dormir que quelques heures, toujours prête à répondre aux caprices d’un maître difficile, pointilleux, exigeant. Ainsi, une des tâches de Céleste consiste à préparer du café qui doit être prêt à toute heure et fait selon un cérémonial précis qui se reproduit plusieurs fois par vingt-quatre heures.
Généralement Proust se réveille au milieu de l’après-midi. Il commence alors les fumigations qui soulagent son asthme et la chambre se remplie d’une brume si dense qu’il devient difficile d’apercevoir les meubles. Malgré cela, il est interdit d’ouvrir les fenêtres. Dans ces conditions, faire le ménage devient un exploit que Céleste n’accomplit que rarement, à l’occasion des sorties nocturnes de son maître. Elle se plie à tous ses caprices avec une patience étonnante.
Ainsi, il faut mettre à sa disposition des piles de mouchoirs très fins car lorsqu’il s’est essuyé le nez avec l’un d’eux, sans se moucher jamais, il le jette par terre. Elle lui prépare ses boules d’eau chaude, s’occupe de la garde-robe, mais jamais, au grand jamais, ne voit Proust à sa toilette, c’est le domaine interdit de cet homme d’une grande pudeur. Pour cette toilette, il se tamponne le corps avec des serviettes qu’il jette ensuite par terre, il en utilise ainsi une vingtaine chaque jour. Il ne couche jamais deux nuits de suite dans les mêmes draps.
Il passe le plus clair de son temps à travailler allongé sur son lit, les jambes repliées, ses genoux lui servant de pupitre, soutenu par deux oreillers et emmitouflé de plusieurs lainages et de châles, tant il est frileux.
Le plus extraordinaire est que, malade comme il l’est, il ne cesse de travailler, ne se nourrissant parfois pour toute la journée que d’un café accompagné d’un croissant et de lait, lui aussi chauffé et servi selon un cérémonial immuable. Ses caprices sont nombreux et Céleste les satisfait tous, sans broncher. Il était fin gourmet – rapporte t’elle – ou plutôt l’avait été. « Je voyais bien que ses envies le prenaient comme des coups de souvenir ».
Proust souhaite-t-il au milieu de la nuit manger une glace ? Odilon Albaret, le mari de Céleste, va aussitôt avec son taxi chercher l’entremets souhaité au Ritz où l’on fabrique les meilleures glaces de Paris, mais souvent, une fois servi, Proust goûte une cuillerée et repousse son assiette à peine entamée. Une autre fois, c’est un gâteau au chocolat qu’on va chercher chez Latainville rue de la Boétie, une autre fois encore une poire. Lorsqu’il se lève pour sortir, il laisse son lit jonché de journaux, de revues et de petits papiers sur lesquels il a pris des notes. Céleste les range soigneusement sans jamais rien jeter.
En raison de la guerre, la parution du deuxième tome de La Recherche est suspendue. Proust en profite pour reprendre son texte à loisir, le retravailler et l’enrichir.
La guerre s’enlise dans les tranchées. Les hécatombes des premiers mois accélèrent le rythme de la conscription et les conseils de réforme se montrent de moins en moins exigeants. Proust craint que les certificats médicaux qu’il a obtenus ne suffisent pas à l’exempter d’un service et multiplie les démarches pour échapper à une incorporation. Le 13 avril après les affres de l’attente, il reçoit une convocation pour un conseil de réforme à l’Hôtel de ville. Affolé, il se fait délivrer par son médecin un certificat précisant qu’il n’est pas en état de se présenter à l’Hôtel de Ville
. Il réitérera à deux reprises la production d’un certificat médical. Lorsqu’enfin il est obligé d’obtempérer aux convocations, il est surpris de constater que les majors qui l’examinent ignorent tout de lui. Le nom de Proust ne leur évoque rien, ni les travaux de son père, ni ceux de son frère. Il est ajourné pour six mois et peut retourner à ses travaux et à ses soucis d’argent. Au milieu des angoisses de la guerre, sa préoccupation principale est de pouvoir terminer son œuvre avant que la mort le prenne.
On a vu que Gallimard a pris conscience de l’erreur commise en refusant l’édition de Du côté de chez Swann. Gide qui est à l’origine de ce refus, écrit alors à Proust une lettre restée célèbre : « Depuis quelques jours je ne quitte plus votre livre. Hélas ! Pourquoi faut-il qu’il me soit si douloureux de tant l’aimer ? » En juillet 1915, Grasset confirme à Proust son intention de poursuivre la publication d’A la recherche du temps perdu, toutefois sans être en mesure de donner une date même approximative car la maison est pratiquement fermée.
Proust, dont la principale raison de vivre est la publication de son œuvre, ne veut pas attendre davantage. En février 1915, Gide, vraisemblablement envoyé par Gaston Gallimard, l’informe qu’il serait le bienvenu à la N.R.F. Gallimard lui propose de faire imprimer dès à présent A l’ombre des jeunes filles en fleurs, de mettre l’ouvrage en vente le mois suivant et envisage même de racheter les droits de Du côté de chez Swann à Grasset. Après des discussions longues et compliquées, Bernard Grasset finit par déclarer à un émissaire de Proust venu plaider sa cause : « …
Marcel Proust veut une rupture ; j’ai, croyez-le, trop de fierté pour retenir un auteur qui n’a plus confiance en moi et je lui faciliterai la reprise complète de sa liberté. ». La rupture du contrat intervient en août 1916. Proust envoie à Gallimard la première partie d’ A l’ombre des jeunes filles en fleurs et annonce la seconde partie qui sera effectivement remise en mars 1917 avec les premières pages de Le côté de Guermantes. Les imprimeurs sortent Les Jeunes Filles en Fleurs le 30 novembre 1918. Dans le même temps, Proust corrige les épreuves de Le côté de Guermantes. A l’ombre des jeunes filles en fleurs et la nouvelle édition de Du côté de chez Swann paraissent enfin en juin 1919. Un succès modeste n’empêche pas Proust d’avoir confiance en lui et, en septembre, sur la pression de certains de ses amis parmi lesquels un Léon Daudet enthousiaste, il pose sa candidature au prix Goncourt pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs.
Après trois années de guerre, la vie sociale a repris à Paris, au grand dam des permissionnaires rentrés du front. Lassés, d’héroïques les Parisiens sont devenus frivoles. Proust lui-même recommence à sortir dans le monde. Dans les salons parisiens, son arrivée tardive et son aspect fantomatique surprennent les invités. Il a besoin de nouveaux visages pour remplacer ceux déjà nombreux qui se sont effacés de sa vie. Mais Proust ne fréquente pas que du beau monde. Certains sont moins fréquentables tel un ancien valet de pied, Albert le Cuziat, entremetteur idéal et discret, que Proust a certainement connu avant la guerre.
Le Cuziat a fini par acheter un établissement, l’hôtel Marigny, rue de l’Arcade, pour en faire une maison de rendez-vous où se rendent de nombreux aristocrates et bourgeois qu’il a connus à l’époque où il était maître d’hôtel. Intéressé par sa connaissance prodigieuse de l’étiquette et de la généalogie, Proust l’invite à plusieurs reprises dans son appartement du boulevard Haussmann pour lui soutirer des informations.
Il se rend personnellement à l’hôtel Marigny où il constate que certains meubles qu’il avait donnés à Albert, pour l’aider à s’installer à ses débuts, trônent dans ce « temple de l’impudeur » (ceci rappelle le canapé de tante Léonie retrouvé dans un lupanar fréquenté par le Narrateur). Il devient un visiteur assidu de l’établissement où, vraisemblablement, il n’a joué qu’un rôle de voyeur favorisant ses plaisirs solitaires mais ses visites lui ont probablement inspiré la séance de flagellation de Charlus dans La Recherche.
Au printemps de 1917, au cours d’une visite à la princesse Soutzo, Proust découvre le confort et l’élégance de l’hôtel Ritz, la qualité de son service et de sa table. A partir de ce moment, il abandonne peu à peu Larue et le café Weber pour prendre ses quartiers au Ritz où il donne de somptueux dîners qu’il préside, pâle et funèbre, et au cours desquels il glane des anecdotes à utiliser dans ses écrits.
Proust décide de composer Sodome et Gomorrhe, un volume suivi de deux autres, La Prisonnière puis La Fugitive, qui comme les précédents, rassemblent des cahiers déjà écrits qu’il défait, complète, réorganise en ajoutant de nouveaux personnages et de nouveaux thèmes.
En 1908, après la mort de ses parents, Proust s’était installé au 102 du boulevard Haussmann, dans un appartement appartenant à son grand-oncle Louis qu’il a toujours apprécié, se sentant bien parmi les meubles de son choix les plus chargés de souvenirs. En 1918 sa tante vend l’appartement sans le prévenir. Proust voit là une trahison dont il souffre beaucoup. Après plusieurs mois de recherche, il s’installe pour quelque temps dans un appartement situé rue Hamelin.
Peu satisfait, il déménage à nouveau rue Laurent-Pichat près de l’avenue Foch, dans un appartement situé dans l’hôtel particulier de la grande comédienne Réjane, très admirée de Proust. Mais là encore, il ne se sent pas chez lui et finalement il s’installe au 4ème étage du 44 rue Hamelin en 1919. Il fait exécuter des travaux contre le bruit et, pour plus de sécurité encore, il loue au propriétaire l’appartement situé à l’étage supérieur.
La vie s’organise, mais l’appartement s’avère trop petit pour y loger tous ses meubles familiers. Proust ne supporte pas le chauffage central à cause de son asthme, mais les cheminées du nouvel appartement sont petites et le tirage fonctionne mal. L’appartement est glacial et humide et Proust, de plus en plus frileux, doit enfiler une couche supplémentaire de lainages et de châles. Conscient que sa santé décline, il sent que la mort le talonne et craint de ne pouvoir finir son œuvre.
En 1918, cette œuvre est presque achevée. La Recherche comprend désormais cinq volumes dont deux sont déjà parus, Du côté de chez Swann en 1913 et A l’ombre des Jeunes filles en fleurs. Le tome III, Le Côté de Guermantes ainsi que les suivants sont prêts à sortir. Le tome IV est intitulé Sodome et Gomorrhe I et sera suivi d’un Sodome et Gomorrhe II – Le Temps retrouvé. Mais ce plan n’est pas définitif et de nouveaux découpages interviennent, sans remise en cause de la structure générale toutefois. Les titres de La Prisonnière et de La Fugitive n’existent pas encore mais le contenu de ces futurs volumes est inclus sous forme de chapitres dans Sodome et Gomorrhe II.
En décembre 1919, Proust se voit avec bonheur décerner le prix Goncourt pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Ce prix lui est attribué par six voix contre quatre pour Les croix de bois de Roland Dorgelès. Le livre sera apprécié par l’élite mais ne rencontrera pas un succès de masse.
Le Côté de Guermantes paraîtra en deux parties. La première, Le Côté de Guermantes I est édité en 1920, provoquant le mécontentement de certains amis de Proust qui se reconnaissent dans l’ouvrage sous une description peu flatteuse. Quelques-uns iront jusqu’à se brouiller avec l’auteur. Le Côté de Guermantes II paraît le 2 mai 1921 et encore une fois, l’accueil est mitigé.
Le travail et la gloire écartent Proust de ses amis. Il ne recherche plus le monde et ressent un besoin de solitude, refusant les invitations devenues plus nombreuses depuis sa reconnaissance littéraire. Désormais, il préfère les causeries en tête à tête avec des amis fidèles. L’un d’eux, Bernard Faÿ décrit ainsi l’antre de la rue Hamelin : « Une fumée épaisse régnait dans la pièce, elle dissimulait les murs qu’on apercevait à peine, mais on distinguait une masse blanche dans un grand lit. Le visage de Proust, blafard et bouffi, semblait grisâtre à cause de la barbe mal taillée qui y poussait; la voix le paraissait aussi … Tout autour de Proust, sur les couvertures, s’étalaient en désordre des feuilles d’épreuves, griffonnées et noircies de corrections. Je ne pouvais comprendre comment la pâle lumière d’une lampe si faible lui suffisait pour ce travail épuisant et délicat. »
Au lieu de se soigner selon les règles, Proust continue de suivre un régime alimentaire absurde et de faire une grande consommation de médicaments. Insomniaque, il alterne la prise de somnifères puis d’excitants pour sortir de sa torpeur. Toutes ces drogues finissant par perdre de leur efficacité, il doit augmenter sans cesse les doses pour obtenir quelque effet, et tout ceci hors contrôle médical. Il se nourrit de plus en plus mal, refusant les plats que Céleste va chercher chez Larue. Bien souvent, il se contente de croissants et de café. Et pourtant il ne cesse pas de travailler. Le nouveau tome de La Recherche, le Côté de Guermantes est en cours d’impression et, à la lecture, Proust découvre horrifié des erreurs grossières passées inaperçues lors de la correction des épreuves. C’est André Breton, le correcteur, qui s’est acquitté de son travail avec une coupable désinvolture. Gallimard est assailli de plaintes émanant de Proust, parfois justifiées mais le plus souvent parfaitement saugrenues.
Proust ne dédaignerait pas de rentrer à l’Académie Française. Venue sur une vague proposition d’Henri de Régnier, l’idée chemine dans son esprit et Proust commence à parler de ce projet à des amis comme Paul Morand, sans cacher qu’il faut agir vite car il est persuadé qu’après la publication de Sodome et Gomorrhe la chose ne sera plus possible. Il recherche l’appui de Barrès, mais il prend conscience que le projet est mal engagé, et renonce à devenir un éphémère immortel. A l’automne, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur à la suite d’une démarche collective de ses amis auprès du ministre de l’Instruction publique.
Le Côté de Guermantes I est sorti à la fin du mois d’octobre 1920 en dépit des nombreuses fautes d’impression qui n’ont pu être corrigées à temps. La plupart des gens de la société parisienne sont moins intéressés par l’histoire que par les portraits que, sous le voile d’une fiction, Proust a pu faire d’eux-mêmes ou de leurs amis. Ce livre vaut à Marcel Proust le statut de grand écrivain.
Sa santé se détériore, il continue pourtant à travailler avec acharnement sur la première partie de Sodome et Gomorrhe dont il fait paraître quelques extraits dans la presse. Le volume est mis en vente le 29 avril 1921. A nouveau certains de ses amis s’irritent de se reconnaître. La deuxième partie sort au mois d’avril de l’année suivante. Ce sera le dernier ouvrage publié du vivant de Marcel Proust.
Les dernières semaines de la vie de Proust seront très actives. Il rassemble les cahiers dont certains ont été écrits dès 1915, les retouche, les complète pour bâtir une composition romanesque cohérente qui deviendra bientôt le cinquième volet de La Recherche : La Prisonnière se substituant au Sodome et Gomorrhe III initialement prévu. De même Sodome IV deviendra La Fugitive pour s’intituler ensuite Albertine disparue, le titre étant déjà pris par un autre écrivain.
En septembre 1922, des crises d’asthme d’une violence exacerbées s’accompagnent de vertiges à l’origine de plusieurs chutes. Proust ne quitte sa chambre que très exceptionnellement, pour aller dîner au Ritz aux environs de quatre heures du matin. Jamais il n’a été aussi obsédé par le travail. Le début de La Prisonnière ne le satisfait pas et il remanie trois fois la dactylographie existante. Il corrige sans cesse les manuscrits d’Albertine disparue. La fidèle Céleste, l’aide toujours à coller les becquets et autres paperolles, mais sa santé continue à se détériorer, son corps est usé, il ne dort plus et ne mange plus.
Ses sorties s’espacent de plus en plus. Au cours de la dernière qui date d’octobre 1922, il prend froid et la grippe s’installe. Proust refuse les soins de son médecin et de son frère Robert. Seuls breuvages tolérés, un peu de café et surtout de la bière fraîche que le fidèle Odilon va chercher aux cuisines désertes du Ritz.
Céleste le veille avec une abnégation remarquable. Bien qu’épuisée, elle refuse de quitter le chevet de son malade. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, malgré son état de grande faiblesse, il appelle Céleste pour l’aider à travailler, ajoutant : « Si je passe cette nuit, je prouverai aux médecins que je suis plus fort qu’eux. Mais il faut la passer. Croyez-vous que j’y arriverai ? ».
Et tous deux commencent une fastidieuse besogne de corrections et d’ajouts. A trois heures et demie du matin, à bout de force, il avoue : « je suis trop fatigué, arrêtons Céleste, je n’en peux plus, mais restez là » et il lui fait alors des recommandations pratiques concernant ses papiers et ses cahiers. A l’aube, il réclame du café, puis demande à Céleste de le laisser seul. Céleste appelle le médecin qui lui fait une piqûre contre sa volonté, on lui pose des ventouses, on lui administre de l’oxygène, mais rien n’y fait. Son frère Robert arrive et, après s’être consultés, les deux médecins décident de cesser leurs soins. Proust s’éteint le 18 novembre 1922 à quatre heures et demi de l’après-midi en présence de son frère Robert et de Céleste.
Dessin réalisé par Paul Morand (Galerie Gallimard)
(notons l’erreur de la date portée sur ce dessin : 19 octobre 1922 alors que Marcel Proust est mort le 18 novembre)
Ses funérailles ont lieu le mardi 21 novembre, en l’église de Saint-Pierre-de-Chaillot, avec les honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d’Honneur. L’assis-tance est très nombreuse. Il est inhumé auprès de ses parents, dans la partie haute du Père-Lachaise.
La version de La Prisonnière, remise à Gaston Gallimard après la mort de Proust, et révisée par son frère Robert et un ami Jacques Larivière, sera publiée le 14 novembre 1923. Albertine disparue paraîtra en 1925 et enfin Le Temps retrouvé dont l’écriture a débuté très tôt (Proust ne disait-il pas que Combray et Le Temps retrouvé avaient été écrits ensemble) ne paraîtra qu’en 1927, soit cinq ans après la disparition de Proust.
Marcel Proust, biographie (t. I)
de Jean-Yves Tadié,
édition 2011.
________________
Proust (au 2e rang, le 1er à gauche) au lycée Condorcet, 1888-1889.
Jean Béraud, La Sortie du lycée Condorcet.
De gauche à droite : Robert de Flers, Marcel Proust et Lucien Daudet, v. 1894.
Proust devance l'appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire en 1889-1890
Rédaction de Jean Santeuil
Boldini, Robert de Montesquiou.

L'esthétique de Ruskin
Gustave Caillebotte, Jeune homme à la fenêtre (1876).
Immeuble (no 102, boulevard Haussmann) où vécut Marcel Proust de 1907 à 1919.
L'écriture de La Recherche
Plaque au 44 rue de l'Amiral-Hamelin.
La carrière artistique de Marcel Proust
Succès, renom et autres anecdotes sur Marcel Proust
Parmi ses dizaines de titres, Marcel Proust met en relief les sentiments. Dans ses romans, il était un des premiers auteurs à mettre de l’importance à l’homosexualité. Cette dernière est surement un caractère marquant sa biographie. Autrement, en 1919, Proust reçoit le prix Goncourt grâce à son œuvre intitulée « A l’ombre des jeunes filles en fleur ». Actuellement, ses écrits font objet d’analyse littéraire et de réflexion philosophique. De nombreux auteurs contemporains y trouvent inspiration. Finalement, en hommage à cet écrivain légendaire, le jardin et la maison de Tante Léonie à Illiers-Combray, source de ses inspirations, sont classés monuments historiques.
Contre Sainte-Beuve
Le Contre Sainte-Beuve n'existe pas réellement : il s'agit d'un ensemble de pages, publiées à titre posthume en 1954 sous la forme d'un recueil associant des courts passages narratifs et de brefs essais (ou esquisses d'essais) consacrés aux écrivains que Proust admirait tout en les critiquant : Balzac, Flaubert, etc. Il y attaque Charles-Augustin Sainte-Beuve et sa méthode critique selon laquelle l'œuvre d'un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et ne pourrait s'expliquer que par elle. En s'y opposant, Proust fonde sa propre poétique ; on peut considérer À la recherche du temps perdu comme une réalisation des idées exposées dans ces pages, dont certaines sont reprises par le narrateur proustien dans Le Temps Retrouvé, ou attribuées à des personnages ; d'autre part, nombre de passages narratifs ont été développés dans le roman.
Pastiches et Mélanges
Pastiches et Mélanges est une œuvre que Proust publie en 1919 à la NRF. Il s'agit d'un recueil de préfaces et d'articles de presse parus principalement dans Le Figaro à partir de 1908, rassemblés en un volume à la demande de Gaston Gallimard.
Un extrait de cette œuvre "Journées de Lecture", préface à la traduction de Sésame et les lys de Ruskin, a été publié notamment chez 10-18, 1993 (ISBN 2-2640 1811-9), Gallimard, 2017 (ISBN 978-2-0727-0534-2) et Publie.net.
À la recherche du temps perdu[modifier | modifier le code]
Article détaillé : À la recherche du temps perdu.
|
Des critiques[Qui ?] ont écrit que le roman moderne commençait avec Marcel Proust. En rompant avec la notion d'intrigue, l'écrivain devient celui qui cherche à rendre la vérité de l'âme. La composition de La Recherche en témoigne : les thèmes tournent selon un plan musical et un jeu de correspondances qui s'apparentent à la poésie. Proust voulait saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui des fluctuations de la mémoire affective. Il laisse des portraits uniques, des lieux recréés, une réflexion sur l'amour et la jalousie, une image de la vie, du vide de l'existence, et de l'art.
Son style écrit évoque son style parlé, caractérisé par une phrase parfois longue, « étourdissante dans ses parenthèses qui la soutenaient en l'air comme des ballons, vertigineuse par sa longueur, (...) vous engaînait dans un réseau d'incidentes si emmêlées qu'on se serait laissé engourdir par sa musique, si l'on n'avait été sollicité soudain par quelque pensée d'une profondeur inouïe », mais selon « un rythme d'une infinie souplesse. Il le varie au moyen de phrases courtes, car l'idée populaire que la prose de Proust n'est composée que de phrases longues est fausse (comme si d'ailleurs les phrases longues étaient un vice)36 ».
Épreuve annotée de Du côté de chez Swann, vendue chez Christie's en pour 663 750 £.
« Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y ait d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et qui, bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial.
« Ce travail de l'artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots, quelque chose de différent, c'est exactement le travail inverse de celui que, chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l'amour-propre, la passion, l'intelligence, et l'habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie » (Le Temps retrouvé).
Dernière page de La Recherche.
L'œuvre de Marcel Proust est aussi une réflexion majeure sur le temps. La « Recherche du Temps Perdu » permet de s'interroger sur l'existence même du temps, sur sa relativité et sur l'incapacité à le saisir au présent.
Une vie s'écoule sans que l'individu en ait conscience et seul un événement fortuit constitué par une sensation — goûter une madeleine, buter sur un pavé — fait surgir à la conscience le passé dans son ensemble et comprendre que seul le temps écoulé, perdu, a une valeur (notion de « réminiscence proustienne »). Le temps n'existe ni au présent, ni au futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche de la mort. La descente de l'escalier de Guermantes au cours de laquelle le Narrateur ne reconnaît pas immédiatement les êtres qui ont été les compagnons de sa vie symbolise l'impossibilité qu'il y a à voir le temps passer en soi comme sur les autres.
On garde toute sa vie l'image des êtres tels qu'ils nous sont apparus le premier jour et la prise de conscience de la dégradation opérée par le temps sur leur visage nous les rend méconnaissables jusqu'à ce que les ayant reconnus l'individu prenne conscience de sa mort prochaine. Seule la conscience du temps passé donne son unité au quotidien fragmenté.
Le Grand Hôtel à Cabourg, où Proust séjourna chaque été de 1907 à 1914.
L'analyse du snobisme et de la société aristocratique et bourgeoise de son temps fait de l'œuvre de Proust une interrogation majeure des mobiles sociaux de l'individu et de son rapport aux autres, instruments de l'ascension sociale. Comme Honoré de Balzac, Marcel Proust a su créer un monde imaginaire, peuplé de personnages devenus aujourd'hui des types sociaux ou moraux. Comme le Père Goriot, Eugénie Grandet, la Duchesse de Langeais ou Vautrin chez Balzac, Madame Verdurin, la duchesse de Guermantes, Charlus ou Charles Swann sont, chez Proust, des personnages en lesquels s'incarne une caractéristique particulière : ambition, désintéressement, suprématie mondaine, veuleriem,37,38.
Relations entre les personnages.
L'amour et la jalousie sont analysés sous un jour nouveau. L'amour n'existe chez Swann, ou chez le narrateur, qu'au travers de la jalousie. La jalousie, ou le simple fait de ne pas être l'élu, génèrerait l'amour, qui une fois existant, se nourrirait non de la plénitude de sa réalisation, mais de l'absence. Swann n'épouse Odette de Crécy que lorsqu'il ne l'aime plus. Le Narrateur n'a jamais autant aimé Albertine que lorsqu'elle a disparu (voir Albertine disparue). On n'aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d'inaccessible, on n'aime que ce qu'on ne possède pas, écrit par exemple Proust dans La Prisonnière. Cette théorie développée dans l'œuvre reflète exactement la pensée de Proust, comme l'illustre la célèbre rencontre entre l'écrivain et le jeune Emmanuel Berl, rencontre que ce dernier décrira dans son roman Sylvia (1952). Lorsque Berl lui fait part de l'amour partagé qu'il éprouve pour une jeune femme, Proust dit sa crainte que Sylvia ne s'interpose entre Berl et son amour pour elle, puis devant l'incompréhension de Berl, qui maintient qu'il peut exister un amour heureux, se fâche et renvoie le jeune homme chez lui.
La Recherche réserve une place importante à l'analyse de l'homosexualité, en particulier dans Sodome et Gomorrhe où apparaît sous son vrai jour le personnage de Charlus.
Enfin, l'œuvre se distingue par son humour et son sens de la métaphore. Humour, par exemple, lorsque le Narrateur reproduit le style lyrique du valet Joseph Périgot ou les fautes de langage du directeur de l'hôtel de Balbec, qui dit un mot pour un autre (« le ciel est parcheminé d'étoiles », au lieu de « parsemé »). Sens de la métaphore, lorsque le Narrateur compare le rabâchage de sa gouvernante, Françoise, une femme d'extraction paysanne qui a tendance à revenir régulièrement sur les mêmes sujets, au retour systématique du thème d'une fugue de Bach.
Influences de Proust
Selon Jacques de Lacretelle, "les deux écrivains qui ont marqué Proust le plus profondément et donné un axe à la Recherche du temps perdu sont sans conteste Saint Simon et Balzac"
___________________________________
Publiés par Proust
John Ruskin, La Bible d'Amiens, traduction, notes et préface par M. Proust, 1904.
- Les Plaisirs et les Jours, Calmann-Lévy, 1896, recueil qui contient notamment la nouvelle « La Fin de la jalousie »
- La Bible d'Amiens, préface, traduction et notes de l'ouvrage de John Ruskin, The Bible of Amiens, Mercure de France, 1904
- Sésame et les lys, traduction de l'ouvrage de John Ruskin, Sesame and Lilies, Mercure de France, 1906, avec une longue préface de Proust intitulée » Sur la lecture »Ces deux traductions proustiennes des ouvrages de Ruskin ont été réunies dans une édition critique établie par Jérôme Bastianelli, collection Bouquins, Robert Laffont, 2015.
- Pastiches et Mélanges, NRF, 1919
Éditions posthumes
- Chroniques, 1927
- Jean Santeuil, 1952
- Contre Sainte-Beuve, 1954
- Le chagrin de la marquise, 1961
- Chardin et Rembrandt, Le Bruit du temps, 2009
- Le Mensuel retrouvé, précédé de « Marcel avant Proust » de Jérôme Prieur (sous-titré Inédits), éditions des Busclats,
- Mort de ma grand-mère, suivie d'une conclusion de Bernard Frank (écrivain). Grenoble, Éditions Cent Pages, 2013
À la recherche du temps perdu
Éditions originales
À la recherche du temps perdu, tome 1, édition 1919.
- Du côté de chez Swann,
- Grasset,
- 1913
- Partie 1 : Combray

- Partie 2 : Un amour de Swann
- Partie 3 : Noms de pays : le nom
- _____________

- À l'ombre des jeunes filles en fleurs,
- NRF, 1918, prix Goncourt
- Le Côté de Guermantes I et II,
- 1921-1922

- Sodome et Gomorrhe I et II,
- 1922-1923
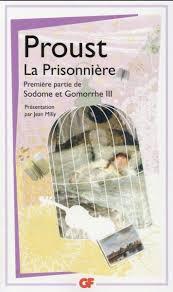
- La Prisonnière,
- 1923

- Albertine disparue (La Fugitive),
- 1925
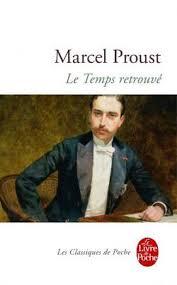
- Le Temps retrouvé,
- 1927
Éditions diverses
- A la recherche du temps perdu : L'essentiel lu par Daniel Mesguich aux éditions Frémeaux & Associés
- Du côté de chez Swann Vol.1 - Coffret 4 CD
- A l'ombre des jeunes filles en fleurs Vol. 2 - Coffret 4 CD
- Le Côté de Guermantes Vol. 3 - Coffret 4 CD
- Sodome et Gomorrhe Vol. 4 - Coffret 4 CD
Le Côté de Guermantes I - Édition originale, NRF, 1920.
- Gallimard : Les quatre versions chez Gallimard utilisent toutes le même texte :
- Pléiade : édition en 4 volumes, avec notes et variantes
- Folio : édition en 7 volumes, poche
- Collection blanche : édition en 7 volumes, grand format
- Quarto : édition en 1 volume, grand format
- Garnier-Flammarion : édition en 10 volumes, poche
- Livre de Poche : édition en 7 volumes, poche
- Bouquins, Robert Laffont : édition en 3 volumes, grand format
- Omnibus, Presses de la Cité : édition en 2 volumes, grand format
- Intégrale, lue par André Dussollier, Guillaume Gallienne, Michael Lonsdale, Denis Podalydès, Robin Renucci et Lambert Wilson aux éditions Thélème
- Texte intégral de l'édition Gallimard de 1946-1947 en ligne sur Gutenberg [archive]
- Le manuscrit retrouvé d'À la recherche du temps perdu, Éditions des Saints Pères, 2016
Correspondance
- Plusieurs volumes posthumes, publiés à partir de 1926.
- Robert de Billy, Marcel Proust, Lettres et conversations, Paris, Éditions des Portiques, 1930.
- Une première édition en 6 tomes (classée par correspondants), publiée par Robert Proust et Paul Brach : Correspondance générale (1930-1936).
- Une grande édition de référence en 21 tomes, où les lettres des volumes précédents sont reprises, augmentées, dotées d'une annotation universitaire et classées chronologiquement par Philip Kolb : Correspondance, Paris, Plon, 1971-1993.
- Une édition anthologique de l'édition de Philip Kolb, corrigée et présentée par Françoise Leriche, avec de nouvelles lettres inédites : Marcel Proust, Lettres, Paris, Plon, 2004.
- M. Proust - R. de Montesquiou. Correspondance, préface de Mathilde Bertrand, Paris, éditions Rivages, coll. « Rivages Poche Petite Bibliothèque », 2019.
Bibliographie
Ouvrages généraux
- Pierre Abraham, Proust, Rieder, 1930
- Pierre Assouline, Autodictionnaire Proust, Omnibus, 2011
- Jérôme Bastianelli, Dictionnaire Proust-Ruskin, Classiques Garnier, 2017, (ISBN 978-2-406-06716-0)
- Samuel Beckett, Proust, essai composé en anglais en 1930, traduit en français par É. Fournier, Les Éditions de Minuit, 1990
- Annick Bouillaguet, Brian G. Rogers (dir.), Dictionnaire Marcel Proust, Honoré Champion, coll. « Dictionnaires et références », 2004
- Georges Cattaui, Marcel Proust, Proust et son Temps, Proust et le Temps, préface de Daniel-Rops, Julliard, 1953
- Pietro Citati, La Colombe poignardée, Proust et la Recherche, Gallimard, 1997
- Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, Le Seuil, 1989
- Antoine Compagnon et autres, Un été avec Proust, Éd. des Équateurs, 2014
- Ernst Robert Curtius, Marcel Proust, Paris, La Revue Nouvelle, 1928
- Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, 1970
- Ghislain de Diesbach, Proust, Perrin, 1991
- Roger Duchêne, L'Impossible Marcel Proust, Robert Laffont, 1994
- Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, Plon/Grasset, 2013
- Michel Erman, Marcel Proust, Fayard, 1994
- Ramon Fernandez, À la gloire de Proust, Éditions de La Nouvelle Revue Critique, 1943 rééd. Grasset sous le titre Proust, 2009 (ISBN 9782246075226).
- Luc Fraisse, L'Éclectisme philosophique de Marcel Proust, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, coll. Lettres françaises, 2013.
- Laure Hillerin, Proust pour Rire - Bréviaire jubilatoire de À la recherche du temps perdu, Flammarion, 2016.
- Edmond Jaloux, Avec Marcel Proust, La Palatine, Genève, 1953
- Julia Kristeva, Le Temps sensible : Proust et l'expérience littéraire, Folio Essai, 2000
- Giovanni Macchia, L'Ange de la Nuit (Sur Proust), Gallimard, 1993
- Diane de Margerie, Proust et l'obscur, Albin Michel, 2010
- Diane de Margerie, À la recherche de Robert Proust, Flammarion, 2016
- Claude Mauriac, Proust par lui-même, coll. « Écrivains de toujours », Seuil, 1953
- François Mauriac, Du côté de chez Proust, La Table ronde, 1947
- André Maurois, À la recherche de Marcel Proust, Hachette, 1949, étude et biographie littéraire46.
- Ouvrage collectif, Proust, Hachette (coll. « Génies et réalités »), c1965, 1972
- George D. Painter (trad. Georges Cattaui (et préface)), Marcel Proust, Mercure de France, (1re éd. 1966-1968), 2 vol. initialement — édition revue, en un volume, corrigée et augmentée d'une nouvelle préface de l'auteur.
- Gaëtan Picon, Lecture de Marcel Proust, Mercure de France, 1963
- Jérôme Picon, Marcel Proust, une vie à s'écrire, Flammarion, 2016
- Léon Pierre-Quint, Marcel Proust, sa vie, son œuvre, Sagittaire, 1946
- Jean-François Revel, Sur Proust, Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 1987
- Jean-Pierre Richard, Proust et le monde sensible, Seuil, 1974
- Ernest Seillière, Marcel Proust, Éditions de La Nouvelle Revue critique, 1931
- Anne Simon, Proust ou le réel retrouvé, Paris, PUF, 2000
- Jean-Yves Tadié, Marcel Proust, Gallimard, coll. « NRF/Biographie », .
- Jean-Yves Tadié, De Proust à Dumas, Gallimard (coll. « Blanche »), 2006
- Edmund White, Marcel Proust, Fides, 2001
- Gilbert Romeyer-Dherbey, La Pensée de Marcel Proust, Classiques Garnier, 2015
« Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense plateau fermé à l'horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seule la pointe fine du clocher de St Hilaire, mais si mince, si rose, qu'elle semblait seulement rayée sur le ciel par un ongle qui eût voulu donner à ce paysage, à ce tableau rien que de nature, cette petite marque d'art, cette unique indication humaine. »
Chemin des aubépines
« Je le trouvais tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir; au-dessous d'elles, le soleil posait un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière.
C'est au mois de mai que je me souviens d'avoir commencé à aimer les aubépines. N'étant pas seulement dans l'église, si sainte, mais où nous avions le droit d'entrer, posées sur l'autel même, inséparables des mystères de la célébration desquels elle prenaient part, elles faisaient courir au milieu des flambeaux et des vases sacrés leurs branches attachées horizontalement les unes aux autres en un apprêt de fête, et qu'enjolivaient encore les festons de leur feuillage sur lequel étaient semés à profusion, comme une traîne de mariée, de petits bouquets de boutons d'une blancheur éclatante... »
« Au haut des branches pullulaient mille petits boutons d'une teinte encore plus pâle qui, en s'entrouvrant laissaient voir, comme au fond d'une coupe de marbre rose, de rouges sanguines et trahissaient plus encore que les fleurs, l'essence particulière, irrésistible de l'épine, qui partout où elle bourgeonnait, où elle allait fleurir, ne le pouvait qu'en rose »
Manoir de Mirougrain - Demeure de Juliette Joinville d'Artois, poètesse
Ce manoir du XVIIIe siècle était l'une des promenades préférées de Marcel Proust pendant ses séjours à Illiers Combray. Dans son enfance, le manoir était occupé par une poétesse, Mademoiselle Juliette Joinville d'Artois qui inspirera le personnage de Mademoiselle Vinteuil dans "A la recherche du temps perdu". Le lieu aurait inspiré Marcel Proust pour" Du côté de Guermantes".
En 1886, elle a fait recouvrir la façade est de son manoir, de blocs mégalithiques provenant des champs environnants, pour marquer son chagrin causé par une déception amoureuse, et les fenêtres ont été agrémentées de linteaux en arc brisé.

Eléments protégés MH: les façades et les toitures : inscription par arrêté du 26 juillet 1977.
Propriété privée.
Le viaduc
« Parfois nous allions jusqu'au viaduc, dont les enjambées de pierre commençaient à la gare et me représentaient l'exil et la détresse hors du monde civilisé, parce que chaque année en venant de Paris, on nous recommandait de bien faire attention, quand ce serait Combray, de ne pas laisser passer la station, d'être prêts d'avance, car le train repartait au bout de deux minutes et s'engageait sur le viaduc au-delà des pays chrétiens dont Combray marquait pour moi l'extrême limite... »
Les ruines du château
« Ils étaient semés des restes, à demi-enfouis dans l'herbe, du château des anciens comtes de Combray qui au moyen-âge avait de ce côté le cours de la Vivonne comme défense contre les attaques des sires de Guermantes et des abbés de Martinville. Ce n'étaient plus que quelques fragments de tours bossuant la prairie, à peine apparents, quelques créneaux d'où jadis l'arbalétrier lançait des pierres, d'où le guetteur surveillait, aujourd'hui au ras de l'herbe, dominés par les enfants de l'école des frères qui venaient là apprendre leurs leçons ou jouer aux récréations... »
____________
_________
___________
__________
____
____________
_________
__________
___________
Nous invitons le lecteur à une promenade à travers le Paris de Marcel Proust, promenade largement illustrée par des photos et reproductions de tableaux et enrichie de passages extraits de « La Recherche » et de témoignages empruntés à certains acteurs de l’époque. Elle a pour ambition d’apporter une lumière sur la capitale de la fin du XIXème et du début du XXème siècles, de la défaite de Sedan en 1871 aux années qui suivent la victoire de 1918, période qui correspond à ce que l’on appellera « la Belle Epoque ».
Embrasement de la Tour Eiffel de Georges Garen
Après la guerre franco-prussienne, l’Europe va vivre une longue période de paix de quatre décennies, chose rare et favorable aux progrès économiques, techniques et sociaux.
La populations de cette époque est optimiste et insouciante quant à l’avenir, grâce aux extraordinaires progrès techniques. La Belle Époque se fait ressentir essentiellement dans les capitales européennes, tant sur les boulevards dans les cafés et les cabarets, dans les ateliers et les galeries d’art, dans les salles de concert et les salons fréquentés par une bourgeoisie qui profite des progrès économiques.
Le bar de Maxim’s par Pierre-Victor Galland
La haute société mêle l’ancienne aristocratie, bien implantée par ses propriétés rurales dans les provinces, et la grande bourgeoisie d’affaires. Des capitaines d’industrie, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques ou des médecins célèbres constituent des élites qui partagent fortune, puissance et influence, au moment où Paris devient le lieu de toutes les spéculations internationales permettant un enrichissement rapide.
Les traditions familiales varient quelque peu pour chacun de ces groupes mais ils partagent le même genre de vie et fréquentent les mêmes lieux. À Paris, ils vivent dans des hôtels particuliers servis par de nombreux domestiques et animent la « saison », c’est-à-dire la période des réceptions et des spectacles qui ont façonné le mythe de la Belle Époque. En été, ils s’installent dans leurs châteaux à la campagne ou dans les villas de la côte normande. Les stations thermales et les stations balnéaires préférées sont Biarritz, Deauville, Vichy, Arcachon et la Côte d’Azur.
Marcel Proust va réussir à se glisser avec détermination et délice dans ce milieu de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie.
Ce site propose par ailleurs des rubriques portant sur la biographie de Marcel Proust, http://proust-personnages.fr/?page_id=4315, ainsi que sur les différents domiciles qu’il a ooccupés à Paris, de sa naissance en 1871 à sa mort en 1922: http://proust-personnages.fr/?page_id=11766 et qui ne seront donc évoqués ici que succinctement
Dans la cour de l’immeuble du boulevard Malesherbe où habite Marcel Proust et sa famille se trouve la boutique d’un tailleur dont s’inspirera Proust pour créer le personnage de Jupien, giletier qui officiait dans la cour de hôtel particulier de la Marquise de Villeparisis.
Même à Paris, dans un des quartiers les plus laids de la ville, je sais un fenêtre où on voit après un premier, un second et même un troisième plan fait des toits amoncelés de plusieurs rues, une cloche violette, parfois rougeâtre, parfois aussi, dans les plus nobles « épreuves » qu’en tire l’atmosphère, d’un noir décanté de cendres, laquelle n’est autre que le dôme Saint-Augustin et qui donne à cette vue de Paris le caractère de certaines vues de Rome par Piranesi (Swann 60/127).
Scène de rue
A neuf ans, lors d’une promenade dominicale au Bois de Boulogne, Marcel est victime soudaine crise d’asthme d’une extrême violence. Son père assiste impuissant aux efforts épuisants de son fils pour reprendre son souffle et pendant un instant craint le pire. La crise finit heureusement par se calmer, mais l’asthme chronique va s’installer et le jeune garçon.
Le Bois de Boulogne par Vincent Van Gogh
Afin de lui éviter les promiscuités vulgaires, Marcel est inscrit au cours Pape-Carpentier où il restera deux ans. Il se lie avec Jacques Bizet, le fils du compositeur, puis il entre, en 1882, au lycée Fontanes, l’un des plus réputés de Paris, qui prendra l’année suivante le nom de Condorcet.
Sortie du lycée Condorcet par Jean Béraud
Après les heures de lycée ainsi que les jeudis et dimanches après-midi, il va jouer aux Champs-Elysées où il tient sa cour, retrouvant des amis qu’il étonne par sa vivacité d’esprit. Doué d’une surprenante mémoire, il déclame devant ses camarades, charmés mais un peu déconcertés, des vers de ses poètes favoris, Musset, Hugo, Lamartine, Racine, Baudelaire. Aux jeux, il préfère la conversation avec ses camarades auxquels il confie les idées tumultueuses qui emplissent son esprit.
Les Champs-Elysées à l’époque de Marcel Proust (Abel Truchet)
LES SALONS LITTERAIRES
Puisqu’il ne rencontre que peu de succès auprès de ses condisciples, Marcel Proust décide de s’attaquer au monde littéraire et de pénétrer les salons parisiens très en vogue à cette époque. Pour parvenir à ses fins tout est bon, relations, charme, flatteries et il réussit puisque bientôt il est admis, très jeune encore, dans plusieurs salons littéraires.
A Anatole France, l’un des écrivains les plus en vue, il écrit une lettre très adroite, lettre anonyme d’un élève de philosophie qui ne demande pas de réponse mais qui lui permettra quelques mois plus tard de rencontrer le célèbre écrivain par des voies détournées. Grâce à ses amis de Condorcet dont Jacques Baignères et Jacques Bizet, il accède avec gourmandise, aux salons de Mmes Baignères et Strauss. Cette dernière deviendra une de ses plus fidèles amies. C’est chez elle qu’il rencontre Charles Haas. C’est à cette époque que naît la réputation d’homme snob de Marcel Proust qui le poursuivra toute sa vie.
Au cours de l’été 1889, Proust est introduit dans le salon de Mme Arman de Callavet qui le présente à Anatole France dont le physique le déçoit, comme l’aspect physique de Bergotte déçoit le Narrateur dans La Recherche.
Le faubourg Saint-Germain est très souvent cité par Marcel Proust car c’est là que se déroulent les nombreuses scènes parisiennes. N’imaginons pas que ce « fameux » faubourg est situé tout entier rive gauche et qu’il correspond comme aujourd’hui aux VIe et VIIe arrondissement. A la lecture de l’œuvre, on comprends vite que ce fameux faubourg Saint-Germain a passé le pont. Dans l’imaginaire de Proust, ce quartier n’a pas de limite et les descriptions qu’il en donne sont aussi approximatives, floues et changeantes que certaines descriptions physiques qu’il fait parfois de ses personnages.
Ces salons sont toujours portés par des femmes, généralement épouses d’hommes importants : politiques, artistes, écrivains. Ce sont des lieux de vie littéraire où les réputations se font et se détériorent. Chaque salonnière a ses protégés, des artistes qu’elle invite, porte, défend et porte sur le devant de la scène. Ce sont des lieux où sont organisées de nombreuses lectures, des représentations.
Le salon de Mme Straus : Mme Straus a épousé le compositeur Georges Bizet avec lequel elle a eu un fils, Jacques, qui est un ami de lycée de Marcel. Devenue veuve en 1875, elle se remarie avec l’avocat Emile Straus en 1886.
Son salon se situe au 134 Boulevard Haussmann. Mme Straus reçoit tous les dimanches et acquiert une grande influence dans Paris. Quoique juive et roturière, elle a de nombreuses relations dans le Faubourg Saint-Germain, tout comme dans le monde des arts et des lettres. Parmi Edgar Degas, Forain, Paul Bourget, Jules Lemaître, Paul Hervieu, Robert de Montesquiou, mais aussi des politiciens comme Léon Blum, des comédiens comme Lucien Guitry, Réjane ou Emma Calvé. Marcel Proust, ami et condisciple au lycée Condorcet de Jacques Bizet, premier mari de Geneviève Straus, et de Daniel Halévy, y rencontre Charles Haas, futur modèle de Swann. Geneviève Straus est elle-même donnée comme l’un des modèles d’Oriane de Guermantes.
Marcel Proust invite fréquemment Mme Straus et son fils au théâtre, lui envoie des fleurs, lui adresse des compliments et, charmeur, feint d’être amoureux d’elle.
Geneviève Halévy par Nadar
Le salon de Madame Baignères qu’elle tient dans son hôtel au 40 de la rue du Général-Foy, Elle y reçoit chaque semaine le « tout-Paris » politique, financier, militaire, artistique littéraire et musical. Son fils unique, Jacques Baignères s’est lié d’amitié avec Marcel au Lycée Condorcet l’a introduisit dans le salon de sa mère à Paris ainsi qu’à Trouville. Nombreux sont les personnages et les lieux inspireront Proust pour ses écrits.
Le salon de Léontine Aman de Cavaillet : Née Lippmann d’un père banquier d’origine allemande, Léontine dispose d’une fortune confortable. Mariée, les époux ne sont guère fidèles mais ne divorceront pas. Léontine vit des amours orageuses avec Anatole France au vu et au su de tous, passion qui durera des années. Elle reçoit dans son hôtel particulier du 12 avenue Hoche des écrivains, députés, avocats, comédiens, peintres mais on n’y rencontre pas de musicien car Léontine n’aime pas la musique. Proust est un des fidèles.
Outre les réceptions du dimanche qui réunissent plus de cent visiteurs, les dîners du mercredi inspireront fortement Marcel Proust dans la description des réceptions de Mme Verdurin et de certains de ses invités (Dumas fils en Brochard, Le docteur Pozzi en Brichot.
Le salon de Mme Lemaire : au n° 31 rue de Monceau se trouve un petit hôtel particulier qui se caractérise pas sa taille modeste et son architecture originale. C’est là que se trouve l’atelier de Madeleine Lemaire, peintre et aquarelliste renommée. Il est décrit par Marcel Proust dans un article intitulé « La cour aux lilas et l’atelier aux roses » et publié sous un pseudonyme dans le figaro du 11 mai 1903.
Madeleine Lemaire dans son atelier
Reynaldo Hahn, Madeleine Lemaire, Marcel Proust
Marcel Proust est un fidèle et c’est chez Mme Lemaire qu’en 1893, il faira la connaissance de Montesquiou dont il s’inspirera pour créer l’étonnant personnage de Charlus.
Les comédiennes Réjane et Sarah Bernhardt viennent s’y produire, Camille Saint-Saëns, Reynaldo Hahn ou Jules Massenet, y jouer du piano. S’y pressent également des hommes politiques tels que Paul Deschanel ou Léon Bourgeois, des ambassadeurs, des aristocrates, des écrivains tel Alexandre Dumas fils dont elle fut la maîtresse.
Madeleine Lemaire illustrera Les Plaisirs et les jours publiés par Proust en 1896
Le salon de la princesse Mathilde : la princesse Mathilde est la fille de Jérôme Bonaparte, cousine de Napoléon III qui reçoit au 20 rue de Berri.
Véranda du salon de la princesse Mathilde d’après Giraud
Marcel lui a été présenté chez Mme Straus dont elle est l’amie. La princesse est alors assez âgée puisqu’elle est née en 1820. Elle a un fort caractère et peu se montrer brutale en certaines occasions.
Le salon de la comtesse Potocka : Elle est mariée avec le comte polonais Nicolas Potocki héritier d’une immense fortune. Ils font construire un palais au 27, avenue de Friedland (qui abrite aujourd’hui la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France). Il y reçoivent le tout-Paris.
La comtesse Potocka
Marcel Proust la décrira comme une « beauté antique » avec une « grâce florentine » et une « élégance parisienne ». Il aurait trouvé en elle les traits de la duchesse de Guermantes.
La comtesse à une réputation sulfureuse. Elle organise tous les vendredis un repas scandaleux, le « dîner des Macchabées » au cours duquel on célèbre le culte particulier de l’Amour. Chaque convive doit y jouer le rôle d’un mort d’amour, c’est-à-dire mort d’épuisement pour s’être trop adonné aux ébats amoureux et cela se terminait parfois en en bacchanale
Le cercle des Macchabés
En dehors des salons, les réceptions et sorties mondaines sont très fréquentes, tant au théâtre à l’opéra, au restaurant et sont abondamment relatées dans la presse parisienne.
Plusieurs peintres dont Jean Béraud, ami de Marcel Proust, ont illustré avec talent des scènes de la vie parisienne : scènes des grands boulevards, soirées mondaines, affluence des magasins, grisettes, ouvrières sortant du travail, soldats en parade, bourgeois sortant de l’église…
Une soirée mondaine de Jean Béraud
Une soirée au Pré-Catelan en 1909 d’Henri-Alexandre Gervex
Boulevard des Capucines par Jean Béraud
Avenue du Bois (actuelle avenue Foch) par Georges Stein
Odette Swann aime se promener Avenue du Bois (actuelle avenue Foch)
Ce qui augmentait cette impression que Mme Swann se promenait dans l’avenue du Bois comme dans l’allée d’un jardin à elle, c’était — pour ces gens qui ignoraient ses habitudes de « footing » — qu’elle fût venue à pieds, sans voiture qui suivît, elle que dès le mois de mai, on avait l’habitude de voir passer avec l’attelage le plus soigné, la livrée la mieux tenue de Paris, mollement et majestueusement assise comme une déesse, dans le tiède plein air d’une immense victoria à huit ressorts. A pieds, Mme Swann avait l’air, surtout avec sa démarche que ralentissait la chaleur, d’avoir cédé à une curiosité, de commettre une élégante infraction aux règles du protocole, comme ces souverains qui sans consulter personne, accompagnés par l’admiration un peu scandalisée d’une suite qui n’ose formuler une critique, sortent de leur loge pendant un gala et visitent le foyer en se mêlant pendant quelques instants aux autres spectateurs. Ainsi, entre Mme Swann et la foule, celle-ci sentait ces barrières d’une certaine sorte de richesse, lesquelles lui semblent les plus infranchissables de toutes. (JF 638 ou 207)
*****
Théâtres, opéra, cafés, restaurants
et autres lieux de plaisir…
Le Café de la Paix, 5 place de l’Opéra, on retrouve Robert de Saint-Loup qui dîne avec le prince d’Orléans. Saint-Loup, neveu du baron de Charlus et marquis lui-même, affiche des idées républicaines, socialistes et dreyfusardes. Ami du narrateur, il épouse Gilberte Swann avant de mourir à la guerre
Le café de la Paix en 1906 par Constant Korovine
Chez plusieurs engagés, appartenant à d’autres escadrons, jeunes bourgeois riches qui ne voyaient la haute société aristocratique que du dehors et sans y pénétrer, la sympathie qu’excitait en eux ce qu’ils savaient du caractère de Saint–Loup se doublait du prestige qu’avait à leurs yeux le jeune homme que souvent, le samedi soir, quand ils venaient en permission à Paris, ils avaient vu souper au Café de la Paix avec le duc d’Uzès et le prince d’Orléans. Et à cause de cela, dans sa jolie figure, dans sa façon dégingandée de marcher, de saluer, dans le perpétuel lancé de son monocle, dans « la fantaisie » de ses képis trop hauts, de ses pantalons d’un drap trop fin et trop rose, ils avaient introduit l’idée d’un « chic » dont ils assuraient qu’étaient dépourvus les officiers les plus élégants du régiment, même le majestueux capitaine à qui j’avais dû de coucher au quartier, lequel semblait, par comparaison, trop solennel et presque commun.(Guer)
La Brasserie Weber : Située au 21 rue Royale, cette brasserie était le lieu de rendez-vous des artistes, écrivains, dessinateurs et journalistes. Elle n’existe plus aujourd’hui.
Léon Daudet a écrit dans « Salons et Journaux » :
« Vers 7 h 1/2 arrivait chez Weber un jeune homme pâle, aux yeux de biche, suçant ou tripotant une moitié de sa moustache brune et tombante, entouré de lainages comme un bibelot chinois. Il demandait une grappe de raisin, un verre d’eau, et déclarait qu’il venait de se lever, qu’il avait la grippe, qu’il s’allait recoucher, que le bruit lui faisait mal, jetait autour de lui des regards inquiets puis moqueurs, en fin de compte éclatait d’un rire enchanté et restait. Bientôt sortaient de ses lèvres, proférées sur un ton hésitant et hâtif des remarques d’une extraordinaire nouveauté et des aperçus d’une finesse diabolique. Ses images imprévus voletaient à la cime des choses et des gens, ainsi qu’une musique supérieure, comme on raconte qu’il arrivait à la taverne du Globe, entre les compagnons du divin Shakespeare. »
Le Café Anglais : Il est situé à l’angle du Boulevard des Italiens et de la rue Marivaux, tout près de l’Opéra Comique. À son ouverture, c’était un restaurant fréquenté principalement par des cochers et des domestiques. A la fin du second Empire, il devient le plus snob de tous les cafés et le plus couru dans toute l’Europe. Bien que sa façade soit particulièrement austère, l’intérieur est particulièrement cosy : boiseries d’acajou et de noyer, miroirs clinquants patinés à la feuille d’or. Ses salons particuliers accueillent une clientèle aisée fréquemment accompagnée de “cocottes”.
Le Café Anglais d’Adolphe Dugléré.
Odette a quitté le salon des Verdurin sans attendre l’arrivée de Swann. Celui-ci affolé part à sa recherche et fait le tour des restaurants où il espère pouvoir la trouver.
Swann se fit conduire dans les derniers restaurants ; c’est la seule hypothèse du bonheur qu’il avait envisagée avec calme ; il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix qu’il attachait à cette rencontre et il promit en cas de succès une récompense à son cocher, comme si en lui inspirant le désir de réussir qui viendrait s’ajouter à celui qu’il en avait lui-même, il pouvait faire qu’Odette, au cas où elle fût déjà rentrée se coucher, se trouvât pourtant dans un restaurant du boulevard. Il poussa jusqu’à la Maison Dorée, entra deux fois chez Tortoni et, sans l’avoir vue davantage, venait de ressortir du Café Anglais, marchant à grands pas, l’air hagard, pour rejoindre sa voiture qui l’attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire : c’était Odette ; elle lui expliqua plus tard que n’ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle était allée souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l’avait pas découverte, et elle regagnait sa voiture (Swann).
La Maison Dorée se situe entre le Café Riche au n°18, et le fameux glacier Tortoni au n°22, La Maison Dorée, au 20 boulevard des Italiens, est l’un des plus chers et le plus recherchés des restaurants parisiens pendant plus d’un demi-siècle.
Il poussa jusqu’à la Maison Dorée, entra deux fois chez Tortoni et, sans l’avoir vue davantage, venait de ressortir du Café Anglais, marchant à grands pas, l’air hagard, pour rejoindre sa voiture qui l’attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire : c’était Odette ; elle lui expliqua plus tard que n’ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle était allée souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l’avait pas découverte, et elle regagnait sa voiture.

|
 |
Le restaurant est divisé en 2 parties, l’une donne sur le boulevard, est réservée au « tout venant », l’autre, rue Laffitte, reçoit les habitués de marque, à l’abri des curieux, dans de luxueux « Cabinets ». Le plus demandé est le numéro 6, fréquenté par ce qui compte le plus à Paris, princes, comtes et marquis ainsi que d’excentriques fortunés se l’arrachent. La cave somptueuse avec ses 80 000 bouteilles attira tout ce qui comptait de noceurs et de fêtards de la capitale.
Le restaurant La Rue au 15 place de la Madeleine Aujourd’hui occupé par le tailleur Cerutti, Proust s’y rendait souvent au début des années 1900. C’est là que Bertrand de Fénelon aurait voltigé entre les tables pour apporter à Proust son manteau, comme Saint-Loup dans le roman l’apporte victorieusement au narrateur frigorifié.
Le Ritz : c’est une amie, la princesse Soutzo, qui y loge, qui va faire redécouvrir l’établissement à Marcel Proust. Aussitôt il va devenir un habitué fidèle puisqu’il a coutume d’y dîner plusieurs fois par semaine.
Depuis la mort de ses parents et son emménagement boulevard Haussmann, et c’est au Ritz qu’il aime inviter ses amis, et en particulier ses amies qu’il n’ose recevoir dans sa chambre imprégnée des odeurs de fumigations.
Le premier dîner qu’il y organise a lieu en juillet 1907, en l’honneur de Gaston Calmette, le directeur du Figaro.
Le grand hôtel devient son second domicile. Il y rencontre des personnalités du tout Paris. Proust le fréquentera assidûment jusqu’à sa mort.
Après la guerre, il fait souvent chercher au Ritz des glaces à la framboise ou à la fraise. L’arrivée de Céleste Albaret en 1914 le pousse à fréquenter davantage le Ritz car Céleste n’aime pas cuisiner.
Le 18 mai 1922, Proust assiste au Ritz à un souper en l’honneur de Stravinsky, auquel participent également Picasso, Joyce, Diaghilev.
La nuit était aussi belle qu’en 1914, comme Paris était aussi menacé. Le clair de lune semblait comme un doux magnésium continu permettant de prendre une dernière fois des images nocturnes de ces beaux ensembles comme la place Vendôme, la place de la Concorde auxquels l’effroi que j’avais des obus qui allaient peut-être les détruire, donnait par contraste, dans leur beauté encore intacte, une sorte de plénitude, et comme si elles se tendaient en avant, offrant aux coups leurs architectures sans défense (TR 802/109).
LA MUSIQUE
Première saison ballets russes par Léon Bakst
La passion de Proust pour la musique va se réveiller à l’occasion du récital de piano et de violon qu’il offrit à ses amis le 1er juillet 1907 dans un salon de l’hôtel Ritz. Elle va s’amplifier avec la venue des Ballets Russes à Paris en 1909. Réunis autour de Diaghilev, des danseurs chorégraphes, peintres et musiciens russes apportent l’éblouissante démonstration que la danse peut être autre chose qu’un aimable divertissement. Les spectateurs ouvrent des yeux émerveillés sur une révolution artistique qui marquera le siècle. Proust n’a pas caché son enthousiasme et se rend fréquemment à l’Opéra et au Châtelet pour assister aux représentations qui rencontrent un immense succès.
Place de l’Opéra Garnier de Franck Myer
A partir de 1911, il se passionne pour les derniers quatuors de Beethoven dont Paris s’est engoué.
Marcel Proust, reclus dans son appartement parisien du boulevard Haussmann, appela une nuit à trois heures du matin Lucien Capet, fondateur du Quatuor qui porte son nom, pour lui demander de venir illico avec ses collègues lui jouer le Quatuor de Debussy. Et Capet s’exécuta…
Le quatuor Capet
Le quatuor Poulet qui rencontre un immense succès vivra la même aventure. Amable Massis, l’altiste du groupe, interviewé à la radio (source INA) raconte : J’ai vu un homme s’approcher de moi, vêtu d’une pelisse à col de loutre, la canne dans la poche, il n’avait pas de toque mais une moustache très caractéristique et les cheveux bien lissés sur le côté me demandant, sans préambule, si avec mes collègues nous accepterions de jouer chez lui le quatuor de Franck. Très étonné naturellement, j’ai dit : « mais qui êtes-vous ? » Il me donna sa carte : Marcel Proust. »
Massis accepta et quelques jours plus à minuit, Proust alla lui-même en taxi au domicile de chacun des quatre musiciens pour leur rappeler la promesse et il réussit malgré les protestations véhémentes de certains à les ramener chez lui. Il s’étendit sur son lit, les musiciens installèrent leurs partitions sur les meubles et à une heure du matin dans le silence de la nuit, ils exécutèrent le quatuor en ré majeur de Franck.
A la fin, réconforté par un souper au champagne servi par Céleste, alors qu’ils allaient partir, Proust leur demanda de rejouer le quatuor ce qu’ils firent malgré leur fatigue.
Enthousiaste, Proust les remercia chaudement et leur donna des poignées de billets de 50 francs pris dans un coffret chinois. Quatre taxis attendaient les musiciens pour les ramener chez eux. Proust pouvait se montrer odieux mais il restait toujours grand seigneur.
LE THEATRE
Marcel Proust a toujours marqué de l’intérêt pour le théâtre. Tout au long de sa vie il a eu l’occasion de côtoyer les comédiennes les plus en vue et d’établir avec certaines d’entre elles des relations amicales durables.
Dans du côté de chez Swann le Narrateur de la Recherche cite les meilleures comédiennes sans hésiter à placer en tête de son classement Sarah Bernhardt :
Mais si les acteurs me préoccupaient ainsi, si la vue de Maubant sortant un après-midi du Théâtre-Français m’avait causé le saisissement et les souffrances de l’amour, combien le nom d’une étoile flamboyant à la porte d’un théâtre, combien, à la glace d’un coupé qui passait dans la rue avec ses chevaux fleuris de roses au frontail, la vue du visage d’une femme que je pensais être peut-être une actrice, laissait en moi un trouble plus prolongé, un effort impuissant et douloureux pour me représenter sa vie ! Je classais par ordre de talent les plus illustres : Sarah Bernhardt, la Berma, Bartet, Madeleine Brohan, Jeanne Samary, mais toutes m’intéressaient.(Swann)
D’une fenêtre de l’appartement du boulevard Malesherbes, Marcel enfant peut apercevoir la colonne Morris où il court voir les spectacles de théâtre annoncés. Cette colonne existe toujours de l’autre côté du boulevard, au n° 9.
Tous les matins je courais jusqu’à la colonne Moriss pour voir les spectacles qu’elle annonçait. Rien ’était plus désintéressé et plus heureux que les rêves offerts à mon imagination par chaque pièce annoncée et qui étaient conditionnés à la fois par les images inséparables des mots qui en composaient le titre et aussi de la couleur des affiches encore humides et boursouflées de colle sur lesquelles il se détachait. (Swann 73/136).
Sarah Bernhardt
Marcel sera un de ses admirateurs et s’est fortement inspiré d’elle pour dresser le personnage de la Berma.
En 1894, Sarah Bernhardt a besoin d’urgence d’affiches pour son nouveau spectacle, Gismonda de Victorien Sardou. A la veille de Noël, aucun dessinateur n’est disponible dans l’atelier pour les réaliser, excepté un jeune artiste tchèque correcteur d’épreuves, Alphons Mucha. Il relève le défi et le 1er janvier 1886, Paris découvre, émerveillé, les affiches longilignes annonçant le spectacle de la comédienne. Elles auront un tel succès que beaucoup seront dérobées dans la nuit. Mucha devient célèbre et le restera.
Marcel Proust vit Réjane sur scène pour la première fois le soir de la première de Germinie Lacerteux. Réjane disputait alors à Sarah Bernhardt le titre de plus grande actrice de la Belle Époque. Ces deux grandes comédiennes servirent de modèle au personnage de la Berma auquel rêve le narrateur d’À la recherche du temps perdu. Jacques Porel, fils de Réjane, et Marcel Proust devinrent bons amis après la Grande Guerre.
Réjane invita Proust à occuper un appartement dans sa maison. Le jour où Proust y emménagea, il reçut les premières épreuves du Côté de Guermantes et ajouta certains traits de la personnalité de Réjane au personnage fictif de la Berma.
Louisa de Mornand
C’est une jeune actrice qui a commencé sa carrière pas des levers de rideau sur les Grands Boulevards. Marcel Proust en brosse le portrait :
« Louisa nous semble à tous une pure déesse
Son corps n’en doutez pas doit tenir la promesse
De ses deux yeux rêveurs, malicieux et doux. »
Louisa de Mornand
Puis plus tard sa relation avec la comédienne semble prendre un tour nouveau puisqu’il écrit ce distique :
A qui ne peut avoir Louisa de Mornand
Il ne peut plus rester que le péché d’Onan.
Pendant quelque temps, leurs relations se poursuivent sur le même pied. Vingt ans plus tard Louisa déclarait « Ce fut entre nous une amitié amoureuse où il n’y avait rien d’un flirt banal ni d’une liaison exclusive, mais, de la part de Proust, une vive passion nuancée d’affection et de désir, et, de la mienne, un attachement qui était plus que de la camaraderie et qui touchait vraiment mon cœur ».
Le théâtrophone
Des micros installés de chaque côté de la scène de l’Opéra Garnier permettent d’écouter l’opéra en restant chez soi. Le système sera rapidement étendu à d’autres salles de spectacle. Il connaîtra dans un certain succès malgré la qualité médiocre du son mais il disparaîtra après l’instauration du système de droit d’auteur.
 |
 |
En 1911, plus casanier que reclus, Marcel Proust, grand amateur de musique et féru d’opéra, s’abonne au théâtrophone, essentiellement pour écouter les opéras de Richard Wagner, qu’il adore et dit connaître par cœur (en particulier l’Anneau du Liebelung, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, mais surtout Tristan et Isolde et Parsifal), ce qui lui permet de suppléer aux limites techniques de la retransmission1. Le 21 février 1911, il entend aussi par ce moyen Pelléas et Mélisande de Claude Debussy.
AUTRES LIEUX DE PLAISIR
La IIIe République est l’âge d’or des maisons closes qui font partie intégrante de la vie sociale. À Paris, on compte environ 200 établissements officiels, sous le contrôle de la police et des médecins, au milieu du siècle mais de nombreux bordels clandestins existent. De 1871 à 1903 environ, l’écrivain Maxime du Camp dénombre 155 000 femmes officiellement déclarées comme prostituées, mais la police en a arrêté pendant la même période 725 000 autres pour prostitution clandestine
La police estime à 40 000 clients par jour la fréquentation des diverses maisons, ce qui équivaudrait à dire que le quart des hommes parisiens avait des relations avec les prostituées.
Sur le tard, Marcel Proust fréquentera assidûment ce genre d’établissement. Il sera un habitué de ces lieux, mais sûrement avait-il plus besoin de bordels masculins pour « voir » et rêver que pour y assouvir ses penchants.
L’un d’eux a eu pour lui une importance toute particulière, le bordel pour hommes le Marigny.
Marcel Proust a rencontré Le Cuziat en 1911, dans une soirée mondaine où ce dernier travaillait comme valet. Enthousiasmé par ses connaissances des us et coutumes de la haute société, aussi bien se ses coutumes que de la généalogie, il va se rapprocher de lui et lui soutirer, contre rémunération une quantité de renseignement dont il se servira dans ses écrits. Mais le Cuziat a d’autres cordes à son arc, il est « pédéraste » qualificatif utilisé à l’époque, et il a le sens des affaires. En 1913 il ouvre un établissement de bain dont l’usage ne fait guère de doute. A-t’il été aidé financièrement par Proust ? Rien ne permet de l’affirmer mais, chose étonnante, il participera à l’ameublement de l’hôtel en faisant don à Le Cuziat de quelques meubles hérités de ses parents !
Les affaires sont florissantes et quelques années plus tard Le Cuziat reprend l’hôtel Marigny dont il fait une maison de passe pour homosexuels qui reçoit de nombreuses personnalités politiques et artistiques du Tout-Paris.
On pense bien entendu à Charlus Le 11 décembre 1918, Proust sera arrêté puis relâché lors d’une descente de Police dans l’hôtel.et Jupien associés dans la tenue d’un bordel dans La Recherche, le baron de Charlus pratique de même quand Jupien ouvre son Temple de l’Impudeur.
…le baron, ayant soudain largement ouvert ses yeux mi-clos, regardait avec une attention extraordinaire l’ancien giletier sur le seuil de sa boutique, cependant que celui-ci, cloué subitement sur place devant M. de Charlus, enraciné comme une plante, contemplait d’un air émerveillé l’embonpoint du baron vieillissant. Mais, chose plus étonnante encore, l’attitude de M. de Charlus ayant changé, celle de Jupien se mit aussitôt, comme selon les lois d’un art secret, en harmonie avec elle. Le baron, qui cherchait maintenant à dissimuler l’impression qu’il avait ressentie, mais qui, malgré son indifférence affectée, semblait ne s’éloigner qu’à regret, allait, venait, regardait dans le vague de la façon qu’il pensait mettre le plus en valeur la beauté de ses prunelles, prenait un air fat, négligent, ridicule. Or Jupien, perdant aussitôt l’air humble et bon que je lui avais toujours connu, avait—en symétrie parfaite avec le baron—redressé la tête, donnait à sa taille un port avantageux, posait avec une impertinence grotesque son poing sur la hanche, faisait saillir son derrière, prenait des poses avec la coquetterie qu’aurait pu avoir l’orchidée pour le bourdon providentiellement survenu. (SG 604/6).
LA GUERRE
Gare de l’Est « Le Départ des poilus, août 1914 » d’Albert Helter
Marcel Proust passe pour le prototype de l’écrivain désengagé, exclusivement attentif à son œuvre. Mais le dernier volume de « »A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé », constitue aussi un très grand livre sur la Première Guerre mondiale dans lequel l’écrivain peint la fin d’un monde et réfléchit sur le rôle que la littérature a à jouer à l’ère de la propagande, du patriotisme et du massacre de masse.
A la recherche du temps perdu a en grande partie été écrite et réécrite pendant et juste après la première Guerre Mondiale. Si l’oeuvre a pris les proportions qu’on lui connaît, c’est directement à cause de la Guerre, qui a suspendu la publication des deux volumes qui devaient suivre Du côté de chez Swann. Le Temps retrouvé se fait la chronique d’une guerre que l’auteur ne connaît que par des canaux indirects : la presse, des ouvrages d’historiens ou de stratèges militaires, et enfin les témoignages oraux de son frère, d’amis ou de combattants qu’il rencontre dans l’hôtel de rendez-vous d’Albert Le Cuziat.
Réservistes en 1914
Proust n’a en rien pris part à la guerre et pourtant son attention à la guerre est extrême, et la stratégie militaire joue un rôle important, à plusieurs niveaux, dans son œuvre. Il a effectué son service militaire au 76e régiment d’infanterie à Orléans, de novembre 1889 (année d’obtention de son baccalauréat) à novembre 1890. Son état de santé très dégradé aboutira à sa réforme, au cours de l’année 1915 mais il vit en communion avec les combattants. Une lettre dès 1914 donne le ton :
« pour bien des amis je tremble chaque jour de trouver les noms dans les listes de tués. Je suis bien humilié, quand tout le monde sert, d’être moi-même si inutile ». ou bien encore : « Imaginez-vous que, lisant sept journaux tous les jours, et relisant dans les sept le même sous-marin coulé, ce qui fait que je crois qu’on en a coulé sept, et ensuite rectifiant mon tir grâce à cette expérience, que quand on en a coulé plusieurs, je crois que c’est toujours le même ».
Face à l’avancée allemande, un grand nombre de Parisiens a quitté la ville. Mais la vie reprend ses droits, les écoles sont ouvertes, les spectacles et les revues continuent de se produire sur scène ; pour les hommes qui se battent, la capitale est considérée comme une ville de l’arrière où l’on prend du bon temps :
A l’heure du dîner les restaurants étaient pleins et si, passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire, échappé pour six jours au risque permanent de la mort, et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitrines illuminées, je souffrais comme à l’hôtel de Balbec quand les pêcheurs nous regardaient dîner, mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore parce qu’elle est plus résignée, plus noble, et que c’est d’un hochement de tête philosophe, sans haine, que prêt à repartir pour la guerre il disait en voyant se bousculer les embusqués retenant leurs tables « On ne dirait pas que c’est la guerre ici. » (TR
Du côté de chez Swann
Dans la première partie de ce livre, Combray, le narrateur évoque les séjours passés dans la maison de tante Léonie alors qu’il était enfant. Il se souvient avec nostalgie du baiser du soir de sa mère, baiser tant attendu, mais parfois retardé par un invité, souvent M. Swann. Il nous fait connaître des personnes de son entourage, sa tante Léonie, malade gardant toujours la chambre, sa grand-mère un peu fantasque qui aime se promener sous la pluie, Françoise la fidèle cuisinière, les habitants du village. Il évoque ses goûts pour la lecture, les longues promenades avec ses parents, du côté de chez Swann ou de Guermantes.
La seconde partie, Un amour de Swann, se déroule quelques années avant la naissance du narrateur. Charles Swann, riche collectionneur d’objets d’art va finir par céder aux avances pas tout à fait désintéressées d’Odette de Crécy, demi-mondaine, qui le fera d’ailleurs beaucoup souffrir. On découvre le salon des Verdurin, fréquenté par de nombreux personnages qui figureront tout au long de l’œuvre : Cottard, Saniette, Brichot, Forcheville et bien d’autres. Lassé par les nombreuses infidélités d’Odette, Swann, recouvre enfin sa liberté, s’étonnant d’avoir été amoureux d’une femme qu’il n’a jamais vraiment aimée.
Dans la troisième et dernière partie, Nom de Pays, nous retrouvons le narrateur alors âgé d’une douzaine d’années. Malade, il a dû renoncer à un voyage à Venise auquel il rêvait depuis longtemps. Au cours de ses promenades aux Champs-Elysées avec Françoise, il rencontre Gilberte (la fille d’Odette qui a fini par épouser Charles Swann) qu’il revoit régulièrement, nouant un amour qui semble partagé.
Première partie
COMBRAY
Combray, la première partie de « Du côté de chez Swann », se déroule dans la maison de tante Léonie où le narrateur et ses parents passent leurs vacances, en compagnie de la grand-mère maternelle du narrateur ainsi que de deux grands-tantes, Céline et Flora. Adolescent alors âgé d’une douzaine d’années, doué d’une grande sensibilité et d’une imagination débordante, le narrateur essaie chaque soir de repousser l’heure où il devra monter se coucher, pour ne pas avoir à attendre trop longtemps le baiser de sa mère, habitude enfantine qui agace profondément son père.
Chambre du Narrateur à Combray (Photo Marcelita)
Malheureusement, le sacro-saint cérémonial du baiser est bousculé lorsqu’il y a des invités. Swann fait partie de ceux-là et le narrateur redoute sa visite. Charles Swann est un voisin qui possède une propriété près de Combray où il vient passer l’été ; la famille du narrateur considère Swann comme une personne serviable, modeste et discrète, elle ignore qu’en réalité, il s’agit d’un homme excessivement riche, collectionneur d’objets d’art et qui mène une vie mondaine intense, côtoyant à Paris les plus grands noms. Les visites de Swann sont moins fréquentes depuis son mariage, peu apprécié par la famille du narrateur. En effet, sa femme Odette a très mauvaise réputation, et la tante du narrateur ne se prive pas de raconter qu’elle trompe son mari avec le baron de Charlus, un de membres de la famille de Guermantes qui séjourne parfois l’été dans le château du même nom situé près de Combray.
« Sans doute le Swann que connurent à la même époque tant de clubmen était bien différent de celui que créait ma grand’tante, quand le soir, dans le petit jardin de Combray, après qu’avaient retenti les deux coups hésitants de la clochette »
Un soir, alors que Swann est venu dîner à Combray, le père du narrateur ordonne brutalement à son fils d’aller se coucher au prétexte qu’il est tard. Gros chagrin de l’enfant qui, après beaucoup d’hésitation, envoie un billet à sa mère par le biais de Françoise, la cuisinière au service de tante Léonie depuis des années ; mais le narrateur ne peut pas s’endormir, car il prend conscience qu’il a commis une grosse bêtise et que ses parents vont être très fâchés. A la fin de la soirée la mère du narrateur monte dans la chambre de son fils et lui fait part de son vif mécontentement. De manière inattendue, c’est le père qui se montre conciliant et suggère à sa femme de passer la nuit avec l’enfant qui paraît tellement triste. Extrêmement surpris par ce changement d’attitude, le jeune garçon ne se réjouit pas vraiment, car il considère que sa mère, ordinairement courageuse, a fait preuve, en l’occurrence, de faiblesse : « c’est une première ride, un premier cheveu blanc ».
Tante Léonie, cousine du grand-père et grand-tante du narrateur, ne quitte plus sa chambre. Vraie ou fausse malade ? Elle s’imagine avoir quelque chose de « cassé » dans sa tête. Le narrateur lui rend visite chaque matin et lui prépare sa tasse de tilleul. Elle lui fait goûter alors des petits morceaux de madeleine trempés dans le tilleul, et le renvoie bien vite, prétextant qu’il la fatigue. Beaucoup plus tard, alors qu’il mange une madeleine, le narrateur éprouve une étrange sensation qu’il a des difficultés à analyser. Peu à peu, resurgit le souvenir de la madeleine de son enfance, trempée dans le tilleul de tante Léonie et, dans le même temps, il se remémore tout l’environnement, la chambre, la maison, le village, et même les alentours de Combray.
 La chambre de Tante Léonie à Combray
La chambre de Tante Léonie à Combray
De son lit installé près de la fenêtre, Léonie surveille les allers et venues des habitants de Combray et les commente à Françoise. Eulalie, une ancienne domestique est avec le curé une des rares personnes dont tante Léonie supporte les visites ; elle lui rapporte les potins de Combray. Le dimanche, le narrateur accompagne ses parents à la messe. A la sortie de l’office on rencontre souvent M. Legrandin, ingénieur parisien propriétaire d’une maison de vacances près de Combray. C’est un bel homme, snob, cultivé, bien considéré par la famille du narrateur même s’il critique avec virulence les aristocrates ce qui ne l’empêche pas de se montrer obséquieux avec les gros propriétaires des environs. En fait, il peine à cacher le profond désir qu’il a de fréquenter cette aristocratie locale qu’il critique tant.
Etienne Moreau-Nélaton (1859-1927)
Le narrateur aime beaucoup la lecture et l’écriture et a coutume d’envoyer des lettres et des petits mots à sa mère et à sa grand-mère. Sans grande conviction, il a aussi commencé à écrire un livre. Son ami Bloch, un peu plus âgé, lui fait connaître les œuvres de l’écrivain Bergotte. Au cours d’une visite, Swann lui déclare bien connaître l’écrivain et lui propose de lui faire dédicacer un livre. La vie à Combray se poursuit, calme et heureuse, ponctuée de menus événements rompant la monotonie des jours, tel l’accouchement de la fille de cuisine. Tante Léonie prend toujours régulièrement sa pepsine et continue, de sa chambre, à observer le moindre mouvement dans la rue. Les samedis, on déjeune une heure plus tôt pour permettre à Françoise de se rendre l’après-midi au marché de Roussainville.
Chaque après-midi, lorsque le temps le permet, la famille fait une promenade dans les environs, soit du côté de chez Swann, soit du côté de Guermantes et, à son retour, le narrateur monte dans la chambre de Tante Léonie lui relater en détail la promenade. Tante Léonie incarne l’âme de la maison. Bien que recluse, elle occupe une grande place dans la vie de la famille. Elle espionne Françoise, qu’elle soupçonne, sans y croire vraiment, de la voler. Françoise en est consciente et en souffre. C’est une fille de la campagne, très attachée à sa patronne ainsi qu’à toute la famille, qui fait preuve d’un solide bon sens paysan et peut se montrer très attentionnée et parfois très dure, surtout avec les domestiques. Un été, si toute la famille n’a cessé de manger des asperges, c’est tout simplement parce que Françoise savait que la fille de cuisine était allergique à ce légume et que le simple fait de les préparer (les « plumer ») la rendait malade ! Depuis le mariage de Swann, on évite les abords de sa propriété, de peur d’y rencontrer sa femme. Un après-midi, croyant les Swann absents, la famille va exceptionnellement se promener près de Tansonville. Soudain le narrateur aperçoit une fillette d’un blond roux, le visage semé de taches roses, image qu’il gardera longtemps dans son esprit ; une voix perçante appelle soudain la petite fille : « Gilberte !». Ce doit être sa mère. Celle-ci est accompagnée d’un homme inconnu. Le narrateur entend son grand-père marmonner : « Ce pauvre Swann, quel rôle ils lui font jouer : on le fait partir pour qu’elle reste seule avec Charlus… ». Ainsi le narrateur vient de côtoyer trois personnages majeurs de « la Recherche » : Gilberte, sa mère (Odette Swann) et M. de Charlus.
M. Vinteuil, professeur de piano, habite à Montjouvain, près de Combray. Sa fille vit sous son toit avec une jeune fille plus âgée et cette situation fait beaucoup jaser les habitants de Combray. Homme à principes et très réservé, M. Vinteuil est tellement affecté par cette situation que sa santé en pâtit ; il vieillit de jour en jour et finira par mourir de chagrin.
Léonie n’était peut-être pas la malade imaginaire que l’on croyait. En effet, elle meurt discrètement, assistée par Françoise qui ne la quitte pas durant les quinze jours de son agonie. Les parents du narrateur vont être fort occupés par la succession de tante Léonie, et livré à lui-même, le jeune garçon découvre soudainement une liberté nouvelle. Se promenant souvent seul avec, parfois, le désir violent d’une femme, il rêve d’en rencontrer une au cours de ses promenades. Réfugié dans le petit cabinet sentant l’iris du haut de la maison, il lui arrive de se livrer à l’onanisme. Un jour, lors d’une promenade solitaire, alors qu’il se repose un instant tout près de la maison de M. Vinteuil mort récemment, il surprend Mlle Vinteuil et son amie qui échangent des propos équivoques et se caressent. C’est ainsi qu’il découvre l’homosexualité féminine.
Les promenades en famille reprennent. Lorsque le temps s’y prête, on entreprend la longue et belle randonnée du côté de Guermantes, le long de la Vivonne dont on admire les nymphéas, puis on goûte au bord de l’eau. Le parcours est si long que les promeneurs n’atteignent jamais la propriété des Guermantes. Le narrateur rêve de rencontrer la duchesse de Guermantes dont il est secrètement amoureux sans jamais l’avoir vue. Un jour pourtant, il l’aperçoit dans l’église de Combray, mais il l’a tellement idéalisée qu’il éprouve de prime abord une certaine déception, à vrai dire très brève car il suffit d’un regard de la duchesse pour que son imagination s’enflamme à nouveau.
Le narrateur s’essaie à l’écriture, trop peu sûr de lui pour que son travail ne subisse pas les aléas de ses doutes quant à ses talents littéraires. Un jour, au retour d’une longue promenade, alors que le Dr Percepied a fait monter la famille dans sa calèche, le narrateur, séduit par la beauté du paysage, compose un petit texte sur les clochers de Martainville. Heureux du résultat, il ne peut s’empêcher de chanter à tue-tête.
 Les trois clochers de Martainville d’après David Richardson
Les trois clochers de Martainville d’après David Richardson
*****
Deuxième partie
UN AMOUR DE SWANN
Nous nous retrouvons une quinzaine d’années en arrière (le narrateur n’est pas encore né), quai Conti à Paris, dans le salon des Verdurin, riches bourgeois mécènes qui aiment réunir chez eux des artistes. Une condition pour être admis dans leur salon, admirer sans réserve le jeune musicien à la mode ainsi que le docteur Cottard, grand ami du couple Verdurin. Parmi les habitués, Odette de Crécy, particulièrement appréciée par Mme Verdurin et qui intervient pour introduire son ami Swann. Très fortuné et grand séducteur, Charles Swann fréquente le milieu aristocratique peuplé de princes, d’ambassadeurs et d’académiciens. S’il aime à séduire les femmes du beau monde, il ne dédaigne pas pour autant la compagnie des midinettes. Très policé, il peut cependant faire preuve de muflerie à l’égard de ses maîtresses. Il est attiré par Odette de Crécy qu’il trouve très belle, tout en relevant chez elle certaines imperfections physiques ; et puis, Odette n’est pas très cultivée. Il lui arrive de se lasser d’elle, jamais pour longtemps car il regrette sa présence dès qu’elle s’éloigne. Odette, elle, cherche le contact de Swann et multiplie leurs rencontres. Lors de sa première visite chez les Verdurin, Swann fait une excellente impression à ses hôtes. Il fait la connaissance des principaux habitués : le docteur Cottard, médecin célèbre, imbu de sa personne et tout à la dévotion de Mme Verdurin ; le peintre Biche (qu’on retrouvera plus tard, devenu célèbre sous le nom d’Elstir) ; Saniette, ancien archiviste, fortuné, issu d’une famille noble (il est le beau-frère du comte de Forcheville). Saniette est un homme foncièrement bon et simple, mais souvent maladroit et devenu le souffre-douleur du ménage Verdurin. Il y a aussi Brichot, professeur à la Sorbonne, bavard et pédant, féru de plaisanteries et de jeu de mots pas toujours du meilleur goût.
Mme Verdurin trône sans partage sur ce petit clan, comme une reine surveillant sa cour, les habitués du salon ne l’appellent-t-ils pas « la Patronne ». Elle va favoriser le rapprochement entre Swann et Odette. Lors d’une soirée, le jeune pianiste joue une petite phrase musicale d’une sonate que Swann a déjà entendue et qu’il a beaucoup aimée. Il apprend que le compositeur est un certain Vinteuil, mais à aucun moment il ne fait le rapprochement entre l’obscur petit professeur de piano de Montjouvain et l’homme capable d’écrire une telle œuvre.
Un jour, Swann a le tort de déclarer qu’il fréquente des gens haut placés. Extrêmement possessive et jalouse, Mme Verdurin voit là une infidélité et même une trahison, et c’est alors le début de la disgrâce. Prenant conscience qu’il a perdu la sympathie de Mme Verdurin, Swann n’hésite pas à prendre lui-même de la distance en ne se rendant chez elle qu’assez tard, après avoir passé le début de soirée avec une jolie ouvrière dont il préfère la beauté « fraîche et bouffie » à celle d’Odette, même s’il reste très attaché à cette dernière, continuant à la voir souvent. Il est amoureux d’elle et, un soir qu’il arrive très tard chez les Verdurin, on lui apprend qu’elle est déjà partie. Rongé d’inquiétude et de jalousie, il passe une partie de la nuit à sa recherche dans les restaurants du tout Paris pour finir, enfin, par la retrouver. Alors qu’ils rentrent ensemble en voiture chez elle, Swann se montre d’abord assez timide. Et puis… Odette porte sur sa robe un bouquet de catleyas et, prétextant vouloir le remettre en place, Swann la caresse et l’embrasse puis la possède pour la première fois, dans la voiture. Désormais ils diront « faire catleya » au lieu de dire « faire l’amour ». Maintenant, Swann se rend tous les soirs chez sa maîtresse, il ne connaît rien de son passé ni de ses activités diurnes et il est assez lucide pour la considérer superficielle, pas très intelligente ni très cultivée mais cela ne l’empêche pas d’être très attaché à elle et de se montrer jalousement possessif.
Un jour, Odette demande aux Verdurin de recevoir un nouvel invité, le comte de Forcheville, bel homme, suffisant, cousin de Saniette. Forcheville fait la cour à Odette, encouragé dans son entreprise par Mme Verdurin qui n’apprécie plus du tout Swann et qui adore faire et défaire les couples. Swann ignore encore la disgrâce dont il est menacé, il comble sa maîtresse de cadeaux et d’argent car, très dépensière, Odette est souvent dans l’embarras et n’hésite pas à le solliciter, ce qui paradoxalement le rend heureux. Cependant, il doute de plus en plus de sa fidélité et va même jusqu’à l’espionner en allant une nuit rôder derrière ses volets clos, pour tenter de savoir si elle a de la visite. Sa jalousie est exacerbée par le fait qu’Odette continue de fréquenter le salon des Verdurin alors qu’il n’y est plus invité. Mais la jeune femme sait souffler le chaud et le froid, elle redevient parfois aimante et attentionnée et aussitôt Swann oublie ses griefs, mais le répit est de courte durée, le faisant bien vite retomber dans le doute et la suspicion. Il la comble d’argent et de cadeaux, il l’aime, il ne l’aime plus, il la voit belle et attirante pour, un instant plus tard, la trouver laide et insignifiante. Les relations entre les deux amants ne cessent de se dégrader, Odette se montrant souvent dure avec son amant qui en arrive à sangloter de désespoir et à souhaiter mourir. Swann qui a complètement cessé d’aller chez les Verdurin, recommence à fréquenter les salons qu’il avait abandonnés. Ainsi, un soir, il se rend à un concert chez Madame de Saint-Euverte, ce qui donne l’occasion à l’auteur de dresser des portraits pittoresques, imagés et souvent cruels des invités : le général de Froberville avec « sa figure vulgaire, balafrée et triomphale », les marquis de Bréauté au « regard infinitésimal et grouillant d’amabilité » et de Forestelle au « visage délicat mélancolique » ; MM. de Saint-Candé « au nez frémissant et rouge et à la bouche lippue », de Palancy « avec sa grosse tête de carpe ». Et bien d’autres personnages que l’on retrouvera tout au long de « la Recherche » : Oriane de Laumes qui s’appellera bientôt la duchesse de Guermantes, Basin, son mari, qui n’a cessé de la tromper depuis le jour où il l’a épousée, une cousine d’Oriane, Mme de Gallardon qu’elle déteste, la jeune Mme de Cambremer, « jolie à croquer ». Au cours de la soirée, on joue la petite phrase de la sonate de Vinteuil et Swann a le cœur déchiré en entendant cette mélodie qui a rythmé son amour pour Odette. Quelques jours auparavant, il a reçu une lettre anonyme l’informant qu’Odette est la maîtresse de nombreux hommes et femmes et qu’elle fréquente les maisons de passe. Il cherche à identifier l’auteur de cette dénonciation à laquelle il refuse d’accorder le moindre crédit. Interrogée, Odette nie, mais sans conviction. Malgré les propos désagréables qu’il leur arrive d’échanger, curieusement Odette lui reste chère et précieuse. Elle part avec les Verdurin pour de fréquentes croisières, dont certaines peuvent durer plusieurs mois, et ces absences procurent à Swann un apaisement momentané. Pourtant, ce sera bientôt la rupture définitive avec, en guise d’épitaphe, cette conclusion étonnante de Swann : « Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre ! »
*****
Troisième partie
NOMS DE PAYS
Agé d’une douzaine d’années, le narrateur va faire un séjour à Balbec avec sa grand-mère pour soigner son asthme. Sur les conseils de M. Legrandin, ils logent au Grand-Hôtel de la Plage. L’imagination du narrateur lui donne une représentation des villes normandes à travers leurs noms, pour l’entraîner ensuite à une évasion vers Parme, Florence, Venise, Pise qu’il meurt d’envie de visiter.
Ses parents ayant enfin décidé de l’emmener à Venise, le rêve devient réalité. Alors que l’on prépare le voyage, le jeune garçon est tellement excité qu’il en tombe malade et le projet doit être annulé. Ses seules sorties devront se limiter désormais aux promenades aux Champs-Elysées avec Françoise, promenades qu’il déteste jusqu’au jour où il y rencontre Gilberte, la fille de Swann et d’Odette qu’il avait aperçue lors d’une promenade à Combray. Il la revoit régulièrement et prend beaucoup de plaisir à jouer avec elle et ses amies. Gilberte semble l’apprécier également, tout en prenant un malin plaisir à le rendre jaloux. Il n’ose pas lui dire qu’il l’aime. Gilberte lui donne parfois des marques d’amitié, alors qu’il attend beaucoup plus. Il est aussi attiré par les parents de Gilberte, appréciant Mme Swann si belle et si élégante lors de ses promenades au Bois. Quand des badauds la reconnaissent, certains ne se privent pas de faire allusion à son inconduite.
_______________________________
A l’ombre des jeunes filles en fleurs
Le narrateur est enfin reçu chez les parents de Gilberte pour lesquels il éprouve une grande attirance. C’est chez eux qu’il rencontre Bergotte, l’écrivain à la mode qu’il admire depuis si longtemps. Ses visites chez les Swann se multiplient et Gilberte finit par trouver que, trop envahissant, le narrateur empiète sur sa liberté. Peu à peu, les relations entre les jeunes gens se tendent et ils cessent de se voir. Attristé par cette séparation, le jeune homme continue cependant de fréquenter les parents de la jeune fille. Avec le temps, sa peine s’estompe jusqu’à le détacher de Gilberte.
Deux ans plus tard, il part à Balbec avec sa grand-mère pour se soigner. D’abord déçu par la ville et l’hôtel, il finit par s’habituer. Sa grand-mère rencontre une amie d’enfance, Mme de Villeparisis, qui présente le narrateur à son neveu Saint-Loup. Après un premier contact très froid, les jeunes gens deviennent amis. Le narrateur retrouve également un ancien ami, Bloch, lui aussi en villégiature à Balbec, puis il fait la connaissance du baron de Charlus, oncle de Saint-Loup, au comportement étrange. Son attention est attirée par une bande de jeunes filles joyeuses et insolentes. Grâce à Elstir, le célèbre peintre qui séjourne près de Balbec, il parvient à les rencontrer et tombe amoureux de l’une d’elles, Albertine. Ce qui ne l’empêche pas de ressentir parfois une certaine attirance pour d’autres jeunes filles de la bande. Un jour qu’il tente d’embrasser Albertine, celle-ci le repousse durement, le laissant fâché. La fin de la saison arrive et les jeunes filles quittent Balbec avant qu’à son tour, le narrateur rentre à Paris.
Première partie.
AUTOUR DE Mme SWANN
Monsieur de Norpois est invité à dîner chez les parents du narrateur. Diplomate compassé et routinier, c’est un homme ennuyeux au langage suranné. La mère du narrateur ne l’apprécie guère mais se montre cependant aimable avec lui pour plaire à son mari. Agé d’une quinzaine d’années, le narrateur assiste au repas. Au cours de la conversation monsieur de Norpois déclare avoir dîné chez « la belle madame Swann« . En effet, à la surprise de beaucoup, Odette a fini par épouser Swann. Après avoir été très liés avec lui, les parents du narrateur qui n’ont pas apprécié ce mariage ont beaucoup espacé leurs relations. Norpois fait perfidement remarquer qu’il y avait beaucoup plus d’hommes que de femmes à ce repas et que les rares femmes présentes appartenaient au monde républicain plutôt qu’à la société habituelle de Swann. L’attention du narrateur est toujours en éveil lorsque l’on parle des Swann car il est secrètement amoureux de leur fille Gilberte et il laisse entendre à M. de Norpois qu’il brûle d’être reçu chez ses parents. Malgré la promesse que fait ce dernier d’intervenir en ce sens, il comprend qu’il n’en fera rien. Le narrateur lance ensuite la conversation sur Bergotte, écrivain très connu qu’il admire mais c’est pour constater à sa grande déception que M. de Norpois n’est pas de son avis. Apprenant que le jeune homme a certains dons d’écriture Norpois lui conseille de viser une carrière littéraire plutôt que diplomatique comme le souhaiteraient ses parents. Le père du narrateur demande alors à son fils de lire à M. de Norpois un petit poème qu’il a écrit récemment à Combray mais le diplomate ne semble pas l’apprécier, se gardant de tout commentaire. Sous l’influence de son collègue, le père du narrateur donne son accord à son fils pour qu’il choisisse la voie des Lettres plutôt que la carrière, un choix que sa femme ne semble pas partager. Tout en se réjouissant de cette autorisation, le jeune garçon reste incertain quant à ses dons littéraires et doute de ses propres motivations. Ce qui le rassure toutefois c’est que l’héritage de sa très riche tante Léonie le met à l’abri du besoin.
Les promenades sur les Champs-Elysées reprennent et le narrateur retrouve avec plaisir Gilberte Swann, toujours aussi imprévisible. Au cours de leurs jeux, répondant parfois à des pulsions subites, il aime lutter avec elle et recherche le contact de son corps, une situation qu’elle semble elle-même assez apprécier pour prolonger le jeu.
Le narrateur ressent les premiers symptômes de l’asthme qui va le handicaper toute sa vie. Sa grand-mère en éprouve beaucoup de chagrin. Le docteur Cottard est appelé pour le soigner. Sa réputation d’homme peu cultivé et auteur de mauvais calembours ne l’empêche pas d’être reconnu comme un médecin ayant un excellent diagnostic. Le traitement qu’il propose s’avère efficace, du moins un certains temps.
Enfin invité chez Gilberte, le narrateur en éprouve une immense joie, d’autant plus qu’il est accueilli très gentiment par ses parents. Cette invitation sera suivie de nombreuses autres. Tout est beau chez les Swann et la mère de Gilberte se montre très aimable avec le jeune homme. Swann a changé depuis son mariage, il a perdu de sa modestie habituelle et les Swann ont désormais la réputation d’être des arrivistes et d’avoir des sympathies pour les républicains ce qui les rend peu fréquentables par l’aristocratie du faubourg Saint-Germain. Lady Rufus Israels tante très riche et influente de Swann n’aime pas Odette et s’emploie à ce qu’elle ne soit pas reçue dans les salons chics où elle passe d’ailleurs pour une cocotte illettrée. Swann ne semble pas remarquer, ou feint d’ignorer les lacunes et les bêtises d’Odette. Bien qu’évoluant dans un nouveau monde depuis son mariage, il continue discrètement de fréquenter certaines de ses anciennes relations. Il n’est plus du tout jaloux d’Odette car il aime une autre femme. Le narrateur, lui, éprouve de plus en plus d’admiration pour Odette et est fier de se montrer avec elle lorsqu’il l’accompagne dans ses promenades. Il est invité un jour chez les Swann à un grand dîner auquel assiste Bergotte, écrivain pour lequel il éprouve beaucoup d’admiration. Il est désagréablement surpris par son physique, son allure, son élocution particulière, sa voix, son nez en colimaçon. Bergotte est conscient de son génie mais reste modeste bien qu’il ait l’ambition d’entrer à l’Académie où sa candidature a été rejetée à plusieurs reprises. L’écrivain remarque l’esprit particulièrement vif du jeune garçon envers lequel il se montre attentionné, entre autre sujet de sa santé. Très critiques à l’égard de l’écrivain, les parents du narrateur n’encouragent pas cette relation amicale, mais lorsqu’ils apprennent que Bergotte a trouvé leur fils intelligent, ils se ravisent, flattés, et finissent par admettre que l’homme a de grandes qualités.
Bloch emmène le narrateur pour la première fois au bordel où il rencontre Rachel, une des pensionnaires qui aura un rôle à jouer dans la suite de l’œuvre. Dans ce bordel, il reconnaît le canapé hérité de tante Léonie et qu’il a offert à la tenancière et se souvient que c’est sur ce canapé qu’il a fait l’amour pour la première fois avec une jeune cousine.
Au cours de ses visites assidues chez les Swann, il retrouve souvent Bergotte. D’une grande générosité il dépense des fortunes pour offrir de magnifiques bouquets de fleurs à Odette. Cependant Gilberte semble contrariée par la fréquence des visites de son ami qui l’obligent à renoncer à certaines sorties. Les deux jeunes gens cessent de se voir mais échangent des lettres. Toujours amoureux de Gilberte, le narrateur souffre de son indifférence. Il continue cependant de fréquenter les Swann mais en choisissant les moments où la jeune fille est absente. Le temps passant il se détache d’elle tout en gardant l’espoir de recevoir une lettre lui disant qu’elle l’aime toujours. Un jour Odette annonce au narrateur que Gilberte l’invite à déjeuner. Après avoir hésité il décide de s’y rendre. Toujours généreux, il vend un vase chinois rare hérité de tante Léonie pour pouvoir offrir un riche cadeau à Gilberte. En arrivant près de chez les Swann il aperçoit au loin Gilberte en compagnie d’un jeune homme. Il se console en allant voir les filles de joie. Ses visites chez les Swann s’espacent de plus en plus et s’il aime toujours Gilberte il retrouve le calme, la distance dissipant la douleur. Toutefois leur correspondance se poursuit et il lui confirme son refus de la revoir en évoquant de mystérieux malentendus auxquels il va finir par croire lui-même.
Avec les beaux jours le narrateur accompagne parfois Odette dans l’avenue du Bois où elle a coutume de se promener dans un magnifique équipage.
*****
.
Deuxième partie
AUTOUR DE Mme SWANN
NOMS DE PAYS : LE PAYS
Deux ans ont passé, le narrateur part soigner son asthme à Balbec. Sa grand-mère l’accompagne, c’est la personne qu’il aime le plus au monde après sa mère, Françoise est aussi du voyage. Avec beaucoup d’émotion le narrateur quitte sa mère pour la première fois. L’arrivée au Grand-Hôtel de Balbec est décevante, le directeur de l’hôtel, poussah mondain, le met mal à l’aise. D’une manière générale, l’inconnu l’indispose comme cette chambre qui ne lui est pas familière. Quand il traverse des moments d’abattement, sa grand-mère qui occupe la chambre voisine le rejoint bien vite avec sa robe de chambre de percale et lui apporte le réconfort dont il a besoin. En revanche le narrateur est émerveillé par la vue de la mer et séduit par les repas pris derrière les vitres de la véranda, face à l’océan. Il regarde avec envie des jeunes, dont il aimerait aimerait tant faire la connaissance, déambuler dans le voisinage. Parmi la clientèle de l’hôtel, il remarque un jeune homme poitrinaire, une vieille dame très riche, beaucoup de bourgeois des environs, imbus de leur importance. Un jour le maître d’hôtel donne par erreur au narrateur et à sa grand-mère une table réservée à M. de Stermaria et à sa fille. Du léger incident qui en résulte, le narrateur retiendra surtout la beauté de Mlle de Stermaria dont le souvenir restera longtemps gravé dans son esprit.
La vieille dame riche n’est autre que la marquise de Villeparisis une amie d’enfance de sa grand-mère qui va passer beaucoup de temps avec elle. Le narrateur n’a d’yeux que pour Mlle de Stermaria à qui il brûle d’impatience d’aller parler. Il souffre de ne connaître personne contrairement à Françoise qui très vite a noué de nouvelles relations.
Mme de Villeparisis témoigne beaucoup de gentillesse envers le narrateur et sa grand-mère. Curieusement elle semble parfaitement au courant du déroulement du séjour des parents du narrateur en Espagne avec M de Norpois et donne de nombreux détails sur ce voyage (ce n’est que bien plus tard qu’on apprendra qu’elle est la maîtresse de M. de Norpois). Chose rare chez les personnes de son milieu, elle est très libérale et fait montre de largesse d’esprit tout en se déclarant antisocialiste. Le narrateur l’écoute avec intérêt raconter les visites chez ses parents, lorsqu’elle était petite fille, de personnages aussi considérables que Balzac, Chateaubriand, Victor Hugo. D’autre part il éprouve de la curiosité pour les jeunes filles en villégiature croisées lors de ses promenades. Parfois il préférerait rentrer à pied dans l’espoir de les rencontrer mais sa Grand-mère le couve littéralement et refuse de le laisser seul. Il observe également les filles du village qui excitent son imagination. Il s’habitue progressivement à son nouvel environnement et éprouve du plaisir à rentrer à l’hôtel le soir, après les longues promenades dans la calèche de Mme de Villeparisis, accueilli sur le perron par le nombreux personnel attentionné ; même sa chambre lui plaît désormais.
La marquise de Villeparisis annonce au narrateur la venue prochaine de son petit neveu, Robert de Saint-Loup, élève officier de cavalerie en garnison à Doncières, un jeune homme très bien mais, précise-t-elle, qui a pour maîtresse « une bien mauvaise femme ». Le narrateur est impressionné par ce jeune homme chic, impertinent, hautain, un tantinet efféminé. Dans un premier temps, Saint-Loup les snobe, lui et sa grand-mère, puis, bien vite change d’attitude pour adopter envers eux un comportement amical, devenant le plus aimable des hommes. Rompant avec les manières aristocrates, il affiche son admiration pour le socialisme et aussi pour Nietzsche et Proudhon. La grand-mère du narrateur est conquise par la gentillesse de Saint-Loup et tous deux deviennent de grands amis.
Bloch, l’ami du narrateur, est également en villégiature à Balbec. C’est un garçon intelligent mais mal élevé, névropathe et snob. Il tient parfois des propos antisémites et le narrateur craint ses visites à l’hôtel car il a honte de se montrer avec cet ami encombrant qui a coutume de se déplacer avec sa famille, dont ses sœurs aussi mal élevées que lui. Sa conversation est de qualité très inégale. Il dit tour à tour du mal de Saint-Loup puis du narrateur en comptant sur chacun pour le répéter à l’autre. Quand il invite les deux jeunes gens à dîner chez son père, c’est avec l’arrière pensée que Saint-Loup l’introduise dans le monde aristocratique.
Saint-Loup attend la visite de son oncle Palamède qu’il décrit comme un homme dédaigneux, entiché de sa noblesse et réputé pour être un coureur de jupons. Un jour le narrateur se sent observé fixement par un homme étrange qu’il prend pour un escroc d’hôtel ou un aliéné, la quarantaine, très grand, gros, affublé d’une énorme moustache noire. Il ignore qu’il s’agit de l’oncle de Saint-Loup, le baron Palamède de Charlus. Lorsqu’il lui est présenté, celui-ci fait preuve de beaucoup de froideur. Apprenant que Charlus est un Guermantes de Combray, le narrateur réalise qu’il l’a aperçu quelques années auparavant, au cours d’une promenade à Tansonville, alors qu’il était en compagnie d’Odette Swann et de Gilberte. Charlus adopte alors avec le narrateur un comportement déconcertant, passant d’une attitude chaleureuse au mépris le plus complet.
Un soir, comme le narrateur s’apprête à se coucher, Charlus lui rend visite dans sa chambre pour lui apporter un livre de Bergotte qu’il sait être un de ses auteurs favoris. Très doux, gentil, il tient un discours incompréhensible, puis quitte brutalement la chambre. Par la suite il se montrera familier avec le narrateur et prononcera des mots étranges assortis de gestes équivoques.
La famille de Saint-Loup se désole que le jeune homme fréquente une grue qui le fait autant souffrir, mais lui, aveuglé par l’amour, pardonne tout à sa maîtresse et continue de la combler d’argent et de cadeaux. Il obtient même qu’une de ses tantes la fasse venir faire une lecture au cours d’une soirée qu’elle donne dans son hôtel particulier parisien. Ce sera un échec total. Saint-Loup qui passe toutes ses permissions à Balbec vit au rythme des rares lettres que consent à lui adresser sa maîtresse qui lui a interdit de venir à Paris. Il a beaucoup de respect et d’affection pour la grand-mère du narrateur. Un jour où il la prend en photo, elle pose avec une complaisance qui étonne le narrateur au point qu’il se moque d’elle. Ce n’est que plus tard qu’il apprendra que sa grand-mère avait sollicité cette photo parce que sentant sa mort proche elle voulait laisser un souvenir à son petit fils. Il regrettera alors amèrement son attitude.
Depuis son arrivée, le narrateur a remarqué une petite bande de fillettes en villégiature à Balbec, très différentes des filles du pays. Il les détaille l’une après l’autre, attiré tout particulièrement par l’une d’entre elles, avec des grosses joues et vêtue d’un polo noir, qui semble l’avoir remarqué elle aussi. Pour lui c’est la plus jolie de la bande.
Devenus de bons amis,le narrateur et Saint-Loup ont pris l’habitude d’aller dîner ensemble sur la côte normande, au restaurant à la mode de Rivebelle où ils aperçoivent pour la première fois le célèbre peintre Elstir, un ami de Swann. Les deux jeunes gens lui font parvenir un message. En quittant le restaurant Elstir s’arrête à leur table et se montre très aimable avec eux, en particulier avec le narrateur qu’il invite à lui rendre visite dans son atelier à Balbec.
Très souvent le narrateur rentre se coucher au petit matin pour ne se réveiller que dans l’après-midi. Ses fréquentes sorties nocturnes ne l’empêchent pas de continuer d’observer le groupe des jeunes filles qui chahutent, pouffent de rire, formant une petite bande insolente. Le narrateur est conscient de mener une vie décousue et de ne pas respecter l’engagement qu’il a pris mais il justifie sa paresse par sa santé médiocre.
La jeune fille au polo noir semble être la meneuse de la petite bande, mais l’intérêt du narrateur ne se limite pas à elle. Il observe avec attention chacune des autres jeunes filles du groupe. Il veut plaire et, de plus en plus coquet, soigne sa tenue. Il passe ses journées à suivre de loin la bande, ne pense qu’à elle et en oublie même la visite promise à Elstir. Sur l’insistance de sa grand-mère il finit par se rendre chez le peintre multipliant par la suite ses visites. Dans un coin de l’atelier il découvre les tableaux de l’artiste dont l’un, très curieux, attire son attention. C’est celui d’une jeune femme habillée en travesti et baptisée Miss Sacripant. Il lui faut un moment pour réaliser que le modèle n’est autre qu’Odette de Crécy, la dame en rose rencontrée jadis chez l’oncle Adolphe.
 Miss Sacripant d’après David Richardson
Miss Sacripant d’après David Richardson
Peu à peu le narrateur découvre la vraie nature d’Elstir, homme plein de génie, solitaire, sage, philosophe à la conversation magnifique. C’est chez lui qu’il rencontre enfin Albertine. Elle semble intimidée, de son côté il éprouve une certaine déception, choqué par certaines de ses attitudes et formes de langage mais il pense que grâce à elle il pourra connaître les autres jeunes filles du petit groupe. Il revoit Albertine quelques jours plus tard, et cette fois la jeune fille l’enchante et lui paraît désirable. Il la considère comme une fille légère, ce qui lui inspire des idées et cependant lorsqu’il la revoit, il se montre très respectueux avec elle. Il rencontre également Andrée, aux yeux très clairs mais Albertine n’est pas disposée à faire connaître au narrateur les autres jeunes filles de la bande. Un autre jour il remarque Gisèle à la chevelure magnifique et bien vite, il s’enflamme à l’idée de la séduire mais la jeune fille fait faux bond au dernier moment. Il finit par connaître toute la bande et passe avec les jeunes filles le plus clair de ses journées abandonnant ainsi sa Grand-mère, Mme de Villeparisis, Elstir, Saint-Loup auquel il a pourtant promis une visite à Doncières. Les jeunes gens occupent leurs après-midi à des goûters sur la falaise et se livrent à des jeux enfantins. Le narrateur est parfaitement heureux. Au cours d’un de ces goûters Albertine lui glisse dans la main un billet avec le message « je vous aime bien ». Malgré une brouille avec la jeune fille, le narrateur est convaincu qu’il l’aime bien aussi ce qui ne l’empêche pas, par moments, de lui préférer Rosemonde et Andrée avec lesquelles il passe beaucoup de temps. Les jours de pluie la petite bande se retrouve au Casino ou chez Elstir. Parfois les jeunes filles rencontrent les sœurs de Bloch qu’elles n’aiment pas parce que trop excentriques, elles ont mauvais genre. L’une d’elles est attirée par Mlle Léa, actrice et homosexuelles notoire.
Pendant ce temps Françoise continue se montre insupportable avec son entourage. Depuis qu’elle est à Balbec, elle a beaucoup moins de travail et pourtant elle ne cesse de se plaindre avec une mine de reine offensée et lançant un regard courroucé au narrateur qui, à son avis, se montre trop exigeant pour sa toilette.
Pour des raisons pratiques Albertine doit passer une nuit au Grand-Hôtel. Elle invite le narrateur à venir lui rendre visite dans sa chambre. Euphorique, celui-ci laisse libre cours à son imagination. Comme convenu Il se rend dans la chambre de la jeune fille où il la trouve couchée. Il essaie de l’embrasser, mais contre toute attente elle refuse brutalement son baiser. Extrêmement surpris par cette réaction que rien ne laissait présager, il va se détourner d’elle pendant quelques temps pour reporter son intérêt sur Andrée, une réaction qu’Albertine lui pardonnera.
La fin de la saison arrive et, l’une après l’autre, les jeunes filles quittent Balbec. Albertine part la première, brusquement. Françoise elle aussi est impatiente de partir. Le Grand-Hôtel est vide, le petit train cesse de fonctionner, le casino ferme, il pleut.
Le narrateur quitte Balbec pour rentrer à Paris.
_______________________________
 Salon littéraire parisien de la fin du 19ème
Salon littéraire parisien de la fin du 19ème
Les parents du narrateur vivent désormais dans un appartement de l’hôtel des Guermantes. Follement amoureux de la duchesse, le Narrateur ne cesse de surveiller ses allers et venues. Alors qu’il est en visite chez son ami Saint-Loup en garnison à Doncières, il doit rentrer précipitamment à Paris, en raison de l’état de santé de sa grand-mère. Albertine vient le voir, elle accepte ses caresses et se donne enfin à lui. En permission à Paris, Saint-Loup présente sa maîtresse au narrateur qui reconnaît en elle Rachel la prostituée rencontrée quelques années auparavant dans un bordel. Enfin, pour la première fois, le narrateur a l’occasion d’échanger quelques mots avec la duchesse de Guermantes mais il constate alors qu’elle le laisse désormais indifférent et se rend compte du ridicule de son attitude passée. Rentré chez lui, le narrateur apprend que l’état de santé de sa grand-mère s’est encore dégradé, elle va bientôt mourir d’une crise d’urémie. Au cours d’une soirée, Charlus, le frère du duc de Guermantes lui demande de passer chez lui et fait preuve à son égard d’une attitude déconcertante, non sans équivoque. Le narrateur rencontre Swann qui, gravement malade, est condamné. La duchesse feint avec coquetterie de ne pas croire à la gravité de sa maladie.
La famille du narrateur a emménagé dans un appartement de l’hôtel des Guermantes. Les Guermantes ne sont pas étrangers à la famille, ils possèdent un château près de Combray et c’est dans l’église du village que le narrateur a aperçu la duchesse de Guermantes pour la première fois. C’est une femme encore jeune, belle et élégante qui le trouble beaucoup et occupe le plus clair de ses pensées. La fidèle Françoise, l’ancienne cuisinière de tante Léonie, n’apprécie pas le déménagement et garde la nostalgie du pays, mais sa curiosité naturelle la pousse à épier sans beaucoup de discrétion les occupants de l’hôtel des Guermantes ; elle se prend d’amitié pour Jupien, ancien giletier, installé dans la cour, que le narrateur qualifie de froid et railleur. Toutes ses pensées sont tournées vers Mme de Guermantes qu’il admire et dont il ne cesse d’observer les allers et venues. Pour lui, tout ce qui touche aux Guermantes est beau, féerique, mystérieux. Il écoute avec intérêt un de leur valet de pied devenu ami avec Françoise, raconter en détail les sorties de ses maîtres. Le duc de Guermantes est un géant à l’aspect débonnaire, qui se promène sans cesse, parle avec les gens et recherche la compagnie du père du narrateur.
Le narrateur a l’occasion d’assister à un gala de l’Opéra où se produit la célèbre comédienne Berma. Ebloui par le beau monde installé dans les loges, où il reconnaît la princesse de Guermantes, cousine de la duchesse, éclatante de beauté, véritable déesse, il donnerait un empire pour être auprès d’elle. Durant la représentation, tous les regards sont attirés par l’arrivée de la duchesse de Guermantes dans la baignoire de sa cousine. Autant la toilette de la princesse est riche et savamment étudiée, autant celle de sa cousine est d’une grande simplicité. Le narrateur remarque avec étonnement la présence de Mme de Cambremer qui a réussi à se faire inviter par la princesse de Parme. Son ambition suprême est d’entrer dans le cercle des Guermantes. Elle travaille à ce projet depuis plus de dix ans et son opiniâtreté a l’air d’aboutir. Le regard rivé sur les deux cousines Guermantes, le narrateur ressent un immense bonheur lorsque la duchesse lui envoie un petit salut de la main, à lui pauvre quidam perdu à l’orchestre.
Dès le lendemain, il n’a de cesse de suivre les déplacements de la duchesse et, apprenant à connaître les itinéraires qu’elle emprunte lors de ses promenades, il ruse pour se trouver comme par hasard sur son chemin. Parfois, il constate que le portrait d’elle qu’il imagine ne coïncide pas exactement avec la réalité, et il ressent alors quelque déception à noter une petite imperfection sur son visage, mais bien vite son admiration réapparaît totale et son trouble renaît. Robert de Saint-Loup éprouve une grande amitié et de l’admiration pour le narrateur. Elève officier, il invite son jeune ami à lui rendre visite sur son lieu de garnison à Doncières. Celui-ci accepte l’invitation, mais malheureusement Robert est consigné et ne peut s’occuper de lui comme il le souhaiterait. Tout d’abord hébergé chez son ami, à sa grande déception il doit ensuite aller loger à l’hôtel où il finit par se sentir à l’aise. Il lui arrive parfois de passer la nuit avec une jeune fille du pays. Robert se montre attentionné, cherchant en toute occasion à le mettre en valeur, mais il se montre jaloux de l’intérêt que porte le narrateur à un jeune militaire de ses amis. On évite de parler de l’affaire Dreyfus pour ne pas froisser les autres, car Saint-Loup est le seul à défendre l’officier. Curieusement, le narrateur s’intéresse aux activités du régiment et suit l’évolution des manœuvres pendant des jours entiers. Il n’a pas oublié que son ami est le neveu de la duchesse de Guermantes et il lui demande de l’inviter un jour en même temps qu’elle. Saint-Loup promet sans enthousiasme. Il essaie alors d’obtenir de son ami une photo de sa tante qui est dans sa chambre, mais celui-ci refuse.
Rentré à Paris, le narrateur retrouve sa grand-mère qu’il surprend, seule, celle-ci ne se doutant pas de sa présence. Pour la première fois, il voit en elle une vieille femme malade et solitaire, lourde et vulgaire.
Le printemps arrive sans que Saint-Loup tienne sa promesse de présenter le narrateur à sa tante. Toujours amoureux, celui-ci reprend ses promenades dans l’espoir de voir passer la duchesse lors de ses promenades quotidiennes. Il l’admire toujours autant, sensible à l’élégance de ses toilettes qu’il décrit avec une précision étonnante. A la grande surprise de la famille, M. de Norpois, diplomate, collègue du père du narrateur, se rend fréquemment chez la madame de Villeparisis (on en connaîtra la raison plus tard). Le père du narrateur est flatté d’apprendre que la princesse apprécie beaucoup son fils et qu’elle pense qu’il devrait fréquenter son salon où il ferait des rencontres intéressantes ; il encourage son fils à suivre son goût pour l’écriture, mais celui-ci se désole de tentatives inabouties. Il est conscient de gâcher ses talents par la vie déséquilibrée qu’il mène.
Malgré ses rebuffades, Saint-Loup éprouve toujours une passion dévorante pour sa maîtresse et il ne cesse de parler d’elle avec enthousiasme, tendresse et émotion. Bien qu’il la soupçonne de ne rester avec lui que pour son argent, il continue de la combler de cadeaux somptueux. En permission à Paris, il invite le narrateur à dîner pour la lui présenter. Quelle n’est pas la surprise du narrateur lorsqu’il reconnaît en la fiancée de Robert, Rachel, la fille de joie qu’il a rencontrée quelques années auparavant dans la maison de passe où l’avait amené Bloch, aussi pense-t-il que Saint-Loup est bien naïf pour donner des millions à une femme que n’importe quel homme peut posséder pour quelques francs.
Sur l’insistance de M. de Norpois et de son père, le narrateur se rend à une invitation de Mme de Villeparisis. A cette occasion, il apprend qu’elle entretient une liaison depuis plus de vingt ans avec M. de Norpois, ce qui explique les fréquentes visites de celui-ci qui avaient tant intrigué la famille. Le narrateur observe avec attention les invités parmi lesquels la duchesse de Guermantes dont il détaille avec soin les yeux, la voix, la stature. Il est surpris de voir invité à cette réception M. Legrandin qui flatte vilement Mme de Villeparisis et paraît gêné de rencontrer le narrateur en ces lieux. La duchesse de Guermantes se livre à une violente critique de Rachel et de sa prestation récente dans son salon, puis elle l’accuse d’avoir fait de Robert un dreyfusard convaincu. Comment peut-il aimer une telle femme ? On assiste ensuite à l’arrivée de son mari, le duc, qui entre dans le salon triomphalement à la façon d’un roi. C’est un homme extrêmement riche, vaniteux et coureur de jupons. Le narrateur observe avec curiosité la duchesse de Guermantes, surpris par la violence de ses attaques contre certaines personnes.
La marquise de Marsantes, mère de Saint-Loup et sœur du duc de Guermantes et de Charlus, fait à son tour son entrée dans le salon. Bien que tout le monde la considère comme un être supérieur et vertueux, le narrateur la soupçonne de partager quelques uns des nombreux défauts de son frère. Son amabilité à l’égard du narrateur se nuance d’un rien de condescendance. Fière de ses origines, elle ne peut se défendre d’un rôle de protectrice pratiquant une certaine humilité auprès des inférieurs. Elle rêve de voir son fils faire « un mariage colossalement riche ». L’arrivée inattendue de Saint-Loup met sa mère en joie. Il refuse que sa mère lui présente Mme Swann qui est une ancienne grue ; venant de lui, cette remarque ne manque pas de piquant, lui qui a pour maîtresse une prostituée. Se retrouvant un instant aux côtés de la duchesse de Guermantes, le narrateur échange quelques banalités avec elle. Le Baron de Charlus arrive à son tour. Il recherche toujours la compagnie des plus jolies femmes pour se mettre en valeur. A l’évidence, sa tante Mme de Villeparisis n’apprécie pas sa visite, malgré leur estime réciproque, leurs relations sont souvent orageuses. Une fois de plus, Charlus adopte une attitude déconcertante avec le narrateur, alternant amabilité et froideur. Subitement, il l’invite à sortir se promener avec lui. Cette initiative semble contrarier Mme de Villeparisis, peut-être connaît-elle les mœurs homosexuelles de son neveu et craint-elle pour le narrateur. Ce dernier apprend avec étonnement que Charlus et le duc de Guermantes sont frères. Charlus demande au narrateur de sermonner Saint-Loup pour sa liaison avec Rachel, puis il tient des propos décousus et équivoques, parfois odieux, souvent ambigus. Certains sont clairement antisémites, d’autres dans un registre sadomasochiste, sans pourtant vraiment choquer le narrateur. Quand celui-ci lui demande de l’introduire dans le cercle des Guermantes, il ne lui soutire pas de promesse et lorsqu’il se renseigne sur Mme de Villeparisis, Charlus se montre méprisant, déclarant « qu’elle ou rien, c’est pareil ». Elle s’est déshonorée en épousant M. Thirion, très riche, certes, mais simple roturier, une mésalliance qu’il ne peut lui pardonner.
Chez lui, le narrateur trouve sa grand-mère malade. Le docteur Cottard, qui la soigne depuis quelque temps, lui a ordonné un traitement qui s’avère peu efficace, et la fièvre persiste. On décide de faire appel au docteur Boulbon qui arrive à persuader la malade que son mal est imaginaire. Tout le monde est soulagé, et la grand-mère accepte de reprendre ses promenades aux Champs-Elysées. Mais au cours de l’une de ces sorties, elle ressent un malaise qu’elle essaie en vain de cacher à son petit-fils. On diagnostique une attaque due à l’urémie, il est évident qu’elle est perdue. Françoise va prendre soin de la grand-mère avec beaucoup de sollicitude, restant constamment à son chevet. Sa santé décline peu à peu, elle devient aveugle puis sourde. Son élocution se fait difficile. Elle tente de cacher à son entourage ses souffrances physiques et morales. Bientôt elle ne reconnaît plus le narrateur. On lui administre de la morphine sans pourtant la délivrer de ses douleurs. Avec son bon sens de campagnarde, Françoise commande déjà sa toilette de deuil et s’absente pour les essayages. La grand-mère va mourir une nuit et le narrateur s’étonnera de constater combien son visage a rajeuni.
Le narrateur continue de mener chez lui une vie paresseuse et inactive. Il est déçu de ne pas trouver dans Le Figaro un article qu’il a envoyé. Saint-Loup, sous la pression de sa famille, est parti au Maroc après avoir rompu avec Rachel. Il a accusé (à tort) le narrateur de perfidie et de trahison après que Rachel lui ait dit qu’il lui avait fait des propositions, puis il semble lui avoir pardonné. Quand il lui écrit qu’il a rencontré à Tanger Mme de Stermaria fraîchement divorcée, à qui il l’a chaudement recommandé, le narrateur envoie aussitôt à celle-ci un billet pour lui proposer un rendez-vous et déjà il attend la réponse avec fébrilité.
Albertine rend visite au narrateur qui en éprouve une grande joie. Il a l’impression que, même si elle a évolué, l’intelligence de la jeune fille est assez limitée. Il essaie de se persuader que la jeune fille lui est désormais indifférente, qu’il n’éprouve plus d’amour pour elle, mais au fond de lui-même il n’en est rien et il la désire toujours. Prétextant un jeu, il lui demande de s’étendre sur son lit. Va-t-il l’embrasser ? Il se souvient de son échec au Grand Hôtel de Balbec, mais cette fois-ci, docile, elle accepte ses caresses. Son désir enfin assouvi, il pense déjà à Mme de Stermaria dont il attend toujours la réponse. Quand cette dernière accepte le rendez-vous, le narrateur en conçoit un immense plaisir.
Le même jour, le narrateur se rend à l’invitation de Mme de Villeparisis, la duchesse Oriane de Guermantes y est présente. Est-ce parce que sa mère lui a fait prendre conscience du ridicule de son attitude vis-à-vis de la duchesse, toujours est-il que son amour pour elle s’est brusquement éteint. A l’inverse, la duchesse, jusqu’alors distante, se montre aimable et attentionnée et le convie à dîner. Mais désormais l’esprit du narrateur est ailleurs, il ne cesse de penser à son proche rendez-vous avec Mme de Stermaria et à la manière dont il la possédera. Rentré chez lui, il trouve Albertine venue lui rendre visite malgré l’heure tardive. Faisant preuve d’un manque de tact évident, il lui demande des conseils sur l’organisation de sa prochaine soirée avec Mme de Stermaria. Son cynisme le conduit à envisager de recourir à Albertine comme pis-aller, si l’aventure tournait court. Le lendemain le narrateur envoie un fiacre chercher Mme de Stermaria, mais le cocher revient bientôt porteur d’un message : en raison d’un empêchement, Mme de Stermaria remet le rendez-vous à plus tard. Désespéré, le narrateur va dîner au restaurant avec Saint-Loup qui est de retour du Maroc. Ils y retrouvent une bande d’amis de Robert, jeunes aristocrates pourris de dettes et en quête d’un bon parti. Les élus sont rares, aussi la lutte est-elle intense, ce qui ne les empêche pas de rester inséparables et le bruit court qu’il existe entre eux des relations homosexuelles, ce que le narrateur refuse de croire, pourtant l’avenir montrera que c’est exact. Le repas avec Saint-Loup est agréable, le narrateur est sensible à la gentillesse de son ami qu’il admire.
Le narrateur se rend à l’invitation de la duchesse de Guermantes. Il est accueilli fort aimablement par le duc. On le présente à plusieurs dames de la haute aristocratie, dont la princesse de Parme qui, consciente de sa haute lignée, fait beaucoup d’efforts pour paraître simple. Le narrateur est très déçu par le prince d’Agrigente qu’il compare à un « vulgaire hanneton ». Il observe avec effarement le cérémonial instauré pour passer à table, « ingénieuse mécanique humaine ».
Le duc et la duchesse de Guermantes font toujours forte impression partout où ils vont, d’ailleurs nombreuses sont les femmes qui jalousent Oriane douée d’une forte personnalité et considérée par beaucoup comme la plus belle, la plus instruite, la plus vertueuse de l’aristocratie. Pourtant elle n’épargne ses railleries à personne, excepté son mari. Elle aime désarçonner les gens par son attitude peu conformiste. Le duc, lui, a la réputation d’être radin, sauf pour ses attelages et les toilettes de la duchesse et, comme par une sorte de compensation, il devient même généreux lorsqu’il tombe amoureux d’une nouvelle femme. Il collectionne en effet les maîtresses qui ont généralement toutes le même type de beauté, blondes, grandes, majestueuses et désinvoltes. A chaque nouvelle liaison, le duc se montre possessif et passe tout son temps avec sa nouvelle conquête. La duchesse est tolérante. Il lui arrive parfois de demander à son mari de lui présenter sa nouvelle conquête et il n’est pas rare que des maîtresses fraîchement abandonnées aillent pleurer dans les bras de la duchesse. Bien que la trompant sans vergogne, le duc éprouve de la fierté de l’avoir pour épouse, surtout lorsqu’elle aborde des sujets littéraires et cite des auteurs.
Au cours de la soirée, la discussion porte sur Saint-Loup. Selon le prince de Foix, Robert continuerait de voir Rachel lorsqu’il vient en permission, et d’ailleurs il ne souhaite pas retourner en garnison au Maroc. La princesse de Parme demande aux Guermantes d’intervenir auprès du général de Monserfeuil (qui a plus de talent pour faire des enfants à sa femme que pour gagner des élections ; « c’est le seul arrondissement où le pauvre général n’a jamais échoué » fait cruellement remarquer la duchesse de Guermantes). Le duc refuse d’intervenir par négligence, la duchesse par méchanceté. Durant la soirée, les jalousies entre familles et les cancans en tous genres occupent une bonne partie des discussions au point que le narrateur, bien qu’intéressé par la généalogie des grandes familles, se lasse de ces échanges de méchancetés, avec par moments l’impression d’être comme un corps étranger dans ce milieu où il observe avec étonnement l’évolution rapide des us et coutumes de l’aristocratie.
Le narrateur quitte la soirée pour répondre à l’invitation de Charlus. Après qu’un valet l’ait fait attendre longuement, au point qu’il hésite de s’en aller, il est introduit chez le baron où il reçoit un accueil glacial, frisant la grossièreté. De façon tout à fait inattendue, Charlus lui fait une véritable scène de jalousie, le traitant d’impoli, d’ingrat. Le narrateur peine à comprendre une attitude surprenante qui se prolonge et, il finit par perdre son sang-froid et se dirige vers la sortie quand, subitement, le baron s’adoucit et supplie humblement le jeune homme de rester, avant une nouvelle colère suivie à nouveau d’un comportement conciliant. Charlus propose une chambre au narrateur qui refuse et demande qu’on le reconduise. Charlus saisit le menton du jeune homme, remonte ses mains à ses oreilles, lui déclare qu’il serait agréable d’aller voir la lune bleue au Bois de Boulogne avec lui. Et enfin, le narrateur pourra rentrer chez lui.
Un jour le narrateur reçoit une invitation pour aller à une soirée chez le prince et la princesse de Guermantes et il est tellement surpris qu’il se demande si ce n’est pas une erreur ou une mystification. Il se rend chez le duc et à la duchesse de Guermantes pour leur demander leur avis. Il est reçu par le duc qui se prépare à sortir avec sa femme. Deux cousines du duc arrivent sur ces entrefaites pour informer celui-ci qu’un de ses proches cousins est au plus mal. Contrarié par une nouvelle qui risque de gâcher sa soirée mondaine, le duc décide de nier l’évidence. Les deux cousines parties, Swann arrive, porteur d’une grande photo que lui a demandée la duchesse. Gravement malade, il a beaucoup changé physiquement. Affable, il salue le narrateur sans l’avoir reconnu. Le couple Guermantes les rejoint, habillés pour leur soirée. Oriane est magnifique, elle raille sa cousine la princesse qu’elle trouve très belle mais un peu bête, nébuleuse et loufoque. Puis, avec beaucoup légèreté, invite Swann à les accompagner dans leur voyage en Italie l’année suivante, invitation maladroite eu égard à l’état dans lequel se trouve Swann, mais elle feint avec coquetterie et inconscience de nier la gravité de la maladie de son ami.
________________
Le temps retrouvé
De nombreuses années se sont écoulées et le narrateur, malade, a passé de longs séjours en province pour se soigner. La guerre a éclaté et, lors d’un retour dans la capitale, le narrateur constate que ni l’élégance, ni le luxe, ni la recherche du plaisir n’ont perdu leurs droits. Mmes Verdurin et Bontemps règnent sur les deux salons les plus courus de Paris, entre autres par la haute aristocratie du faubourg Saint-Germain. Dans l’ensemble, les gens se montrent patriotes, excepté Charlus qui ne cache pas sa sympathie pour l’ennemi. En vieillissant, il se livre à des expériences sadomasochistes dans un hôtel de passe qu’il a acheté et dont il a confié la gérance à Jupien. Prenant conscience que sa maladie l’empêchera de réaliser une œuvre littéraire, le narrateur se désespère. Lors d’une soirée chez le prince de Guermantes, il a l’impression d’assister à un bal costumé, tant les anciennes connaissances qu’il y retrouve ont vieilli, paraissant déguisées. Cependant, trois incidents mineurs déclenchent en lui un effort de mémoire qui va ranimer des souvenirs lointains. Ces réminiscences mettent en évidence l’intérêt de ces introspections pour préserver de l’oubli certains événements du passé. Il décide alors d’orienter son travail dans ce sens pour faire aboutir son projet d’écriture. Victime d’une légère attaque cérébrale, il craint de de ne plus avoir assez de temps pour concrétiser son rêve.
*****
Le narrateur séjourne à Tansonville, chez Gilberte qui se plaint d’être abandonnée et trompée par son mari Robert de Saint-Loup. Sachant que sa femme apprécie la présence du narrateur, Saint-Loup approuve cette visite, tout en faisant preuve d’une certaine désinvolture, alors que les deux hommes sont des amis intimes. Robert aime Gilberte, mais ne cesse de lui mentir maladroitement. Au courant de l’ancienne liaison de son mari avec Rachel, Gilberte s’inspire des photos de la jeune femme pour se farder et s’habiller, dans l’espoir de le reconquérir.
Le narrateur doit se rendre dans une maison de santé loin de Paris. Le dernier soir de son séjour à Tansonville, il lit dans le journal des Goncourt la relation d’une soirée donnée chez les Verdurin. On apprend que M. Verdurin est un ancien critique de La Revue, que Mme Verdurin se vante d’avoir été celle qui a « fait » Elstir (appelé à l’époque Tiche) jusqu’à lui enseigner son art, s’attribuant les idées qui ont amené le peintre à la création de ses tableaux les plus célèbres. Le narrateur, qui connaît bien les habitués du salon des Verdurin, est surpris de la description très idéalisée qu’en font les Goncourt .
A son retour à Paris, il découvre que la mode a beaucoup évolué. Bien que le pays soit en guerre, l’élégance n’a pas perdu ses droits, ni la recherche du plaisir. Malgré tous les efforts déployés par Mme de Saint Euverte, son salon n’atteint pas, et de loin, le succès et la gloire que connaissent les salons des deux reines de Paris, Mmes Verdurin et Bontemps. Les temps ont bien changé et les aristocrates du faubourg Saint-Germain fréquentent désormais volontiers le salon des Verdurin où, malgré les restrictions dues à la guerre, les réceptions sont d’un luxe inouï.
Le narrateur s’étonne du manque d’objectivité des journaux dans leur description de la guerre. Les Allemands approchent de Paris et Gilberte part se réfugier à Tansonville avec sa fille, mais elle veut faire croire qu’elle est allée là-bas pour sauver le château. Les Allemands y arrivent deux jours plus tard et elle doit héberger leur état-major. Saint-Loup, qui a réintégré l’armée, envoie au narrateur de très belles lettres du front.
La brouille entre Charlus et Mme Verdurin va en s’aggravant. La situation de Charlus a changé, ses goûts pour la gent masculine sont désormais connus de tous. Faute d’hommes à Paris du fait de la guerre, il s’intéresse aux jeunes garçons et cesse de fréquenter les gens qu’il voyait habituellement et qui, d’ailleurs, ne recherchent plus sa compagnie. Rancunière, Mme Verdurin, ne cesse de dire du mal de lui et répand dans les salons qu’il serait prussien, voire un espion à la solde des Allemands. Morel, qui voue à Charlus une haine totale, participe à cette réputation. Mme Verdurin fait jouer ses relations pour que Morel puisse rester embusqué à Paris. Celui-ci vit depuis deux ans avec une femme dont il est très épris et qui a su lui imposer une fidélité absolue.
Dans l’ensemble, les parisiens se révèlent patriotes. M. de Cambremer, bien qu’âgé, travaille dans un état-major près du front, le duc de Guermantes se montre très anglophile, de même qu’Odette qui ne cesse de débiter des lieux communs sur la guerre, Brichot, lui, affiche ses idées militaristes. En revanche, Charlus nourrit une évidente sympathie pour l’ennemi et, sans aller jusqu’à souhaiter la défaite de la France, il espère que l’Allemagne ne sera pas écrasée. Pleutre, fanfaron et jaloux, Bloch critique violemment les gens de l’aristocratie.
Le cercle des habitués s’est considérablement élargi dans le salon des Verdurin et, de ce fait, les fidèles membres fondateurs comme Brichot ont perdu de leur intérêt. Depuis le début de la guerre, l’universitaire écrit dans la presse des articles dont le succès lui vaut une gloire soudaine qui indispose Mme Verdurin. Celle-ci espace les invitations de Brichot, afin de lui éviter la rencontre de nouvelles personnes qui pourraient accroître sa renommée.
Un soir, à Paris, le narrateur rencontre par hasard Charlus suivant deux zouaves. Charlus lui parle de Morel dont il est séparé depuis plus de deux ans, à la suite d’une brouille dont, sans se l’avouer, il souffre beaucoup. Au terme de sa longue promenade nocturne, le narrateur quitte Charlus et, assoiffé, entre dans le seul hôtel éclairé qu’il aperçoit et d’où il voit sortir discrètement un militaire, en qui il croit reconnaître Saint–Loup. Puis, il découvre dans une chambre, Charlus, enchaîné sur un lit et en train de se faire fouetter par un homme l’abreuvant d’injures. Acheté par Charlus, cet hôtel est tenu par Jupien. Le Baron ne se plaît plus qu’avec les gens du peuple, il aime côtoyer le monde du vice qui d’ailleurs l’exploite en lui soutirant le plus d’argent possible.
Le narrateur apprend la mort de son ami Saint-Loup qui a eu au front une fin glorieuse. Il en a beaucoup de chagrin et observe avec étonnement que la duchesse de Guermantes, réputée femme sans cœur, est elle aussi très affectée par ce décès.
Le narrateur va passer à nouveau plusieurs années dans une maison de santé, mais sans grands résultats. Il rentre à Paris, d’autant plus désespéré qu’il est conscient de ne rien avoir d’un artiste ou d’un poète et qu’il ne réalisera jamais son rêve d’écrire. Malgré sa longue absence de Paris, il continue de recevoir de nombreuses invitations auxquelles il décide de se rendre. Convié à une matinée chez le prince de Guermantes, il retrouve ses anciennes connaissances après bien des années. En se rendant à cette invitation, il a marché sur un pavé posé de guingois et, lorsqu’à partir de cette aspérité, ses pensées le ramènent aux dalles inégales d’un baptistère à Venise, il ressent un bonheur intense. Peu après, quand un domestique cogne une cuillère contre une assiette, il croit entendre le bruit du marteau sur une roue d’un wagon du petit train arrêté dans une clairière près de Balbec. Un peu plus tard, en s’essuyant la bouche, il trouve à sa serviette la même raideur que la serviette de bain avec laquelle il avait eu tant de peine à se sécher devant la fenêtre de sa chambre d’hôtel, le premier jour de son arrivée à Balbec. Ces trois signes successifs le tirent de son découragement, le rendant soudain impatient d’entreprendre une œuvre littéraire, même s’il est conscient des difficultés à venir. Pour ne pas déranger le bon déroulement du concert qui a déjà commencé, on le fait attendre dans un petit salon où il se livre à de profondes réflexions sur l’art, l’écriture, la recherche du passé, le temps perdu.
Le morceau de musique terminé, on vient le chercher et il se trouve mêlé à une fête bien étrange : tous les invités sont déguisés, avec des têtes poudrées, des barbes et des moustaches blanchies, des visages ridés. Le narrateur est ébahi par la qualité du travestissement, sous lesquels il reconnaît avec étonnement certaines personnes. Il lui faut plusieurs instants pour comprendre que, mieux que le plus habile des maquilleurs, c’est le temps qui a changé ainsi les invités et que, malheureusement, à la fin de la fête, un débarbouillage ne leur permettra pas de récupérer leur aspect d’antan. Ainsi, une sèche et maigre jeune fille s’est transformée en une vaste et indulgente douairière. Mais le narrateur prend conscience soudainement que le temps qui a passé pour les autres a également passé pour lui : la duchesse de Guermantes l’interpelle avec ces mots « mon plus vieil ami », un jeune homme l’aborde « vous qui êtes un vieux Parisien… ». Certains des invités ressemblent à des jeunes de dix-huit ans, extrêmement fanés et ayant perdu tous leurs défauts alors que jadis ils étaient insupportables, d’autres semblent marmonner la prière des agonisants. Comment retrouver dans cette lourde dame marchant pesamment, la blonde valseuse qu’il a connue autrefois ? Certains paraissent ne pas avoir vieilli, sauf lorsqu’on s’approche, découvrant alors toutes les imperfections de leur visage. Seule, Odette de Forcheville semble ne pas avoir changé, avec son visage comme injecté de paraffine, elle a l’air d’une « cocotte à jamais naturalisée ». Elle a gardé la même voix, mais plus triste, comme celle des morts dans l’Odyssée. Le narrateur a de la peine à reconnaître son ami de jeunesse Bloch, qui se fait désormais appeler Jacques du Rozier.
Le prince de Guermantes, veuf et ruiné par la guerre s’est remarié avec Mme Verdurin qui est devenue ainsi la nouvelle princesse de Guermantes, le rêve le plus fou qu’elle ait jamais imaginé ! Lors de son veuvage, elle avait épousé le duc de Duras, cousin ruiné du prince de Guermantes, mort deux ans après le mariage.
Le narrateur est surpris que certains jeunes de la nouvelle génération semblent tenir la duchesse de Guermantes pour peu de chose alors que, pour d’autres personnes plus âgées, avoir Oriane chez soi, fût-ce pour une petite heure, représente un grand honneur.
Une grosse dame salue le narrateur qui a de la peine à la reconnaître. C’est Gilberte, qui n’apprécie guère de se retrouver la nièce de Mme Verdurin. Ils parlent longuement de Saint-Loup pour qui Gilberte a conservé beaucoup de respect, mais à vrai dire elle semble parler davantage de l’ancien ami du narrateur que de son mari. Elle est devenue l’amie inséparable d’Andrée. Un peu plus loin, le narrateur aperçoit la duchesse de Guermantes en conversation avec une affreuse vieille dame qui n’est autre que Rachel devenue désormais célèbre et qui ne peut s’empêcher de lui faire de l’œil. Quand, au cours de la soirée, elle déclame des vers, sa prestation est si ridicule qu’elle laisse les auditeurs stupéfaits… en dépit des applaudissements.
La duchesse de Guermantes, qui était la reine incontestée des réceptions, a beaucoup perdu de son brillant et de son insolence. Charlus raconte au narrateur qu’elle a trompé abondamment son mari dans le passé, celui-ci n’ayant jamais cessé de tromper sa femme. Malgré son âge, le duc s’est soudainement épris d’Odette de Forcheville, ce qui la flatte et la gonfle de vanité, pas mécontente de jouer ainsi un mauvais tour à la duchesse de Guermantes. Fidèle à ses habitudes, elle trompe son vieil amant. La duchesse de Guermantes se montre méprisante avec Gilberte de Saint-Loup : « Pour moi, c’est exactement rien cette femme, ce n’est même pas une femme » dit-elle. A l’inverse, elle éprouve une admiration sans bornes pour Rachel. Le narrateur rencontre Morel qui, à sa grande surprise, jouit de la considération de son entourage, qualifié d’une haute moralité.
La mémoire du narrateur est parfois défaillante et il constate que les souvenirs des gens sont souvent approximatifs, ce qui le renforce dans son désir de commencer son œuvre. D’avoir pu observer les visages apparemment grimés, accentue pour lui la notion du temps perdu. Quel bonheur ce serait d’écrire un tel livre, même s’il est conscient de l’ampleur de la tâche ! Il s’imagine travaillant avec Françoise à ses côtés, Françoise, vieille femme ignorante qui sait percevoir le bonheur du narrateur et respecte son travail, Françoise qui l’aidera à ranger et coller ses paperoles. Il n’est pas trop tard pour écrire, il doit commencer. Il décide que pour mener à bien son œuvre littéraire, il va cesser d’aller dans le monde. Mais malgré cela il craint de ne pas en avoir le temps. Ne va-t-il pas succomber le soir même dans un accident d’automobile ou à la suite d’une attaque cérébrale ? Prémonition ? Peu après, il est victime d’une attaque légère, mais qui le laisse quelque temps sans mémoire et sans force. Cependant son projet ne quitte plus ses pensées. Il se reproche d’avoir mené une vie de paresse, de plaisir et de maladie, et de ne commencer cette œuvre si importante pour lui qu’à la veille de mourir. Depuis son attaque, il a perdu le goût de vivre, la maladie l’a privé de ses forces et l’idée de la mort l’obsède, bien qu’il soit soutenu par la volonté de terminer son œuvre. Il vit de plus en plus dans le passé, persuadé que le déclin de sa volonté et de sa santé date de l’époque où, enfant à Combray, sa mère un soir a abdiqué son autorité en acceptant de passer la nuit dans sa chambre avec lui et du jour où sa grand-mère est morte après une lente agonie. Le tintement de la sonnette du jardin de Combray annonçant le départ de Swann et laissant espérer que sa mère va venir enfin l’embrasser, ce souvenir hante les derniers jours du narrateur.
*****
Un fait divers
___________
Le Duel de Proust
____________
Cependant, c’est dans les pages du quotidien Le Journal que l’ouvrage est le plus durement reçu. Jean Lorrain, qui publie sous le nom de Raitif de la Bretonne, assassine en effet Les Plaisirs et les Jours. En se fendant d'une critique particulièrement acide dans le numéro du 3 février 1897, il traîne dans la boue « la médiocrité et la mièvrerie » du futur grand auteur.
« D’ailleurs, l’amateurisme des gens du monde. Un livre commis par l’un d’eux, livre autour duquel grand bruit fut mené l’autre printemps, me tombe entre les mains. […]
Les Plaisirs et les Jours, de M. Marcel Proust : de graves mélancolies, d’élégiaques veuleries [...], d’inanes flirts en style précieux et prétentieux, avec, entre les marges ou en tête des chapitres, des fleurs de Mme Lemaire en symboles jetés, et l’un de ces chapitres s’appelle : La mort de Baldassare de Silvande, le vicomte de Silvande.
Illustration : des feuilles de roses (je n’invente pas). »
Plus grave encore, Jean Lorrain insinue avec perfidie que Proust entretient une relation homosexuelle avec Lucien Daudet, le fils du célèbre Alphonse Daudet.
« Marcel Proust obtiendra sa préface de M. Alphonse Daudet, de l'intransigeant M. Alphonse Daudet lui-même, qui ne pourra la refuser, cette préface, ni à Mme Lemaire ni à son fils Lucien. »
À cette époque, un article comme celui-ci est en mesure de mettre un coup d'arrêt définitif à la carrière d'un écrivain débutant. C’est pourquoi le jeune Proust ne peut laisser se déverser ce torrent d'injures sans réagir. Il décide ainsi de « laver son honneur » en provoquant le critique Jean Lorrain en duel.
Le rendez-vous est fixé au surlendemain et les témoins désignés. Proust se rend donc dans le bois de Meudon accompagné de son ami le peintre Jean Béraud et du maître d'armes Gustave de Borda. À l'heure convenue, Proust et Lorrain se font face.
Les deux hommes sont séparés de vingt-cinq pas comme l’exige le Code du duel. Ils échangent deux coups de feu avec un pistolet de tir. Aucune des balles n’effleure l'autre. Soulagés et indemnes, les deux adversaires décident d'en rester là.
Les duels étant monnaie courante à l'époque, et Marcel Proust n'étant pas encore l'immense écrivain que l'on connait, l'évènement n'inspire chez les journalistes que de minces entrefilets.
Ainsi, le 7 février, le quotidien Le Siècle relate :
« Un duel au pistolet a eu lieu hier dans les environs de Paris entre M. Jean Lorrain et M. Marcel Proust, à la suite d'un article de M. Jean Lorrain paru dans Le Journal sous pseudonyme de Raitif de la Bretonne. Deux balles ont été échangées, sans résultat. »
Le même jour, comme le veut l'usage, le quotidien Le Journal fait paraître le procès-verbal administratif du duel – celui-ci sera également publié dans d’autres publications telles que Le Gaulois, La Justice ou La Lanterne.
« À la suite d'un article de Raitif de la Bretonne (Jean Lorrain), paru récemment dans Le Journal, M. Marcel Proust s'étant jugé offensé, a adressé ses témoins, MM. Gustave de Barda et Jean Béraud à l'auteur. M. Jean Lorrain a chargé ses amis MM. Octave Uzanne et Paul Adam de ses intérêts.
Les témoins se sont rendus chez M. Jean Béraud, et après avoir discuté toutes les chances de conciliation sans avoir pu arriver à une entente, une rencontre a été jugée nécessaire. L'arme choisie est le pistolet de tir. Deux balles seront échangées : la distance est de vingt-cinq pas, et le duel aura lieu au commandement.
Pour M. Marcel Proust : Gustave de Borda, Jean Béraud
Pour M. Jean Lorrain : Octave Uzanne, Paul Adam
En conformité du procès-verbal arrêté ce matin entre les témoins de M. Marcel Proust et Jean Lorrain, ces messieurs se sont rencontrés, assistés de leurs amis, dans les environs de Paris, ou le duel a eu lieu.
Deux balles ont été échangées sans résultat, et les témoins d'un commun accord, ont décidé que cette rencontre mettait fin au différend. »
Heureusement pour la littérature française, Marcel Proust n'aura plus jamais à défendre son honneur à l’aide d'un pistolet.
Après dix années de doutes et de voyages, il commencera la rédaction de La Recherche à compter de 1907 ; Du côté de chez Swann, le premier volume, paraîtra en 1913.
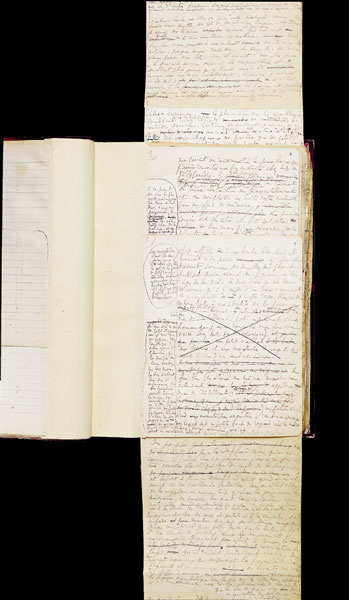
|
À l'époque du Contre Sainte-Beuve, Proust avait déjà l'intention de clore son roman sur le thème de la fuite du temps. Dans un cahier de 1909 figure une "soirée" chez la princesse de Guermantes, devenue "matinée" dans des brouillons de 1910-1911, au cours de laquelle le Narrateur constate les ravages opérés par le temps sur les personnes qu'il a connues dans sa jeunesse. Mais Proust a toujours repoussé à la fin de son œuvre Le Temps retrouvé, qui s'imposait à lui comme sa conclusion. Dans la série des vingt cahiers contenant la mise au net de la Recherche, Le Temps retrouvé occupe les six derniers, enrichis de longues "paperoles". Rédigé en 1917-1918, le texte s'est considérablement modifié au cours des années, notamment avec l'introduction des épisodes de la guerre. Mais le "bal de têtes" est resté pour témoigner de la marche inexorable du temps
|
Comment séparer aujourd’hui le texte de la Recherche de sa genèse ? Comment ne pas s’émouvoir devant les milliers de pages saturées d’ajouts et de corrections, écrites dans la hâte de tout dire, et augmentées à la fin de l’œuvre des fameuses "paperoles" interminablement collées les unes au bout des autres ?
Il aura fallu des années de travail et de réclusion pour que cette écriture d’abord fragmentaire, répétitive et dispersée à travers des dizaines de cahiers, puisse se déployer dans une structure qui mêle récit et démonstration et aboutir à ce livre immense : moins un roman que l’aventure d’une conscience, cherchant à s’affranchir "de l’ordre du Temps".
1908- 1922 quatorze année d'écriture
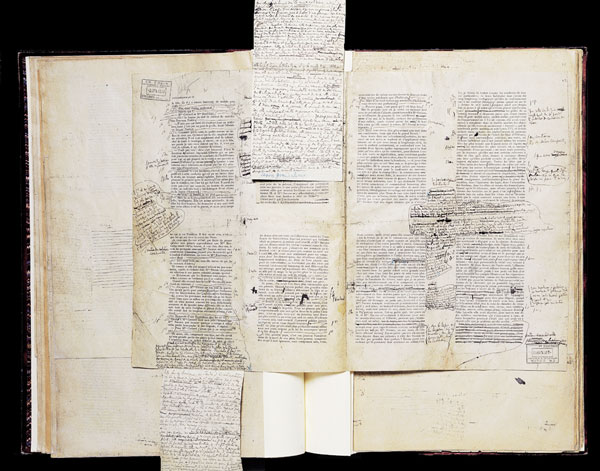
A la recherche du temps perdu du côté de chez Swann
75 cahiers de brouillon
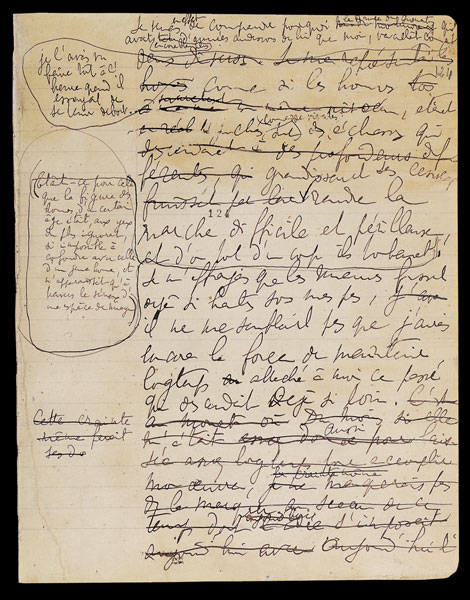
En 1910, Proust se consacre à son roman, modifiant et développant des fragments du Contre Sainte-Beuve : le Narrateur commence par y évoquer les vacances de son enfance, passées à Combray, au sein de sa famille qu'un voisin, Charles Swann, vient visiter.
En 1912, le roman est prêt pour l'édition. Après avoir essuyé les refus de Fasquelle, de la NRF et d'Ollendorff, Proust passe un contrat à compte d'auteur avec Bernard Grasset, et reçoit les premiers placards de son livre, intitulé Les Intermittences du cœur. Le temps perdu et divisé en trois parties. Mais Grasset l'oblige à abréger son texte en supprimant les vingt-cinq derniers placards. Il remanie donc sa troisième partie, "Noms de pays", dont il réutilisera le reste dans à l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Dès Jean Santeuil, roman de jeunesse abandonné en 1899, Proust écrit son texte sous forme de fragments, sur des feuillets de papier de formats variés, difficiles à dater avec précision et à relier les uns aux autres.
Lorsqu’il décide de se mettre à "un travail assez long", en février 1908, il a en tête un essai contre le critique Sainte-Beuve dont il entend dénoncer la méthode. Mais, rapidement, il introduit dans son essai le "récit d’une matinée", ouvrant ainsi la porte à des thèmes romanesques qui vont l’emporter sur l’essai littéraire et donner naissance au roman qui deviendra, au cours des années, À la recherche du temps perdu.
Avec le Contre Sainte-Beuve Proust reprend le même type de composition que pour Jean Santeuil, utilisant cette fois comme support unique d’écriture le cahier d’écolier, à quelques exceptions près au début. La rédaction se fait sous forme de séquences assez brèves et surchargées de ratures. Proust progresse par touches successives, grâce aux esquisses qui souvent n’ont pas de lien entre elles, n’hésitant pas à utiliser un cahier tête-bêche pour commencer une nouvelle esquisse sans rapport avec celles qui se trouvent à l’autre extrémité. Il réécrit plusieurs fois le même texte avec des variantes plus ou moins importantes. On a recensé seize "ouvertures" différentes du Contre Sainte-Beuve dont le point commun est le réveil du Narrateur et les réminiscences qui affleurent à sa conscience à ce moment-là. C’est en créant des liens entre ces fragments auxquels il en a ajouté de nouveaux que Proust parvient à une version définitive qui sera dactylographiée fin 1909. Cette dactylographie comporte encore de très nombreuses corrections et des additions autographes portées sur des feuillets intercalaires.
Proust reste fidèle à sa méthode lorsqu’à partir de 1910 il entreprend de rédiger des textes destinés à "Combray", "Un amour de Swann" et "Noms de pays". Il puise alors largement dans les brouillons et dans la dactylographie du Contre Sainte-Beuve qu’il enrichit de développements et de nouveaux épisodes. Il écrit généralement son premier jet sur la page de droite, au recto du cahier, se réservant le verso de la page précédente pour y porter des additions qui courent parfois sur plusieurs feuillets consécutifs ou des notes de régie pour "ne pas oublier" d’introduire dans un passage précis un fragment déjà existant. Le roman qui est prêt pour l’édition en 1912 s’intitule Les Intermittences du cœur et se subdivise en deux parties : Le Temps perdu et Le Temps retrouvé. Mais dès la parution de l’édition originale de Du côté de chez Swann, en novembre 1913, est annoncé Le Côté de Guermantes qui doit sortir en 1914. La guerre interrompt brutalement toute activité et laisse le loisir à Proust d’opérer une restructuration profonde de son œuvre qui comptera finalement sept parties.
Au fil des années, Proust aura à gérer l’accroissement du nombre de ses cahiers de brouillon. On en compte actuellement soixante-quinze auxquels il convient d’ajouter quatre carnets de notes. Pour se repérer dans ce labyrinthe, il utilise de plus en plus fréquemment deux systèmes :
– des phrases aide-mémoire pour retrouver facilement une idée qui lui est venue en cours d’écriture et qu’il a notée aussitôt : "ajouter quelque part", "il faudra dire", "penser à mettre". La formule "capital" ou "capitalissime" deviendra la plus courante à partir de 1913.
– des renvois à l’intérieur d’un même cahier par des croix et des signes divers ou par des mentions manuscrites précises : "Voir précédemment 6 à 7 pages moins loin – je crois 6 doubles-pages donc 12" ; mais aussi des renvois d’un cahier à l’autre, certains ayant reçu un nom particulier, "Fridolin", "Vénusté", "Querqueville", "Dux", "Babouche" ou étant désignés d’après leur aspect matériel : "cahier vert", " gros cahier rouge", etc. Les carnets ou "petits cahiers Kirby Beard" sont inclus dans cette pratique de renvois.
En 1915, Proust commence à rédiger la mise au net des dernières parties de la Recherche, de Sodome et Gomorrhe à la fin du Temps retrouvé, dans une série de vingt cahiers où des additions très importantes seront insérées sous forme de "paperoles", ces longues bandes de feuilles de papier collées bout à bout par Céleste Albaret. Parallèlement, il utilise de 1918 à 1922 des cahiers contenant des additions à apporter aux épreuves envoyées par Gallimard. Il retravaille en effet indéfiniment son texte, tant qu’il l’a sous la main, qu’il s’agisse de dactylographies ou d’épreuves abondamment corrigées et, elles aussi, enrichies de "paperoles".
Proust meurt en novembre 1922, en corrigeant la dactylographie de La Prisonnière. C’est dire l’incroyable énergie déployée durant des années par l’écrivain animé d’un besoin de perfectionnisme insatiable que l’étude génétique de ses manuscrits permet de mesurer.









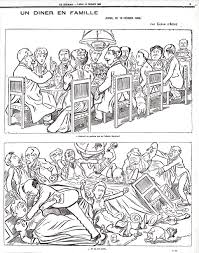







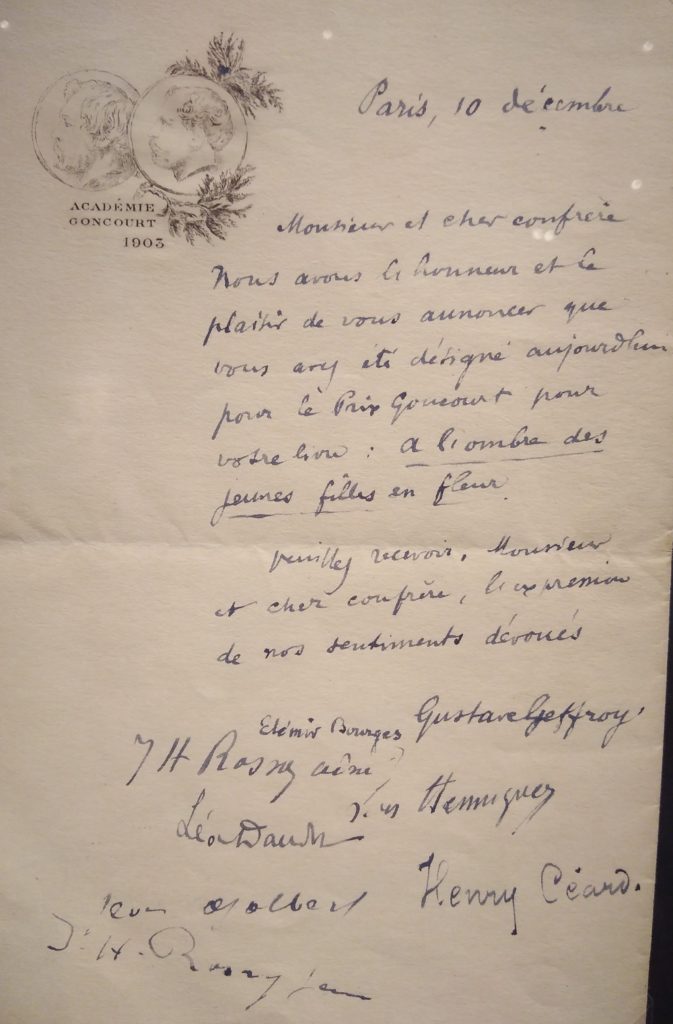











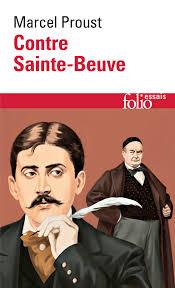



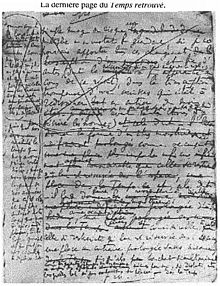




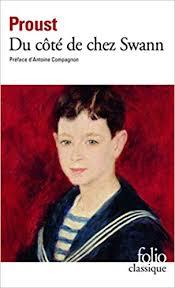
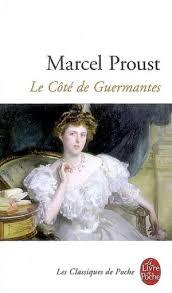

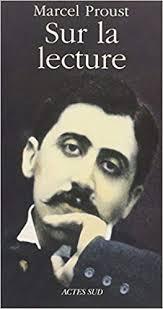

























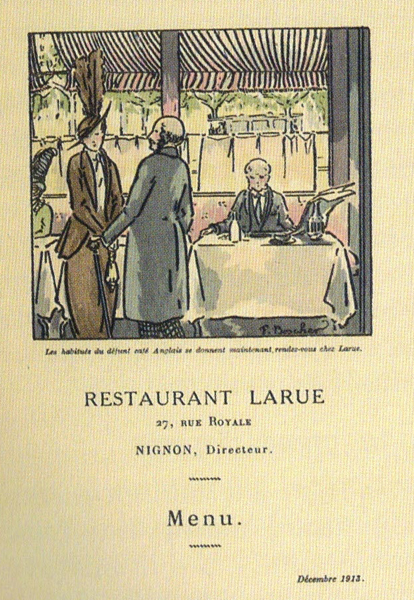











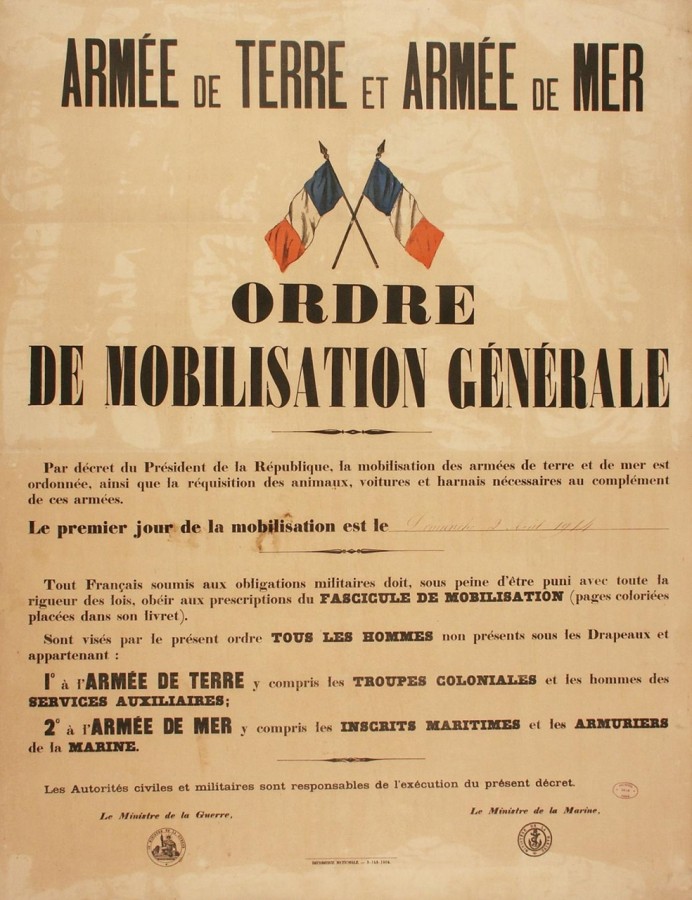














 Dernière page manuscrite du « Temps retrouvé »
Dernière page manuscrite du « Temps retrouvé »