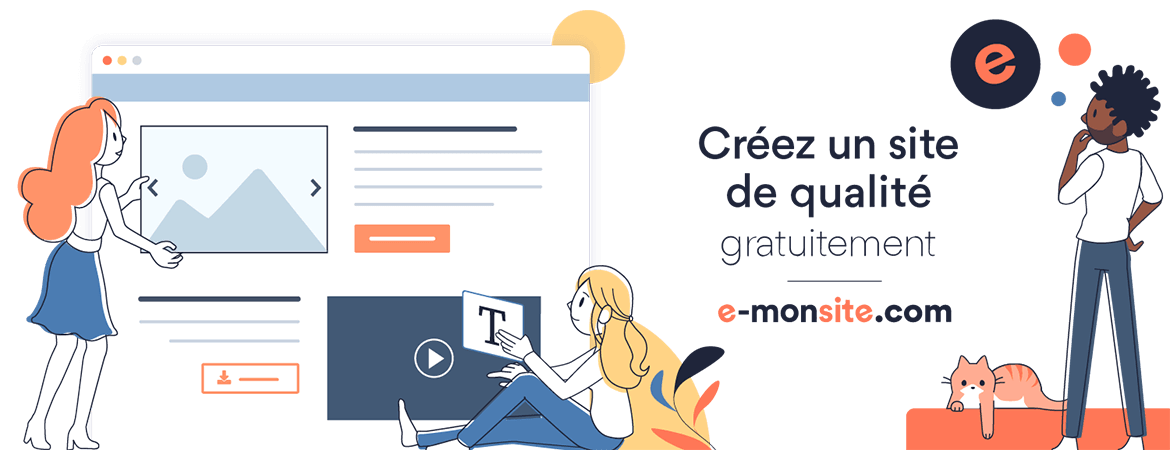- Accueil
- Pages
- Un jour une oeuvre un destin
- une oeuvre Salammbô
une oeuvre Salammbô
C'est le 24 novembre 1862 que paraît le roman historique de Gustave Flaubert Salammbô chez Michel Lévy frères
c'est la guerre des Mercenaires au IIIe siècle av J.C qui va intérésser notre auteur: la ville de Carthage s'opposa aux mercenaires barbares qu’elle avait employés pendant la première guerre punique, et qui se révoltèrent, furieux de ne pas avoir reçu la solde convenue.
Flaubert eut pour principal soucis de respecter l’histoire connue, mais profita du peu d’informations disponibles pour décrire un Orient à l’exotisme sensuel et violent.
À l'instar de son œuvre, les travaux de recherche et d'élaboration déployés pour l'écriture de Salammbô sont considérables.
En effet, en avril 1858, Flaubert se rend en Tunisie afin de voir Carthage, de s'y renseigner, et de lui permettre de rendre avec justesse son sentiment sur les lieux où se déroule son récit.
Dès 1857, Flaubert entreprend de se renseigner sur Carthage. En mars, il écrit une lettre à Félicien de Saulcy, archéologue français, dans laquelle il lui demande des renseignements sur cette région. À partir de ce moment, il multipliera les lectures sur le sujet1.
Du 12 avril au 5 juin 1858, Flaubert se rend en Tunisie afin de se documenter davantage sur Carthage. Il souhaite également observer par lui-même le lieu où se déroulera son roman. À son retour, Flaubert révise entièrement les idées qu'il avait à l'origine pour son récit. Il écrit une lettre à Ernest Feydeau dans laquelle il explique qu'il doit repartir à zéro dans son projet ; son projet initial se voulait, dit-il, « absurde et impossible »1.
Lorsqu'il achève son roman en avril 1862, Flaubert écrit une lettre à Mlle Leroyer de Chantepie dans laquelle il annonce :
« J'ai enfin terminé, le 24 avril 1862, dimanche dernier [le 20 avril], à sept heures du matin, mon roman de Salammbô. Les corrections et la copie me demanderont encore un mois et je reviendrai ici dans le milieu de septembre, pour faire paraître mon livre à la fin d'octobre. Mais je n'en puis plus. J'ai la fièvre tous les soirs et à peine si je puis tenir une plume. La fin a été lourde et difficile à venir
Aperçu de l'oeuvre
Le festin
« C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar », la soirée puis la nuit qui suit la paix faite avec Rome par Carthage, par l'intermédiaire du général Giscon. D'abord est décrit le festin auxquels prennent part les mercenaires dans les jardins de leur général, Hamilcar. Échauffés par son absence et par le souvenir des injustices qu’ils ont subies de la part de Carthage, ils ravagent sa propriété. Le premier personnage à apparaître est Spendius, un esclave qui vient d'être libéré. Apparaît ensuite le général Giscon ; qui tente de calmer les mercenaires qui veulent se saisir des coupes de la Légion sacrée, mais n'y parvient pas. Au sommet du palais apparaît alors la fille d'Hamilcar qui descend alors d'abord pour les tancer (en faisant pour la première fois allusion à son serpent noir) de leurs destructions, puis pour les calmer. Mais deux hommes la fixent : Narr'Havas, un chef numide hôte d'Hamilcar, et Mâtho le Libyen, ayant au cou un collier à lune. Elle tend une coupe à Mâtho, symbole de noces futures dans la symbolique gauloise, ce qui irrite Narr'Havas qui blesse Mâtho avec son javelot. Dans l'agitation, Salammbô disparaît dans son palais. Mâtho la suit mais en vain. Spendius se met alors au service de Mathô et lui conseille de prendre Carthage afin d’obtenir Salammbô au moment où le dieu Soleil se lève sur la ville. Ils assistent à son lever et à l'arrivée de deux femmes sur un char.
II. À Sicca
Deux jours plus tard, après avoir été persuadés par les Carthaginois, les mercenaires quittent la ville avec la promesse de recevoir leur solde. Ils se mettent en route pour la ville sacrée de Sicca qu'ils atteignent après sept jours, non sans avoir vu, peu avant d'arriver, une lignée de lions crucifiés, ce qui suscite leur inquiétude. Là Spendius découvre Mâtho hanté par l'image de Salammbô dont il essaie, en vain, de se débarrasser par tous les moyens. Un soir arrive le suffète Hannon, gras et malade, qui cherche à convaincre les Barbares du mauvais état des finances de Carthage, mais Spendius, profitant de l'incompréhension de ces derniers, les monte contre Hannon. L'indignation augmente quand Zarxas, rescapé de Carthage, raconte le massacre des frondeurs des Baléares par les habitants de Carthage. Hannon s'enfuit, sa litière est mise à sac. Les Mercenaires décident de retourner à Carthage.
III. Salammbô
Une nuit de lune, Salammbô apparaît, accompagnée d'une esclave, sur une terrasse du palais. Elle invoque la déesse Tanit (= la lune), « déesse des choses humides » et fait de la lune un portrait paradoxal, alternant entre des caractéristiques de fécondation et de destruction. Elle fait également un portrait d'elle-même, de ses désirs de façon paradoxale, entre feu et langueur. Élevée de façon solitaire et loin de toute dévotion populaire, elle désire ardemment voir la statue de Tanit mais Schahabarim, le grand prêtre de Tanit, s'y refuse résolument, car "on en meurt", de la contempler. Il aperçoit alors l'armée des Barbares.
IV. Sous les murs de Carthage
L'armée des Mercenaires s'installe dans l'isthme, devant Carthage. Des envoyés de cette dernière sont envoyés aux Barbares pour négocier mais aucune stratégie claire n'est définie. Pour calmer les Mercenaires, on leur envoie Giscon qui commence à les payer, mais, excités par Spendius et Zarxas, ils se rebellent et tuent Giscon et ses capitaines. Le lendemain, ils sont pris de langueur et craignent la vengeance de Carthage. Spendius amène alors Mâtho à l'aqueduc par lequel ils pénètrent, de nuit, dans Carthage. Spendius veut aller au temple de Tanit.
V. Tanit
Sur le chemin du temple, Spendius révèle à Mâtho qu'il veut dérober le zaïmph, le voile de Tanit. Mâtho est saisi de terreur mais il suit tout de même Spendius. Ils pénètrent dans le temple où ils volent le voile dont Mathô se revêt. Sentant en lui une puissance nouvelle, il se dirige vers le palais d'Hamilcar pour aller voir Salammbô. Il la découvre endormie : Mais la lumière s'arrêtait au bord; - et l'ombre, telle qu'un grand rideau, ne découvrait qu'un angle du matelas rouge avec le bout d'un petit pied nu posant sur la cheville. Quand elle se réveille, Mâtho lui déclare son amour. Salammbô est fascinée par le voile qu'elle lui demande de lui donner. Quand elle se rend compte du sacrilège, elle déclenche l'alarme. Spendius s'enfuit par la falaise tandis que Mâtho sort de la ville par la grande porte, comme protégé par le zaïmph.
VI. Hannon
Narr'Havas le Numide vient faire alliance avec Mâtho, auréolé du vol du zaïmph, contre Carthage. Spendius va attaquer Utique, Mâtho Hippo-Zaryte (l'actuelle Bizerte) - il s'agit de deux villes qui n'ont pas pris parti contre Carthage, et Autharite, le chef des mercenaires gaulois, reste devant Carthage. Cette dernière a donné tout pouvoir à Hannon qui enrôle tous les citoyens et prépare les éléphants. Un jour, il attaque les Mercenaires devant Utique et les bat grâce aux éléphants mais Mâtho et Narr'Havas interviennent et la situation se retourne. Hannon fuit vers Carthage qui se tourne alors vers Hamilcar.
VII. Hamilcar Barca
Un matin, Hamilcar revient à Carthage sur son navire. Il se rend dans son palais où les hommes de son parti lui racontent la débandade. Un de ses serviteurs, Iddibal, vient lui parler de son fils caché secrètement. Ensuite il se rend, dans le temple de Moloch, à l'assemblée des Anciens où il a une violente altercation avec Hannon. Il y apprend que sa fille Salammbô aurait couché avec un Barbare. Les Anciens lui proposent tout de même le commandement des armées puniques mais il refuse. Il parcourt ensuite son palais et ses dépendances et les voit dévastés. Deux larmes jaillissent quand il voit les éléphants mutilés. Le soir, il accepte le commandement.
VIII. La bataille du Macar
Hamilcar prépare alors son armée et ses éléphants, mais, contre toute attente, il repousse le moment de partir en guerre. Il va souvent seul en reconnaissance. Une nuit, cependant, il mène son armée, par un chemin dangereux et bourbeux, jusqu'au pont sur le Macar. La bataille avec les Barbares s'engage, elle semble pencher en faveur de ces derniers, dirigé par Spendius, mais l'intervention des éléphants d'Hamilcar change tout. Quand Mâtho arrive en renfort, il ne peut que constater, pour la deuxième fois, le désastre.
IX. En campagne
Hamilcar s'en va chercher l'aide des tribus du Sud. Il envoie des prisonniers de guerre barbares à Carthage où ces derniers sont exécutés, contre sa volonté. La stratégie d'Hamilcar demeure incompréhensible aux quatre chefs barbares (Mâtho, Spendius, Narr'Havas et Autharite). Mais, vers le lac d'Hippo-Zaryte, ils parviennent à l'encercler. Débute alors le siège du camp carthaginois qui peu à peu n'a plus de vivres. Hamilcar en veut au Conseil des Anciens de ne pas le soutenir, tandis que les Carthaginois le tiennent pour responsable de la défaite. On se tourne alors vers Moloch au détriment de Tanit qui a perdu son voile, dont Salammbô est indirectement responsable. On rêve de la punir.
X. Le serpent
Dans le palais, Salammbô est inquiète car son serpent - un python - dépérit et elle se sent responsable de la disparition du zaïmph. Le prêtre-eunuque Schahabarim - désespéré d'avoir vu enfant sa virilité sacrifiée - la convainc d'aller chercher le zaïmph chez Mâtho, sous sa tente, en le séduisant. Salammbô accepte sans comprendre. Le python reprend alors des forces. Le jour venu, Salammbô exécute une danse de l'amour avec lui, puis l'esclave Taanach la pare magnifiquement, comme pour ses noces. Salammbô s'en va alors, une ombre gigantesque marchant à ses côtés obliquement, ce qui était un présage de mort.
XI. Sous la tente
Avec un esclave de Schahabarim, Salammbô se rend au camp des Mercenaires qui encerclent l'armée d'Hamilcar. Elle demande à voir Mâtho en se faisant passer pour un transfuge. Il la conduit sous sa tente où elle voit le zaïmph et dévoile son identité. Mâtho est subjugué. Elle lui dit être venue chercher le zaïmph, mais il ne l'entend pas. Il la contemple, puis la touche du bout du doigt, il lui déclare sa passion, oscille entre le désir d'être son maître et celui d'être son esclave. Alors « Mâtho lui saisit les talons, la chaînette d'or éclata, et les deux bouts, en s'envolant, frappèrent la toile comme deux vipères rebondissantes. Le zaïmph tomba, l'enveloppait; elle aperçut la figure de Mâtho se courbant sur sa poitrine. - "Moloch, tu me brûles!" et les baisers du soldat, plus dévorateurs que des flammes, la parcouraient; elle était comme enlevée dans un ouragan, prise dans la force du soleil. »
Après qu'un incendie s'est déclenché dans le camp, Salammbô, après avoir vu Giscon qui la maudit d'avoir couché avec Mâtho, s'enfuit au camp de son père avec le zaïmph. Hamilcar, qui voit la chaînette brisée, la donne alors en mariage à Narr'Havas qui vient de trahir Mâtho, au moment où les troupes du suffète attaquent les Barbares.
XII. L’aqueduc
« Douze heures après, il ne restait plus des Mercenaires qu'un tas de blessés, de morts et d'agonisants. » Le courage manque aux survivants, qui se vengent alors en torturant, puis en tuant les prisonniers puniques. Spendius parvient, non sans mal, à leur redonner le goût du combat. Ils s'en vont par voie de terre sur Hippo-Zaryte tandis qu'Hamilcar s'y rend par mer. La ville tombe aux mains des Barbares qui prennent en chasse l'armée carthaginoise. Arrivés à Carthage, ils en débutent le siège. Spendius, une nuit, sabote l'aqueduc : "c'était la mort pour Carthage" qui n'est plus approvisionnée en eau.
XIII. Moloch
Les Mercenaires se préparent à l'assaut ainsi que les Carthaginois, assaut qui se produit bientôt. Après quelque temps, les Carthaginois, qui subissent le siège, commencent à souffrir de la soif et de la faim. « Moloch possédait Carthage. » Salammbô, malgré les reproches de Schahabarim, ne s'en sent nullement responsable. Un soir, Hamilcar lui amène son fils de dix ans - Hannibal - qu'elle a charge de garder. Peu à peu les Barbares prennent le dessus. Les Anciens pensent que Moloch est offensé et décident de lui sacrifier des enfants, dont le fils d'Hamilcar, qui envoie un esclave à sa place. L'horrible sacrifice a lieu.
XIV. Le défilé de la Hache
À la suite du sacrifice, la pluie tombe et les Carthaginois reprennent courage. Hamilcar, grâce à un subterfuge, entraîne une grande partie des Mercenaires dans le Défilé de la Hache où il les affame durant trois semaines, ce qui les contraint à des actes de cannibalisme. Hamilcar les achève lorsqu'ils sortent pour se rendre (scène où les hommes sont écrasés par les éléphants). Après cela, Hamilcar se rend à Tunis pour prendre la ville. Là Hannon se fait crucifier par les Barbares tandis que les ambassadeurs des Barbares sont crucifiés par le suffète. La guerre s'enlise alors devant Carthage. Mâtho propose un défi à Hamilcar : en finir dans une dernière bataille. Hamilcar accepte. Le lendemain, le combat s'engage mais les Mercenaires sont défaits à cause de l'aide inattendue des citoyens de Carthage et du dernier éléphant. Mâtho est alors fait prisonnier. Les derniers Mercenaires de la Hache sont dévorés par des lions.
XV. Mâtho
« Carthage était en joie (…). C’était le jour du mariage de Salammbô avec le roi des Numides. (…) La mort de Mâtho était promise pour la cérémonie. (…) Les Anciens décidèrent qu’il irait de sa prison à la place de Khamon, sans aucune escorte, les bras attachés dans le dos ; et il était défendu de le frapper au cœur, pour le faire vivre plus longtemps, de lui crever les yeux, afin qu’il pût voir jusqu’au bout sa torture (…). Mâtho se mit à marcher. (…) Un enfant lui déchira l’oreille ; une jeune fille, dissimulant sous sa manche la pointe d’un fuseau, lui fendit la joue ; on lui enlevait des poignées de cheveux, des lambeaux de chair ; d’autres avec des bâtons où tenaient des éponges imbibées d’immondices lui tamponnaient le visage. Du côté droit de sa gorge, un flot de sang jaillit : aussitôt le délire commença. Ce dernier des Barbares leur représentait tous les Barbares, toute l’armée. (…) Il n’avait plus, sauf les yeux, d’apparence humaine ; c’était une longue forme complètement rouge (…). Il arriva juste au pied de la terrasse. Salammbô était penchée sur la balustrade ; ces effroyables prunelles la contemplaient, et la conscience lui surgit de tout ce qu’il avait souffert pour elle. Bien qu’il agonisât, elle le revoyait dans sa tente, à genoux, lui entourant la taille de ses bras, balbutiant des paroles douces ; elle avait soif de les sentir encore, de les entendre ; elle allait crier. Il s’abattit à la renverse et ne bougea plus. (…) Salammbô se leva comme son époux, avec une coupe à la main, afin de boire aussi. Elle retomba, la tête en arrière, par-dessus le dossier du trône, blême, raidie, les lèvres ouvertes, et ses cheveux dénoués pendaient jusqu’à terre. Ainsi mourut la fille d’Hamilcar pour avoir touché au manteau de Tanit.
Principaux personnages
Carthaginois
- Hamilcar Barca, l’un des deux suffètes de Carthage. Il revient de Sicile pour reprendre le contrôle de l’armée. Le personnage d'Hamilcar serait fortement inspiré du Hannibal Barca historique. On peut notamment rapprocher leur impiété et leur génie militaire insurmontable.
- Salammbô, fille d’Hamilcar, dédiée à la déesse Tanit. Son nom a été inspiré à Flaubert par un des noms de la déesse Astarté : Salambo (provient du phénicien Shalambaal « image de Baal »3)
- Hannibal, fils secret d’Hamilcar, caché par l’esclave Abdalonim.
- Giscon, général et diplomate.
- Hannon, l’autre suffète de Carthage, atteint par une maladie de peau.
- Schahabarim, prêtre de Tanit et instructeur de Salammbô.
Mercenaires
- Mâtho, chef des mercenaires libyens.
- Narr’Havas, chef des mercenaires numides, à qui Salammbô est promise en cas de victoire.
- Spendius, esclave grec animé d'une haine féroce de Carthage qui se met au service de Mâtho
- Autharite, chef d’une partie des mercenaires.
la critique littéraire du 12 janvier 1863
Salammbô dans les yeux d'un sculpteur
L'incipit du roman est très célèbre. Celui-ci s'ouvre sur « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. »
Dans son article, "Positions, distances, perspectives dans Salammbô", Jean Rousset propose l'analyse suivante de la structure du roman:
Le récit, chez Flaubert, fonctionne sur le mode de la répétition et de la transformation des mêmes éléments, ce qui leur donne un nouveau sens. Salammbô peut également se lire comme un jeu de relations entre positions et perspectives des personnages.
Un diptyque : le début et la fin de Salammbô sont constitués de deux solitudes représentant la communauté adverse (Salammbô / Mâtho) au milieu d’un mouvement de foule (les Mercenaires / les Carthaginois), avec une relation d’inversion entre les personnages. Ces personnages sont à la fois séparés de la foule et encerclés par elle. A cette inversion s’ajoute également les différences de niveaux : Salammbô se trouve en haut du palais, les mercenaires, puis Mâtho l’observent depuis le bas, avant que ce dernier adopte un point de vue surplombant en allant à sa poursuite. La fin reprend le même procédé, avec Salammbô sur une terrasse, s’identifiant à Tanit et à la cité. C’est elle qui voit d’abord le héros vaincu Mâtho, puis c’est le point de vue de la foule qui prend le relais (inversion du procédé initial). A l’inverse du début, Mâtho descend vers Salammbô pour s’abattre à ses pieds.
La passion des distances : dans l’ensemble du roman, les positions des personnages (en haut / en bas) commandent les distances entre les personnages. Ce qui change, d’une séquence à l’autre, c’est soit la position (en haut / en bas), soit la perspective adoptée (un personnage isolé ou une entité collective). Le schéma général du roman est celui de l’opposition (Carthaginois / Barbares ; Salammbô / Mâtho) où les protagonistes sont en conflit, d’où l’importance des postes d’observation pour abolir optiquement la distance avec les adversaires.
Dans ce jeu des perspectives, Flaubert a tendance à personnaliser le conflit politique à travers le regard des protagonistes (Salammbô vue comme Carthage par Mâtho, Mâtho vu comme le chef des Barbares par Salammbô). Mais au duel politique s’ajoute également le duel érotique. La guerre comme l’amour se fait à distance, dans la séparation. Seule la bataille du Macar est vue comme une grande étreinte amoureuse et cruelle, tandis que l’autre étreinte, celle des amants, est évoquée de façon elliptique grâce au récit indirect (c’est seulement par métaphores et allusion, avant et après que l’acte est évoqué). Même dans cette scène du contact, Flaubert ne veut pas le dire directement.
Les effets de la perspective : le statut des positions et des distances a des conséquences stylistiques : il provoque la déformation de la perception à travers les points de vue adoptés. Ces visions déformées sont signes d’incertitude sur le réel ; celui-ci apparaît au regard non tel qu’il est, mais tel qu’il semble être. Flaubert propose souvent d’abord la vision fallacieuse, puis la cause véritable du phénomène, soit par le biais du narrateur, soir par le biais de l’auteur. La rectification de l’illusion se fait souvent grâce au c’était. Ce modèle de présentation suit l’ordre des perceptions. Proust opère de même, mais il suspend la présentation juste avant le c’était. Il y aurait passage de la comparaison (Flaubert) à la métaphore (Proust) où le terme de comparaison n’est plus présent.
Dans Salammbô, on assiste à la naissance de la comparaison, au moment où le personnage, dans l’incertitude perceptive, interprète le phénomène à l’aide d’un comparant qui se trouve confirmé (ou infirmé) par la rectification objective. L’acteur au centre de la perspective est l’auteur et l’origine de la forme comparative.
Noces à distance : dans la scène initiale et dans la scène finale, on assiste aux noces de sang de Salammbô et de Mâtho (Mâtho blessé par Nar’Havas à la suite du verre versé par Salammbô ; Mâtho écorché venant mourir au pied de l’épouse de Nar’Havas qui meurt elle-même). Mais la symétrie ne l’est plus : du début à la fin quelque chose d’irrémédiable s’est produit. « Etreinte des regards sans contact des corps, mariage mystique, intimité à distance ; c’est bien le sens des relations de personnes dans ce livre. »
C’est pourquoi il faut placer l’interprétation sur le plan mythique, où Salammbô s’identifie à Tanit, la Lune, et Mâtho à Moloch, le Soleil, deux principes qui s’attirent tout en ne pouvant jamais s’atteindre.
Les objets
Le zaïmph
Dans son article, "La zaïmph métamorphique : objet et réification dans Salammbô de Flaubert", Mireille Dobrzynski propose l'analyse suivante du zaïmph, du voile de Tanit.
En littérature, et plus particulièrement chez Flaubert, les objets ne servent pas seulement à créer un effet de réel. Parmi tous les objets de Salammbô, le zaïmph – le voile sacré de la déesse Tanit – joue le rôle d’un fil d’Ariane. Il construit toute une mythologie de la séduction et conduit Salammbô vers l’émancipation. Il s’agit d’un objet protéiforme (parure, manteau, chiffon, etc.), qui est enjeu de possession et de pertes pour les protagonistes.
Qu’est-il ? Il est décrit de façon métaphorique par référence aux éléments naturels et apparaît comme impalpable et immatériel et comme divin. Il est décrit simultanément comme dangereux – fatal pour celui qui le touche – et comme vide – puisqu’on ne doit pas le voir. Aucun protagoniste ne met en doute l’efficacité de son pouvoir. Il est le symbole du désir de pouvoir et de domination et chaque camp veut se l’approprier. C’est pourquoi Mâtho et Salammbô, lorsqu’ils le prennent à l’autre camp, sont considérés avec reconnaissance par les leurs. Mais ils en meurent aussi. Le voile fonctionne cependant de façon privative : ceux qui l’ont ne reçoivent pas de pouvoirs spéciaux, mais ceux à qui il est dérobé perdent leurs puissances. C’est pourquoi progressivement le culte de Tanit est remplacé par celui de Moloch.
Le voile a également une dimension érotique. Il intervient au moment des ébats des amants : il est le symbole de la découverte de la sexualité par la vierge Salammbô. Le zaïmph signifie également en hébreu l’organe sexuel mâle, ce qui explique la fascination du voile sur Salammbô. Il symbolise – dans une perspective psychanalytique - également l’hymen, à la fois mariage – celui de Salammbô – et le voile de la virginité – que Salammbô va perdre. La couleur pourpre – dominante – renvoie d’ailleurs au sang de la déchirure de l’hymen et à la mort de l’héroïne après son hymen. Le voile est plus particulièrement associé au personnage de Salammbô. Pour elle, le voile est d’abord lié à son désir de savoir, qui devient désir de dominer et de devenir déesse. Ce qui la rend audacieuse.
Le roman s’inscrit dans l’iconographie biblique de Salomé, fille d’Hérodias, qui, en récompense de sa danse, a demandé la tête de Jean-Baptiste. Salammbô danse également avant de récupérer le zaïmph et qui préfigure le passage à l’acte avec Mâtho.
Les voilages se retrouvent partout dans le roman. Dans le fantasme fétichiste de Mâtho, le zaïmph et Salammbô s’identifient. Tant qu’il ne la possède pas, le zaïmph est le substitut de Salammbô, qu’il désire mais ne peut atteindre. Le personnage de Salammbô disparaît d’ailleurs derrière la description de ses vêtements, en particulier de son manteau pourpre qui ressemble au voile sacré. Elle ressemble de plus en plus à la statue de Tanit. Elle passe de la femme-sujet à la femme-objet. Le personnage subit de plus en plus une réification. Le voile de Tanit devient, à la fin, le linceul de Salammbô.
Dans un monde qui opposent en conflit les hommes et où les femmes sont seulement monnaie d’échange, le voile sacré permet à Salammbô de s’émanciper en lui octroyant le pouvoir, mais paradoxalement elle se libère (du jugement des hommes) en se réifiant (dans la mort).
Salammbô vient après Madame Bovary. Flaubert en commence les premières rédactions en septembre 1857. Quelques mois plus tôt, après avoir gagné le procès qui avait été intenté contre Madame Bovary, il avait fait part dans sa correspondance (lettre à Mlle Leroyer de Chantepie) de son désir de s’extirper littérairement du monde contemporain, et de travailler à un roman dont l’action se situe trois siècles avant Jésus-Christ. En avril-juin 1858, il séjourne à Tunis pour s’imprégner du cadre de son histoire. Si l’intrigue est une fiction, il se nourrit des textes de Polybe, Appien, Pline, Xénophon, Plutarque, et Hippocrate pour peindre le monde antique et bâtir la couleur locale. Dès sa parution en 1862, le roman connaît un succès immédiat, en dépit de quelques critiques réservées (Charles-Augustin Sainte-Beuve) mais avec d’appréciables encouragements (George Sand, Victor Hugo, Jules Michelet, Hector Berlioz).
Sources Wilkipédia
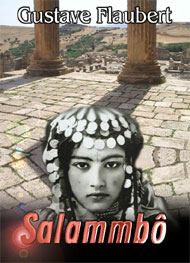 http://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-romans/gustave-flaubert-salammbo.html
http://www.audiocite.net/livres-audio-gratuits-romans/gustave-flaubert-salammbo.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1177376
"Ecrire,c'est s'emparer du monde"
Flaubert
Né sous Louis XVIII et mort sous Jule Grevy Flauert s'est intéressé à l'histoire immédiate.Non pas tant celle de des personnages de Salammbô,mais l'histoire en marche,celle de son temps dans ses furies et ses débordement,la seule qui puisse le réveler en profondeur: la révolution de 1848,la guerre de 1870 et la Commune.
Patriote en marche durant la première,prêt à en découdre au corps à corps avec les Prussiens,il est dégouté par la "sauvagerie moyenâgeuse" des communards.Sa réaction est celle d'un gardien du liberalisme.Son plus grand reproche aux partisans de la Commune est d'avoir réussi ce "tour de force" de déplacer la haine:les bourgeois parisiens en veulent désormais davantage aux insurgés qu'aux envahisseursSauf que lui au moins ne se joint pas à la curée des grandes plumes:
On le retrouve dans l'immense cortège aux funérailles de Thiers,ourreau de la Commune, un"géant qui avait une rare vertu :le patriotisme..Personne n'a résumé comme lui la France".Ainsi parlait aussi l'ami de l'ordre. Un réactionnaire mais à sa manière,on s'en doute,qui n'est pas celle d'un Joseph de Maistre ou des monarchistes.Pour le saisir dans sa complexité,il faut relire Tocqueville.
Les pages de De la démocratie en Amérique,dont on ignore d'ailleurs si Flauert les a jamais eues sous les yeux reflètent bien son etat d'ésprit:phobie du nombre,de la foule,des masses;haine de la démocratie et du suffrage universel; plebiscite de la supériorité des élites.
Flaubert fréquentait les diners Magny et le salon de la princesse Mathilde,il n'en était pas moins un bourgeois qui vécut toujours de ses rentes,même si ce fut de plus en plus périlleux les derniers temps,l'épargne lui étant étrangère ,et les ennuis financiers de sa nièce insurmmontables; ce qui ne l'empêchait pas d'éporouver un mépris inépuisable pour la bourgeoisie;classe à laquelle il reprochait sa mesquinerie,sa petitesse,sa bassesses,son indifférence à la beauté,aux chose de l'art et de l'esprit et pour tout dire sa bêtise.
Lui ne voulu vivre que pour son art dans ce qu'il a de fondamentalement intemporel.Il placait le style au dessus de tout.L'influence durable de Rabelay et de Byron qui furent les maitres de sa jeunesse est incontestable.
Le journal condensait toute sa detestation du monde pour son culte de l'éphèmère,de la nouveauté, de l'inessentiel.C'est peu dire que son époque l'ennuyait.Ses amours sont difficile,impossibles.Il y a bien des coups de foudre,et des liaisons,mais la femme incarne à ses yeux un abîme aussi effrayant qu'attirant..Il n'en est pas moins devenu le romancier le plus moderne de son temps,tout en rejetant la modernité.
L’écriture de Flaubert dans Salammbô est gouvernée par un principe analogue au tableau vivant, qui tire le roman vers les arts visuels et les arts du spectacle. Le tableau vivant, pratique culturelle qui atteint sa plus grande popularité au cours du Second Empire, traverse à la fois le théâtre, la peinture, la photographie et la sculpture, arts avec lesquels l’écriture de Flaubert entretient une relation d’imitation ou de rivalité. La question du tableau vivant permet de renouveler la réflexion sur l’écriture picturale, et offre un véhicule idéal à l’orientalisme flaubertien, définie comme une synthèse de beauté et de sadisme. Elle révèle aussi des liens entre Salammbô et des écritures romanesques plus modernes (Roussel, Perec) ainsi que des pratiques artistiques contemporaines (performance art) qui reposent sur un retour au tableau vivant.
« ... Il rêve ses acteurs dans la pose de la statuaire... »
Attendue impatiemment, Salammbô fut reçue avec la plus grande admiration par les amis de Flaubert. Théophile Gautier s’enthousiasme : « Ce n’est pas un livre d’histoire, ce n’est pas un roman, c’est un poème épique ! » et Leconte de Lisle fait écho : « Bravo, mon bonhomme ! Tu es un poète et un peintre comme il y en a peu. Tu as vu et bien vu, je n’en doute pas. » Même réaction chez Eugène Fromentin : « Vous êtes un grand peintre, mon cher ami, mieux que cela, un grand visionnaire ! » chez George Sand : « C’est du Beethoven » chez Guy de Maupassant : « une sorte d’opéra en prose ». Ainsi le roman est un poème, un opéra, un tableau. Les commentaires moins élogieux vont dans le même sens : « Mathô n’est au fond qu’un ténor d’opéra dans un poème barbare » raillent les Goncourt dans le secret de leur journal Le point essentiel ici, bien sûr, est que les lecteurs contemporains de Salammbô sont sensibles à la nature non-romanesque de ce « roman », et le comparent plutôt à d’autres arts — la peinture, l’opéra, etc. Le livre est, dès le début, assimilé à d’autres arts : peinture ou drame, il paraît relever du spectaculaire et du visuel plutôt que de l’art verbal.
Cet article se propose d’explorer le principe du tableau vivant comme forme génératrice de l’écriture. Selon une définition moderne, un tableau vivant désigne une « disposition de personnages immobiles sur une scène évoquant une peinture ou une sculpture » Par ailleurs, le tableau vivant est aussi une pratique culturelle historiquement datée, à la fois un passe-temps mondain et une forme artistique, qui atteint sa plus grande popularité sous le Second Empire, précisément au cours des mêmes années que Salammbô. Le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle définit un tableau vivant comme la « Reproduction de certains tableaux connus ou de certaines scènes de l’histoire, à l’aide de personnages vivants qui prennent les attitudes indiquées par le sujet ». Cette étude entend montrer que le texte de Salammbô est gouverné par un principe analogue au tableau vivant, qui tire le roman dans la direction des arts du spectacle, peinture et théâtre. Le tableau vivant, qui combine théâtre, peinture, photographie et sculpture, apparaît comme une sorte de point névralgique, à l’intersection de plusieurs genres et techniques que Flaubert prend, soit comme modèles, soit comme rivaux de l’écriture. En tout premier lieu, bien sûr, se pose la question du rapport à la peinture en général, et à la peinture orientaliste en particulier. La question du tableau vivant peut se comprendre comme une sorte de sous-ensemble au sein de la question plus large de la dimension picturale du roman. De plus, comme on va le voir, le tableau vivant offre un véhicule idéal pour le type d’orientalisme particulier à Flaubert, qui mêle la beauté et l’horreur en une synthèse qu’il estime essentiellement orientale : la cruauté sans relâche de cette succession de scènes splendides illustre les liens qui rattachent les tableaux vivants à l’esthétique du sadisme. En second lieu, se pose la question du rapport au théâtre : on sait que Flaubert s’intéressa de près à l’adaptation scénique de Salammbô, et qu’il s’essaya aussi, dans les années qui suivirent la parution du roman, au genre populaire des féeries, s’obstinant sans succès à atteindre la gloire à la scène avec ses propres féeries, notamment Le Château des cœurs, écrit en collaboration avec Louis Bouilhet et Charles d’Osmoy. La décision de Flaubert de se détourner de la platitude du réalisme, vers un genre qui autorisait — voire qui exigeait — l’excès, les effets spéciaux, la fantasmagorie, offre une nouvelle preuve du chevauchement entre les tableaux vivants du roman et le style théâtral hautement visuel qu’il affectionnait. La photographie à ses débuts est elle aussi proche du tableau vivant, puisque les contraintes techniques exigent, pour le succès de l’image photographique, la composition des groupes et l’immobilité complète des sujets : « la durée des temps de pose, note Bernard Vouilloux, [tire] irrésistiblement la photographie de groupe vers le tableau vivant 7. Depuis le voyage décisif en Orient en compagnie de Maxime Du Camp, qui en avait rapporté des centaines de photographies, Flaubert, c’est bien connu, entretient une relation complexe avec la photographie, qui lui est à la fois un modèle fascinant pour l’art de l’écrivain et une rivale détestée L’écriture de Flaubert dans Salammbô traverse toutes ces formes d’art, faisant du tableau vivant un point d’entrée privilégié pour aborder la question de l’écriture picturale.
Une grande machine
Tant par son hybridité générique que par son thème oriental, Salammbô est très proche de La Tentation de Saint Antoine, qui consiste en une succession d’épisodes hallucinatoires, si bien que la prédominance de la composante visuelle dans les deux textes vient renforcer leur indétermination générique, comblant le fossé entre les arts littéraire, théâtral, pictorial et photographique9. « Saint Antoine n’est pas une pièce, ni un roman non plus. Je ne sais quel genre lui assigner, » écrit Flaubert ; même si Salammbô est bien plus clairement romanesque que Saint Antoine (au moins si l’on convient que les ingrédients de base incluent le passage du temps et une histoire d’amour), c’est un texte qui permet à l’auteur de brouiller les frontières génériques10. « Une grande machine, » c’est ainsi que Michel Butor l’appelle très justement11 : au sens pictural, Salammbô est un grandiose tableau d’histoire empli de personnages en costume et de scènes spectaculaires tirées de l’Antiquité (matérialisées notamment dans le tableau de Paul Buffet, Le Défilé de la Hache) :
Paul Buffet, Le Défilé de la Hache
1894, Musée des Beaux Arts, Nantes
Crédit photographique : © Musée des Beaux Arts, Nantes
au sens théâtral, le roman est une gigantesque production, dont le goût excessif annonce les péplums d’Hollywood qui suivront cinquante ou cent ans plus tard. Salammbô, écrit Michel Butor, baigne dans « une antiquité demi-fabuleuse, qui correspond dans notre mythologie actuelle à la Rome hollywoodienne du technicolor et du cinémascope »12.
- Sur l’amour de Flaubert pour le théâtre, ses ambitions théâtrales, son engagement avec les pièces d (...)
Rien d’étonnant donc à ce que le roman ait été bientôt adapté à la scène. Flaubert lui-même, on le sait, était très désireux de voir son roman transformé en opéra, suffisamment, semble-t-il, pour s’essayer à la composition d’un livret. Bien que la Salammbô d’Ernest Reyer soit rarement représentée aujourd’hui, elle eut à l’époque un énorme succès, atteignant une centaine de représentations en 1900
Rose Caron dans l’opéra d’Ernest Reyer Salammbô
1890
L’opéra fut aussi le cœur d’une folie Salammbô qui comprenait des formes typiques de commercialisation du XIXe siècle. La mode est lancée : les dames portent des robes Salammbô dans les bals costumés, on imprime des affiches Salammbô :
Salammbô par Alfons Mucha
et bien sûr, parodies et caricatures se multiplient :
Le Temple de la déesse, d’après les documents les moins authentiques
D.D., « Quelques pages de Salammbô, roman plus carthaginois que nature », Vie parisienne, numéro spécimen, fin 1862
La Naissance de Nana-Vénus, par André Gil, La Lune Rousse, 19 octobre 1879
L’industrie cinématographique suivra bientôt, avec une succession de Salammbô jusque dans les années soixante :
Jeanne De Balzac et Rolla Norman dans Salammbô, mis en scène par Pierre Marodon (1925)
Jacques Sernas dans le rôle de Mathô, dans Salammbô, mis en scène par Sergio Grieco (1960)
8Il est probable que le chapitre babylonien du grand film épique de D.W. Griffith, Intolerance (1916), doit une partie de son ADN au roman de Flaubert, avec ses grandes scènes de foule et ses éléphants blancs :
En outre, le film illustre de manière exemplaire les liens étroits qui se tissent entre films muets, tableaux orientalistes et tableaux vivants, comme le montre par exemple la pose de l’actrice Seena Owen dans le rôle de la Princesse Bien-Aimée, pose qui reproduit à la fois l’Odalisque couchée d’Ingres (1842) et la photographie de Madame Algernon Bourke en Salammbô, dans le tableau vivant représenté en 1897 à Blenheim Palace :
10Même de nos jours, le roman de Flaubert connaît une sorte de vie ultérieure dans la culture populaire, avec des adaptations pour le roman graphique (un genre auquel la dimension spectaculaire se prête somme toute assez bien), dont l’un transpose bizarrement Carthage sur une autre planète15.
Les adaptations visuelles du roman de Flaubert ont donc proliféré depuis le début. Naturellement, le rôle-clef du visuel est en harmonie avec l’ambition esthétique de Flaubert telle qu’elle s’énonce dans ses textes de voyage en Orient : l’impératif de « faire voir », et par conséquent le rejet des descriptions conventionnelles et des récits de voyage au sens traditionnel. Le résultat de son voyage, grogne Flaubert dans une lettre à Frédéric Baudry, sera de « [l]’empêcher d’écrire jamais une seule ligne sur l’Orient ». Flaubert renonce assez rapidement à faire des scènes et des images de son voyage en Orient un grand récit, préférant devenir lui-même un œil, et enregistrer ce qu’il voit sous la forme de notes brèves et non développées, l’équivalent verbal de clichés photographiques, capturant des couleurs éblouissantes, des gestes suspendus, des formes frappantes : « Les premiers jours je m’étais mis à écrire un peu, mais j’en ai, Dieu merci, bien vite reconnu l’ineptie. Il vaut mieux être œil, tout bonnement ». En préservant la fraîcheur, l’intensité des impressions sensorielles — la première impression de l’Égypte, écrit-il à sa mère, est d’ « une ventrée de couleurs » l’écrivain s’assure que les souvenirs visuels demeureront matière fraîche pour le roman à venir. Un lever de soleil observé à Tunis sera par exemple recyclé dans le premier chapitre de Salammbô. Non seulement Flaubert refuse de transformer la matière de son voyage en un texte aisément assimilable pour le lecteur français, mais il rejette également toute tentative d’élaboration narrative de ses notes, préférant les laisser à l’état d’éclaboussures de couleurs impressionnistes sans composition, de scènes singulières, disconnectées, brèves et frappantes. Cette prédilection pour les images visuelles discontinues, à partir desquelles l’histoire se développe, se poursuit dans les romans, où elle est à l’origine de la fameuse écriture flaubertienne comme « scénographie », ainsi que l’ont noté les critiques21.
- 22 Sur l’importance de la notion de jouissance dans les notes du voyage en Orient de Flaubert, voir Ph (...)
- 23 Flaubert, Voyage en Orient (Paris, Gallimard, coll. Folio, 2006), p. 349.
- 24 Lettre à Louis Bouilhet, 14 novembre 1850 (Correspondance, 1, p. 710).
- 25 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1989), (...)
- 26 J.R. Dugan analyse plusieurs techniques flaubertiennes qui tendent à immobiliser le roman, de la pa (...)
- 27 Sur l’imaginaition visuelle de Flaubert, voir en particulier les articles rassemblés par Gisèle Ség (...)
- 28 David Scott, Pictorialist Poetics: Poetry and the Visual Arts in Nineteenth-Century France (Cambrid (...)
- 29 « Dans mon roman carthaginois, je veux faire quelque chose de pourpre » (Journal des Goncourt, tome (...)
12Ces scènes, privées de développement narratif, sont donc l’équivalent de clichés, retenus pour leur capacité à provoquer la jouissance — un mot qui se décline si souvent dans les notes de voyage de Flaubert. « Ah ! C’est beau ! Orientalement et antiquement splendide ! Ça rappelle les luxes perdus, les manteaux de pourpre brodés d’or. Erostrate ! Comme il a dû jouir ! » ou, inversement, ce reproche à soi-même : « Imbécile, tu n’as pas assez joui ». Ces scènes, d’une certaine manière, sont des moments d’extase, qui gèlent le temps dans une intensité de plaisir presque préverbale, proche du célèbre « Zut, zut, zut, zut » de Proust dans Combray. Les clichés du voyage oriental de Flaubert migrent dans une « sorte de roman », qui cependant s’attache moins au cours dramatique de l’intrigue qu’à l’intensité foudroyante des moments visuels. Les critiques ont été nombreux à souligner l’origine visuelle de l’imagination de Flaubert. Au départ des récits, on trouve des scènes visuelles fortes : en ce sens Flaubert, même au siècle de « l’esthétique picturale » (l’expression renvoie au livre de David Scott, Pictorialist Poetics est peut-être, parmi tous les écrivains, le plus visuel. Pourtant, si tous ces moments visuels fulgurants sont la source du récit, ils sont aussi impossibles à visualiser de façon claire et détaillée. Que voyons-nous en effet ? « quelque chose de rouge » (la litière d’Hannon), « quelque chose de grand » (les éléphants dans la bataille finale), « une longue forme complètement rouge » (Mathô expirant aux pieds de Salammbô) ; le roman tout entier, à en croire les Goncourt, est conçu dans l’imagination de son auteur comme « quelque chose de pourpre »
- Isabelle Daunais note ainsi que le tracé de l’image se perd dans les notations de couleur ou de mat (...)
13Non seulement l’accumulation massive de détails et de gros plans fait obstacle à la perception de la composition et de l’ensemble (phénomène qui a fait l’objet de nombreuses études critiques mais inversement, le choc impressionniste de ces couleurs violentes tend à donner une tonalité générale au roman plutôt qu’à permettre au lecteur d’en visualiser distinctement aucune partie. Comme il convient à cette histoire sanglante, la première couleur mentionnée est le rouge (« Un voile de pourpre à franges d’or ») sous lequel les capitaines des mercenaires festoient. Rouge et or, splendeur et violence : la première combinaison de couleurs met en place une harmonie chromatique impressionniste, au sens où un James McNeill Whistler, par exemple, peint des « harmonies en bleu et or », des « harmonies en blanc », des « harmonies en rose et gris », etc.
Les scènes picturales de Flaubert mettent en place un ensemble de couleurs dominantes (souvent quelque chose de rouge), et elles dépendent d’une gestuelle spectaculaire et hiératique de la part de personnages qui semblent imiter un tableau. La première apparition de Salammbô sur la terrasse au-dessus de la foule des mercenaires est un de ces tableaux vivants, auquel répond, dans les dernières pages, la composition en miroir où un Mathô mourant lève les yeux vers son amante31. D’autres tableaux vivants auxquels cette étude s’attachera (parmi les très nombreux exemples du roman, qui en propose presque à chaque page) comportent la première apparition de Hannon, émergeant de sa litière au milieu du camp des mercenaires, et bien sûr la mort horrible d’Hannon sur la croix, un tableau de crucifixion parmi bien d’autres.
« Tout un défilé de beautés dévêtues… »
15Pour réfléchir à l’usage des tableaux vivants chez Flaubert, la comparaison avec un autre romancier qui en fait lui aussi un usage fréquent pourra être utile. On conviendra que la part du visuel est aussi déterminante dans les romans d’Émile Zola, et que le pictorialisme, des paysages urbains aux natures mortes et aux tableaux vivants, est tout autant au cœur de l’esthétique zolienne. Cependant, chez Zola, les tableaux vivants servent à souligner l’enjeu dramatique de l’histoire. Reflétant l’intrigue, ils reproduisent de manière métatextuelle les personnages et leurs destins. Par exemple, le tableau vivant mis en scène par le Baron Hupel de la Noue, poète à ses heures, à l’occasion du grand bal à l’Hôtel Saccard au chapitre six de La Curée, constitue un triptyque basé sur le mythe de Narcisse, dans lequel les amants, Renée et Maxime, sont costumés respectivement en Écho et Narcisse, et entourés de Vénus, de Cupidon, et d’autres dieux et allégories.
Extrêmement populaires tout au long du XIXe siècle, tant comme divertissements de cour que comme jeux de société élégants, les tableaux vivants atteignent leur apogée sous le Second Empire, l’époque correspondant au cycle des Rougon-Macquart33. On prend parfois pour modèle un tableau célèbre, dont les acteurs costumés, disposés et immobiles reproduisent les personnages. La mythologie reste une source d’inspiration privilégiée pour les tableaux vivants, notamment parce qu’elle fournit un alibi lettré à l’exhibition de la nudité féminine. De fait, une industrie théâtrale spécialisée en tableaux vivants érotiques ne tarde pas à se créer, notamment en Angleterre, où la loi interdit la nudité sur la scène sauf si la dame en question demeure silencieuse et immobile, à la manière d’un tableau ou d’une statue. Rien d’étonnant donc à ce que le mépris de Zola pour la corruption de la société de Napoléon III se reflète dans son traitement de l’épisode du tableau vivant. Dans La Curée, roman écrit à la suite de la défaite de Sedan, le tableau vivant chez Saccard symbolise la corruption de « la fête impériale » à tous les niveaux : les deux premiers tableaux, où Renée-Écho tente de séduire Maxime-Narcisse, puis de l’acheter avec de l’or, offre une allégorie transparente de la double turpitude du régime impérial. La mise en scène soi-disant « poétique » du Baron touche à l’obscénité : dans le rôle de Vénus, l’ample Mme de Lauwerens, « un peu forte, portant son maillot rose avec la dignité d’une duchesse de l’Olympe », révèle des rondeurs roses, tandis que Maxime-Narcisse exhibe ses belles cuisses ; la comtesse Vanska, qui incarne La Volupté, est « tordue par un dernier spasme », pendant que deux autres dames ajoutent « un coin risqué dans le tableau, un souvenir de Lesbos ». Tons charnels, dentelles et éclairage rose se combinent pour intensifier l’illusion érotique : « Et sous le rayon électrique... la gaze, les dentelles, toutes ces étoffes légères et transparentes se fondaient si bien avec les épaules et les maillots, que ces blancheurs rosées vivaient, et qu’on ne savait plus si ces dames n’avaient pas poussé la vérité plastique jusqu’à se mettre toutes nues » . Le thème de la nudité, littérale et métaphorique, se répète dans tout le chapitre : Renée, après le scandale du tableau vivant, revêt un « costume d’Otaïtienne » indécemment révélateur pour le bal masqué , puis, à la fin du chapitre, elle est surprise dans sa chambre en compagnie de Maxime, par son mari qui l’abandonne à sa honte, la laissant dépouillée de ses vêtements, de sa dignité, et enfin de sa fortune. Homme du Second Empire, Saccard ne tue pas sa femme, il la vole : « Ils l’avaient mise nue » .
Dans Nana, autre roman de Zola très admiré de Flaubert, Nana apparaît en Vénus, entièrement nue sur la scène hormis un bout de gaze transparente. Le fait qu’elle reste silencieuse et immobile, s’il s’explique principalement par son manque pitoyable de talent dramatique ou musical, tourne cependant à son avantage : son immobilité de statue la transfigure en puissante idole du sexe. Dans chacun de ces épisodes, le tableau vivant mis en scène dans le récit fonctionne comme une mise en abyme de l’intrigue : l’amour de Renée pour le vain Maxime, comme celui d’Écho pour Narcisse, est condamné à une fin tragique ; Nana-Vénus, dans cette scène inaugurale, s’apprête à asservir les mâles de Paris à ses charmes opulents. La célèbre formule de Flaubert, « Nana tourne au mythe sans cesser d’être réelle. Cette création est babylonienne » exprime avec une remarquable concision comment, d’une part, le tableau vivant sert à intensifier l’effet dramatique, et comment, d’autre part, il contribue à élever l’intrigue au niveau allégorique : non seulement Nana va dominer les hommes qui la regardent nue sur la scène, mais aussi le tableau vivant de Nana-Vénus rend visible la dimension allégorique du livre que Zola, dans ses notes, exprime énergiquement par ces mots : « toute une société se ruant sur le cul. » La nudité spectaculaire de Nana fait d’elle un mythe : « Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair [...] C’était Vénus naissant des flots, n’ayant pour voile que ses cheveux [...] la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l’inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d’un sourire aigu de mangeuse d’hommes » À l’autre bout du roman, le tableau vivant final, la mort de Nana de la petite vérole, tandis que la France tombe aux mains des Prussiens en 1870, que les foules furieuses passent dans la rue, que les anciens clients de Nana regardent d’en bas ses fenêtres et que les autres filles contemplent, effondrées, la chair pourrie de leur amie, a la même valeur allégorique dans la mesure où le corps en décomposition de Nana, outre qu’il offre une fin cliniquement réaliste, métaphorise aussi la corruption du régime napoléonien : « C’était un charnier, un tas d’humeur et de sang, une pelletée de chair jetée là, sur un coussin [...] Vénus se décomposait. Il semblait que le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l’avait pourri »
Par contraste, les tableaux vivants dans Salammbô sont statiques et non dramatiques, comme si leur fonction était non de faire avancer l’action, mais au contraire de paralyser le mouvement narratif dans une sorte de fascination visuelle. Le lien fort et organique qui s’observe dans les textes de Zola entre allégorie et narration est déchiré dans le roman de Flaubert. Ainsi lors de la première entrée de Salammbô, les groupes de mercenaires, pétrifiés au milieu de leur orgie destructrice, lèvent les yeux vers l’apparition. Toute rouge et noire, éclairée par derrière, suivie d’un cortège de prêtres qui psalmodient, couverte de bijoux, Salammbô semble être — est en effet — une déesse, d’autant plus impénétrable que la langue archaïque de son chant est incompréhensible aux soldats qui la contemplent. La fonction dramatique de l’épisode (c’est la première rencontre des amants) faiblit en regard de la puissance visuelle harnachée au service de ce simple but. Dans ce tableau vivant, l’œil s’attarde sur les soldats pris de stupeur, « la bouche ouverte et allongeant la tête » (p. 60 ; p. 583), qui « s’ébahissaient de sa parure » (p. 58 ; p. 582), sur Narr’Havas tapi comme un léopard guettant sa proie sur la bouche souriante de Mathô (p. 62 ; p. 584). Le récit des mythes et des gloires de Carthage semble s’étendre durant des heures dans un vide intemporel, gelé dans l’imparfait de la performance : « elle chantait maintenant les anciennes batailles contre Rome ; ils applaudissaient » (p. 62 ; p. 584)36. La dimension picturale contribue fortement à détourner le roman du psychologique vers le mythique : Salammbô est Tanit, mais aussi une incarnation terrifiante de Vénus — assez semblable en cela à Nana, que Flaubert qualifie, mémorablement, de « Babylonienne »37. Pourtant, dans le cas de Salammbô, le tournant vers le mythe est bien plus radical. On ne peut dire de l’héroïne de Flaubert ce qu’il disait lui-même de Nana, qu’elle tourne au mythe sans cesser d’être réelle. De même que le destin entraîne les amants infiniment au-delà de leurs personnages individuels, de même l’histoire d’amour transporte le lecteur loin de l’intrigue romanesque, dans le royaume du mythe. En réponse à Sainte-Beuve qui met en doute la réalité de Salammbô, Flaubert invoque, comme on sait, son mystère d’Orientale : « Je ne suis pas sûr de sa réalité, car ni moi, ni vous, ni personne, aucun ancien, aucun moderne, ne peut connaître la femme orientale, par la raison qu’il est impossible de la fréquenter ». Mais l’Orient n’explique pas tout. L’absence de complexité psychologique de l’héroïne, notée par tous les lecteurs, n’est pas dûe uniquement au fait que Salammbô, femme d’Orient, est inconnaissable : elle est à la fois cause et effet de l’esthétique du tableau qui l’immobilise et la met à distance comme spectacle.
19Il résulte de cette subordination des personnages à la mythologie qu’une expérience extatique, quasi-mystique prend la place de la communication interpersonnelle. Les rencontres entre les deux groupes ennemis tiennent à la fois de l’opaque et du spectaculaire : les mercenaires, au cours du festin, sont fascinés par Salammbô, qu’ils ne comprennent pas ; les Barbares « béants d’horreur » contemplent les Carthaginois en train de brûler leurs propres enfants ; auparavant, ils regardent avec une terreur hypnotique les rangées de lions crucifiés . Cette opacité ne se borne pas à l’incommunicabilité entre les cultures : les personnages semblent également opaques à eux-mêmes, comme on l’a souvent remarqué. Salammbô semble inconsciente à la fois de ses propres émotions et du sens des rituels qu’elle accomplit dans une sorte de transe. En témoigne l’épisode emblématique du python : dans ce parfait tableau orientaliste, véritable fourre-tout d’ingrédients fantasmatiques — femme nue, serpent, danse érotique sous la lune : une sorte de contrepartie nocturne au sulfureux Charmeur de serpent de Jean-Léon Gérôme, en somme :
Jean-Léon Gérôme, Le Charmeur de serpents
Agrandir Original (jpeg, 420k)
1880, Clark Institute, Williamstown, Massachusetts, USA
Crédit photographique : Clark Institute, Williamstown, Massachusetts, USA
— la soumission aveugle de l’héroïne au rituel de Schahabarim et à son propre destin prélude à sa transformation par la vieille nourrice en idole à la splendeur fascinante mais impénétrable : « Salammbô lui avait ordonné de la rendre magnifique, et elle l’accommodait dans un goût barbare » (p. 281 ; p. 730).
20Ainsi magnifiquement pétrifiée, Salammbô est prête pour le tableau amoureux avec Mathô, ou plutôt pour la conjonction mythique de deux divinités, Tanit et Moloch, comme cela a souvent été observé. Mathô, dans son égarement, ne distingue pas le corps de Salammbô des broderies compliquées de son vêtement : « Mathô n’entendait pas ; il la contemplait, et les vêtements, pour lui, se confondaient avec le corps. La moire des étoffes était comme la splendeur de sa peau, quelque chose de spécial et n’appartenant qu’à elle » (p. 291 ; p. 737). Le tableau de Salammbô sous la tente reproduit la vision onirique des prêtresses tatouées de Tanit dans l’épisode précédent du temple de la déesse : « Des femmes dormaient en dehors des cellules, étendues sur des nattes [...] elles étaient si couvertes de tatouages, de colliers, d’anneaux, de vermillon et d’antimoine, qu’on les eût prises, sans le mouvement de leur poitrine, pour des idoles ainsi couchées par terre » (p. 136 ; p. 632).
- 39 Sur les relations entre Moreau et Flaubert, voir Martine Alcobia, « Flaubert et les peintres orient (...)
- 40 Voir Marie-Cécile Forest, Françoise Frontisi-Ducroux, et Pierre Pinchon, Gustave Moreau : Hélène de (...)
21Il évoque également les images visionnaires de Gustave Moreau : les corps tatoués et brodés de Salomé, d’Hélène de Troie et d’autres femmes fatales semblent l’écriture même du destin. On sait que les deux artistes, qui ne se fréquentaient pas, s’admiraient cependant mutuellement Dans la série tardive des « Hélène »40, la composition, peut-être inspirée du roman, rappelle fortement les scènes initiale et finale de Salammbô : Hélène se dresse devant une pile de soldats condamnés, comme Salammbô pose au dessus des mercenaires dont les jours sont comptés, et domine un Mathô agonisant mais consentant dans les dernières pages :
Gustave Moreau, Salomé
1876, Musée Gustave Moreau, Paris
Gustave Moreau, Hélène glorifiée
1896, collection privée ; image, courtoisie The AthenaeumCrédit photographique : domaine public (http://www.the-athenaeum.org)
Gustave Moreau, Hélène sur les remparts de Troie
1888, Musée Gustave Moreau, Paris
Les tableaux symbolistes de Moreau se prêtent donc à la même « lecture » que les tableaux vivants de Flaubert : dans la fascination d’une image plus grande que l’histoire qu’elle prétend illustrer, mais qu’au contraire elle dépasse.
23Le tableau vivant se prête aussi naturellement à l’idolâtrie qui domine le roman, où elle caractérise autant le mode de pensée des Carthaginois que celui des Barbares. Dans la mesure où il repose sur la confusion entre la chair vivante et l’image, le tableau vivant offre une expression iconographique idéale au fétichisme mystique de Salammbô et de Mathô, qui ne distingue pas entre la réalité et la représentation. Salammbô — selon la formule de Flaubert « une espèce de sainte Thérèse »41 — est une mystique païenne, dont la croyance superstitieuse au pouvoir spirituel des objets (le zaïmph) et des animaux (le python) se reflète dans l’hétéroclite amas de signes du tableau vivant
Pôle opposé de la beauté tragique de Salammbô, le personnage d’Hannon offre d’autres occasions de tableaux vivants. Sa première apparition au camp des mercenaires est soigneusement mise en scène, insistant longuement sur la litière et la suite, sur le détail insolite de la main « grasse, chargée de bagues » sortant de la fenêtre, révélant enfin toute l’horreur de l’homme au regard fasciné du lecteur :
Les courtines de pourpre se relevèrent ; et l’on découvrit sur un large oreiller une tête humaine tout impassible et boursouflée ; les sourcils formaient comme deux arcs d’ébène se rejoignant par les pointes ; des paillettes d’or étincelaient dans les cheveux crépus, et la face était si blême qu’elle semblait saupoudrée avec de la râpure de marbre […] L’abondance de ses vêtements, son grand collier de pierres bleues, ses agrafes d’or et ses lourds pendants d’oreille ne rendaient que plus hideuse sa difformité. On aurait dit quelque grosse idole ébauchée dans un bloc de pierre ; car une lèpre pâle, étendue sur tout son corps, lui donnait l’apparence d’une chose inerte. (p. 87-88 ; p. 600-601).
Flaubert s’écarte de ses sources historiques, qui ne parlent ni d’obésité ni de lèpre, pour créer un suffète mieux en harmonie avec sa propre image fantasmatique de l’Orient : un mélange spectaculaire de splendeur et d’horreur. Le luxe « oriental » (orientaliste, dirait Edward Said) de son costume et de ses accessoires, combiné avec l’opulence repoussante de sa chair lépreuse (ou peut-être syphilitique), illustre puissamment la théorie provocante de Flaubert sur la séduction de l’abject en Orient. Kuchiouk-Hanem serait moins attirante sans les punaises malodorantes de son lit ; la fascination de l’Orient consiste précisément dans cette synthèse de poésie et d’horreur, comme il l’explique dans sa célèbre lettre à Louise Colet :
Voilà l’Orient vrai et partant, poétique : des gredins en haillons galonnés et tout couverts de vermine. Laissez donc la vermine, elle fait au soleil des arabesques d’or. Tu me dis que les punaises de Kuchiouk-Hanem te la dégradent ; c’est là, moi, ce qui m’enchantait. Leur odeur nauséabonde se mêlait au parfum de sa peau ruisselante de santal [...] Cela me rappelle Jaffa où, en entrant, je humais à la fois l’odeur des citronniers et celle des cadavres [...] Ne sens-tu pas combien cette poésie est complète, et que c’est la grande synthèse ?
Du coup, le personnage d’Hannon — devenu incarnation de « l’Orient » échappe également aux limites de l’intrigue et aux contraintes psychologiques pour acquérir des proportions mythiques. Le tableau vivant qui fait pendant à sa première apparition est bien entendu sa crucifixion, qui offre une image magnifiquement cauchemardesque de la chair suintant le long de la croix :
Au faîte de la plus grande, un large ruban d’or brillait ; il pendait sur l’épaule, le bras manquait de ce côté-là, et Hamilcar eut de la peine à reconnaître Hannon. Ses os spongieux ne tenaient pas sous les fiches de fer, des portions de ses membres s’étaient détachées, et il ne restait à la croix que d’informes débris, pareils à ces fragments d’animaux suspendus contre la porte des chasseurs. (p. 406 ; p. 819-820).
Ici la fascination de l’horreur pétrifie l’action, y fait diversion, au lieu de la faire avancer. On atteint une sorte d’extase : les explosions orgasmiques de couleur et de violence qui rythment le texte rappellent de très près la « jouissance » invoquée par Flaubert dans les notes de son voyage en Orient. Ces « tableaux » d’une violence spectaculaire, loin de contribuer à l’action, rappellent plutôt le « pouvoir plastique de la littérature », dont l’impression ne s’efface ou ne s’affaiblit jamais, telle que la décrit Robert Louis Stevenson dans son essai célèbre « À bâtons rompus sur la fiction » :
Les fils d’une histoire se rencontrent parfois, pour tisser une image dans la toile, parfois les personnages adoptent, les uns envers les autres ou face à la nature, une attitude qui marque le récit comme une illustration. Robinson Crusoë découvrant, incrédule, des empreintes de pas, Achille hurlant ses imprécations à la face des Troyens, Ulysse bandant son grand arc, Christian fuyant en se bouchant les oreilles de ses doigts : ce sont là des moments cruciaux de la légende, et chacun restera à jamais gravé dans les mémoires […] Tel est donc le pouvoir plastique de la littérature : incarner un personnage, une pensée, une émotion, dans une action, ou une attitude qui frappe les esprits, pour s’y imprimer à jamais.
Ces mots, cités avec admiration par Jorge Luis Borges qui reconnaissait Stevenson comme un de ses maîtres (mais qui cependant n’appréciait guère « la laboriosa Salammbô de Flaubert » s’appliquent fort bien aux tableaux vivants de Flaubert, qui fascinent le lecteur et s’impriment dans sa mémoire. Ils font penser à l’étrangeté et à la violence des images mnémoniques telles que les décrit Frances Yates dans son ouvrage fondateur, L’Art de la mémoire. Dans l’Antiquité, l’art de la mémoire enseignait à retenir une abondance d’informations en plaçant des images de ce que l’on souhaitait mémoriser dans des « lieux » visualisés mentalement ; ces images mentales devaient nécessairement être excessives pour être mémorables. L’art de la mémoire comporte donc une dimension affective essentielle : il repose sur « l’idée qu’il faut aider la mémoire en suscitant des chocs émotionnels à l’aide de ces images frappantes ou inhabituelles, belles ou hideuses, comiques ou grossières. Il est clair que [l’auteur anonyme du traité] pense à des images humaines, à des êtres humains portant des couronnes ou des manteaux de pourpre, tachés de sang ou couverts de peinture, à des personnages engagés de façon dramatique dans une action, en train d’agir . De même, ce qui s’imprime dans la mémoire du lecteur du roman antique de Flaubert, ce sont ces images étranges et macabres.
Cependant, à la différence de Stevenson, dont les « images dans la toile » ne sont pas particulièrement sanglantes, c’est bien sûr cet aspect des images de Flaubert qui est si frappant. La question se pose donc : pourquoi toute cette violence ? Une réponse évidente renvoie à la tradition de la peinture orientaliste, qui privilégie une certaine image de l’Orient comme le lieu où l’érotisme se mêle à la violence. En ce sens, Flaubert ne fait que suivre les traces de Delacroix (La Mort de Sardanapale ; La Chasse au lion), Decamps (Tigre et éléphant à la source), Régnault (Exécution sans jugement), et tant d’autres peintres « Orientalistes » au sens Saidien du terme :
Eugène Delacroix, La Mort de Sardanapale
1827, Musée du Louvre, Paris
Eugène Delacroix, Chasse au lion
Potter Palmer Collection
Alexandre-Gabriel Decamps, Tigre et Éléphant à la source
1849, Paris, musée du Louvre
Henri Régnault, Exécution sans jugement
1870, Paris, musée d’Orsay
Mais, et la critique ne s’est pas fait faute de le souligner, il y a autre chose ici qu’une banale fantaisie orientaliste du XIXe siècle : l’implacable et sanglante horreur de ces tableaux vivants va au cœur de l’imagination de Flaubert. Si l’épisode de la tente (la seule scène d’amour dans ce roman curieusement chaste) semble paradoxalement terne et comme en sourdine, ainsi que l’ont noté plusieurs critiques, c’est peut-être parce que l’intensité sexuelle a été déplacée vers les images finales, véritable noces sanglantes dans toute leur somptueuse horreur De la « longue forme rouge » de Mathô à son cœur battant dans la cuiller pseudo-aztèque de Schahabarim, et aux flammes rouges du soleil couchant, le texte a atteint son paroxysme de rougeur.
Sainte-Beuve, lucide comme souvent dans sa malveillance, soulève la question du sadisme dans son compte rendu : « Une pointe d’imagination sadique se mêle à ces descriptions, déjà bien assez fortes dans leur réalité [...] [Flaubert] cultive l’atrocité. » Il suggère aussi le lien entre cruauté et érotisme : « La volupté est à deux pas d’une atrocité » écrit-il de l’épisode de la tente. C’est là une accusation dont Flaubert, mal remis de l’humiliation du procès pour outrage à la morale publique de Madame Bovary, se défend avec indignation dans sa réponse : mais on sait que dans sa correspondance privée, il exulte de se reconnaître une imagination sadique, invoquant à plusieurs reprises le marquis de Sade comme génie tutélaire pour la « grillade des moutards »(épisode qui dépasse de loin son modèle en horreur, comme Flaubert ne pouvait l’ignorer), et se vantant de marcher dans le sang avec délices. « D’un bout à l’autre c’est couleur de sang » écrit-il à Théophile Gautier (27 janvier 1859) ; « Je tue les hommes comme des mouches. Je verse le sang à flots » confie-t-il à Ernest Feydeau (septembre 1859), « J’écris des horreurs et cela m’amuse » (à Amélie Bosquet, 24 août 1861), « Je fais du style cannibale [ce qui] me fera passer pour pédéraste et anthropophage. Espérons-le ! » et ainsi de suite. Au delà des plaisirs sadiques que lui offre le roman sur la « guerre inexpiable » Flaubert revendique avec jubilation son goût pour les tyrans cruels et les régimes sanguinaire : « J’ai un culte profond pour la tyrannie antique » écrit-il à Louise Colet dès 1846, ajoutant qu’il aurait voulu vivre sous Néron.
C’est pourquoi on peut tenter de comprendre la curieuse fixation du roman sur les tableaux vivants en termes sadiens : de la même manière que les « récits » sadiens sont, plutôt que des récits, une succession linéaire de scénographies à la théâtralité artificielle regroupant des personnages unidimensionnels détachés de toute prétension à la vraisemblance psychologique, de même la Salammbô de Flaubert, avec ses séries répétitives de cruautés orgasmiques, corrobore la réflexion de Roland Barthes sur les tableaux vivants de Sade, dans son Sade, Fourier, Loyola de 1971. Les tableaux vivants, note Barthes, étaient un passe-temps très prisé de la bourgeoisie du XIXe siècle, qui y faisait volontiers figurer des enfants dans de jolis arrangements de contes de fées, mais sans se douter que ce jeu innocent avait une contrepartie sadique :
Le groupe sadien, fréquent, est un objet pictural ou sculptural : le discours saisit les figures de débauche, non seulement arrangées, architecturées, mais surtout figées, encadrées, éclairées ; il les traite en tableaux vivants. Cette forme de spectacle a été peu étudiée, sans doute parce que personne n’en fait plus. Faut-il rappeler pourtant que le tableau vivant a été pendant longtemps un divertissement bourgeois, analogue à la charade ? Enfant, l’auteur de ces pages a assisté plusieurs fois, lors de ventes de charité pieuses et provinciales, à de grands tableaux vivants — par exemple, la Belle au bois dormant ; il ne savait pas que ce jeu mondain est de la même essence fantasmatique que le tableau sadien
Barthes oppose le tableau vivant (qu’il associe au fétichisme) et le film (qu’il associe à l’hystérie). Peut-être serait-il plus près de la vérité s’il reconnaissait la continuation de cette pratique dans le cinéma à ses débuts (les films de Georges Méliès, héritiers à la fois de la féerie et du tableau vivant, en sont un bon exemple),
Georges Méliès, La Tentation de Saint Antoine
Film de 1912
- 53 Sur les films de Georges Méliès, et sur leur dette à l’égard de la pratique du tableau vivant et du (...)
et, de manière encore plus frappante, sa résurgence dans l’art contemporain53. De fait, Barthes ne pousse pas très loin sa remarquable intuition : il semble ignorer que les tableaux vivants n’étaient nullement limités aux innocents spectacles pour enfants, et que les adultes du XIXe siècle avaient su exploiter pleinement leur potentiel érotique, ainsi que l’a montré en particulier l’exemple de Zola. Un cas intéressant, outre-Manche, est, en 1857, le célèbre tableau allégorique d’Oscar Gustave Rejlander, The Two Ways of Life
Oscar Gustave Rejlander, The Two Ways of Life
1857, National Media Museum, Bradford, UK
- 54 Rejlander, artiste suédois fixé à Londres, s’était aussi acquis une réputation pour les photographi (...)
- 55 Jacques Neefs rappelle que Flaubert a lu de près la thèse du docteur Savigny sur les naufragés du R (...)
qui était extrêmement populaire, quoique aussi fort controversé à cause des nus figurant du côté du « vice »54. Bien que la popularité de la pratique ait décliné après les années vingt, surtout du fait du triomphe du cinéma, elle a survécu ; voire, elle connaît tout récemment une renaissance spectaculaire dans l’art d’installation et de performance. Parmi les tableaux vivants récents, on peut citer les Tableaux Vivants of the Delirium Constructions (2011) de l’artiste new-yorkaise Sarah Small, qui captent la cruauté de l’exhibition de chair humaine, les tableaux vivants du Norvégien Crispin Gurholt, qui jouent sur la juxtaposition de la statue et de la chair, ou ceux de l’artiste Montréalais Adad Hannah, dont les reproductions de tableaux célèbres tels que Le Radeau de la Méduse de Géricault (2009) sont très proches de la pratique du XIXe siècle
- Nouveaux lundis, 22 décembre 1862, 4, p. 77. La formule est aussi citée par Niklas Bender dans son (...)
34Néanmoins, l’intuition de Barthes à propos de l’imagination scénographique du sadisme, pour aussi peu développée qu’elle soit, peut nous aider à comprendre l’essence sadique des tableaux vivants de Salammbô. La violence est sa propre fin : confrontés, dans les termes de Jean Rousset, à « une orgie où la volupté de tuer et d’étriper égale une autre volupté, celle qu’éprouve l’écrivain à dire et à redire ces spasmes sanguinaires » nous sentons qu’il ne peut y avoir ni progression ni fin de la violence (sauf, par défaut, quand tous sont morts) — rien qu’une série d’épisodes orgasmiques, qui ont, tout comme les scénarios sadiens, un effet engourdissant sur le lecteur. Quand Sainte-Beuve se plaignait que les lecteurs modernes ne sauraient s’intéresser à des personnages si barbares, peut-être pensait-il plutôt à la fatigue qu’engendre chez le lecteur la répétition accablante des scènes de cruauté : « Les nerfs humains ne sont pas des cordages, et, quand ils en ont trop, quand ils ont été trop broyés et torturés, ils ne sentent plus rien ».
- Nouveaux lundis, 22 décembre 1862,
- J. M. Coetzee, Waiting for the Barbarians, publié en 1980. Le roman sera adapté à l’opéra par Phili (...)
35L’impression de piétiner, de manque absolu de progression téléologique, n’est pas due, comme le croit Sainte-Beuve, au peu d’importance historique du sujet : « Comment voulez-vous que j’aille m’intéresser à cette guerre perdue ? [...] Que me fait, à moi, le duel de Tunis et de Carthage ? Parlez-moi du duel de Carthage et de Rome, à la bonne heure ! J’y suis attentif, j’y suis engagé ». L’inquiétante réversibilité entre les Carthaginois, supposément civilisés, et les mercenaires, supposément barbares, atteint son apogée dans le tableau du sacrifice des enfants auquel ces derniers assistent « béants d’horreur » : c’est quelque chose dont se souviendra J.M. Coetzee, qui transposera la scène dans son roman au contexte colonial historiquement indéterminé, Waiting for the Barbarians, lequel se fonde aussi sur le renversement entre civilisés et barbares, puisque les colons de la ville se révèlent infiniment plus barbares que les Barbares qu’ils redoutent et qu’ils exterminent59.
- 60 3 mars 1860 ; cité par Niklas Bender, « Pour un autre orientalisme », p. 894. Plusieurs interprétat (...)
- 61 William Shakespeare, Macbeth, Act 5, Scene 5, lines 26-28.
- 62 Niklas Bender souligne la continuité de la critique de Sainte-Beuve à celle de Georg Lukacs, qui dé (...)
36Dans une lettre aux Goncourt, Flaubert s’oppose fortement à toute position moralisatrice : « [Salammbô] ne prouve rien, ça ne dit rien. Ce n’est ni historique, ni satirique, ni humoristique. En revanche ça peut être stupide » Les célèbres paroles de Macbeth nous reviennent : « It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing » : de ce non-sens sadique de l’histoire, les lions crucifiés — un des tableaux vivants les plus mémorables de cette première partie du roman sont un symbole approprié, puisqu’ils sont, tout comme les éléphants, à la fois victimes et aggresseurs. « Quel est ce peuple qui s’amuse à crucifier des lions ? » s’interrogent les Barbares, figés de stupeur : le mot-clef ici est peut-être s’amuse, qui évoque le plaisir orgasmique d’une cruauté insensée, répétitive, de cette histoire « stupide » qui se raconte dans une succession de tableaux stupéfiants.
En fin de compte, le grand roman orientaliste de Flaubert, avec son usage obsessionnel, sériel, de tableaux vivants, est à rapprocher des œuvres d’un écrivain ultérieur, proto-surréaliste : Raymond Roussel. Flaubert et Roussel sont à leur tour rapprochés par un troisième écrivain, l’Oulipien Georges Perec, qui les revendique tous deux comme ses pères spirituels et emprunte à tous deux la pratique de la liste et l’usage des tableaux vivants comme générateurs du récit. La succession de tableaux vivants bizarres et sadiques à la fin de Locus Solus (1914), et plus encore, les exécutions raffinées et spectaculaires mises en scène pour distraire le public lors des cérémonies du couronnement du roi Talou VII dans les Impressions d’Afrique (1910) — lettre brûlée sur la plante de pieds du faussaire, épingles à cheveux enfoncées dans le dos de la reine adultère, sacrifice animal compliqué, entre autres supplices — rappellent la cruauté des tableaux vivants de Salammbô. En dernière instance, leur intensité visuelle stupéfiante, leur essence profondément théâtrale (rien de surprenant à ce que les deux romans aient été adaptés pour la scène du vivant de Roussel)
: